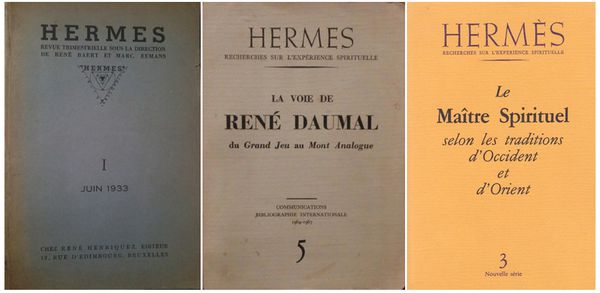
Hors commerce sauf tomes III et V
I. Lilian Silburn, Premiers travaux (1947 —) et extraits de Une vie mystique [Jacqueline Chambron]
II. Instant et Cause, Le discontinu dans la pensée philosophique de l’Inde (1955)
III. Lilian Silburn et ses Amis dans la Revue « Hermès » (1967 —)
IV. Aux sources du Bouddhisme (1977 —)
V. Études sivaïtes (1957 —) : Paramartha sûtra, Vatulanatha sûtra, Vijñana Bairava, La Bhakti
VI. Études sivaïtes (1968 —) : Mahartamanjari, Hymnes d’Abhinavagupta, Hymnes aux Kali & Sivananda
VII. Études sivaïtes (1980 —) : Sivasutra & Vimarsini, La Kundalini
VIII. Études sivaïtes (1990-1992) Spandakarika de Vasugupta, Tantraloka, chapitres 1-5.
Sous un même titre « HERMES » parurent de nombreuses séries de contributions consacrées à la réalité intérieure. Elles étaient ouvertes à « l’expérimentation spirituelle ». Plusieurs se succédèrent ainsi entre 1933 et 2010. Sur cette longue durée proche de celle d’un siècle s’exprimèrent de nombreuses figures de « sensibilité spiritualité érudite 1 ».
Mais le public n’était « pas aussi important qu’on pouvait le croire, en tout cas à ce niveau d’exigence ». Aussi leurs contributions restèrent confidentielles 2 malgré une qualité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
§§
On trouvera ici un choix effectué dans les dernières parutions d’« HERMES ». Il s’agit des textes rédigés par Lilian Silburn, Jacqueline Chambron, Jacqueline Sebeo, Jean et Marinette Bruno. Ils constituent une magnifique conclusion aux séries. Ils sont un appel adressé à tous les chercheurs de vie intérieure.
Le quart du présent volume constitue une anthologie mystique qui ouvre à l’universel. Elle est constituée de choix d’écrits de Ruusbroec, de Jean de la Croix, de Madame Guyon et s’achève sur une une présentation du Nuage d’Inconnaissance apprécié par Lilian Silburn. L’ouverture sur les trois traditions en terres d’Islam, en Inde, en Chine est assurée par des textes de Jîli, Abhinavagupta, K’uo an3.
L’ensemble de tous les textes, incluant l’anthologie que nous venons d’évoquer, suit strictement l’ordre des parutions d’« HERMES », soit n° 4 et n° 6 de la Deuxième série dirigée par Jacques Masui, puis n° 1, n° 2 [= n° 6 de la Deuxième série], n° 3, n° 4 de la « Nouvelle [Troisième] série sous la direction de Lilian Silburn »4.
Présentation aérée où les contributions sont précédées d’une page blanche. Deux tables des matières, dont la dernière réduite aux titres principaux.
Il serait désastreux de démanteler la structure sous-jacente révélée par les sommaires ou tables de matières. Ils révèlent des choix et la pensée profondément structurée de leur « dame directrice5 ».
Cette pensée s’unifie autour de trois thèmes essentiels : les Voies mystiques, le [vrai] Vide, le Maître spirituel. Ce sont les trois parties de la présente restitution. À ces parties I, II, III, reprenant les titres des HERMÈS numéros 1, 2, 3, s’ajoutent IV, V, VI beaucoup plus brèves : numéro 4, textes inédits, présentation et histoire des séries.
§§
On découvrira aussi que les SOMMAIRES rétablis intégralement en section VI « HERMES » méritent une méditation attentive. Les « grands connaisseurs » d’auteurs spirituels sont presque tous présents6. Bien des contributions oubliées et écartées du présent tome « Lilian Silburn et ses Amis III Revue HERMÈS » mériteraient redécouverte. Une autre sauvegarde, intellectuelle donc vraiment moins urgente, serait à faire ?
Dominique Tronc
Cette réédition se limite aux contributions de Lilian Silburn et de quatre contributeurs, ses ami(e)s proches appartenant à la « génération des Aînés ». Il s’agit de Jacqueline Chambron, Jacqueline Sebeo, Jean et Marinette Bruno.
Les titres des contributions sont suivis du nom de leur auteur(e).
L’ordre suivi est chronologique.
La « table des matières » principale livre les contenus détaillés7.
La « table réduite » qui achève le tome facilite une recherche par titre de contribution.
Styles uniformisés8.
Hermès va se spécialiser davantage. Les premières séries ont répondu à un besoin de leur temps. Dans ce même esprit, il nous semble que ce qui manque le plus de nos jours, c’est une connaissance ou une approche de l’expérience mystique libératrice dans sa totalité et particulièrement à ses plus hauts niveaux. Si l’on perd de vue sa finalité, on risque de s’égarer dès le départ.
Nous employons le mot mystique en son sens noble qui est son sens premier. Il s’applique, dans le langage des Pères grecs, à la connaissance des « mystères »10 qui relève de la voie contemplative proprement dite.
Dûment conduite, une expérience de cet ordre, malgré l’intensité de l’énergie éveillée et les bouleversements profonds qu’implique la mort du « moi », exclut les extravagances d’un mysticisme devenu par la suite fort douteux.
Le mot a l’avantage d’englober les divers aspects de cette expérience — que l’on mette l’accent sur l’amour divin ou sur la prise de conscience. Il suggère la vie nouvelle, spécifique, indéfinissable, à laquelle on accède en découvrant ce que nous appelons, avec des auteurs spirituels français du XVIIe siècle, « l’intériorité ». [30]
Notre grande enquête s’ouvre à toutes les traditions — telle a toujours été la ligne d’Hermès — car en toutes on trouve des hommes et des femmes qui ont voulu toucher le fond du Réel, qui ont réalisé pleinement leur nature d’Eveillés, qui n’ont eu de cesse qu’ils se soient abîmés en Dieu ou dans l’Absolu. Nous respecterons le langage et les conceptions propres à chacune et nous verrons que, si différentes qu’elles soient en leurs formes religieuses extérieures, ces traditions se rejoignent au niveau de l’expérience mystique.
L’Inde qui s’est forgé, tant dans l’Hindouisme que dans le Bouddhisme, un vocabulaire rigoureux, propre à exprimer la subtilité de ses analyses des états spécifiques d’absorption ainsi que des cheminements psychiques conscients ou subconscients, offre au chercheur à la fois un instrument de travail et une mine inépuisable de matériaux. Nous publierons notamment des textes inédits des différentes écoles du Sivaïsme moniste du Cachemire, dont la très grande richesse commence à être connue. Cette investigation aura naturellement recours aux œuvres des soufis qui possèdent, eux aussi, une véritable science de la progression mystique. Elle puisera également dans le vaste fonds chrétien, d’un accès linguistique et philosophique plus simple, dans la mystique juive ou les classiques du taoïsme11.
Bien loin d’un comparatisme étroit et passionné, bien loin d’analogies au niveau de généralités, nous voulons mettre en parallèle des textes lourds de sens, autour d’un thème que des études achèveront d’élucider.
Dans la plupart des textes sacrés et dans les œuvres des grands mystiques tout est envisagé du point de vue de l’homme libéré de la pensée dualisante. Il s’ensuit que les conceptions exprimées sont extrêmement difficiles à saisir par l’esprit non libéré qui doit, à chaque pas, s’efforcer hors de son erreur « congénitale » pour tâcher de comprendre. (Cf. ici p. 183.12)
Le regard de « l’homme parfait » descend vers les plans inférieurs tandis que nous nous efforçons d’entrevoir des cimes voilées !
À ce libre regard correspond l’argument des œuvres : l’exposé commence à la Réalité suprême pour descendre de degré en degré jusqu’au monde visible, épousant ainsi le [31] mouvement de la manifestation divine13. Il ne saurait en être autrement puisque c’est de la Réalité ultime que tout part, à elle que tout revient, et elle que jamais rien ne quitte.
À rebours de ce déploiement, les voies mystiques constituent le retour à la source unique. Dans le présent volume, avant de les aborder, il fallait donc esquisser cette « descente ». Étant donné l’ampleur du sujet — traiter de plusieurs systèmes à la fois — et la brièveté de développement que le volume autorisait, il était impossible de distinguer les nuances propres à chaque doctrine. Plutôt que d’en faire un exposé sommaire, il a paru préférable de laisser parler les textes eux-mêmes de sorte que le chapitre d’introduction se présente comme une anthologie centrée sur la réalité divine, telle — ne l’oublions pas — que les très grands mystiques la découvrent. Les voies s’expliquent en fonction d’elle.
Ce premier volume est d’une difficulté exceptionnelle, car son champ couvre à la fois toute la réalité et tout l’ensemble des voies. L’aventure mystique ayant été ainsi évoquée en sa totalité, les volumes ultérieurs n’auront plus qu’à en analyser des aspects précis et limités.
Voici quelques-uns des thèmes que nous envisageons d’aborder :
— Découverte de ce domaine de « l’intériorité » qui définit la mystique. Sa comparaison avec des expériences isolées de poètes, d’écrivains.
— Analyse des états de vigilance et d’absorption : oraison, contemplation, dhydna, samadhi, samàpatti, etc.
— Description des différents types de saints, de mystiques et de maîtres : yogin, jñânin, etc.
— Quiétude et non-agir. Bon et mauvais quiétisme.
— L’indifférencié et la mystique nocturne. Avec une étude de la « nuit » qui la distinguerait des états d’indifférenciation primitive et de dépression.
— Le souffle. Pneuma, prana, etc.
— Réminiscence et reconnaissance. Platon, soufisme, école sivaïte Pratyabhijñâ, poètes anglais.
Un reprint du numéro ancien d’Hermès sur Le Vide va paraître prochainement et un peu plus tard Le Maître spirituel sera réédité avec des modifications et des additions.
À un musulman qui insultait un juif, al-Hallâj dit, en guise de reproche :
« Mon fils, toutes les croyances relèvent du Très-Haut : Il assigna à chaque groupe une croyance, non par un choix émanant d’eux, mais par un choix à eux imposé… Sache aussi que le judaïsme, le christianisme, l’islamisme et autres croyances sont des surnoms différents et des appellations diverses. Mais le But de ces croyances ne change ni ne varie. »
Ensuite il récita :
« J’ai médité sur les croyances en m’efforçant de les comprendre ;
Je les ai trouvées telle une base unique à multiples ramifications.
Ne va point exiger de quiconque qu’il adopte telle ou telle croyance ;
Cela empêcherait toute entente solide.
Réclame de lui plutôt une Base qui exprime pour lui
Toutes les hautes significations : alors il comprendra. »
(Al-H. 133)14
Que le lecteur ancien heureux de renouer avec la Revue Hermès ou celui qui la découvre ne s’effarouche pas de la difficulté de ce premier numéro.
Nous nous proposons de faire apparaître les similitudes profondes des traditions et des expériences qui ont trait à ce que nous nommons « Vie mystique ». Aussi nous a-t-il paru nécessaire d’en mettre à jour les fondements et les directions générales tels qu’ils sont exprimés à travers les textes et les courants de pensée aussi différents que ceux que nous avons retenus.
Les jalons de cette convergence de fond et d’ensemble suggèrent plus que tout autre discours la Réalité d’une seule et même expérience qui se répète identique à elle-même à travers la diversité des siècles, des lieux et des hommes.
Si l’on pénètre vraiment dans l’univers des grands mystiques, si l’on recueille avec amour et vigilance chacun de leurs aperçus, c’est une merveille de découvrir qu’il n’y a pas de contradiction, d’impossibilité, de dilemme : lorsque tous les aspects ont trouvé leur éclairage, tout devient simple, harmonieux, ils se fondent les uns dans les autres sans heurt ; il suffit de mettre en place chaque pièce du grand puzzle pour que les contours s’en estompent les uns après les autres et se perdent dans la paix profonde de la Lumière primordiale, signes anéantis sitôt qu’ils ont été lus. [38]15
On ne peut sentir cette simplicité sans avoir esquissé une vaste vue d’ensemble, dût-elle donner le vertige. A l’origine, l’ineffable simplicité de l’Essence, à l’arrivée, pourrait-on dire, celle de « l’homme commun », qui définitivement enraciné en son origine disparaît dans la foule de ses semblables sans se distinguer ni se confondre. Entre les deux, la grande fresque de l’ombre et de la lumière, faite d’éclairs et d’obscurités, d’effrois et d’ivresses, trame lumineuse de haillons, reflets de l’éternel combat toujours perdu, mais inlassablement repris, et le plus glorieux qui soit.
De ce combat avec la Réalité, pour elle et par elle nous évoquons les grands moments à travers des textes chrétiens, sivaïtes et sûfi16.
Nous avons choisi pour ce numéro des textes mystiques qui traitent des trois voies intérieures couronnées par la Non-Voie.
Des cimes qu’ils atteignent, ils jettent un même regard sur le chemin parcouru : celui de l’expérience.
À ce titre les génies comme Maître Eckhart, Ibn'Arabî, Abhinavagupta et Jîlî se révèlent d’une même famille. Leur mystique sobre et paradoxale est une mystique de l’Essence et ils se jouent non sans humour des difficultés de l’expression : il n’y a point d’antinomie pour qui réside à la source de la vie, et leur style puissant tient à la force unitive de leur expérience.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, la mystique à laquelle nous donnons la parole à travers les textes que nous choisissons, en marge de tous les substituts frelatés que notre époque voit pulluler, n’est pas une théologie ni une mystique spéculative ou intellectualiste, elle n’est pas non plus une mystique de l’affectivité ou des effusions extatiques si souvent décriées.
Vie essentielle, elle englobe tous les aspects qu’on lui prête isolément : amour, connaissance, activité, mais dans une intériorité qui les transcende. C’est pourquoi les textes que nous citons invitent plus à recouvrer plénitude et liberté qu’à obtenir salut et libération.
S’ils ne proposent que nudité et indistinction, anéantissement du moi, car ils savent que « dans ce qui comporte [39] distinction on n’éprouve ni être, ni Dieu, ni unité, ni repos, ni perfection » ils montrent aussi — et c’est la magie de la grâce — qu’il n’est point de nudité qui n’ait sa plénitude jusqu’au jour où l’une et l’autre se confondent dans un cœur libre et détaché, vibrant à l’unisson de l’univers, signe d’une intériorité cosmique.
Si nous nous plaisons à rapprocher des textes aussi différents que ceux de Madame Guyon, Ruysbroeck, Abhinavagupta, Jîlî et Eckhart pour mettre en évidence les courants identiques qui les traversent, nous ne voulons pas nous perdre dans un comparatisme méticuleux qui ferait oublier la saveur propre à chacun. Nous nous attachons au contraire à conserver aux traditions leur spécificité. C’est elle, en effet, qui donne sa couleur aux rapprochements proposés puisqu’elle en assure la variété et la diversité.
Il suffira de se tenir à la source pour saisir leurs correspondances dans les multiples aspects que prend la lumière divine à travers le prisme de leur cœur :
Rouge intense et fulgurant de Ruysbroeck dont le style abrupt allie les éclats sauvages de l’expérience au cadre traditionnel.
Lumière diffuse et enveloppante de la prose intime et modeste de Madame Guyon qui tient l’expérience à notre portée.
Lumière irisée, subtile et chatoyante de Jîlî.
Mais aussi vaste espace de la chaude lumière du Cachemire où s’épanouit, harmonieuse et transparente, la Science divine d’Abhinavagupta.
Éclairs décisifs de l’éloquence sans artifice de Maître Eckhart et, enfin, sombre luminosité du Pseudo-Denys.
Certes les apparences diffèrent si l’on s’en tient aux colorations des styles, des époques et des traditions. Et pourtant, à l’origine, la même Lumière divine, blanche, incolore, l’Un sans mode…
Il est au seuil de toute création un moment merveilleux et fécond, celui où l’on s’arrête interdit, étonné, celui où la vision ordinaire s’évanouit, où le cri de surprise jaillit du cœur devant la nouveauté entrevue. Ce dépaysement qui accompagne toute découverte, surgit dans la vie mystique avec une profondeur et une intensité particulières.
Et si nous n’avons pas reculé devant la difficulté des textes, ce n’est point pour exiger du lecteur un effort, une tension intellectuelle, inutiles ici, mais dans l’espoir de susciter le plus fertile des dépaysements.
Si, en marge de toute pensée dualisante, il sait rester disponible et réceptif à la vision soudaine et subtile que fera jaillir pour lui, l’éclair de l’une ou de l’autre des citations proposées, alors peut-être lui sera-t-il donné de prendre pied dans ce qu’il reconnaîtra, ô surprise, pour sa vraie patrie.
Il est, semble-t-il, quelques êtres qui atteignent les rivages d’une mer aussi mystérieuse qu’inaccessible, et à travers leur stupéfaction ou leur émerveillement nous parviennent les échos de leur découverte même s’ils ne cessent de répéter leur impuissance à décrire l’aventure qui est la leur. N’est-il point étrange, en effet, d’entendre leurs chants résonner toujours des mêmes accents, leurs paroles se briser sur les mêmes impossibilités, sur les mêmes limites du langage et de la raison ? La convergence de leurs émois, l’identité de leurs thèmes nous apportent des éléments sur lesquels fonder une connaissance qui nous les rend plus proches, même si le premier jalon en est l’abîme infranchissable qui sépare l’expérience de la conscience ordinaire de ce qui est vécu par le mystique.
Ainsi à l’orée de cette expérience, chacun à sa manière et selon sa tradition, va le répétant ; il ne peut dire, rien ne peut être dit, car Cela ne se compare à rien, c’est insaisissable et sans accès. Et de l’unanimité de leurs témoignages, nourris de paradoxes et de balbutiements, se détache la Réalité divine, Essence une, simple, sans égale et, par là indicible, inconnaissable, à elle-même sa propre preuve. [44]
Suc, nectar, ambroisie, effleurement, fulguration, les expressions sensorielles se multiplient cependant pour tenter de suggérer le caractère concret d’une expérience qui se dérobe à toute idée, que toute notion, que tout discours dénature et trahit.
Mais n’est-ce pas céder à l’inévitable trahison que de commencer par célébrer l’Un hors duquel il n’y a rien ?
« Dis
Lui, Dieu, est UN !
Dieu !...
L’Impénétrable !
Il n’engendre pas ;
Il n’est pas engendré ; nul n’est égal à Lui ! 18. »
La définition même de l’Islam est une affirmation éclatante et exclusive de l’Unité dont tous les sūfī sont les défenseurs ardents et subtils. Dans le Traité de l’Unité la formule célèbre est explicitée ainsi : « il n’y a pas de lieu autre que Lui, il n’y a pas d’existence autre que Lui, il n’y a pas d’autre autre que Lui, et il n’y a pas de Dieu si ce n’est Lui. » (Un. 34.)19.
« L’Essence de Dieu est le mystère de l’Unité » dit Jîlî. (H. J. 26.)
Et Al-Hallāj parle de l’Unité en tant « qu’énigme obscure vers laquelle il n’y a ni voyage ni étape ».
« Énigme », car Dieu, dit-il, « a prescrit d’attester Son Unité et interdit de décrire le fond de Son Essence ». Mais dans un même mouvement, il dénonce la vanité de cette affirmation pourtant essentielle : « Garde-toi de proclamer son Unité. » « À Dieu seul appartient de proclamer son Unité. »
En effet, d’une part cette proclamation est trop en dehors du langage pour être exprimée et d’autre part : « Sache, dit-il, que l’homme qui proclame l’Unité de Dieu s’affirme lui-même. Or, s’affirmer soi-même c’est s’associer implicitement à Dieu. En réalité, c’est Dieu Lui-même qui proclame Son Unité par la bouche de qui Il veut d’entre Ses créatures. » (Al-H., 139-143.)
[45]
Le Pseudo-Denys, dans un chapitre intitulé « Du parfait et de l’unique », écrit : « Unique, il l’est en ce sens qu’il est toutes choses de façon synthétique dans la transcendance d’une seule unité, et qu’il produit toutes choses sans sortir pour autant de sa propre unité… Cet Un, cause universelle, n’est pas cependant l’unité de plusieurs réalités, car il précède la distinction même de l’unité et de la pluralité et c’est lui qui définit tout ensemble unité et pluralité. » (D. 173.)
De nombreux mystiques chrétiens éprouvent eux aussi le besoin d’affirmer Dieu comme l’Un absolu. Ainsi Maître Eckhart : « Dieu est l’Un absolu sans que s’y ajoute la moindre multiplicité d’une distinction, ne serait-ce que d’une pensée, du fait que tout ce qui est en lui est Dieu lui-même. » Et encore : « C’est le propre de Dieu et de sa nature que d’être incomparable et de n’être semblable à personne. » (Anc. 130-131 et Pf. 235.)
Dans une autre tradition, celle du Śivaïsme du Cachemire, Abhinavagupta rend hommage lui aussi à « Cet Un dont l’essence est l’immuable Lumière de toutes les clartés et de toutes les ténèbres, en qui clartés et ténèbres résident, le Souverain même, nature innée de tous les êtres… » (H. A. 25.)
Mais, comme Denys, il tient à dégager l’unique Réalité de notions telles que dualité, multiplicité et unité qu’on lui surimpose arbitrairement, et il célèbre « cette Lumière consciente, illimitée, autonome, véritable, infinie, sans imperfection, éternelle, spontanée qui disperse les ténèbres faites de deux ennemis irréconciliables : dualisme et non-dualisme… » (H. A., 68.)
Soulignant le caractère ineffable de la Réalité afin d’exprimer que rien ne peut ni révéler l’absolu ni conduire à lui puisque, toujours présent, il est l’évidence même, Abhinavagupta, dans sa glose à la Parātrimsikā 20 emploie le terme anuttara, « Insurpassable », pour désigner la Réalité, en jouant sur la riche étymologie de la racine de ce mot : an-uttara signifie « incomparable » — rien n’est supérieur à la Conscience plénière de la Divinité —, mais aussi « inexprimable » si l’on donne à uttara son sens de « spécifications verbales », l’anuttara transcendant alors toute distinction.
S’il en est ainsi, on se demande : « Face à cet Insurpassable et Ineffable, quel discours peut-il y avoir et quelle [46] Voie différencierait adoré, adorant et adoration ? » (H. A., 57.)
L’Essence unique est non seulement incomparable, mais inconnaissable et donc indicible.
Denys, Ruysbroeck, Al-Hallāj se font l’écho de ce témoignage, chacun dans la tonalité qui le caractérise :
« Si la Déité dépasse tout raisonnement et toute connaissance, absolument supérieure à l’intelligence et à l’essence, embrassant toutes choses et les rassemblant, les comprenant et les anticipant, mais elle-même inaccessible à toutes prises, si elle exclut et sensation et image et opinion et raisonnement et contact et science, comment pourrons-nous discuter sérieusement des noms qui conviennent aux réalités divines ayant d’abord montré que la Déité suressentielle échappe à toute expression et transcende tout nom ? » (D. 73.)
« Cette lumière simple de l’essence est infinie, immense et sans mode », dit Ruysbroeck, et encore : « Dans cette simplicité toute pure de l’essence divine, il n’existe ni connaissance, ni désir, ni activité ; car c’est là un abîme sans mode où n’atteint jamais aucune compréhension active. » (R., 143 et 147.)
.
Al-Hallāj, avec son intransigeance coutumière, disait de Dieu : « Rien ne se mélange avec Lui et aucun ne se mêle à Lui… Nulle pensée ne Le jauge, nulle idée ne Le figure, nul regard ne L’atteint… »
Et il recommandait : « Mon fils, garde ton cœur de penser à Lui, et ta langue de Le citer ; emploie-les plutôt à Le remercier sans cesse. Car, penser à Son Essence, imaginer Ses attributs, proclamer Son Existence, sont à la fois faute immense et orgueil démesuré. » (Al-H., 113-114.)
.
Jîlî, parlant de l’Essence, explique pourquoi elle échappe à la raison.
« On ne La conçoit donc pas par quelque idée rationnelle, pas plus qu’on ne La comprend par quelque allusion conventionnelle ; car on ne comprend une chose qu’en vertu d’une relation qui lui assigne une position, ou par une négation, donc par son contraire ; or, il n’y a, [47] dans toute l’existence, aucune relation qui “situe” l’Essence, ni aucune assignation qui s’applique à Elle, donc rien qui puisse La nier et rien qui Lui soit contraire. Elle est, pour le langage, comme si Elle n’existait pas, et sous ce rapport Elle Se refuse à l’entendement humain. »
Par contre, l’évidence réside uniquement dans la connaissance immédiate et indifférenciée, en quoi consiste précisément « la perception de l’Essence par Elle-même ».
L’Essence est donc inconnaissable, mais paradoxalement, constate Jîlî, « il est impossible de l’ignorer :
.
« Est-ce que j’ai tout appris, globalement et distinctement,
De Ton Essence, ô Toi, en Qui s’unissent les Qualités ?
Ou est-ce que Ta Face est trop sublime pour que Sa nature puisse être saisie ?
Je saisis donc que Son Essence ne peut être saisie.
Loin de Toi que quelqu’un Te sonde, et loin de Toi
Que quelqu’un T’ignore, — ô perplexité. » (H. J. 26.)
.
Comment la raison poursuivrait-elle son chemin face à l’évidence ? La connaissance distinctive conduit à une certitude d’ordre intellectuel, non à l’évidence.
C’est aux Śivaïtes du Cachemire qu’il appartient d’être très clair à ce sujet. Avec quelle simplicité n’énoncent-ils pas que la Conscience, évidente par soi, en soi, est à elle-même sa propre preuve21.
Aucun moyen ou critère de connaissance ne peut la révéler : bien loin de démontrer son existence, ces moyens dépendent de la conscience et, sans elle, ils ne sont rien. Mettre en doute la Conscience, c’est assumer tacitement sa validité. Ksemarāja, glosant ainsi les Śiva sūtra, cite l’exemple suivant, tiré d’un ancien traité, pour montrer que la conscience s’affirme dans l’effort même qu’elle fait pour se nier :
“Il en est de l’énergie consciente de Śiva comme d’un homme qui s’efforce de sauter avec ses pieds par-dessus l’ombre de sa tête, alors que (l’ombre) de sa tête ne se trouve déjà plus là où ses pieds s’étaient posés.” (S.S.v., I. I. p. 36.)
Les sūfī récusent toute preuve du Dieu Très-Haut étant donné que le témoin « se tient à l’intérieur même de ces preuves » (lbn al-A’rabi)22. [48]
Al-Chibli, à qui l’on demandait quand arrive-t-on à contempler la Vérité ? répondait : « Lorsque le Témoin apparaît, annihilant les preuves du témoignage. » (Kh., 112.)
Ibn “Arābi disait encore :
« Comment pourrait-on décrire Celui qui n’a pas d’autre attribut que Lui-rnême. Celui qui n’a pas d’autre Témoin que Lui-même qui puisse saisir son Essence totale, Celui qui est son propre Témoin, Celui dont la Réalité est son Être même. Le connaît celui qui L’a trouvé… » (Kh., 129.)
Et Al-Hallāj :
‘(1) Il n’y a plus, entre moi et Dieu, d’explication (intermédiaire), ni démonstration, ni miracles, pour me convaincre… (3) La preuve est à Lui, de Lui, vers Lui, en Lui, le Témoin même du Réel dans une révélation se formulant. (4) La preuve est à Lui, de Lui, en Lui et pour Lui ; en vérité, c’est Lui que nous y avons trouvé, comme une science en sa démonstration. (5)… vous tous, êtres contingents, êtes déviés de Lui de toute la fissure des temps…’ (Dîw., a 29.)
.
Essence, unité, lumière, Conscience abyssale et sans mode, nuée, ténèbre, désert, suprême domaine ou royaume de Dieu, tous ces termes tentent de dire et de redire, aux limites de l’expérience, la simplicité nue de l’Essence indifférenciée, impersonnelle et qui se dérobe à toute relation, mer insondable où s’abîment tous les grands mystiques. Et si le mot de Dieu leur échappe encore, ce n’est plus pour désigner le Dieu personnel ou le Dieu corrélatif à l’univers qu’il manifeste ou qu’il crée, mais la merveilleuse Essence dans laquelle ils se perdent.
Ce que les mystiques tiennent à communiquer avant tout, c’est l’aspect profond et dynamique de leur expérience. Il ne s’agit point d’une approche philosophique abstruse qui chercherait à dépasser les autres, grâce à une dialectique plus subtile, ni de la découverte d’une entité abstraite ou figée, mais de la Réalité même qui « vibre », « bouillonne » et se répand, source de toute vie.
Ici encore les témoignages venant de différentes traditions concordent. Choisissant quelques exemples, nous [49] allons montrer comment Śivaïtes, chrétiens ou musulmans voient l’univers émaner d’une surabondance de vie, de lumière et d’amour.
Pour les mystiques cachemiriens, Śiva, étant inséparable de son Énergie, est puissance et fécondité infinies. Eternellement il opère. La Réalité frémit de vie sous forme de spanda, Acte vibrant ; l’énergie est en effet une source à jamais jaillissante, toujours en acte ; en vibrant elle manifeste le différencié et c’est en vibrant aussi qu’elle conduit au repos dans l’indifférencié. L’image de la Roue des énergies, privilégiée dans le système Krama, figure le Tout comme un pur dynamisme. Au moyeu de la Roue réside le Cœur divin dont la pulsation se propage en énergies rayonnantes qui perpétuellement déploient les niveaux de l’univers, puis reviennent se résorber au Centre pour y être, non pas abolies, mais en quelque sorte transfigurées23.
.
Commentant dans un traité en latin la réponse de Dieu à Moïse : ego sum qui sum, Maître Eckhart observe que ce redoublement du verbe signifie l’acte divin intérieur qui révèle dans le mouvement la quiétude de l’Essence. C’est, dit-il, une sorte de bouillonnement ou d’effervescence de l’Être s’échauffant intérieurement, « qui se liquéfie et bouillonne en lui-même et vers lui-même comme la lumière qui se pénètre totalement, lux in luce et in lucem. Ainsi l’Être revient sur lui-même et se réfléchit totalement sur sa propre totalité24. »
« La Vie signifie une sorte de jaillissement dans lequel une chose fermente et se verse d’abord en soi-même, en épanchant tout ce qu’elle est dans tout ce qu’elle est, avant de se déverser et de se répandre en dehors25. »
« Dieu seul est la Vie, car ni fin extérieure, ni cause, ni raison ne le déterminent, et que vivre en soi-même, c’est jaillir spontanément sans dépendance, sans concept et sans pourquoi. »
Ainsi l’activité divine est d’abord en elle-même bullitio, la Vie avant la vie, puis ebullitio, débordement en dehors de soi-même, écoulement hors du fond divin qui produit l’univers. [50]
Ruysbroeck met aussi en valeur l’activité divine :
‘… L’Unité des Personnes… est féconde et engendre sans cesse l’éternelle Sagesse… (Dieu) agit sans cesse, car Il est pure activité selon la fécondité de sa nature ; et s’Il n’agissait pas, Il n’existerait pas, ni aucune créature au ciel ou sur la terre : aussi est-Il toujours agissant et sans cesse jouissant26.’
« Comme cette Unité tournée vers elle-même est pure jouissance, et tournée vers le dehors fécondité, la source de l’Unité s’écoule…27. »
« Source vive et insondable » dit Ruysbroeck (R. 158) Il compare aussi le Saint-Esprit à une « mer houleuse de laquelle tout bien découle, tout en y demeurant rassemblé sans mesure. » (R. 157.)
C’est d’une surabondance de l’Essence que surgit l’univers et, pour tous nos mystiques, l’effusion consiste en un débordement de puissance, de lumière, de béatitude ou d’amour.
Selon Abhinavagupta, le Seigneur engendre l’univers par « l’excès d’expansion de son énergie innée. » (P.S. 64.)
Denys, parlant de la Cause unique, déclare : « Par un débordement de sa propre essence, elle a produit toutes les essences ». Ou encore : « la diffusion infiniment puissante de Dieu pénètre tous les êtres, et il n’est aucun être qui soit totalement privé de toute puissance ».
En effet, ‘par la surabondance de son pouvoir (elle) confère la puissance à la faiblesse même.’ Dieu « se répand tout entier en toutes choses28. »
Ibn ‘Arabî, à propos du Verbe Adamique, évoque « l’effusion inépuisable de la révélation essentielle », le terme « effusion » (al-fayd) référant à cette Parole « Dieu a créé le monde dans les ténèbres ; puis il versa sur lui de Sa Lumière. » (Sag. 20-22.)
Il existe une double irradiation ou effusion : l’une [51] suprême, intérieure, en laquelle Dieu se révèle de toute éternité à lui-même, puis, lui succédant, l’effusion extérieure, objective, en laquelle apparaissent les perfections, et qui se produit dans les êtres, simples reflets de la pure essence29.
Maître Eckhart affirme : « L’art de Dieu est de devenir perceptible à soi-même dans un rayonnement qui retourne en soi. » Il cite aussi la parole du prophète : « J’ai épanché mon âme — en moi-même. » (P. 99, 310.)
Et Denys, avant lui, évoquait ce même débordement de Dieu illuminant le monde comme étant la « Lumière intelligible » — celle de la Conscience pour les Śivaïtes.
« On appelle donc Lumière intelligible ce Bien qui est au-delà de toute lumière, car il est source de tout rayonnement et il répand le trop-plein de sa lumière sur toutes les intelligences… C’est lui qui les illumine de toute sa plénitude, qui renouvelle leurs puissances d’intellection… qui contient d’avance et conserve en soi l’entière maîtrise de la puissance illuminatrice. » (D. 99-100.)
Effusion de béatitude ou d’exultation
Dans le Śivaïsme c’est de l’énergie de félicité qu’émane l’univers30.
« Dès que la félicité s’éveille, écrit Abhinavagupta, apparaît un jaillissement qui se déploie jusqu’à l’énergie d’activité. » Plus précisément l’énergie divine inséparable de Śiva est la prise de conscience que Śiva a de Soi sous forme de béatitude quand il tend imperceptiblement à se dilater au sortir de la plénitude indivise et qu’il se met à vibrer de façon spontanée en vue de s’exprimer. » (T.A. III, 67-68.)
Dans le Royaume des Amants, Ruysbroeck insiste sur la très haute Unité de la nature divine, à la fois vivante et féconde. Dieu jouit et agit. Antérieurement à cette activité divine, ne règne dans l’Essence que la félicité à laquelle nulle voie ne mène.
Ibn ‘Arabî définit l’ordre divin comme un mouvement se dégageant du repos : « Or, le mouvement qui est l’existence même du monde est un mouvement d’amour comme l’indique la parole du Prophète (prononcée au nom de [52] Dieu) : “J’étais un trésor caché. Je voulus être connu, et J’ai créé le monde” ; s’il n’y avait pas cet amour divin le monde n’eût pas été manifesté. » (Im.)
Denys ne dit pas autre chose : Dieu est désir et amour 31... « C’est lui-même qui, de soi-même, est manifestation de soi-même… mouvement simple d’un amoureux désir qui se meut de soi-même et agit par soi-même : qui préexiste dans le Bien et déborde du Bien sur tout être avant de se retourner derechef vers le Bien. Il apparaît ainsi que le divin Désir est en soi sans fin et sans principe, tel un cercle perpétuel, qui, grâce au Bien, à partir du Bien, au sein même du Bien et en vue du Bien, parcourt une parfaite orbite, demeurant identique à soi-même et conforme à son identité. »
« Ce Bien lui-même dont l’amoureux désir, à la fois beau et bon, s’étend à la totalité des êtres par la surabondance de son amoureuse bonté, sort aussi de lui-même lorsqu’il exerce ses Providences à l’égard de tous les êtres et qu’en quelque façon il les captive par le sortilège de sa bonté, de sa charité, et de son désir32. »
On pourrait évoquer en parallèle l’amour mutuel de Śiva et de son énergie, leurs jeux amoureux qui fondent l’univers. Et de même que Śiva se donne sans compter, allant jusqu’à offrir son Soi, pour Denys : « Ce Dieu qui est être de façon suressentielle fait don de son être aux autres êtres et produit toute essence. » (88.)
Mais que l’effusion soit de lumière, de puissance ou d’amour, la manifestation émane et se résorbe, sans jamais laisser de trace, au cœur de l’unité, c’est ce que s’efforcent de dire les formules lapidaires qui se font écho à travers les différentes traditions.
Avec la même sobriété et la même vigueur intransigeante, elles tentent de formuler le mystère de la manifestation et du retour à l’Un, de résoudre la contradiction apparente de l’Un et du multiple.
Abhinavagupta évoque ainsi la Conscience indifférenciée :
« C’est en elle-même, par elle-même et à partir d’elle-même qu’elle manifeste tout ce qui existe. » [53]
Denys cite saint Paul pour montrer que le Beau-et-Bien est tout ensemble principe, fin et moyen :
« Tout est de lui, par lui, en lui et pour lui33. »
Denys encore, avec une extrême concision, définit comme suit l’Unité divine : « À partir de qui, à travers qui, en qui et pour qui existent tout être, tout ordre, toute subsistance, toute plénitude et toute conversion. » (174.)
.
Pour les Śivaïtes, tout ne fait qu’un avec Śiva — Soi cosmique, soi individuel, l’énergie qui sert de voile et d’obstacle à la réalisation du Soi — puisque Śiva est le seul existant qui se voile et se dévoile à sa guise. C’est pourquoi Somānanda, au début de sa Śivadrsti, se salue lui-même en ces termes :
« Que Śiva qui nous est totalement immanent rende hommage à lui-même, Soi tout-épanoui, à l’aide de sa propre énergie, (Śiva) qui par soi-même se fait obstruction à soi-même, obstruction qui n’est autre que le Soi ! »
Ibn al-Fāridh disait aussi : « Et c’est de moi à moi que va ma Salutation. »
À qui lui demandait en quoi consistent les états d’émission, de manifestation et de résorption de l’univers, Abhinavagupta répondait : « c’est la projection du Soi dans le Soi et par le Soi ». « Par le Soi », glose Jayaratha, c’est-à-dire en excluant tout recours à la nature ; l’émission a lieu « dans le Soi » et non en un lieu ou un temps qui en seraient séparés. C’est « l’œuvre du Soi, uniquement de lui qui est sujet et objet de connaissance. La projection est une fulguration, sous des formes internes et externes à travers les aspects variés de la manifestation. Ainsi, seule la suprême Conscience, plénitude parfaite, est ce qui fulgure… » (III. v. 141.)
.
Maître Eckhart : « Et le Seigneur parle ainsi par la bouche du Prophète Osée : “Je veux conduire l’âme noble dans une solitude et là, je parlerai dans son cœur”. Un avec l’Un, Un de l’Un, Un dans l’Un et, dans l’Un, Un éternellement34. »
En sa surabondance, l’Essence flue et se manifeste ; puis elle reflue et se révèle en tant qu’unique. Mais qu’elle flue ou reflue, elle reste immuable comme le firmament, car tout a lieu par elle-même et en elle-même. [54]
« La Déité est une source, tout provient d’elle et tout s’écoule de nouveau en elle : aussi est-elle également une mer. » (A.S. III, 168.)
« Quand je me perds en Dieu, je reviens à nouveau au lieu où j’ai été de toute éternité, avant moi » déclare Angelus Silesius. (V. 332.)
Ruysbroeck dit de l’homme qui possède le don de force spirituelle :
« Il voit Dieu se répandre et s’écouler comme la mer en furie avec d’inconcevables délices en tous ceux qui sont capables de le recevoir, et puis refluer avec eux et les attirer dans les hautes vagues de son unité. Ils ne peuvent plus tenir en eux-mêmes quand s’offre à eux l’unité ; ils s’écoulent ainsi dans ce mouvement de flux et de reflux, portés par un amour véritable. » (R. 121.)
.
Pour exprimer le mouvement sur fond d’immutabilité, les Śivaites recourent à l’image de la vague (ūrmi) qui s’enfle, déferle sur le rivage, puis reflue vers le large. Source de tout dynamisme — sans elle, point de mouvement ni de vie —, elle est aussi source de repos dans l’indifférencié, car flux et reflux ont lieu dans le lac infini de l’énergie consciente, « océan de la suprême ambroisie, source d’où flue l’univers, Lac transparent et tout jaillissant » 35 et qui ne s’écoule qu’en lui-même.
Ce double mouvement d’aller et de retour qui a sa source en lui-même a également été saisi par Denys, en ces termes :
« Mais ramenons derechef toutes ces puissances à l’unité et disons qu’il n’existe qu’une Puissance simple, productrice d’union et de cohésion, qui est le principe spontané de son propre mouvement, et qui du Bien jusqu’au dernier des êtres, puis de nouveau de cet être même jusqu’au Bien, parcourt sa révolution cyclique à travers tous les échelons, à partir de soi, à travers soi et jusqu’à soi, sans que cesse jamais, identique à soi-même, cette révolution sur soi-même. » (D. 110.)
Cet intense, ce prodigieux mouvement de vie se retrouve aussi chez notre mystique rhénan. L’image d’une roue qui roule d’elle-même exprime la révolution éternelle. Dieu passe d’abord de l’unité à la diversité du Dieu personnel — la trinité incluant le Verbe renferme du même coup la multiplicité de l’univers — puis il retourne à [55] l’indivisible unité. Cette émanation du monde ne doit pas être considérée comme un simple mirage sans portée réelle ; le monde est au contraire souverainement positif. En effet, la procession à partir de l’unité indivise jusqu’à l’universelle diversité, puis le retour à l’unité primordiale — flux et reflux — tendent à la plénitude :
« Dieu, dit Eckhart, ne se repose pas là où il est le premier commencement. Au contraire, il se repose là où il est la fin et la trêve de tout être. Non que cet être devienne néant ; au contraire, il est alors accompli dans sa plus haute perfection36. »
.
La position des Śivaïtes est similaire : Śiva à travers l’énergie se manifeste en l’univers puis, à travers cette même énergie, il fait retour à Paramasiva, c’est-à-dire Śiva en sa suprématie, qui contient tout en lui-même et que ce déploiement a enrichi.
Ibn'Arabî 37 admet que l’achèvement est plus parfait que le début :
« Car l’Essence aime la perfection ; or, la connaissance qu’a Dieu de Lui-même en tant qu’Il est indépendant des mondes, ne se rapporte qu’à Lui seul ; pour que la connaissance soit parfaite à tous les degrés, il faut que la connaissance de l’éphémère… se réalise également. La perfection (ou l’Infinité) divine s’exprime donc en ce qu’elle manifeste la connaissance relative aussi bien que la connaissance éternelle, de sorte que la dignité divine de la Connaissance soit parfaite sous l’un et l’autre aspects […].
« De la même manière se parfait l’Être… L’Être éternel est l’être de Dieu en Lui-même ; l’être non éternel est l’Être divin [se reflétant] dans les “formes” du monde immuable… Il se manifeste donc à Lui-même dans les formes du monde, afin que l’Être soit parfait [sous tous les rapports bien que le relatif ne puisse rien ajouter à l’éternel]. » (Sag., 163.)
Dhou’l-Noun l’Égyptien adresse au Créateur la louange suivante :
« Tes créatures, personne d’autre que Toi ne les a créées et, en les créant, Tu T’es exalté. » (Kh., 43.)
Ainsi, rien ne peut échapper à l’unique Réalité, le [56] multiple ne saurait provenir d’autre chose que de l’unité. IL n’y a pas contradiction, mais nécessité ; « Rien, dit Denys… n’existe qui ne participe d’une certaine façon à l’unité de Celui qui contient d’avance et synthétiquement la totalité universelle, sans excepter les opposés mêmes, qui en lui se réduisent à l’unité. Sans l’unité, la multiplicité n’existerait pas ; sans multiplicité, par contre, l’unité reste possible… » (D. 173.)
Pour les musulmans, « la totalité du divin est faite du divin incréé (haqq) et du divin créé, ces deux faces de la réalité absolue » écrit H. Corbin (Im. 227, n. 46). Le divin incréé, Essence en soi (dhat), est indépendant de l’univers et se suffit à lui-même.
D’après Jāmî :
« “La Réalité des réalités”, qui est l’Être divin essentiel, le plus exalté, est la Réalité de toutes choses. Il est Un en Lui-même et “unique” de telle sorte que la pluralité ne peut pénétrer en Lui…
« Supprime les mots “ceci” et “cela”
La qualité implique la différence et l’hostilité.
Dans tout cet univers plein de beauté et sans imperfection,
Ne vois qu’une seule substance et qu’une seule Essence. »
« Cette Essence unique sous son aspect absolu, dénuée de tous phénomènes, toutes limitations, toute multiplicité, est la “Réalité”. Par ailleurs, la multiplicité par laquelle Dieu Se manifeste quand il Se revêt des phénomènes fait qu’Il est tout l’univers créé. C’est pourquoi l’univers est l’expression extérieure et visible de la “Réalité”, et la “Réalité” est la réalité intérieure et invisible de l’univers. Avant d’être manifesté à la vue extérieure, l’univers était identique à la “Réalité” ; et la “Réalité”, après cette manifestation, est identique à l’univers. Bien plus : il n’y a en fait, qu’un seul Être réel ; Son occultation et Sa manifestation, Son antériorité et Sa postériorité ne sont que Ses relations et Ses aspects. “Il est le Premier et le Dernier, l’Extérieur et l’Intérieur” (Coran, LVII. 3). » (Antho., 245.)
« II est l’existence de ce qui se révèle et l’Essence de ce qui reste caché. » [57]
Dans le Śivaïsme, la Conscience absolue ou le suprême Śiva renferme tous les contrastes et n’exclut rien :
« Ce que l’on nomme Conscience n’est autre que… la nature même de l’univers entier avec ses modalités d’être et de non-être », trouve-t-on dans la Śivasūtravimarsinī (I. 1).
« (Ces) clartés au sein de la Clarté, et (ces) ténèbres au sein de la Ténèbre, clartés et ténèbres au plus haut degré — je salue cette Splendeur sans pareille ! » chante Abhinavagupta à la première stance de sa Laghuvrtti.
Le Samvidullāsa dit de même :
« La Réalité Śivaïte est d’une manière indescriptible nonchalance pleine d’ardeur, ténèbres intenses identiques à la lumière, vacuité faite de plénitude. » (MM., 140.)
Et pourtant il n’y a point d’opposés dans l’Un, en ce sens que, selon Somānanda, « la nature divine demeure identique en toutes choses. Si l’on y distingue des états supérieurs et inférieurs, c’est à l’intention de gens imbus de convictions erronées. » Privés de l’évidence qui accompagne la vision mystique, intuitive et globale, ces hommes forgent arbitrairement des contrastes : pur-impur, bien-mal, alors que la même puissance divine et la même Conscience infinie se trouvent partout indifféremment dans le pur et dans l’impur. (S.D. I. 48.)
.
Chez les mystiques, paradoxes et contrastes se fondent dans une intuition globale. Comme le suggère Maître Eckhart :
« L’Essence unifie et enferme tout en soi… Dans cette étreinte générale Tout se résout en Tout, car, là, Tout tient Tout enfermé en soi. Mais en soi-même cela reste quelque chose de non fermé pour soi. » (P. 77.)
C’est ce que dit Jîlî, mais en d’autres termes, à propos du Tout :
Il est inconnaissable et il ne l’est pas, car « la connaissance distinctive ne s’y rapporte pas, quel que soit le point de vue puisqu’il est impossible que Dieu ait une limite et qu’il n’y a pas moyen de connaître ce qui n’a pas de limite. Mais Dieu (al-haqq) se révèle dans cet état par voie de totalisation et d’intégration. » (H. J. 43.)
Abhinavagupta fait, lui aussi, appel à la « grande intégration » (mahāvyāpti). Ce terme désigne à la fois la diffusion omnipénétrante de la Conscience dans le Soi puis dans l’univers en ses divers aspects, et aussi une intégration totale lorsque l’univers est réintégré à l’énergie divine [58] et celle-ci à la Conscience incomparable (anuttara), l’ensemble se perdant en Paramasiva (T.A. III v. 205).
Selon Ruysbroeck, « Cette lumière simple de l’essence… embrasse l’unité des personnes divines ainsi que l’unité de l’âme et de toutes ses puissances, de telle sorte que cette simple lumière enveloppe et pénètre de ses rayons la tendance naturelle et fondamentale à s’attacher à Dieu par simple jouissance » (143). À elle adhèrent de façon fruitive les esprits aimants, tous les êtres étant « suspendus… à l’essence divine » (142), dans les abîmes de laquelle reflue et se résorbe l’activité de Dieu et de toutes les créatures.
Nos mystiques soutiennent que l’essence ou la divinité sans aspects « simplifie » en réduisant tout à l’unité. Elle ne peut être ni sujet ni objet de connaissance, et pourtant cette essence, inconnaissable comme telle aux êtres limités, constitue la réalité intime de toute connaissance.
Pour Abhinavagupta, nos connaissances ne sont unifiées que par le Seigneur puisqu’il est « l’unique conscience lumineuse par soi ». (P.S. 40.)
Denys dit de même :
« Comme l’ignorance divise ceux qui se sont égarés, ainsi la présence de la lumière intelligible rassemble et réunit ceux qu’elle éclaire, elle les perfectionne, les convertit à l’être absolu, et les détournent de la pluralité des conjectures, en ramenant la variété de leurs visions — ou plutôt de leurs imaginations — à une seule connaissance, véridique, purifiée, unifiée, et en les emplissant d’une lumière unique et unifiante. » (100.
Les grands mystiques nous font entrevoir la pure Essence resplendissant de son propre éclat et qui englobe tout.
Plus proches de nous, nous émeuvent les lamentations de ceux qui, l’ayant entrevue ou la pressentant, se plaignent ou souffrent de ce qu’elle se cache et se dérobe, de ce qu’elle leur échappe alors qu’elle est là.
Comment cette Essence lumineuse de son propre éclat peut-elle se voiler à elle-même ? Abhinavagupta formule merveilleusement l’énigme :
« Qu’y a-t-il en effet de plus difficile que de faire apparaître en Lui, lumière par nature, la négation de la lumière au moment même où sa nature essentielle de lumière consciente brille sans interruption ? Une telle œuvre de Sa libre énergie semble impossible aux êtres limités que nous sommes. » (H. A., 29.)
Quant aux sūfī, ils voient précisément dans ce mystère une preuve de grandeur et de toute-puissance :
« Quel mystère que Sa manifestation soit Sa non-manifestation même » s’écrient-ils, nous rendant perceptible le fait que Dieu ne saurait se révéler sans s’être caché. Là réside le mystère de la manifestation [60] :
« Voilà ce qui te démontre Sa Toute-puissance, exalté soit-Il : qu’Il se cache à toi par ce qui n’a pas d’existence hors de Lui » dit Al-Iskandarî (Doct., 60).
Meister Eckhart, citant Denys, rappelle que « Dieu est une fontaine qui s’est écoulée en elle-même en sorte que sa nature est cachée à tout le créé. » (P. 101.)
De même que nous ne pouvons jouir de la plénitude du soleil parce qu’il nous éblouit, parce que des nuages le cachent ou en raison d’une maladie congénitale de l’œil qui trouble la vision, de même, pourrait-on dire, trois obscurités nous voilent l’Essence divine : l’intensité omnipénétrante de sa Lumière, l’opacité des attributs différenciés, la taie de l’ego et sa vision à double pôle38.
La Lumière remplit l’univers. Évidente par elle-même, elle est source de toute connaissance. « Partout où vous vous tournez, là est la Face de Dieu » (Coran II, 109). Et pourtant elle reste invisible. Utpaladeva proteste et se plaint de ne pas voir ce qui seul peut être vu et que dérobe son éclat :
« Pour Te connaître, il n’est nul besoin d’aide ; il n’existe pas d’obstacle non plus. Tout est submergé par le flot surabondant de Ton existence. » Et encore : « Ta pure Lumière surpasse en éclat le rayonnement de milliers de soleils. Tu remplis l’univers entier et cependant nulle part Tu n’es visible. » (Bh., p. 17 et 19.)
La lumière pure est un voile, son propre éclat la cache. « Ceux qui sont voilés le sont ou par la lumière pure ou par les attributs humains. »
Selon un verset de Mahesvarānanda :
« Le plus beau des rubis est voilé par l’éclat de ses propres rayons. Ainsi, bien qu’il resplendisse du plus grand éclat pour tout le monde, le Soi n’est pas manifeste. » (M.M., v. 9.)
Le Soi se cache sous un éblouissement silencieux, voilé et déformé par l’extension de ses propres énergies comme la pierre précieuse par ses rayons ou comme le soleil de midi que son éclat excessif dérobe aux regards ; la lumière du Soi est nuit pour la pensée empirique et pour les sens, les pensées dualisantes n’ayant nul accès à la lumière parfaite et sans ombre. [61]
Abhinavagupta salue « Śiva (qui) éclaire perpétuellement avec la torche de son énergie cognitive la multiplicité des choses immergées dans l’abîme profond qu’est son propre Cœur. » (I. P. v. I. V. 1.) L’éclat lumineux de cette insondable caverne reste invisible à cause de sa luminosité même. Et parce que cette divine lumière seule éclaire tout ce que nous voyons elle nous échappe. Comment en effet pourrions-nous voir la source de ce par quoi nous voyons ?
Scellé en nous, Śiva, soleil de la vibrante et fulgurante Conscience éclaire le monde à travers nos organes, mais si nous voyons tout en Lui, nous ne voyons ni Lui ni le foyer de sa lumière, notre propre cœur.
« C’est en tournant le dos au soleil, écrit T. Burckhardt, qu’on regarde l’arc-en-ciel ; de même, la vision de Dieu se reflétant par Ses “couleurs” dans l’univers s’opère en vertu de la Lumière divine, sans qu’on puisse directement contempler la source de celle-ci. » (H. J., 10.)
Ainsi en raison de sa pureté, de sa nudité, de son infinité, la lumière échappe à nos yeux trop faibles pour la contempler et demeure invisible à force d’être patente.
« Gloire plus cachée que le caché, plus évidente que l’évident lui-même » chante la Mahārthamanjari (V. 68). Éternellement présente, elle repose invisible dans la caverne de l’illusion ; évidente, elle fulgure sans interruption, mais non reconnue dans sa plénitude, elle demeure cachée, Réalité à la fois secrète et manifeste, comme le proclame un Tantra, par la bouche de la Déesse, s’adressant ainsi au Seigneur :
« O Tout-Puissant, Toi mon propre moi, révèle-moi ce grand abîme mystérieux qui est aussi le grand abîme sans mystère39, cette énergie qui séjourne dans le cœur et par laquelle j’obtiendrai un parfait assouvissement. »
C’est de cette évidence que s’efforce de se persuader le sūfī Ibn « Atā » Allah d’Alexandrie qui prie en ces termes :
« Ô Toi qui es voilé dans les enveloppes de Ta gloire de sorte que personne ne peut Te voir ! Ô toi qui rayonnes au-dehors dans la perfection de ta Splendeur, de sorte que le cœur (des mystiques) a perçu ta Majesté ! Comment serais-tu caché puisque tu es à jamais manifeste ou comment serais-tu absent puisque tu es à jamais présent et que tu veilles sur nous ! » (Arb., 102.) [62]
Mais en deçà du pur éclat de la lumière blanche de l’Essence, le Dieu doué d’attributs, de qualités ou d’énergies, selon les traditions, arrache des cris douloureux aux mystiques souffrant d’être séparés de la pure Essence par cela même qui la leur révèle, tout comme le nuage rend perceptible l’éloignement du soleil :
Al-Hallāj se plaint : « Il se dérobe à tout dévoilement et à toute manifestation. Il est trop saint pour être atteint par nos yeux et embrassé par les conceptions de nos esprits. Il s’isole des créatures par Sa pérennité, de même façon que les créatures s’isolent de Lui par leur temporalité. Ainsi celui dont les qualités sont telles, comment peut-on chercher le chemin qui mène à Lui ? Puis il pleura et récita :
« Et je leur dis : Mes amis, voyez le soleil ; sa lumière
Est proche ; mais pour l’atteindre, qu’il y a loin ! 40 »
Et s’il y a loin, c’est que ses propres attributs le voilent.
Le Traité de l’Unité affirme nettement :
« Personne ne peut Le voir, sauf Lui (— même). Personne ne le saisit, sauf Lui-même… Il Se voit par Lui-même. Il Se connaît par Lui-même… Autre-que-Lui ne peut Le saisir. Son impénétrable voile est Sa propre Unicité. Autre-que-Lui ne Le dissimule pas. Son voile est Son existence même. Il est voilé par Son Unicité d’une façon inexplicable… » (p. 24.)
Plus concrètement Ibn Al-Arābi formule le paradoxe de la présence-absence qui est le lieu douloureux de la vie mystique :
« C’est un Être puissant, toujours présent en même temps qu’inaccessible et absent, voilé par ses rayons à sa propre lumière, par ses qualités à la compréhension qu’on peut avoir de Lui, par ses Noms divins à sa propre Essence. » (Kh., 129.)
Mais cette occultation est preuve d’amour, car sans elle la lumière ne serait jamais perceptible puisqu’elle nous consumerait :
« J’entendis Abd-al-Wāhid Ibn Kakr dire : “Il les a [63] couverts du Nom et ils ont pu vivre. S’Il leur avait présenté les Sciences de la Toute-Puissance, ils en eussent ressenti du vertige. Mais s’Il leur avait dévoilé la Réalité, ils eussent péri.” »
Selon la parole du Prophète : « Dieu se cache par soixante-dix mille voiles de lumière et de ténèbre ; s’il les enlevait, les fulgurations de Sa Face consumeraient quiconque le regarderait. »
Dans le Śivaïsme, le Seigneur, afin de voiler sa lumineuse Essence, cache librement son autonomie ainsi que sa conscience à l’aide de l’énergie de grande Illusion (mahā-māyā) et fait apparaître en son propre Soi homogène comme l’espace une limitation qui s’étend à tous les êtres. Il rétrécit et cristallise ses énergies de toute-puissante liberté, d’omniscience, de plénitude, d’éternité et d’omniprésence, qui, perdant leur infinité, ne sont plus qu’activité fragmentatrice, science différenciée, désir restreint, temps et nécessité causale.
Ainsi revêt-il l’aspect de multiples sujets conscients soumis à l’illusion (māyā), asservis par une connaissance limitée qui ne se situe nullement en Śiva, mais relève de l’individu, lequel, ayant perdu l’intuition du Soi à cause de cette double illusion, se croit limité, imparfait, confond le moi et le Soi.
À ce stade, le grand jeu de l’Amour dans la félicité et dans la surabondance devient l’alternative asservissante. Oublieux de sa gloire native, l’homme sombre dans la confusion ; s’imaginant dépourvu de plénitude, il désire les formes qui en sont privées et se les approprie. Il s’éloigne du sanctuaire de son être et se sépare de la Réalité simple et globale ; au cours d’une quête désespérée au dehors de lui-même, il se perd dans l’agitation, le « désir morcelé »41, le savoir limité dans lesquels les jeux de l’Amour, de la connaissance, de la fécondité de l’action deviennent séparation, ignorance, dispersion, que cette perte soit appelée, selon les traditions, illusion, faute originelle ou voile.
Pour Ibn « Arabî « (Le monde) est à lui-même son propre voile, en sorte qu’il ne peut pas voir Dieu du fait [64] même qu’il se voit ; il ne peut jamais se défaire par lui-même de son voile, tout en sachant qu’il se rattache par sa dépendance, à son Créateur. C’est que le monde ne participe pas à l’autonomie de l’Être essentiel, si bien qu’il ne le conçoit jamais. Sous ce rapport, Dieu reste toujours inconnu, à l’intuition comme à la contemplation, car l’éphémère n’a pas de prise sur cela (c’est-à-dire sur l’éternel). » (Sag., 32.)
Ne voyant pas la lumière toujours présente, nous nous en détournons explique Plotin : Quant à la présence de l’Un qui est conscience, calme, éternel et n’a pas besoin de venir, « s’il n’est pas avec vous, c’est que vous vous êtes détournés de lui… En sa présence vous vous êtes tournés vers son contraire… 42. »
Nous sommes accaparés, en effet, par le multiple, l’appropriation et la temporalité ; ce que Maître Eckhart confirme quand il écrit :
« Ce trésor du royaume de Dieu, le temps l’a caché, et la multiplicité et les œuvres propres de l’âme, bref sa nature de créature. » (P., 311.)
Ruysbroeck, parlant des contemplatifs eux-mêmes, précise lui aussi : « Cette lumière insondable brille sans interruption dans tous les esprits, mais l’homme qui vit ici-bas dans le temps s’embarrasse souvent d’images, de sorte qu’il ne peut pas toujours, au moyen de cette lumière, contempler actuellement la Suressence et y plonger son regard. » (R., 151.)
Plus simple, Attar déplore :
« C’est toi le souverain, au commencement et à la fin. Mais, hélas, l’homme voit double.
Au lieu de un, tu vois deux, au lieu de deux, tu vois cent…
Doué à l’origine d’une essence merveilleuse, tu as rapiécé de haillons ta robe de satin. » (Antho., 35-36.)
Une même allégorie pour les Śivaïtes et les soufis, celle du théâtre d’ombres, illustre de quelle manière un rideau — l’écran — permet à la fois de cacher et de révéler la Réalité.
Ibn al-Fāridh écrit à ce sujet des stances aussi belles [65] que secrètes sur l’unique acteur qui fait mouvoir à sa guise des marionnettes derrière un écran transparent, éclairé de l’intérieur. Les spectateurs, assis à l’extérieur, de l’autre côté de l’écran et dans l’obscurité, perçoivent les ombres projetées sur l’écran par les marionnettes.
Derrière ce voile mystérieux, l’unique acteur reste invisible ; c’est pourtant lui qui exhibe les actes variés aptes à provoquer chez les assistants maints sentiments ou réactions.
Le montreur de marionnettes est l’âme ; l’écran, le corps ; les ombres sont les phénomènes. Les marionnettes font comprendre comment cohabite ce qui est opposé par nature, comment la vie se manifeste par son contraire : « Muettes, elles parlent, inertes elles se meuvent, sans lumière propre elles se manifestent clairement. » (V. 681.)
L’écran suggère à la fois l’intérêt, la nécessité et l’inconsistance de l’obscurité du voile, quel que soit le degré d’obscurité ou de séparation qu’il crée.
Les ombres qui se détachent sur l’écran, centre du spectacle, protègent de la lumière sur le fond de laquelle elles se détachent ; la transparence du voile, en revanche, guide vers elle ; et, le moment venu, écran et ombres s’évanouissent sans laisser de trace tandis que seul se révèle, tout lien délié, le montreur de marionnettes.
C’est pourquoi Ibn al-Fāridh recommande : « Ne néglige pas entièrement le jeu des ombres. » « Ne te détourne pas avec mépris… de l’illusion et de l’irréel. Car dans le sommeil de l’illusion, l’apparition des ombres te mène vers ce qui t’est montré à travers un voile transparent. » (V. 677 à 679.)
Il développe un parallèle entre le montreur de marionnettes et sa propre âme :
« Ainsi j’ai laissé tomber entre moi et Moi-même le voile qui obscurcit l’âme dans la lumière de l’obscurité. » (707.)
« Ses marionnettes étaient les formes par lesquelles, à l’aide d’un écran, il déployait son action ; elles s’annihilèrent et disparurent lorsqu’il se révéla.
« Et mon âme lui ressemble quant à l’action, car mes impressions sont comme les marionnettes et le vêtement corporel est mon écran. » (711-712.)
« Dès que j’ai eu écarté de moi cet écran, mon âme m’est apparue sans aucun voile.
« Déjà le soleil de la contemplation s’était levé ; toute existence en était illuminée, et en moi les nœuds de l’attache des sens étaient défaits. » (713-714.) [66]
« Je me tournai alors pour répandre la surabondance de ma grâce sur tout être créé, selon les temps et les circonstances.
« Et si je n’étais voilé par mes attributs, les objets en qui je me manifeste seraient consumés par la splendeur de ma gloire. » (716-717.)
Et le poète conclut :
« Tout ce que tu vois est l’acte d’un seul
Dans la solitude, mais il est bien voilé.
Il suffit qu’il soulève l’écran
et aucun doute ne subsiste.
Les formes évanouies, Lui seul est partout.
Et toi, illuminé, tu sais que par sa lumière,
Tu découvres ses actes dans l’obscurité des sens43. »
Comment résister à la magie d’une telle simplicité ; comment ne pas espérer quand tout devient si léger ? Il suffit qu’il soulève l’écran !
De cette allégorie on peut rapprocher celle du danseur qu’utilisent souvent les Śivaïtes. Par le spectacle de sa danse Śiva disperse les ténèbres de l’ignorance, piétine les liens des êtres enchaînés et les délivre.
L’unique acteur, le Soi, déploie en dansant la pantomime universelle sur la paroi immuable de sa Conscience. La scène où il pose les pieds et exhibe le grand jeu cosmique est son propre cœur, le soi intérieur. Sur l’écran lumineux, les mouvements de sa danse se détachent en ombres mouvantes — les apparences de la Réalité — si bien que par son jeu l’écran de lumineuse conscience reste caché.
Dans la joie débordante qu’il éprouve à montrer au public la pantomime de la transmigration, il éveille par la subtilité de son jeu une profonde impression chez les spectateurs, à savoir les organes.
Parmi les assistants, certains, victimes du jeu divin dont les reflets cachent l’écran, ne s’intéressent qu’aux ombres mouvantes et ignorent la présence de l’acteur. D’autres dont l’intuition est bien exercée ne la décèlent qu’à des moments privilégiés. Quant au yogin doué de Science mystique, il se reconnaît identique à l’acteur divin, il [67] prend conscience de sa véritable Essence, le Soi ; il est à la fois spectateur et danseur.
Cachée aux ignorants, son essence rayonne à ses propres yeux. Il vaque à ses occupations tout en sachant que son activité se déroule à l’intérieur de la Conscience divine, il joue ses rôles, mais n’en est pas dupe. Libre et détaché, il prend joyeusement part au grand jeu cosmique des ombres et des lumières.
L’allégorie Śivaite évoque un niveau d’expérience sans doute supérieur à celui du théâtre d’ombres. Ici l’écran n’est pas un voile à enlever, il est au contraire la paroi lumineuse de la Conscience ; nul ne doit le soulever, il suffit de se rendre à l’évidence de sa lumière.
Mais qu’il s’agisse des ombres ou du danseur, c’est à travers les rôles que l’on assume et dont on est victime que l’on prend conscience de Soi : c’est grâce à l’écran qu’on perçoit la Lumière.
Dans l’obscurité la plus profonde, sous les voiles les plus épais, l’Essence est toujours là, réalité foncière de toute chose, notre nature même.
Résidant dans notre cœur, elle illumine toute notre vie sans elle nous serions insensibles, aveugles, et aucune expérience ne serait possible.
Pour les Śivaïtes la lumière du cœur reste toujours présente ; comme un sirop en se cristallisant garde sa saveur sucrée, elle conserve sa douceur en dépit de la fragmentation ou de la solidification de la Conscience à travers les différentes étapes de la manifestation. (P.S., v. 26.)
De même pour Ruysbroeck tout homme est suspendu à l’unité divine, et s’il s’en détachait, il tomberait dans le néant, mais par la dissemblance ou le péché, il est privé de la béatitude ou de la fécondité qu’elle engendre.
Et pourtant cette béatitude est toujours disponible, comme l’exprime Denys :
« Dans sa bonté, la Lumière divine ne cesse jamais de s’offrir aux yeux de l’intelligence, c’est à eux qu’il appartient de la saisir, car elle est là et toujours divinement prête au don de soi-même. » (D., 257.) [69]
Ce n’est pas le moindre de nos paradoxes que de vivre privés ou séparés de ce qui est là, de ce que nous sommes ou de ce que nous voyons sans savoir que nous le voyons.
Détenteurs d’un trésor oublié, nous vivons dans le dénuement :
Śiva, pure Lumière, évidence même, conscient de soi et par soi « ne brille-t-il pas comme sujet percevant dans le cœur de tous les êtres ? Oui, répond Abhinavagupta, mais bien qu’il y brille, il n’est pas véritablement appréhendé, assimilé de façon intime par le cœur, et ce qui n’est pas assimilé par le cœur, même existant, c’est comme s’il n’existait pas, ainsi les feuilles et l’herbe (du chemin pour quelqu’un) qui passe sur un char44. »
C’est parce qu’il saisit dans son cœur ce qui est perpétuellement là, en effet, que le mystique peut en jouir ; par cette seule saisie intime, il diffère de l’homme ordinaire. Et l’entrée dans le cœur n’est autre que la bienheureuse stupeur de celui qui s’avise de ce qui est évident depuis toujours.
Faut-il préciser qu’il ne s’agit point ici du cœur sensible ou affectif, mais de ce lieu qui, au plus intime de nous-mêmes, échappe à toute forme de pensée ou de sentiment, point central qui connaît et qui sent à la fois, et que les sūfī définissent comme le lieu de coïncidence de l’être et de la connaissance.
.
« Toujours nouveau et secret45,
Ancien et universellement connu,
Ce cœur incomparable fulgure
De lui-même en de suprêmes irradiations. »
.
Et Rūmî chante :
« J’ai cherché une âme dans la mer Et j’y ai trouvé un corail
Sous l’écume à mes yeux
Un océan se déploya.
Dans la nuit de mon cœur Le long d’un chemin étroit
J’ai creusé ; et la lumière a jailli
Une terre infinie de jour. » (Arb., 137.) [70]
En ce lieu jaillit, il est vrai, l’expérience de celui qui touche ou goûte à ce qu’il nomme le Soi ou le divin. Car il s’agit, en effet, d’une connaissance concrète qui ne peut être assimilée à une découverte intellectuelle ou à une banale introspection ; on la reconnaît à ce qu’elle « met l’apaisement dans le cœur », comme le note H. Corbin qui distingue deux connaissances du divin : « l’une par la créature » celle des philosophes et des théologiens, l’autre par la « créature dans le divin ». Cette dernière, d’ordre contemplatif, « explore le fond des attributs de l’âme » (Im., 234, n. 81).
Prise de conscience immédiate de la présence divine, cette connaissance abolit tous les doutes. Elle est éprouvée dans une rencontre où le secret de la créature et celui de la divinité sont simultanément vécus dans une expérience unique. « Certes, on peut connaître une Essence (dhat) éternelle, mais on ne sait pas qu’elle est Dieu, jusqu’à ce que la reconnaisse quelqu’un qui l’éprouve comme son Dieu… L’Être nécessaire que la philosophie isole avec ses attributs dont résulte le concept de divinité, ce n’est pas Dieu. » (Im., 229, n. 60.)
Cette rencontre bouleverse la connaissance ordinaire : « Quand tu es entré dans mon paradis, alors tu es entré en toi-même… et tu te connais d’une autre connaissance, différente de celle que tu avais quand tu connaissais ton Seigneur par la connaissance que tu avais de toi-même » dit Ibn « Arabî (Im., 101).
Et elle change l’orientation de tout l’être, met en suspens la dispersion dans le temps et l’espace, touche le voile le plus intime, révélant « l’Aimé… plus proche de l’amant que sa veine jugulaire ». « Proximité si excessive », glose Henry Corbin, « qu’elle commence justement par être un voile. C’est pourquoi le novice encore sans expérience spirituelle, dominé par l’Image qui investit tout son être intérieur, s’en va pourtant la chercher au-dehors de lui-même, en une quête désespérée de forme en forme du monde sensible, jusqu’à ce qu’il revienne au sanctuaire de son âme, — s’aperçoive que l’Aimé réel est tellement intérieur à son être qu’il ne cherche l’Aimé que par l’Aimé. » (Im., 119.)
En un mot, cette saisie par le cœur rend évidente au cœur du mystique la réalité de Dieu.
Sur quoi repose la vraie possession de Dieu, demande Maître Eckhart et il explique lui-même :
« Elle repose sur le sentiment du cœur » et non pas sur une idée, car « on [71] doit avoir un Dieu réel, qui est élevé au-dessus de la pensée de l’homme et de tout le créé. Ce Dieu ne disparaît pas, à moins qu’on ne s’en détourne volontairement.
« Qui a ainsi Dieu, essentiellement, celui-là seul prend Dieu divinement et Dieu rayonne devant lui à travers toutes choses : toutes lui donnent le goût de Dieu, dans toutes Dieu se reflète en lui… »
Mais, ajoute Eckhart plus loin : « il faut pour cela… une conscience éveillée, vraie, agissante, sur laquelle l’âme doit faire fond en dépit des choses et des gens. » (P., 165.)
Si les images, les doctrines varient avec les traditions évoquées pour décrire cette expérience simple, mais fondamentale, toutes, cependant, la rattachent à ce qu’elles nomment la grâce, sur les caractéristiques de laquelle elles sont unanimes.
Pour toutes, en effet, c’est la grâce et elle seule qui confère à l’éveil de l’âme son caractère libre, gratuit et spontané ; car cet éveil échappe à tout ce qui est détermination, effort, intention ou mérite.
Sous forme de motion, incitation, touche, attraction ou irradiation, elle opère dans l’intime du cœur :
« L’irradiation de la grâce de Dieu touche et meut promptement du dedans l’homme intérieur, et cette prompte motion est la première chose qui nous rend voyants. » (R., 239.)
C’est elle qui révèle ou rend perceptible l’orientation intime du cœur à laquelle s’associe étroitement son action. De cette intimité naît le feu d’amour ou de connaissance dont la force ne cesse de grandir.
À son propos, Ruysbroeck parle de rencontre de l’époux, il l’associe à ce qu’il nomme la « conversion amoureuse » et aux exercices intérieurs qui en découlent. La grâce ou la lumière surnaturelle « constitue, dit-il, un premier point, et de là résulte le second, lequel a trait à ce qui vient de l’âme : il s’agit d’une libre conversion de la volonté vers Dieu, laquelle s’effectue en un moment du temps ; c’est alors que naît la charité dans l’union de Dieu et de l’âme. Ces deux points dépendent si étroitement l’un de l’autre que l’un ne peut s’effectuer sans l’autre. Lorsque Dieu et l’âme s’unissent dans l’unité de l’amour, alors Dieu donne sa lumière de grâce au-dessus [72] du temps ; et l’âme se tourne librement vers Lui, fortifiée par la grâce, en un bref moment du temps ; c’est alors que naît la charité dans l’âme, de Dieu et de l’âme elle-même. » (R., 189.)
De même, les sūfī décrivent l’interaction subtile de « l’irradiation divine » et de ce qu’ils désignent comme « prédisposition du cœur ». T. Burckhardt, exposant la doctrine d’Ibn « Arabî, explique ainsi l’un de ses aspects :
« La prédisposition du cœur… ne peut être connue en dehors de l’irradiation divine.., c’est l’irradiation qui actualise la prédisposition… (qui) comme telle reste “la chose la plus cachée qui soit” (Ibn “Arabî)… Il n’y a donc rien dans la réceptivité du cœur qui ne soit pas la réponse à l’irradiation ou révélation divine, dont elle subit tour à tour les fulgurations ; celles-ci varient suivant les divers “aspects” ou “noms” de Dieu, et ce processus ne s’épuise jamais ni du côté de l’irradiation divine, qui est essentiellement inépuisable, ni du côté de la plasticité primordiale du cœur. » (Doct., 109-110.)
Dans cette collaboration intime de la grâce et du cœur, tous les mystiques proclament unanimement que c’est toujours la grâce qui a l’initiative. Là, réside en effet un aspect essentiel de l’expérience décrite.
Śiva prend l’initiative en accordant sa grâce, il inspire l’amour et l’amour s’éveille, puis grâce et amour forment un cercle sans fin, l’amour appelant la grâce et la grâce, l’amour : « Tu n’es satisfait, Seigneur, que par l’amour et il n’y a d’amour que si tu es satisfait. Toi seul sais comment porter remède à ce cercle vicieux », dit Utpaladeva (XVI. 21.).
Dans le Sermon sur la naissance éternelle, Maître Eckhart dit :
« Tu voudrais bien être préparé en partie par toi, en partie par lui ; cela pourtant n’est pas possible. Si vite que tu puisses jamais penser ou concevoir la préparation, Dieu est toujours déjà là avant. »
Dieu, poursuit-il, se tient toujours à la porte du cœur, attendant qu’on lui ouvre.
« Maintenant tu pourrais dire : Comment cela se peut-il ? Je ne le trouve pourtant pas. Écoute ! Le trouver n’est pas en ton pouvoir. Bien plus : cela est dans le sien. S’il lui plaît, alors il se montre, et il peut aussi se cacher s’il le veut. » (Pf., 27-28.)
Et n’est-ce pas pour cette même raison qu’un sūfī, à peu près son contemporain, Ibn « Atā » Allah d’Alexandrie, chantait [73] :
« O Dieu, cherche-moi au nom de ta Miséricorde pour que je vienne à Toi ; attire-moi par ta Grâce pour que je retourne vers Toi. » (Arberry, p. 102.)
De cette grande liberté divine, ne nous plaignons pas : elle est notre seule chance d’échapper aux limites de notre raison, de notre effort et de notre faiblesse, comme le suggère la prière de Dhou’l-Noun l’Égyptien :
« O Dieu, notre Dieu… C’est toi qui envoies à tes créatures une provision de force et de puissance. Tu fais agir les êtres selon ta volonté : ni la faiblesse, ni la sotte ignorance, ne peuvent mettre un obstacle à ton action ; ni la privation, ni la surabondance d’une qualité quelconque ne peuvent la modifier. » (Kh., p. 43.)
Avec la grâce naît la double conscience de la lumière et de l’écran, mais aussi le désir unique de la pure lumière désormais pressentie ou entrevue, « Cette Lumière secourable qui est à l’origine de toute naissance ». (Rūmî, Antho., 16.)
Aussi quand elle se manifeste, commence une vie nouvelle dite vie surnaturelle ou vie de la grâce, « vie intermédiaire, selon Ruysbroeck, entre le sentiment d’être en nous-mêmes et celui d’être Dieu » jusqu’à ce que le mouvement d’amour qu’elle ne cesse de nourrir et d’intensifier nous ait ramenés « à l’unité de laquelle nous sommes issus en tant que créature et au sein de laquelle nous demeurons essentiellement » écrit Ruysbroeck.
En réalité il n’y a que l’Essence, mais nous parlons de la grâce quand, au cœur du voile, nous percevons son irradiation, ou quand, après l’avoir touchée, nous retombons dans l’obscurité du voile, mais en bénéficiant des effets du dévoilement.
Lorsqu’il n’y a plus de jeux d’ombres et de lumières, il n’y a plus de grâce ; ne demeure que la Pure Lumière, l’unique Lumière que nous sommes devenus. La grâce s’est évanouie dans la Gloire.
Le propre de la grâce est de disparaître sans laisser de traces puisqu’elle n’a pour effet que de rendre les choses à leur vraie nature, à leur origine en dissolvant les voiles ou [74] les conditions limitatives, ignorance ou péché qui, en fait, s’évanouissent dès qu’apparaît la Réalité :
« Dans un cœur contracté, l’illumination s’est transformée en ignorance. Que cesse la contraction et la nature propre resplendit » peut-on lire dans le treizième chapitre du Tantrāloka.
C’est précisément la manière dont cesse la contraction qui caractérise l’action de la grâce et conduit à distinguer les différentes voies mystiques.
Pour Abhinavagupta une double manière met fin aux conditions limitatives, selon qu’elle est paisible et progressive ou violente, instantanée et liée « à un appétit pour tout dévorer, tel un feu ardent et ininterrompu »46.
De son côté Jîlî note que ces conditions disparaissent soit par un aperçu qui atteint l’Essence, soit par ce qui jaillit spontanément de celle-ci (p. 80). Et les sūfī distinguent deux modes d’approche vers Dieu : le premier est un processus graduel d’état spirituel en état spirituel par assimilation de qualités divines qui deviennent objet de contemplation. Attributs, noms, qualités offrent un accès à la connaissance de Dieu, mais, en raison de leur multiplicité, ils ne peuvent conduire à l’Essence. La seconde approche est immédiate, sans progression, par-delà tout état, elle se réfère « au Soi de l’homme, à son essence intime qui s’identifie mystérieusement à l’essence divine » (H. J., 12).
La seule manifestation de la Splendeur est délivrance.
Deux premières voies correspondent à la disparition paisible, progressive, par aperçu, des conditions limitatives47, elles sont dites de perfectionnement, tandis qu’à la maturation violente, à ce qui jaillit spontanément de l’Essence, correspond une voie de l’instantanéité, voie divine ou de la volonté. Quant à la non-voie, étant intemporelle, elle transcende voie et grâce.
Śivaïtes et sūfī font appel à une même illustration pour montrer que le monde objectif n’est qu’une parcelle congelée de la Conscience ou de la Réalité : « O Bien-aimée ! celui qui dans les livres sacrés ou de la bouche d’un maître [75] apprend ce que sont l’eau et la glace n’a plus de devoir à accomplir. Cette (présente) naissance sera pour lui la dernière. » (S.S.v., p. 88.)
Celui qui a percé le mystère de l’eau et de la glace a compris en effet comment l’eau de la Conscience indifférenciée se solidifie, et comment la glace de la conscience empirique se liquéfie à nouveau ; il est libre, il sait que l’eau et la glace ne font qu’un.
.
On trouve une même comparaison chez Jîlî :
« En parabole, la création est pareille à de la glace,
Et c’est Toi qui en es l’eau jaillissante.
La glace, si nous la réalisons, n’est autre que son eau…
Mais la glace fondra et sa condition se dissoudra,
La condition liquide s’établira, de fait.
Les contrastes s’unifient dans une seule beauté.
C’est en elle qu’ils s’anéantissent et c’est d’eux qu’elle rayonne. » (H. J., 52.)
À la lumière de cette parabole la grâce apparaît comme le feu qui fait fondre la glace de la conscience contractée pour la rendre à sa nature indifférenciée. Au moment de l’entrée dans le cœur s’allume le foyer de la Conscience à partir duquel fond la glace de la conscience empirique. Et la forme et la rapidité de la fonte déterminent et caractérisent la voie suivie.
Pour les Śivaïtes, l’énergie divine indifférenciée, de par sa liberté, s’amuse à se cristalliser 48 telle une eau vivante et limpide solidifiée par les froids. Le Tout fissuré n’est plus que glaçons figés, allant à la dérive et en constante collision. Ces fragments (anu), êtres impuissants, ont perdu le sentiment du Tout et ne peuvent le retrouver par eux-mêmes.
C’est le feu de l’Énergie divine, le feu de la grâce, qui seul se révèle apte à faire fondre les glaçons.
Si la grâce est faible, le feu couve : du cœur il fait se dégager de minces filets d’eau qui creusent peu à peu des canaux, l’individu l’attise constamment, aidant à la fonte par son application ; les canaux, dégagés de leurs limitations s’élargissent peu à peu et l’eau coule vers le fleuve de l’énergie. C’est la voie de l’activité.
Avec une grâce plus forte la rapidité de la fonte fait [76] confluer tous les courants vers le centre de la glace qui communique elle-même avec l’eau environnante ; les glaçons — représentations ou images — subsistent dans les profondeurs, mais il suffit qu’ils s’enfoncent et se perdent dans la force du fleuve qui les emporte pour qu’ils disparaissent : c’est la voie de la connaissance.
Si la grâce est surabondante, toute la glace tombe d’un coup à l’irruption d’un puissant volcan sous-marin qui affleure en surface et dont les flammes fulgurent : c’est la voie de la volonté.
Dans la Non-Voie, il n’y a qu’une seule et même eau…
Il ne faut pas prendre ici ce qui est appelé voie pour un itinéraire déterminé dont on suivrait méthodiquement les étapes avant d’aboutir. Rendre compte des différentes voies ne consiste pas non plus à élaborer une sorte de marche à suivre ou de recette pour qui voudrait accéder à la vie mystique ou à l’illumination : d’une part, rien ne peut conduire à l’Essence puisque rien ne lui est extérieur, et d’autre part, nul ne décide de sa voie, on la découvre au fur et à mesure qu’on avance.
On pourrait dire que la voie est la manière dont l’esprit de Dieu nous meut et la manière dont nous y répondons, ou selon Madame Guyon, la manière et la rapidité avec lesquelles nous suivons la pente naturelle ou l’instinct qui nous ramène à Dieu une fois qu’Il s’est dévoilé à nous, ou encore la façon dont on est emporté par le reflux divin vers l’Essence que l’on n’a jamais quittée.
Connaître les modalités de ce reflux, c’est déjà pouvoir discriminer ce qui n’est pas lui, et si l’on ne peut décider de sa voie, on peut du moins éviter de prendre pour mystique ce qui ne l’est pas.
Les voies varient pour chacun selon l’intensité de la grâce, le but poursuivi et l’effort fourni.
« Cette splendeur sans fond a été donnée en commun à tous les esprits jouissants en grâce et en gloire. Ainsi, elle coule pour tous comme la splendeur du soleil, et cependant, ceux qui la reçoivent ne sont pas tous également éclairés. Le soleil transillumine plus clairement le verre que la pierre, et le cristal que le verre, et chaque pierre précieuse brille et montre sa noblesse et sa puissance et sa couleur à la clarté du soleil. De même chacun est illuminé [77] à la fois en grâce et en gloire selon son aptitude à la sublimité… 49. »
Sur une même voie les degrés sont multiples et l’on progresse à l’infini. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père » rappelle Madame Guyon.
À travers cette grande souplesse et cette extrême variété, le Śivaïsme du Cachemire, Ruysbroeck, Madame Guyon distinguent nettement trois voies ou avènements en des termes différents, mais dont le rapprochement souligne les correspondances étroites.
Quand les Śivaites caractérisent les voies par trois principales énergies, quand Ruysbroeck distingue trois unités ou oppose ressemblance, union et unité, quand Madame Guyon évoque la voie de l’activité, celle des lumières et celle de la Foi nue, il semble bien que tous différencient trois niveaux intérieurs à partir desquels l’orientation vers Dieu est rendue perceptible par la grâce.
Qu’ils parlent d’énergies, de facultés ou de puissances, c’est pour les saisir dans un mouvement qui les fait se résorber les unes dans les autres jusqu’au fond indifférencié d’où elles émanent en cascade. Les voies sont en quelque sorte trois moments ou trois paliers de cette résorption.
Il nous faut préciser que les voies dont il est ici question sont purement mystiques, elles se situent à un niveau élevé de la vie contemplative et ne correspondent ni aux voies dites purgative, illuminative et contemplative ou unitive, ni aux trois sortes de yoga, karmayoga, jñānayoga et bhaktiyoga, qui constituent des étapes préliminaires à la vie mystique profonde décrite par les auteurs que nous citons.
Par le terme « voie » nous désignons le courant de grâce qui entraîne les énergies ou les facultés vers l’unification. Ce courant dynamique renferme procédés, moyens, intermédiaires et modes de tous ordres dont l’ensemble varie selon le niveau touché par la grâce. À chaque voie correspondent ainsi un domaine, un mode d’unification qui déterminent la vie nouvelle dans laquelle on est précipité dès qu’on a « touché Dieu » :
« Dieu est un aimant, mon cœur est l’acier : il se tourne toujours vers lui s’il l’a une fois touché », déclare Angelus Silesius (V. 130.)
[78] Plus intérieur, plus profond est le point de contact où opère la grâce, plus intense est le feu de l’attraction divine, plus abrupt le chemin, plus directe et plus pure la voie.
En général, les mystiques accèdent à l’étape élevée du recueillement ; ils entrent dans leur cœur en y entraînant leurs sens ; « comme les abeilles qui retournent à leur ruche et y rentrent pour faire du miel » 50 ; ils sont tirés vers l’intérieur par une source vivante de paix, qu’ils la nomment Dieu, le Soi ou qu’ils ne la nomment pas. Elle imprègne et apaise le corps, les sens, l’activité physique et mentale, elle unifie le cœur individuel.
Mais ces mystiques ne se dégagent pas aisément de la vision objective ; sans cesse détournés vers l’extériorité, ils doivent faire effort pour répondre à l’attraction divine ; ils suivent la voie de l’activité dite également voie de l’individu.
Au terme de cette voie, ils tendent, cependant, à reconnaître l’opération divine en toutes choses ; leur activité dégagée de l’objectivité, devient l’acte désintéressé d’une conscience individuelle apaisée et unifiée mais encore aux prises avec la dualité.
Quelques mystiques plus rares, délivrés de l’objet, suivent la voie de la connaissance. Pour eux l’attraction divine opère dans l’esprit, au niveau des facultés supérieures ou de l’énergie cognitive, sur les modalités de la connaissance. Elle y est si forte « qu’on aime Dieu directement, sans connaître comme objet ce qu’on aime » selon l’expression de Madame Guyon, et que le cœur est élargi aux dimensions universelles. Grâce à la purification des images, notions et représentations jusque dans leurs racines inconscientes, les énergies sont unifiées. Si l’obstacle est l’alternative ou le dilemme, le secret de la progression réside dans une puissance de réalisation qui tient à l’union efficace du zèle et du discernement, et culmine dans l’acte d’adoration où le fidèle s’unit à Dieu à travers ses attributs.
Sur cette voie on tend à une vision unitive de l’univers : Dieu est partout. À son sommet on égalise cette vision et l’intériorité ; les attributs s’éteignent dans l’Essence.
Sur la voie divine la grâce intense opère sans moyen dans la volonté dès que celle-ci est touchée : elle mène à la disparition de la conscience empirique ; l’attraction est si forte que le moi est consumé tandis que volonté humaine et volonté divine fusionnent. C’est la voie de la Foi nue et du silence, car il n’y a plus ni mots ni relation. L’intériorité parfaite à jamais acquise et la vision de l’unicité de l’univers se compénètrent pour ne faire qu’un : c’est la liberté de la Vie divine.
Au-delà des trois voies ne règne que la béatitude ou jouissance fruitive de l’Essence dans le repos profond de la « divinité qui ne sera plus jamais remuée »51. C’est la non-voie, l’Essence de pure Lumière.
La première œuvre proposée au lecteur, la plus proche de nous dans le temps ( XVIIe siècle) et d’une lecture aisée, n’est point un ouvrage faisant autorité mais le simple témoignage d’une grande mystique séculière.
Madame Guyon, veuve, vivait alors à Gex et c’est durant un séjour à Thonon qu’elle écrivit son premier livre. « Dans cette retraite il me vint un si fort mouvement d’écrire que je ne pouvais y résister », raconte-t-elle dans son autobiographie. « En prenant la plume je ne savais pas le premier mot de ce que je voulais écrire. Je me mis à écrire sans savoir comment, et je trouvais que cela venait avec une impétuosité étrange. Ce qui me surprenait le plus était que cela coulait comme du fond, et ne passait point par ma tête. Je n’étais pas encore accoutumée à cette manière d’écrire ; cependant, j’écrivis un traité entier de toute la voie intérieure sous la comparaison des rivières et des fleuves52. » Si elle avait repris une phrase ou un mot, elle eût cru commettre une « infidélité ».
Si Madame Guyon obéit ainsi spontanément à une inspiration profonde et d’une qualité éminente c’est qu’elle est alors parvenue à « la vie nouvelle et divine » des âmes que Dieu « cache dans son sein et sous l’extérieur de la vie la plus commune, afin qu’elles ne soient connues qu’à lui seul, quoiqu’elles fassent ses délices ». « Lorsqu’il faut qu’une telle âme écrive ou parle, elle est de même étonnée que tout coule de ce fonds divin sans qu’elle eût jamais pensé à posséder ces choses. Elle se trouve comme une science profonde, sans mémoire ni ressouvenir, comme un trésor inestimable, que l’on ne remarque que lorsqu’on est obligé de le manifester ; et c’est la manifestation pour les autres qui est la manifestation pour soi. » Ou pour mieux dire encore : « cette âme n’est plus, elle n’agit plus, mais Dieu agit… »53.
L’écriture spontanée, sans retour ni esprit critique, de Madame Guyon nous vaut un véritable traité, un exposé d’ensemble des diverses modalités et des degrés de la vie mystique, digne d’être mis en parallèle, bien qu’il se tienne au seul plan de l’expérience vécue, avec les œuvres savantes des grands mystiques philosophes ici cités.
Ce livre n’est pas une étude également fouillée des trois voies puisqu’un seul chapitre suffit à caractériser chacune des deux voies inférieures tandis que tout le reste du volume est consacré à la voie la plus haute, dite ici de « Foi nue », que Madame Guyon a suivie et à laquelle elle voudrait rallier tous les chercheurs de Dieu.
Elle emploie avec bonheur la métaphore des cours d’eau — n’avait-elle pas découvert tout récemment et le Rhône et les paysages de montagne ! — les âmes des deux premières voies étant comparées respectivement à de petites rivières et à des fleuves, celles de la Foi nue à des torrents qui se précipitent dans la mer. L’image est riche de suggestions : rapidité et force du courant qui entraîne, accidents de parcours et jusqu’à l’utilité publique (bateaux ou marchandises transportés) qui figure l’aide spirituelle que l’on peut offrir à autrui. Enfin, l’âme en la vie divine, au terme de sa course, est perdue en Dieu comme la goutte d’eau dans la mer.
Sur la première voie, l’effort humain est encore nécessaire, car la grâce y est faible : c’est la voie de l’activité. Sur la seconde, la grâce est assez forte pour que l’âme soit « passive », c’est-à-dire qu’elle reçoive de Dieu ses états, découvrant et explorant « l’intériorité » : c’est la [83] voie de l’union et de la grandeur, mais aussi de la connaissance. Dans un autre de ses ouvrages, Madame Guyon précise que les âmes de cette voie « reçoivent des lumières distinctes pour leur conduite… marchent sur les témoignages que leurs lumières leur donnent, aidées de leur raison ; et elles font bien » mais, ajoute-t-elle plus loin, elles « peuvent se tromper dans les lumières de leur esprit »54. Dans Les Torrents, notre auteur analyse avec finesse leurs autres imperfections et déplore qu’elles se condamnent à ne point sortir de leurs « lumières » afin d’atteindre au plus haut.
Grands sont les dangers en effet sur cette voie, en raison même de l’immense énergie éveillée et du rôle de la connaissance. À vrai dire, elle exige, peut-être plus que toute autre voie55, la présence d’un maître plein de grâce et de science mystique qui évitera au disciple de s’égarer, de s’illusionner, de stagner dans ses réalisations et qui, éventuellement, le conduira vers le dépassement de ses richesses.
La voie supérieure est de Foi nue et d’abandon total. « Les personnes qui sont conduites par cette voie sont celles qui éprouvent la science savoureuse, quoique conduites par un abandon aveugle. Elles ne vont jamais par les lumières de l’esprit, comme les premières… mais par les routes impénétrables de la volonté cachée… plus sûrement que les premières… » Pour elles « toutes les opérations les plus immédiates se font dans le centre de l’âme, qui n’est autre que les trois puissances réduites dans l’unité de la volonté, où elles s’absorbent toutes… » (Abrégé, G., 318-319.)
Cette voie s’ouvre sur une expérience essentielle et décisive, celle de la « touche efficace dans la volonté » mentionnée dans les Torrents, mais décrite en détail dans la Vie, comme nous allons le voir. Très orientée vers Dieu, et ce, dès son enfance, Madame Guyon se désespérait de ne pouvoir faire oraison lorsqu’elle rencontra un franciscain qui lui dit : « C’est, Madame, que vous cherchez au-dehors ce que vous avez au-dedans. Accoutumez-vous à chercher Dieu dans votre cœur, et vous l’y trouverez. »
Ce fut pour elle une ouverture du cœur instantanée, « un coup de flèche qui perça mon cœur de part en part » écrit-elle. « Ces paroles mirent dans mon cœur ce que je cherchais depuis tant d’années, ou plutôt elles me [84] firent découvrir ce qui y était et dont je ne jouissais pas faute de le connaître. » Une onction merveilleuse s’empara de tout son être, mais aussi « un feu dévorant qui allumait dans mon âme un tel incendie qu’il semblait devoir tout dévorer en un instant, Je fus tout à coup si changée que je n’étais plus reconnaissable ni à moi-même ni aux autres ; je ne trouvais plus ni ces défauts ni ces répugnances ; tout me paraissait consumé comme une paille dans un grand feu. »
Et voici, en un seul paragraphe toutes les caractéristiques principales de la voie de Foi nue :
« Rien ne m’était plus facile alors que de faire oraison, les heures ne me duraient que des moments et je ne pouvais ne la point faire : l’Amour ne me laissait pas un moment de repos… Mon oraison fut, dès le moment dont j’ai parlé, vide de toutes formes, espèces et images : rien ne se passait de mon oraison dans la tête ; mais c’était une oraison de jouissance et de possession dans la volonté, où le goût de Dieu était si grand, si pur et si simple qu’il attirait et absorbait les deux autres puissances de l’âme dans un profond recueillement, sans acte ni discours. J’avais cependant quelquefois la liberté de dire quelques mots d’amour à mon Bien-aimé, mais ensuite tout me fut ôté. C’était une oraison de foi qui excluait toute distinction, car je n’avais aucune vue ni de Jésus-Christ ni des attributs divins : tout était absorbé dans une foi savoureuse, où toutes distinctions se perdaient pour donner lieu à l’amour d’aimer avec plus d’étendue, sans motifs ni raisons d’aimer. Cette souveraine des puissances, la volonté, engloutissait les deux autres et leur ôtait tout objet distinct pour les mieux unir en elle, afin que le distinct, en ne les arrêtant pas, ne leur ôtât pas la force unitive et ne les empêchât pas de se perdre dans l’amour. Ce n’est pas qu’elles ne subsistassent dans leurs opérations inconnues et passives, mais c’est que la lumière de la foi, comme une lumière générale, pareille à celle du soleil, absorbe toutes les lumières distinctes et les met en obscurité à notre égard, parce que l’excès de sa lumière les surpasse toutes56. »
Si la première et la seconde voies envisagées par Madame Guyon réfèrent aux deux mêmes domaines d’expérience que les voies sivaïtes sans en présenter le cheminement [85] savamment conduit, la voie de foi nue est très proche à tous égards de la voie divine (ou de Siva) : on y retrouve l’instantanéité, le rôle de la volonté, l’intensité de l’amour et la force de l’élan, le dépassement des représentations et des attributs dans l’indifférenciation (ou non-distinction), et ici cette image de la lumière n’est pas sans évoquer la souveraine Lumière de la Conscience.
Madame Guyon ne publia jamais elle-même Les Torrents et protesta contre les fautes commises dans certains des manuscrits qui circulaient. L’un de ses admirateurs protestants, le pasteur Pierre Poiret, les publia en 1704 dans un recueil intitulé Les Opuscules spirituels qui contenait également Le Moyen court et le commentaire du Cantique des Cantiques. Madame Guyon était sortie de la Bastille l’année précédente. En 1712, dans une seconde partie des Opuscules, il donna une version corrigée et augmentée des Torrents selon un meilleur manuscrit, probablement mis au point (d’après J. Orcibal) par Madame Guyon elle-même. Enfin en 1720, trois ans après la mort de l’auteur et peu après celle de l’éditeur, parut une édition encore un peu modifiée et augmentée, définitive.
Ces corrections sont surtout de multiples, mais minimes améliorations de style (accords, suppression des répétitions de mots, etc.). Pour le fond, quelques expressions « choquantes » sont adoucies par prudence théologique, et un certain nombre de paragraphes explicatifs ajoutés. Notons bien que la pensée reste la même. Madame Guyon ne se rétracte pas, elle ne modifie que des points de forme et de clarté.
Nous avons choisi la version de 1704 qui contient quelques errreurs de copie manifestes, mais paraît être vraiment un premier jet et correspond le mieux à cette écriture rapide, jaillissante, sans retour qu’atteste la « Lettre de l’auteur à son confesseur ». Comme cette édition ne comporte, en guise de seconde partie, que les articles condamnés par l’évêque de Chartres, Godet-Desmarais, dans son ordonnance de novembre 1795, nous donnons pour cette partie le texte de l’un des deux manuscrits conservés dans les Archives de Saint-Sulpice. Il est d’autant plus intéressant de présenter ces versions rares que l’édition de 1720 des Opuscules spirituels est à présent accessible grâce à la réimpression publiée par Jean Orcibal en 1978 chez Olms57.
C’est P. Poiret qui a donné à l’ouvrage sa présentation matérielle : il le divise en chapitres numérotés et précédés d’un sommaire, en articles ou paragraphes également numérotés, met en note des références bibliques ou des comparaisons justificatrices et ajoute le mot « spirituels » au titre « Les Torrents », lequel n’était peut-être pas de Madame Guyon. Étant donné notre propos ici, nous avons omis notes et sommaires, conservé presque toujours sa division en chapitres, mais remplacé les numéros par des titres et supprimé la numérotation des paragraphes. Le lecteur trouvera pourtant en note toutes ces références, prises dans l’édition de 1720, de sorte qu’il pourra aisément comparer nos extraits avec la version définitive.
Ce choix représente un peu plus du tiers du traité. Ainsi dépouillée des redites, des considérations secondaires, d’une certaine prolixité dévotionnelle, et même, à vrai dire, réduite à ses lignes de force, l’œuvre laisse mieux voir sa grandeur profonde.
Marinette Bruno.
Sitôt qu’une âme est touchée de Dieu et que son retour est véritable et sincère, après sa première purgation que la confession et la contrition ont faite, Dieu lui donne un certain instinct de retourner à lui en quittant les amusements et bagatelles du monde pour rentrer en son centre, comme à une fin où il faut qu’elle tâche de retourner, et hors de laquelle elle ne trouve jamais de véritable repos.
Cet instinct est mis dans l’âme d’une manière très forte, en quelques âmes plus et en d’autres moins, selon les desseins de Dieu, mais elles ont toutes une impatience amoureuse de se purifier et de prendre les biais nécessaires pour retourner à leur source et origine, semblables aux rivières qui, après qu’elles sont sorties de leurs sources, ont une course continuelle pour se précipiter dans la mer. Vous voyez même que de toutes ces rivières les unes vont gravement et lentement, et les autres vont avec plus de vitesse. Mais il y a des fleuves et des Torrents qui courent avec une impatience effroyable et que rien ne peut arrêter. Toutes les charges que vous pouvez leur donner et les digues que vous pourriez mettre pour empêcher leur course ne serviraient qu’à en redoubler la violence.
Il en est ainsi de ces âmes. Les unes vont doucement à [88] la perfection et elles n’arrivent jamais à la mer, ou très tard, se contentant de se perdre dans quelque rivière plus forte et plus rapide qui les entraîne avec elle dans la mer ; les autres, qui sont les secondes, y vont plus fortement et plus promptement que les premières. Elles y portent même avec elles quantité de ruisseaux, mais elles sont lentes et paresseuses en comparaison des dernières qui se précipitent avec tant d’impétuosité qu’elles ne sont même bonnes à guère de choses. L’on n’ose naviguer sur elles ni leur confier aucune marchandise, si ce n’est en certains endroits et en certains temps. C’est une eau folle et téméraire qui s’ébat contre les rochers, qui effraie de son bruit et qui ne s’arrête à rien. Les secondes au contraire sont plus agréables et plus utiles ; leur gravité plaît et elles sont toutes chargées de marchandises, et on y va sans crainte et sans péril.
Il faut voir avec l’aide de la grâce ces trois sortes de différentes personnes sous les figures que j’ai proposées, et commencer par les premières pour heureusement finir par les dernières.
Les premières âmes sont de celles qui, après leur conversion, s’adonnent à la méditation, aux œuvres mêmes extérieures de la charité, elles font quelques austérités extérieures, enfin elles tâchent peu à peu de se purifier, d’essuyer certains péchés notables et même des véniels volontaires. Elles travaillent selon leurs petites forces à avancer peu à peu, mais faiblement et petitement.
Comme leur source n’est pas abondante, la sécheresse les fait quasi tarir. Il y a des endroits même dans les temps des aridités où elles se dessèchent tout à fait. Elles ne laissent pas de couler de la source, mais c’est si faiblement qu’à peine s’en aperçoit-on. Ces rivières ne portent point ou très peu de marchandises, quelques bois perdus, et si pour le public il faut leur en faire porter, il faut en même temps que l’on supplée à la nature et trouver le moyen de les grossir, ou par la décharge de quelques étangs, ou par le secours de quelques autres rivières de même espèce que l’on joint et unit à elles, lesquelles rivières jointes ensemble augmentent l’eau et, se secourant les unes les autres, se mettent en état de porter quelques [89] petits bateaux, non dans la mer, mais dans quelques-unes de ces maîtresses rivières dont nous parlerons ci-après.
Ces âmes-ci sont ordinairement peu appliquées au-dedans. Elles travaillent au-dehors. Elles ne sortent jamais guère de la méditation, aussi ne sont-elles pas propres à de grandes choses. Elles ne portent point pour l’ordinaire de marchandises : cela veut dire qu’elles n’ont rien pour les autres ; et Dieu ne se sert pas ordinairement de ces âmes si ce n’est pour porter quelques petits bateaux, c’est-à-dire pour quelques œuvres de miséricorde corporelle. Encore pour s’en servir il leur faut décharger les étangs des grâces sensibles ou les unir à quelques autres dans la Religion, où plusieurs d’une grâce médiocre ne laissent pas de porter un petit bateau, non dans la mer même, qui est Dieu, où elles n’entrent jamais dans cette vie, mais bien dans l’autre.
Ce n’est pas que ces âmes ne se sanctifient par cette voie. Il y a même quantité de bonnes âmes qui passent pour très vertueuses qui ne la passent pas, pieu leur donnant des lumières conformes à leur état et qui sont quelquefois très belles et font l’admiration des spirituels ordinaires. Il y a même quelques-unes de ces âmes qui sur la fin de leur vie reçoivent quelques lumières passives, selon la fidélité qu’elles ont eue dans leur voie. Mais pour l’ordinaire elles ne sortent point d’elles-mêmes58, toutes leurs grâces et leurs lumières étant d’une manière créée, je veux dire proportionnées à leurs capacités ; plus ces mêmes lumières sont distinguées, aperçues, accompagnées de faveurs, plus elles s’y attachent et ne trouvent rien de plus grand en cette vie.
Les plus favorisées de ces âmes pratiquent la vertu avec beaucoup de générosité. Elles ont mille inventions saintes et pratiques pour se porter à Dieu et demeurer en sa présence. Le tout cependant se fait par leurs propres efforts, aidés et secourus de la grâce. Mais dans ces âmes, leur opérer semble excéder celui de Dieu, et celui de Dieu ne fait que concourir avec le leur.
Je crois que qui voudrait porter ces âmes à une Oraison plus dénuée n’y réussirait pas pour plusieurs raisons. La première est que, comme ces âmes n’ont rien de surnaturel qu’à mesure de leur travail, si on les tire de ce travail elles perdent tout, quoique cependant elles empêchent par [90] ce travail même le cours des grâces, semblables à ces pompes qui ne donnent de l’eau qu’à mesure qu’elles sont agitées… Vous remarquerez même en ces âmes une grande facilité à raisonner, à s’aider de leurs puissances, d’une activité toujours vigoureuse et forte, d’un désir de faire toujours quelque chose de plus et de nouveau pour se perfectionner, et dans les sécheresses une anxiété pour s’en défaire, aussi bien que de leurs défauts.
Ces âmes ont beaucoup de hauts et de bas. Tantôt elles font merveilles, d’autres fois elles languissent et rampent, et elles n’ont jamais une conduite unie, d’autant que le principal de leur Oraison étant dans les puissances, lorsque ces puissances sont desséchées soit faute de travail de leur part soit faute de correspondance de la part de Dieu, elles tombent dans le découragement ou bien elles s’accablent d’austérités et d’efforts pour retrouver par elles-mêmes ce qu’elles ont perdu. Elles n’ont jamais, comme les autres âmes, une profonde paix ni le calme dans leurs distractions ; au contraire elles sont toujours en alerte59 pour les combattre ou pour s’en plaindre. Elles sont pour l’ordinaire scrupuleuses, entortillées dans leurs voies, à moins qu’elles n’aient l’esprit d’une force assez raisonnable.
Il ne faut donc pas porter ces âmes à l’Oraison passive, car ce serait les ruiner sans ressource, leur ôtant les moyens d’avancer vers Dieu. Car comme une personne qui serait obligée de voyager et qui n’aurait ni bateaux ni carrosses ni aucune autres voies que celle d’aller à pied, si vous lui coupiez les pieds, vous la mettriez hors d’état d’avancer. De même ces âmes, si vous leur ôtiez leur opérer, qui sont leurs pieds, elles n’avanceraient jamais.
Et je crois que c’est ce qui fait aujourd’hui les contestations qui arrivent parmi les personnes d’Oraison. Celles qui sont dans la passive, connaissant le bien qui leur en revient, y voudraient faire marcher tout le monde et les autres, au contraire, qui sont dans la méditation, voudraient borner tout le monde à leur voie, ce qui serait une perte et un dommage qui ne se peut dire. Que faut-il donc faire ? Il faut prendre le milieu et voir si ces âmes sont propres à une voie ou à une autre60.
[Suivent des exemples et des considérations particulières. [91] Dans les manuscrits et les éditions ultérieures, le problème est envisagé de façon plus générale : J
Faut-il donc laisser [les âmes de cette voie active] toute leur vie dans le raisonnement ? Je crois que si ces âmes sont assez heureuses de trouver un directeur habile, il ne laissera pas de les faire bien avancer ; et un nombre innombrable d’âmes qui ne croient être propres que pour la méditation arriveraient à la perfection la plus consommée si elles trouvaient un Directeur avancé. Tant s’en faut qu’un Directeur de grâce nuise à ces âmes ; il leur servira infiniment, les faisant marcher selon toute l’étendue que Dieu veut d’elles, ne précédant pas ni ne différant pas la grâce, mais la secondant et y faisant correspondre ; au lieu qu’un Directeur d’une grâce commune arrête les âmes, empêche qu’elles n’avancent et se les approprie…
Ce que je conclus de là est qu’il faut toujours choisir le Directeur le plus spirituel, qu’en quelque degré que l’on soit il servira, et Dieu vous accordera, ô vous qui n’espérez rien de surnaturel, par cet homme qui lui est si cher, ce qu’il ne vous accorderait pas à vous-même61.
Les secondes âmes sont comme ces grandes rivières qui vont à pas lents et grave. Elles coulent avec pompe et majesté. L’on distingue leur course qui a de l’ordre. Elles sont chargées de marchandises et peuvent aller elles-mêmes dans la mer sans s’écouler dans d’autres rivières ; mais elles n’y arrivent que tard, leur marcher étant grave et lent ; de plus il y en a quelques-unes qui n’y entrent jamais, et pour la plupart elles se perdent dans d’autres plus grands fleuves ou bien elles aboutissent à quelque bras de mer. Plusieurs de ces rivières-ci ne servent qu’à des marchandises, elles en sont très chargées. On les peut retenir par des écluses et les détourner par certains canaux et conduits. Telles sont les âmes qui sont dans la voie passive de la lumière. Leur source est très abondante. Elles sont chargées de dons, de grâces et de faveurs célestes. Elles sont l’admiration de leur siècle, et quantité de saints qui brillent dans l’Église comme des étoiles lumineuses n’ont jamais passé ce degré. (92]
Ces âmes-ci sont de deux manières. Les unes ont commencé par la voie commune et ont été attirées à la contemplation passive par la bonté de Dieu qui a eu pitié de leur travail inutile et aride, ou pour une récompense de leur première fidélité.
Les autres sont prises comme tout à coup : elles ont été saisies par le cœur et elles se sentent aimer sans avoir appris à connaître l’objet de leur amour. Car il y a cette différence entre l’Amour divin et l’amour humain, que le dernier suppose une connaissance distincte de l’objet parce que, comme il est au-dehors, il faut que les sens s’y portent, et les sens ne s’y portent que parce qu’il leur est communiqué : les yeux voient et le cœur aime. Il n’en est pas de même de l’Amour divin. Dieu ayant une puissance absolue sur le cœur de l’homme et étant son principe et sa fin, il n’est pas nécessaire qu’il lui fasse connaître ce qu’il est. Il le prend d’assaut, sans donner de bataille. Le cœur est impuissant de lui résister, non que Dieu use d’une autorité absolue et de violence, si ce n’est en quelques-uns où il l’a fait pour faire éclater son pouvoir. Il prend ces âmes de cette manière, les faisant brûler tout d’un coup, mais pour l’ordinaire il leur donne des éclairs de lumière qui les éblouit et les enlève.
Rien n’est si lumineux ni si ardent que ces âmes. Les Directeurs sont charmés lorsqu’ils les ont sous leur conduite. Et comme le travail de ces âmes-ci n’est pas essentiel, aussi sont-elles plus tôt parfaites selon le degré qu’elles ont à perfectionner. Car, comme Dieu ne veut pas d’elles une perfection si éminente que de celles qui suivent ni si profonde, aussi leurs défauts sont plus tôt épuisés.
Ce n’est pas que ces âmes dont je parle ne paraissent bien plus grandes que celles qui suivent à ceux qui n’ont pas le discernement divin. Car ces âmes-ci arrivent à une perfection éminente, Dieu soulevant leur capacité naturelle à un degré éminent. Elles ont des unions admirables, Dieu s’accommodant à leur capacité qu’il rehausse infiniment en quelques manières. Mais cependant, ces personnes ne sont jamais anéanties véritablement, et Dieu ne les tire pas de leur être propre pour l’ordinaire pour les perdre en lui.
Ces âmes sont pourtant l’admiration et l’étonnement de tous les hommes. Dieu leur donne dons sur dons, grâces sur grâces, lumières sur lumières, visions, révélations, paroles intérieures, extases, ravissements, et il semble que Dieu n’ait pas d’autre soin que d’enrichir et d’embellir ces âmes, que de leur communiquer ses secrets. Toutes les [93] douceurs sont pour elles. Ce n’est pas qu’elles ne portent de grandes croix, de fortes tentations qui sont comme les ombres qui rehaussent l’éclat de leurs vertus, car ces tentations sont repoussées avec vigueur, ces croix sont portées avec force — elles en désirent encore davantage ; elles sont toutes feu et flammes, toute langueur, tout amour. Elles ont un grand cœur, prêt à tout entreprendre. Enfin, en très peu de temps, leur perfection se commence, s’achève et se consomme.
Elles sont des prodiges et les miracles du siècle. Dieu se sert d’elles pour en faire, et il semble qu’il suffise qu’elles désirent quelque chose pour que Dieu le leur accorde. Il semble que Dieu fasse son plaisir d’accomplir tous leurs désirs et de faire toutes leurs volontés. Ces âmes sont dans une mortification très grande, elles portent de très grandes austérités, les unes plus, les autres moins, selon leur état et degré, car dans chaque état il y a bien des degrés, et les uns arrivent à une perfection bien plus grande que les autres. Dans la même voie, il y a bien des degrés différents.
[Certains directeurs peuvent nuire à ces âmes] les arrêtant aux dons de Dieu au lieu de les faire courir à Dieu par ses dons…
Ces âmes-ci sont admirables pour elles-mêmes et quelquefois, par une grâce spéciale, elles peuvent beaucoup aider aux autres, particulièrement si elles ont été pécheurs. Mais pour l’ordinaire.... elles ont de l’horreur pour le péché et souvent de l’éloignement pour le pécheur… Elles ont peine à converser avec les âmes imparfaites, préférant leur solitude à leur vie et à tous les accommodements de charité62.
Si l’on entend parler ces âmes et que l’on ne soit pas divinement éclairé, on les croira dans les mêmes voies des dernières et même plus avancées. Elles se servent des mêmes termes de morts, de perte, d’anéantissement ; et il est bien vrai qu’elles meurent, en leurs manières, s’anéantissent et se perdent, car souvent leurs puissances sont perdues à l’Oraison, elles perdent même l’usage de s’en servir et d’opérer avec, car tout ce qu’elles reçoivent, c’est passivement. Ainsi, ces âmes sont passives, mais en lumière, amour et force. Si vous examinez de près les choses et que vous conversiez avec ces personnes, vous verrez [94] qu’elles sont de volonté très bonne et même d’admirable. Elles ont des désirs des plus grands et éminents du monde, elles portent la perfection où elle peut aller, elles sont détachées, elles aiment la pauvreté, cependant elles sont et seront toujours propriétaires, et même de la vertu, mais d’une manière si délicate que les seuls yeux divins les peuvent découvrir.
La plupart des Saints dont les vies sont si admirables ont été conduits par cette voie. Ces âmes sont si chargées de marchandises que leur course est fort lente. Que faut-il donc faire à ces âmes ? Ne sortiront-elles jamais de cette voie ? Non, sans un miracle de providence, et sans une conduite de direction toute divine qui porte ces âmes non à résister à ces grâces, non à les regarder, mais à les outrepasser, en sorte qu’elles ne s’y arrêtent pas un moment, car ces vues sur elles-mêmes sont comme des écluses qui empêchent l’eau de s’écouler.
Il faut que le Directeur leur fasse connaître qu’il y a une autre voie plus sûre pour elles, qui est la FOI, que Dieu ne leur donne ces grâces qu’à cause de leur faiblesse. Il faut encore que ce Directeur les porte à passer du sensible au surnaturel, de l’aperçu et assuré aux très profondes et très assurées ténèbres de la foi, qu’il ne paraisse faire aucun cas de tout cela…
Il est aussi inutile de vouloir discerner si ces choses sont de Dieu ou non : si elles sont de Dieu, elles s’exécuteront par la Providence en nous y abandonnant, et si elles n’en sont point, nous ne serons pas trompés ne nous y arrêtant pas…
.
Ces âmes sont fermes dans leurs opinions et comme leur grâce est grande et forte, elles s’en tiennent plus assurées. Elles ont des règles et mesures dans leurs obéissances et la prudence les accompagne ; enfin elles sont fortes et vivantes en Dieu quoiqu’elles paraissent mortes. Elles sont bien mortes quant à leur opérer propre, recevant les lumières passivement, mais non quant à leur fond.
Ces âmes ont aussi souvent le silence intérieur, la paix savoureuse, certains enfoncements en Dieu qu’elles distinguent et expriment bien, mais elles n’ont pas cette pente secrète à n’être rien comme les dernières. Elles veulent bien être rien par un certain anéantissement aperçu, une humilité profonde, un certain écrasement ou abattement sous les poids immenses de la grandeur de Dieu. Tout cela est un anéantissement où l’on loge sans être anéanti. L’on a le sentiment de l’anéantissement, mais l’on n’en a {95] pas la réalité, car cela soutient encore l’âme, et cet état est plus satisfaisant qu’aucun autre, car il est plus sûr et elles le savent bien.
Ces âmes pour l’ordinaire n’entrent en Dieu qu’en mourant, si ce n’est des âmes privilégiées que Dieu destine pour être les lumières de son Église ou pour les sanctifier plus éminemment ; et Dieu dépouille ces âmes peu à peu de toutes leurs richesses. Mais comme il y en a peu d’assez courageuses pour vouloir perdre tant de biens, peu aussi — et moins que l’on ne peut dire — passent à ce degré [entendons le troisième degré, de foi nue]63, le dessein de Dieu étant peut-être qu’elles ne le passent pas, et comme il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, elles n’occupent pas celle-ci, ou bien faute de courage ou bien faute de Directeurs éclairés qui 64 croiraient les avoir perdues s’il les voyaient déchoir de ces dons et grâces éminentes. Laissons-en les causes dans le dessein de Dieu.
Quelques-unes de ces âmes n’ont pas ces dons gratuits mais seulement une force généreuse et intime, un amour secret, doux et paisible, général et vigoureux qui consomme leur perfection et leur vie65.
Pour les âmes de ce troisième degré [ou de cette troisième voie] que dirons-nous sinon que ce sont des TORRENTS qui sortent de ces hautes montagnes ? Elles sortent de Dieu même et elles n’ont pas un moment de repos qu’elles ne soient perdues en lui. Rien ne les arrête. Aussi ne sont-elles chargées de rien. Elles sont toutes nues et vont avec une rapidité qui fait frayeur aux plus assurées. Elles courent comme des folles çà et là par tous les endroits qu’elles rencontrent propres à leur faire passage. Elles n’ont ni leurs lits réguliers, comme les autres, ni leur démarche dans l’ordre. Vous les voyez courir par tout ce qui leur arrive sans s’arrêter à rien. Elles se brisent contre [96] les rochers. Elles font des chutes qui font bruit. Elles se salissent quelquefois passant par des terres qui ne sont pas solides ; elles les entraînent à cause de leur rapidité. Quelquefois elles se perdent dans des fonds et dans des abîmes où l’on est bien de l’espace sans les trouver ; enfin on les revoit un peu paraître, mais ce n’est que pour se mieux précipiter de nouveau dans un nouveau gouffre et plus profond et plus long. C’est un jeu de ces torrents de se montrer et de se perdre, de se briser contre les rochers. Leur course est si rapide que les yeux ne les discernent pas. Ce n’est qu’un certain [bruit] général, confus et ténébreux. Mais enfin, après bien des précipices et des abîmes, après avoir été bien battus des rochers, après s’être bien battus, perdus et retrouvés, ils rencontrent la mer où ils se perdent heureusement pour ne jamais se retrouver.
Et c’est où, autant que ce pauvre torrent a été pauvre, vil et inutile et dépouillé de marchandises, autant est-il enrichi admirablement. Car il n’est pas riche de ses propres richesses comme les autres rivières qui ne contiennent qu’une certaine quantité de marchandises ou certaines raretés, mais il est riche des richesses de la mer même. Il porte les plus gros navires : et ce n’est pas la mer qui les porte, mais c’est lui, puisqu’étant dans la mer, il est devenu une même chose avec la mer.
Il est à remarquer que le fleuve [ou torrent] ainsi précipité dans la mer ne perd pas sa nature, quoiqu’elle soit si changée et perdue qu’on ne la connaisse plus. Il est toujours ce qu’il était, mais son être est confondu, fondu, perdu, non quant à la réalité, mais quant à la qualité, car il a pris tellement la qualité de l’eau marine que l’on ne voit plus rien qui lui soit propre : et plus il s’abîme et s’enfonce demeurant dans la mer, plus il perd sa qualité pour prendre celle de la mer.
À quoi n’est pas propre alors ce pauvre torrent ? Sa capacité est sans bornes puisqu’elle est celle de la mer propre. Ses richesses sont immenses quoiqu’il n’en possède aucunes, puisqu’elles sont celles de la mer même. Il est alors capable d’enrichir toute la terre. O heureuse perte ! qui te pourrait décrire et le gain qu’a fait le fleuve inutile et propre à rien, méprisé et appréhendé, qui était un étourdi à qui l’on n’osait confier le moindre bateau puisque, ne pouvant se conserver soi-même et se perdant si souvent, il l’aurait abîmé avec lui ? Que dites-vous du sort de ce torrent, ô grandes rivières qui coulez avec tant de majesté, qui êtes la joie et l’admiration des peuples, quii [97] vous glorifiez dans la quantité des marchandises étalées sur votre dos ? Le sort de ce pauvre torrent que vous regardiez avec mépris ou du moins avec compassion, qui était le rebut de tout le monde, qui paraissait n’être propre à rien, qu’est-il devenu et à quoi est-il propre ? Qu’est-ce qui lui manque ? Vous êtes à présent ses servantes puisque les richesses que vous portez sont ou perdues pour vous ou pour lui en porter de nouvelles.
Mais avant que de parler du bonheur d’une âme ainsi perdue en Dieu, il faut commencer par l’origine et ensuite poursuivre par degrés.
L’âme, comme il a été dit, étant sortie de Dieu, a une pente continuelle à retourner en lui parce que, comme il est son principe, il est aussi sa dernière fin. Sa course serait infinie si elle n’était interrompue ou empêchée ou tout à fait arrêtée par le péché et l’infidélité continuelle. C’est ce qui fait que le cœur de l’homme est dans un perpétuel mouvement et ne peut trouver de repos qu’il ne s’en retourne à son principe et à son centre, qui est Dieu, semblable au feu qui, étant éloigné de sa sphère, est dans une agitation continuelle et ne trouve son repos que lorsqu’il y est retourné ; et c’est là que, par un miracle naturel, cet élément si actif est dans un repos parfait.
Ô pauvres âmes qui cherchez du repos dans cette vie ! Vous n’en trouverez jamais qu’en Dieu. Tâchez d’y entrer et c’est là où toutes vos pentes et peines, vos agitations et anxiétés seront réduites dans l’unité du repos.
Il est à remarquer que plus le feu approche de son centre, plus aussi approche-t-il du repos ; quoique sa vitesse incroyable augmente à mesure qu’il approche, son activité diminue. Il en est de même d’une âme : sitôt que le péché ne la retient plus, elle court d’une manière infatigable pour retrouver Dieu et, si par impossible elle était impeccable, rien n’arrêterait sa course qui serait si prompte qu’elle y arriverait bientôt. Mais aussi, quoique plus elle approcherait de Dieu plus sa course redoublerait, plus [pourtant] cette même course deviendrait paisible, car ce n’est pas alors repos, mais bien plutôt une course paisible, de sorte que la paix redouble sa course et la course augmente la paix. [98]
[L’âme, ayant conçu le désir de retourner à son principe et connu son présent éloignement, cherche les moyens d’opérer ce retour. Certaines âmes « faute d’être instruites qu’il faut chercher Dieu dans leur fond… se portent à la méditation » , laquelle, tout extérieure, ne peut guérir une blessure qui est au cœur. Elles perdent leur temps, mais Dieu leur fait bientôt comme tout naturellement trouver le secours dont elles ont besoin.]
Lors donc que ces âmes sont instruites par quelqu’un (que la Providence leur envoie) qu’elles n’ont garde d’avancer parce que leur blessure est au-dedans et qu’elles veulent guérir le dehors, qu’il faut au lieu de dissiper leurs forces au-dehors les retourner au-dedans d’elles-mêmes et chercher au fond de leur cœur ce qu’elles cherchent inutilement au-dehors, alors ces pauvres âmes éprouvent avec un étonnement qui les ravit et les surprend tout ensemble qu’elles ont au-dedans d’elles-mêmes un trésor qu’elles cherchaient au-dehors, si bien qu’elles se pâment de joie dans leur liberté nouvelle. Elles sont toutes étonnées que l’Oraison ne leur coûte plus rien et que plus elles contemplent et s’abîment en elles-mêmes, plus elles goûtent un certain je ne sais quoi qui les ravit et les enlève, et elles voudraient toujours aimer et s’enfoncer.
Vous remarquerez, s’il vous plaît, que ce qu’elles goûtent, quelque délicieux qu’il paraisse, si elles sont destinées à la pure foi, ne les arrête pas, mais les porte par là même à courir après un je ne sais quoi qu’elles ne connaissent pas. L’âme n’est plus qu’ardeur et amour. Elle croit déjà être en Paradis, car ce qu’elle goûte en dedans, étant infiniment plus doux que toutes les douceurs du monde, elle les quitte sans peine et quitterait toute la terre pour jouir un moment dans son fond de ce qu’elle expérimente.
Cette âme s’aperçoit que son Oraison devient quasi continuelle. Son amour augmente de jour en jour et il devient si ardent qu’elle ne le peut contenir. Ses sens se concentrent si fort et ce recueillement s’empare tellement de toute elle-même que tout lui tombe des mains. Elle voudrait toujours aimer et n’être point interrompue…
[Alors] l’âme est si pleine de ce qu’elle sent qu’elle en voudrait faire part à tout le monde. Elle voudrait apprendre à tout le monde à aimer Dieu. Ses sentiments pour lui sont si vifs, si purs et si éloignés de l’intérêt que les directeurs qui l’entendraient parler, s’ils n’étaient pas expérimentés dans la voie, la croiraient au sommet de la perfection. Elle est féconde de belles choses qu’elle couche par [99] écrit avec une facilité admirable. Ce sont des sentiments profonds, vifs et intimes. Il n’y a plus de raisonnements ici, mais rien qu’amour le plus ardent et le plus fort de l’âme, duquel elle se sent saisie et prise par une force divine qui la ravit et la consume, et la tient jour et nuit sans savoir ce qu’elle fait. Ses yeux se ferment d’eux-mêmes. Elle a peine à les ouvrir. Elle voudrait être aveugle, sourde et muette afin que rien n’empêchât sa jouissance. Elle est comme les ivrognes qui sont tellement possédés du vin qu’ils ne savent ce qu’ils font et ne sont plus maîtres d’eux-mêmes. Si elles veulent lire, le livre leur tombe des mains et une ligne leur suffit ; à peine en tout un jour peuvent-elles lire une page, quelque assiduité qu’elles y donnent. Ce n’est pas qu’elles ne comprennent ce qu’elles lisent ni ne le connaissent, mais c’est qu’un mot de Dieu ou l’approche d’un livre réveille le secret instinct qui les anime et brûle, en sorte que l’amour leur ferme les yeux et la bouche…
L’âme en cet état croit être dans le silence intérieur, parce que son opérer est si doux, si facile et si tranquille qu’elle ne l’aperçoit plus. Elle croit être arrivée au sommet de la perfection et elle ne voit rien à faire pour elle que de jouir du bien qu’elle possède…
.
Ces âmes, cependant si brûlantes et si désireuses de Dieu, commencent à se reposer en cet état et à perdre insensiblement l’activité amoureuse qu’elles avaient pour courir après Dieu, se contentant de leur jouissance qu’elles croient être Dieu même…66
Les défauts des âmes de ce degré sont une certaine estime d’elles-mêmes, plus cachée et enracinée qu’elle n’était avant que d’avoir reçu les grâces et faveurs de Dieu, un certain dédain et mépris des autres qu’elles voient si éloignés de leur voie… un orgueil secret… Elles se rendent propriétaires des dons de Dieu et en font comme s’ils étaient à elles…
Il est vrai qu’elles font quelque bien aux autres, car leurs paroles, toutes de feu et de flammes, embrasent les cœurs qui les écoutent, mais, outre qu’elles ne font pas le bien qu’elles feraient si elles étaient dans le degré où l’ordre de Dieu porte à répandre ce qu’elles ont, c’est que, leurs grâces n’étant pas encore en plénitude, elles en donnent de leur nécessaire au lieu de donner de leur surabondance, en sorte qu’elles se dessèchent elles-mêmes… [100]
Il faut remarquer… que les vertus paraissent être venues dans l’âme sans aucunes peines car l’âme dont je parle n’y pense pas, puisque toute son occupation est un Amour général, sans motif ni sans raison d’aimer. Demandez-lui ce qu’elle fait à l’Oraison et durant le jour ; elle vous dira qu’elle aime. Mais quel motif ou quelle raison avez-vous d’aimer ? Elle n’en sait ni n’en connaît rien. Tout ce qu’elle sait est qu’elle aime…
… Alors l’âme repose dans sa perfection qu’elle croit avoir acquise et, s’arrêtant aux moyens croyant que c’est la fin, elle y demeurerait toujours attachée si Dieu ne faisait rencontrer à ce torrent (qui est comme un lac paisible sur le haut de la montagne) la pente de la montagne, pour le faire précipiter et prendre une course d’autant plus rapide que la chute qu’il fera sera plus profonde.
[Dans cette perspective de l’amour, Madame Guyon anticipe à présent en traçant un tableau général de la purification. L’âme, qui souffre d’abord affreusement de l’absence, en vient à accepter les jeux d’amour de l’Amant qui se cache, car son retour est encore plus délicieux. Puis elle doit apprendre à ne plus se plaindre des absences et à ne plus chercher son propre bonheur ; elle se repose alors dans l’idée que sa peine est agréée. Enfin, elle doit perdre jusqu’à cette consolation.]
Mais souffrir sans que l’Amant le sache, lorsqu’il paraît mépriser et se détourner de ce que nous faisons pour lui plaire… ; se laisser dépouiller sans se plaindre de tout ce qu’il avait donné autrefois pour gages de son amour… ; ne pas laisser de faire toujours de même tout ce qui peut contenter l’Ami quoique absent, ne laisser de courir après ; et si, par une infidélité et surprise, on s’arrête pour quelque moment, redoubler sa course avec plus de vitesse sans craindre ni envisager les précipices quoique l’on tombe et retombe mille fois, tant que l’âme soit terrassée et si lasse qu’elle perde ses propres forces pour mourir et expirer dans les fatigues continuelles… ; enfin l’Ami devient si cruel qu’il la laisse expirer faute de secours : tout cela, dis-je, n’est point de cet état ici, mais de celui qui suit… 67. [101]
Ce torrent ayant commencé à trouver la pente de la montagne de grâce commence aussi le deuxième degré de la voie passive en foi. Cette âme, qui était si paisible sur cette montagne, s’y tenait fort en repos et ne songeait pas à en descendre. Cependant, faute de pente, elle ne pouvait descendre. Les eaux du ciel par le séjour qu’elles faisaient sur la terre commençaient à se corrompre : car il y a aussi cette différence des eaux qui ne coulent pas ou ne se déchargent pas, de celles de la mer ou de ces grands lacs qui lui ressemblent, qu’elles se corrompent, et leur repos fait leur perte. Mais lorsqu’étant sorties de leurs sources elles ont une issue faite, plus elles coulent avec rapidité plus aussi se conservent-elles.
Vous remarquerez que, comme j’ai dit de cette âme, dès que Dieu lui a donné le don de la foi pour l’Oraison passive en foi, il lui a donné en même temps un instinct de courir pour le trouver comme son centre. Mais cette âme infidèle (quoiqu’elle se croie d’une fidélité très grande) étoufferait par son repos cet instinct de courir et demeurerait sans avancer, si Dieu ne réveillait cet instinct en lui faisant trouver la pente de la montagne, où il faut qu’elle se précipite presque malgré elle. Elle sent d’abord perdre son calme qu’elle croyait posséder pour toujours. Ses eaux si calmes commencent à faire bruit. Le tumulte se met dans les ondes, elles courent et se précipitent. Mais où courent-elles ? Hélas ! c’est à leur perte, à ce qu’elles s’imaginent.
Si elles pouvaient vouloir quelque chose, elles voudraient se retenir et retourner à leur calme. Mais c’est une chose impossible. La pente a trouvé 68 où il faut se précipiter de pentes en pentes. Il n’est point encore ici question d’abîme ni de perte. L’eau paraît toujours et ne se perd point dans ce degré. Elle se brouille et se précipite : une onde suit l’autre et l’autre l’attrape et la choque par sa précipitation.
Cette eau rencontre pourtant sur la pente de cette montagne certains lieux unis où elle prend un peu de relâche. Elle se mire dans la clarté de ses eaux, et elle voit que ses chutes, ses courses, ce brisement de ses ondes contre les rochers n’ont servi qu’à la rendre plus pure. Elle se [102] trouve délivrée de ses bruits et orages, et croit être déjà arivée au lieu de repos, et elle le croit avec d’autant plus de facilité qu’elle ne peut douter que l’état par où elle vient de passer ne l’ait beaucoup purifiée. Car elle se voit plus claire. Elle ne sent plus la méchante odeur que certains endroits croupis lui faisaient sentir sur le haut de la montagne. Elle a même acquis une pente qui est un degré de connaissance, en ce qu’elle a vu, par le trouble des passions ou plutôt des ondes, qu’elles [les passions] n’étaient pas perdues, mais endormies.
Comme, lorsqu’elle était dans la pente de la montagne pour arriver à cet endroit uni, elle croyait se perdre et n’avait plus d’espérance de recouvrer sa paix, aussi, à présent qu’elle n’entend plus le bruit de ses ondes, qu’elle se voit couler si doucement et agréablement sur le sable, elle a oublié sa peine première et ne croit pas qu’elle doive revenir, car elle voit qu’elle a acquis plus de pureté et elle ne craint pas de se gâter : car ici elle n’est point arrêtée, mais coule si doucement et agréablement que rien plus. Ô pauvre torrent ! Vous croyez avoir trouvé le repos et y être arrivé ! Vous commencez à vous plaire dans vos eaux ! Mais vous voilà bien surpris lorsqu’en coulant si doucement sur le sable vous rencontrerez sans y penser une pente plus forte, plus longue et plus dangereuse que la première. Alors ce torrent recommence son bruit. Ce n’était qu’un bruit médiocre et il devient insupportable. Il fait un bruit et un tintamarre plus grand que devant. Il n’y a presque plus de lit pour ce torrent ; mais il tombe de rochers en rochers, il se précipite sans raison, il effraie tout le monde de son bruit : chacun craint de l’aborder.
Ô pauvre torrent ! que ferez-vous ? Vous entraînez tout ce que vous trouvez dans votre furie, vous ne sentez que la pente qui vous entraîne et vous vous croyez perdu. Non, non, ne craignez point, vous n’êtes pas perdu, mais le degré de votre bonheur n’est pas encore arrivé. Il faudra bien d’autres bruits et d’autres pertes avant ce temps…
.
L’âme, après avoir passé de longues années dans les lieux tranquilles dont nous avons parlé et qu’elle croyait posséder pour toujours, et avoir acquis les vertus69 dans toute leur étendue, croyant toutes ses passions mortes, lors dis-je, qu’elle croyait tenir avec le plus d’assurance un [103] bonheur qu’elle pensait posséder sans crainte de le perdre, elle est toute étonnée que, croyant ou monter plus haut ou du moins demeurer dans un état égal, elle rencontre sans y penser le penchant de la montagne. Elle est toute étonnée qu’elle commence d’avoir de la pente pour les choses qu’elle avait quittées. Elle voit tout d’un coup ce calme si grand se troubler. Les distractions viennent en foule, elles se battent et se précipitent l’une l’autre ; l’âme ne trouve que peine en ses chemins, que sécheresses, qu’aridités. Le dégoût se met dans ses prières. Ses passions, qu’elle croyait mortes et qui n’étaient qu’assoupies, se réveillent.
Elle est tout étonnée de ce changement. Elle voudrait remonter d’où elle descend ou du moins s’arrêter là, mais il n’y pas moyen. La pente de la montagne est trouvée. Il faut que cette âme tombe. Elle fait usage de son mieux de ses chutes. Elle voit que c’est un faire le faut. Elle fait ce qu’elle peut pour se retenir et se raccrocher à quelque dévotion. Elle redouble ses prières. Elle se fait effort pour regoûter sa première paix. Elle cherche la solitude pour voir si elle la trouvera. Mais son travail est inutile. Elle voit [ou croit] que c’est sa faute, elle se résigne, souffre l’abjection qui lui en revient, déteste le péché. Elle voudrait ajuster les choses, mais il n’y a pas moyen, il faut que le torrent ait son cours. Il entraîne tout ce qu’on lui oppose.
L’âme qui voit qu’elle ne trouve plus en Dieu de repos va chercher si elle en trouvera dans la créature, mais elle n’en trouve point et son infidélité ne sert qu’à l’effrayer davantage.
Enfin cette pauvre âme, ne sachant que faire, pleurant partout la perte de son Bien-aimé, elle est toute étonnée qu’il se présente de nouveau à elle. Cette vue charme d’abord cette pauvre âme qui croyait l’avoir perdu pour toujours. Elle se trouve d’autant plus fortunée qu’elle s’aperçoit qu’il apporte avec lui de nouveaux biens, une pureté nouvelle, une plus grande défiance d’elle-même. Elle n’a plus envie, comme la première fois, de s’arrêter : elle court toujours, mais c’est paisiblement, doucement et elle craint encore de troubler sa paix. Elle appréhende de perdre de nouveau le trésor qui lui est d’autant plus précieux que sa perte lui avait été plus sensible. Elle craint de lui déplaire et qu’il ne s’en aille encore une fois. Elle tâche de lui être plus fidèle et de ne pas faire sa fin des moyens.
Cependant le repos l’enlève, la ravit, la rend plus paresseuse. [104] Elle ne peut s’empêcher de le goûter et elle voudrait toujours être seule. Elle a encore l’avidité et la gourmandise spirituelle, la recherche de la solitude et de l’Oraison. C’est lui arracher l’âme que de l’en tirer. Elle est encore plus propriétaire de ce qu’elle goûte, comme étant plus délicat et l’âme ayant le goût plus fin à cause de la peine qu’elle a soufferte. Il semble qu’elle soit dans un nouveau monde.
Elle va doucement, lorsque tout d’un coup elle rencontre une nouvelle pente plus longue et plus rude que la première. L’âme devient dans une nouvelle surprise, elle veut se retenir, mais inutilement : il faut tomber, il faut courir par les rochers. L’âme est étonnée qu’elle perd le goût de la prière et de l’Oraison. Il faut qu’elle se fasse des violences extrêmes pour y rester. Elle ne trouve que morts à chaque pas. Ce qui la vivifiait autrefois est ce qui lui cause la mort.
.
[Son abandon et sa désolation redoublent]
Cependant elle ne se peut reposer dans la créature, ayant goûté du Créateur. Elle court encore plus fort, et plus les rochers et les obstacles sont forts et s’opposent à son passage, plus elle s’opiniâtre à redoubler sa course…
...[C’est que Dieu] n’amuse ainsi l’âme que pour la faire courir avec plus de vitesse. Il se cache pour se faire chercher. Il s’enfuit pour faire courir… Mais pour ces pauvres âmes ainsi délaissées, elles commencent à ne plus s’appuyer sur elles et à ne s’appuyer que sur leur Bien-aimé. Les rigueurs de ce Bien-aimé leur ont rendu ces douceurs plus souhaitables…
Elle voit bien, cette pauvre âme, qu’il faut mourir, car elle ne trouve plus de vie en rien, tout lui devient mort et croix : l’oraison, la lecture, la conversation, tout est mort ; plus de goût à rien, ni aux pratiques des vertus ni au secours des malades ni à tout le reste qui rend une vie vertueuse. Elle perd tout cela, ou plutôt elle y meurt, le faisant avec tant de peines et de dégoût que ce lui est une mort. Enfin, après avoir bien combattu, mais inutilement, après une longue suite de peines et de repos, de morts et de vies, elle commence à connaître l’abus qu’elle a fait des grâces de Dieu, et combien cet état de mort lui est plus avantageux que celui de vie. Car, comme elle voit son Bien-aimé revenir, que plus elle avance et plus elle le possède purement et que l’état qui précède la jouissance est une purgation pour elle, elle s’abandonne de bon cœur [105] à la mort, et aux allées et venues de son Bien-aimé, lui donnant toute liberté d’aller et de venir comme il lui plaît. Elle connaît alors que de le vouloir retenir, ce serait une propriété défectueuse. Elle est instruite de ce dont elle est capable. Elle perd peu à peu sa propre jouissance et est préparée par là à un état nouveau… 70
[Après ce tableau du trajet général de l’âme sur la pente de la montagne vient une longue analyse des trois dépouillements successifs qu’elle y subit et de sa « mort » ou perte finale. Ainsi, c’est de la nuit mystique que traite ce chapitre étendu et nous en réservons l’essentiel pour un numéro ultérieur d’Hermès qui étudiera ce thème. Un bref aperçu suffira ici, ainsi que pour le degré suivant.]
Son Époux aide à la dépouiller pour deux raisons : la première parce qu’elle a sali ses habits si beaux et si magnifiques, la seconde parce qu’en courant elle se voit arrêtée par cette charge ; même la crainte de perdre tant de richesses l’empêche de courir…
Notre Seigneur commence donc à dépouiller cette âme et lui ôter ses ornements, tous ses dons, grâces et faveurs qui sont comme des pierreries qui la chargent ; ensuite il lui ôte toutes ses facilités au bien qui sont comme ses habits ; après quoi il lui ôte la beauté de son visage, qui sont des divines vertus qu’elle ne peut pratiquer…
La fidélité de ce degré doit être de se laisser dépouiller dans toute l’étendue des desseins de Dieu, sans se mettre en peine de soi-même, sacrifiant à Dieu tous les intérêts du temps et de l’éternité. Il ne faut rien réserver ni retenir sous quelque prétexte que ce puisse être, car la moindre réserve cause une perte irréparable, empêchant la mort totale. Il se faut donc laisser au plein gré de Dieu battre de toutes parts des vents et de la tempête, souvent submergé et enfoncé dans les ondes mutinées71.
[Enfin] cette pauvre âme, après avoir tout perdu, doit se perdre elle-même par un entier désespoir de tout, ou plutôt doit mourir accablée de fatigues horribles… [106]
Le torrent, ainsi que nous l’avons dit, a souffert tous les bruits et les renversements imaginables. Il a été battu dans les rochers, mais il a toujours paru et l’on ne l’a point vu perdre. Il commence ici à se perdre de gouffre en gouffre. Il avait encore un marcher, quoique si précipité et si plein de désordre, mais ici il s’engouffre avec une impétuosité encore plus forte dans des trous. L’on est longtemps sans le revoir, puis on l’aperçoit un peu, plus par son bruit que par la vue, mais il ne paraît que pour se précipiter de nouveau dans un gouffre plus profond. Il tombe d’abîme en abîme, de précipice en précipice jusqu’à ce qu’enfin il tombe dans l’abîme de la mer où, perdant toute figure, il ne se trouve plus jamais, étant devenu la mer même.
L’âme, après bien des morts redoublées, expire enfin dans les bras de l’amour, mais elle n’aperçoit pas ces mêmes bras. Elle n’est pas plutôt expirée qu’elle perd tout acte de vie, pour simple et délicat qu’il soit. Plus elle approchait de sa mort plus elle s’affaiblissait et sa vie, quoique languissante et agonisante, était encore en vie, et il pouvait encore rester à l’âme quelque espérance quoique sa mort fût incurable [ou inévitable] ; mais ici il n’y en a plus. Il faut que le torrent s’abîme et que l’on ne l’aperçoive plus.
[L’âme doit à présent supporter d’être jetée en terre, foulée aux pieds, pis encore : il lui faut endurer la corruption et la pourriture.]
Enfin peu à peu l’âme s’accoutume à la corruption…, commence… à y demeurer en repos sans espérance d’en sortir jamais, sans pouvoir rien faire pour cela, et ainsi ce moribond se hait et tout lui-même s’anéantit… il n’y a plus que de la cendre. L’âme ne souffre plus de la méchante odeur et elle est naturalisée à ces choses. Elle ne voit plus rien et elle est comme une personne qui n’est plus et qui ne sera plus jamais…
L’âme réduite au néant y doit demeurer sans vouloir, lorsqu’elle est pourrie, sentir sa corruption comme autrefois, ni désirer de revivre. Il faut qu’elle demeure comme ce qui n’est plus. Et c’est pour lors qu’elle s’abîme et se [107] perd dans la mer pour ne se trouver jamais et pour devenir une même chose avec la mer.
C’est pour lors que ce mort sent peu à peu, sans sentir, que ses cendres renaissent ou prennent une nouvelle vie, mais cela se meut et se fait peu à peu. Il semble que ce soit un songe et un sommeil où on a bien rêvé. C’est comme un ver qui se forme de la cendre et qui prend vie peu à peu ; et c’est ce qui fait le dernier degré qui est le commencement de la vie divine et véritablement intérieure qui enferme des degrés sans nombre, où l’on avance toujours infiniment, de même que si ce torrent pouvait toujours avancer dans la mer. Il en prend les qualités tant plus il y séjourne72.
Lorsque ce torrent commence à se perdre dans la mer, on le distingue fort bien un temps notable. L’on aperçoit son mouvement, et enfin, peu à peu, il perd toute figure propre pour prendre celle de la mer. L’âme tout de même sortant de ce degré et commençant de se perdre conserve encore quelque chose de propre, mais après quelque temps elle perd tout ce qu’elle avait de propre… Il n’y a qu’en ce degré qu’elle est véritablement tirée hors d’elle-même.
Tout ce qui s’est passé. jusqu’à présent s’est passé dans la capacité propre de la créature, mais ici, cette créature est tirée de sa capacité propre pour recevoir une capacité immense, comme, lorsque ce torrent est dans la mer, il perd son être propre en sorte qu’il ne lui en reste plus rien, pour prendre celui de la mer. De même cette âme perd l’humain pour se perdre dans le divin, et elle y perd son être et sa subsistance, non essentiellement, mais mystiquement. Alors ce torrent possède tous les trésors de la mer et autant a-t-il été pauvre et misérable, autant est-il glorieux.
C’est dans le tombeau que l’âme commence à reprendre vie et la lumière y paraît plus sensiblement. C’est alors qu’on peut dire que ceux qui reposent dans les ténèbres ont une très grande lumière et que le jour s’est levé pour ceux qui demeurent dans la région et dans l’ombre de la [108] mort. Il y a une belle figure dans Ézéchiel de cette résurrection où les ossements reprennent vie peu à peu. Puis cet autre passage : Le temps est venu que les morts entendront la voix du Seigneur.
Ô âmes qui sortez du sépulcre ! Vous sentez en vous un germe de vie qui vient peu à peu. Vous êtes toutes étonnées qu’une force secrète s’empare de vous. Les cendres se raniment. Vous vous trouvez dans un pays nouveau. Cette pauvre âme qui ne pensait plus qu’à demeurer en paix dans le sépulcre reçoit une agréable surprise. Elle ne sait que faire et que penser. Elle croit que le Soleil a dardé pour un peu ses rayons par quelque fente et ouverture, mais que ce n’est que pour quelque moment. Elle est bien plus étonnée lorsqu’elle sent cette vigueur secrète s’emparer fortement de toute elle-même et que peu à peu elle reçoit une nouvelle vie pour ne la plus perdre (du moins autant que l’on peut être assuré en cette vie), ce qui n’arriverait pas sans la plus noire infidélité. Mais cette vie nouvelle n’est plus comme autrefois, c’est une vie en Dieu. C’est une vie parfaite. Elle ne vit plus, n’opère plus par elle-même, mais Dieu vit, agit et opère, et cela va s’augmentant peu à peu en sorte qu’elle devient parfaite de la perfection de Dieu, riche de sa richesse, elle aime de son amour.
L’âme sent bien que tout ce qu’elle avait eu autrefois, pour grand qu’il parût, avait été en sa possession. Mais à présent elle ne possède plus, mais elle est possédée ; et elle n’est plus et ne prend une nouvelle vie que pour la perdre en Dieu, ou plutôt elle ne vit que de Sa vie ; et étant le principe, cette âme ne peut manquer en rien. Quel gain n’a-t-elle point fait par toutes ses pertes ? Elle a perdu le créé pour l’incréé, le rien pour le tout : tout lui est donné, non en elle, mais en Dieu, non pour être possédé d’elle, mais de Dieu. Ses richesses sont immenses. Elles sont Dieu même. Elle sent tous les jours sa capacité s’accroître, et une largeur et étendue l’augmente tous les jours. Il semble que sa capacité devienne immense. Toutes les vertus lui sont données, mais en Dieu.
Mais il faut remarquer que, comme elle n’a été dépouillée que très peu à peu, elle n’est enrichie et revivifiée que peu à peu et par degré. Plus elle se perd en Dieu plus sa capacité devient grande, plus ce torrent se perd dans la mer plus il est élargi et devient immense, n’ayant point d’autres bornes que la mer. Il en participe toutes les qualités. L’âme devient forte, immuable, ferme, et a perdu tous les moyens, mais elle est dans sa fin. Comme une [109] personne qui marcherait sur la terre pour se perdre en mer et se servirait de ce moyen [de marcher] pour y aller : elle le perdrait pour s’y abîmer.
.
Cette vie divine devient toute naturelle à l’âme. L’âme ne se sent plus, ne se voit plus, ne se connaît plus. Elle ne voit rien de Dieu, n’en comprend rien, n’en distingue rien. Il n’y a plus d’amour, de lumières ni de connaissances. Dieu ne lui paraît plus comme autrefois quelque chose distinct d’elle, et elle ne sait plus rien, n’est plus, ne subsiste et ne vit qu’en lui. Ici l’Oraison est l’action et l’action est l’Oraison : tout est égal, tout est indifférent à cette âme, car tout lui est également Dieu.
Autrefois, il fallait pratiquer les vertus pour faire les œuvres vertueuses. Ici toute distinction d’actions est ôtée, n’ayant plus de vertus propres, mais tout étant Dieu à cette âme, l’action la plus basse est autant que la plus relevée pourvu qu’elle soit dans l’ordre de Dieu et dans le mouvement divin. Car ce qui serait de choix propre, s’il n’est dans cet ordre, ne fait pas le même effet, faisant sortir de Dieu à cause de l’infidélité : non que l’âme sorte de son degré ni de sa perte, mais seulement du mouvement divin qui rend toutes choses une et toutes choses Dieu non par nue application73 et pensée, mais par état, en sorte que l’âme est indifférente d’être d’une manière ou d’une autre, dans un lieu ou dans un autre : tout lui est égal et elle s’y laisse aller naturellement.
Cette vie est comme rendue naturelle et l’âme agit comme naturellement. Elle se laisse aller à tout ce qui l’entraîne sans se mettre en peine de rien, sans rien penser, vouloir ou choisir, mais demeure contente, sans soin ni souci d’elle, n’y pensant plus, ne distinguant plus son intérieur pour en parler. L’âme n’en a plus. Il n’est plus question de recueillement. L’âme n’est plus au-dedans d’elle, mais elle est toute en Dieu. Il ne lui est plus nécessaire de s’enfermer dans son fond. Elle ne pense plus à l’y trouver. Elle ne l’y cherche plus, comme si une personne était toute pénétrée de la mer, dedans et dehors, dessus et dessous, de tous côtés est la mer ; elle n’aurait besoin ni d’un lieu ni d’un autre, mais de se tenir comme elle serait.
Aussi cette âme ne se met pas en peine de rien faire. Elle demeure comme elle est et cela suffit. Mais que fait-elle ? Rien, rien, et toujours rien. Elle fait tout ce qu’on [110] lui fait faire. Elle souffre tout ce qu’on lui fait souffrir. Sa paix est toute inaltérable, mais toute naturelle, elle est comme passée en nature. Mais quelle différence de cette âme avec une personne toute dans l’humain ! La différence est que c’est Dieu qui la fait agir sans qu’elle le sache, et [auparavant] c’était la nature qui agissait. Elle ne fait ni bien ni mal, mais elle vit contente, paisible, faisant ce qu’on lui fait faire d’une manière inébranlable.
L’obéissance est son guide, car dans le temps de sa perte elle a perdu toute volonté. Ici l’âme n’en a plus de propre et si vous lui demandiez ce qu’elle veut, elle ne le pourrait dire. Elle ne peut choisir. Tous désirs sont ôtés parce qu’étant dans le tout et dans le centre, le cœur perd toute pente, tendance et activité. Ce Torrent n’a plus de pente ni de mouvement, il est dans le repos et dans la fin.
Mais de quel contentement est-elle contente ? D’un contentement immense, général, sans savoir ni comprendre ce qui la contente,74 car ici tous sentiments, goûts et vues, notices particulières, quelque délicats qu’ils soient, sont ôtés. Rien ne touche l’âme, ni amour, ni connaissance, ni intelligence, ni ce certain je ne sais quoi qui l’occupait sans l’occuper et il ne lui reste rien, mais cette insensibilité est bien différente de celle de la mort, sépulture, pourriture. Alors c’était une privation de vie, pour les choses c’était un dégoût, une séparation, une impuissance de mort, mais ici c’est une élévation au-dessus des choses qui ne prive pas des choses, mais les rend inutiles… Dieu en cet état est l’âme de notre âme, et d’une telle manière qu’il se rend comme le principe naturel de vie sans que l’âme le sente ou l’aperçoive à cause de son unité et identité, s’il est permis de se servir de ces mots. L’âme sent bien qu’elle vit, agit et marche et fait toutes les fonctions de la vie, mais sans sentir son âme.
Lorsque nous avons quelque goût de Dieu, si délicat qu’il soit, que l’on connaît ses enfoncements, certaines langueurs, peines, amours, désirs, jouissance, ce n’est point ce degré ici, mais bien quelque autre, car ici Dieu ne peut être goûté, senti, vu, étant plus nous-mêmes que nous-mêmes, non distinct de nous…
L’âme ici est en Dieu comme dans l’air qui lui est propre et naturel pour maintenir sa nouvelle vie et elle ne le sent pas plus que nous sentons l’air que nous respirons. [111] Cependant, elle est pleine et rien ne lui manque, c’est pourquoi tous désirs lui sont ôtés. Sa paix est grande, non comme dans les autres états. Dans l’état passé c’était une paix inanimée, une certaine sépulture dont il sortait quelquefois des exhalaisons qui la troublaient. Dans l’état de poudre elle était en paix, mais c’était une paix inféconde, semblable à un mort qui serait en paix dans les orages et les flots les plus mutinés de la mer — il ne les sentirait pas ni n’en aurait pas de peine, son état de mort le rendant insensible. Mais ici c’est que l’âme est mise au-dessus, comme si d’une montagne elle voyait gronder les flots sans craindre leurs attaques ou, si vous voulez, comme si l’on était dans le fond de la mer, lequel est toujours tranquille pendant que la superficie est en agitation. Les sens peuvent souffrir leurs peines, mais le fond est de même égalité à cause que celui qui le possède est immuable…
Mais que doit-elle faire pour être fidèle à Dieu ? Rien ; et moins que rien. Il faut se laisser posséder, agir, mouvoir sans résistance, demeurer dans son état naturel et de consistance, attendant tous les moments et les recevant de la Providence sans rien ajouter ni diminuer, se laissant conduire à tout sans vue ni raison ni sans y penser… mais laissant à Dieu le soin de faire naître les occasions et de les exécuter — non que l’on y pense par des actes d’abandon ou de délaissement, mais que l’on y demeure par état…
.
L’âme ne peut parler de son état, ne le voyant pas bien, ni des actions de vie qu’elle exerce ; mais pour leur principe et leur fin, elle n’en peut ni n’en veut rien dire, n’en ayant connaissance qu’autant qu’il plaît à Dieu de lui en donner dans le moment pour le dire et pour l’écrire.
L’âme ne voit-elle pas ses défauts ? ou n’en commet et n’en connaît-elle point ? Elle en connaît et commet, et elle les connaît mieux que jamais. Ceux qu’elle connaît sont bien plus subtils qu’autrefois. Elle les connaît mieux parce qu’elle a les yeux ouverts, mais elle n’en a pas de peine et ne peut rien faire pour s’en défaire. Elle sent bien, lorsqu’elle a fait une infidélité ou commis une faute, un certain nuage ou bien une poussière s’élever, mais elle retombe d’elle-même, sans que l’âme fasse rien ni pour la faire tomber ni pour s’en nettoyer, outre que tous les efforts de l’âme seraient pour lors inutiles et qu’ils ne serviraient qu’à augmenter l’impureté. L’âme sentirait fort bien que la seconde souillure serait pire que la première. [112] Il ne s’agit point ici de retour, quelque simple qu’il puisse être, car du retour suppose éloignement et si l’on est en Dieu, il ne faut que demeurer en lui…
L’extérieur de ces personnes est tout commun et l’on n’y voit rien d’extraordinaire. Ici tout se voit, sans voir, en Dieu tel qu’il est. C’est pourquoi cet état est moins sujet à la tromperie. Il n’y a point de visions, révélations, extases, ravissements, changements. Tout cela n’est point dans cette voie, qui est simple, pure et nue, n’y voyant rien qu’en Dieu, comme Dieu se voit et par ses yeux75.
Après la résurrection, tout est redonné avec une facilité admirable d’en faire usage sans se salir, sans s’y attacher, sans se l’approprier comme autrefois, mais faisant tout en Dieu et le divinisant, usant des choses comme n’en usant point, et c’est où est la véritable liberté et la vie véritable : Si vous avez été semblables à Jésus-Christ en sa mort, vous le serez en sa résurrection…
Dans cet état l’âme ne peut point pratiquer la vertu comme vertu, elle ne veut pas même la voir ni la distinguer, mais les vertus lui sont devenues comme habituelles et naturelles en sorte qu’elle les pratique toutes sans les voir ni connaître et sans y pouvoir faire aucune application et distinction. Lorsqu’elle voit quelques personnes dire des paroles d’humilité et s’humilier beaucoup, elle est toute surprise et étonnée de voir qu’elle ne pratique rien de semblable : elle revient comme d’une léthargie ; et si elle voulait s’humilier elle en serait reprise comme d’une infidélité et même elle ne le pourrait faire parce que l’état d’anéantissement par lequel elle a passé l’a mise au-dessous77 de toute humilité — car pour s’humilier il faut être quelque chose et le néant ne peut s’abaisser au-dessous de ce qu’il est ; l’état présent qu’elle porte l’a mise au-dessus de toute humilité et de toutes vertus par la [113] transformation en Dieu. Ainsi, son impuissance vient de son anéantissement et de son élévation…
.
[Ces âmes] ont une joie immense, mais insensible qui vient de ce qu’elles ne craignent, ni ne désirent, ni ne veulent rien. Ainsi rien ne peut ni troubler leur repos ni diminuer leur joie…
L’âme est bien, en effet, dans un ravissement et extase qui ne lui causent aucune peine parce que Dieu a élargi sa capacité presque à l’infini… Ici l’extase se fait pour toujours et non pour des heures, sans violence ni altération, Dieu ayant purifié et fortifié le sujet au point qu’il est nécessaire pour porter cette admirable extase78.
L’âme après être parvenue à l’état divin est, comme j’ai dit, un rocher inébranlable à toutes sortes d’épreuves et de coups, si ce n’est lorsque Dieu veut que cette âme fasse quelque chose contre l’ordinaire et l’usage commun. Alors, si elle ne se rend pas au premier mouvement, il lui fait souffrir une peine de contrainte à laquelle elle ne peut résister, et elle est contrainte, par une violence qui ne se peut expliquer, de faire ce qu’il veut…
Si vous voulez attribuer quelque chose ou état à cette âme ainsi transformée et devenue Dieu, elle se défendra d’abord, ne pouvant rien trouver en elle qui se puisse nommer et affirmer ou entendre, mais l’âme est dans une négation parfaite. C’est ce qui fait la différence des termes, et les expressions que l’on a peine de faire entendre à moins que ces personnes ne soient ainsi ; et cela vient de ce que cette âme par son anéantissement ayant perdu tout ce qu’elle avait de propre, elle ne se peut rien attribuer non plus qu’à Dieu parce qu’elle ne connaît plus que Dieu seul dont on ne peut rien dire. Aussi, tout est Dieu à cette âme ; car ici il n’est plus question de voir tout en Dieu, car voir ces choses en Dieu c’est les distinguer en lui… [Ici] toutes créatures terrestres et célestes, pures intelligences, tout disparaît et s’évanouit, et il ne reste que Dieu même comme il était avant la création. Cette âme ne voit que Dieu partout et tout lui est Dieu ; non par pensée, vue, lumière, mais par identité d’état qui la rend Dieu sans qu’elle puisse plus se voir elle-même par unité d’identité, elle ne peut aussi rien voir partout…
Et cet abandon à l’aveugle est une chose de l’état de l’âme dont je parle parce qu’étant devenue une même [114] chose avec Dieu, elle ne peut voir79 que Dieu. Car, ayant perdu toutes dissemblances, propriétés, distinction, il n’est plus question de s’abandonner parce que pour s’abandonner il faut être quelque chose et pouvoir disposer de soi.
L’âme dont je parle est par cet état perdue en Dieu, mêlée avec lui comme ce fleuve dont j’ai parlé se mêle dans le mer en sorte qu’il ne se trouve plus. Il a le flux et le reflux de la mer, non plus par choix et volonté et liberté, mais par nécessité d’état, parce que la mer immense a absorbé ses petites eaux bornées et rétrécies, et il participe à tout ce que fait la mer, mais sans distinction de la même mer. C’est la mer qui l’entraîne et s’il n’est pas entraîné80 puisqu’il a perdu tout son propre ; et n’ayant point d’autres mouvements que la mer, il agit aussi infailliblement que la mer même, non que par sa nature il ait ses81 qualités, mais c’est qu’en perdant toutes ses qualités propres il n’en a plus d’autres que la mer, sans pouvoir être jamais autre que mer…
Mais, dira-t-on, vous ôtez ainsi à l’homme la liberté. Non, car il n’a plus de liberté que par un excès de liberté : parce qu’il a perdu librement toute liberté créée, il participe à la liberté incréée qui n’est plus raccourcie, limitée, bornée pour quoi que ce soit, et cette âme est si libre que toute la terre lui paraît moins qu’un point et il lui semble qu’elle renferme toute la terre sans en être renfermée. Plus cette âme est libre pour tout faire et pour ne rien faire, il n’y a point d’état et de condition où elle ne s’accommode : elle peut tout faire ce que les autres font et elle ne peut rien faire de tout ce que les autres font82. O état, qui te pourra décrire !…
.µ
Cette âme ne se soucie pas de la solitude ni du grand monde : tout lui est égal. Elle ne pense plus d’être délivrée de ce corps pour être unie sans milieu. Ici, elle est non seulement unie, mais transformée, changée, libre de son amour, ce qui fait qu’elle ne pense plus à aimer, car elle aime Dieu d’un Amour-Dieu et par état83.
… Cependant ces âmes paraissent des plus communes parce qu’elles n’ont rien à l’extérieur qui les différencie [115] qu’une liberté infinie qui scandalise souvent les âmes rétrécies et resserrées en elles-mêmes. Comme elles84 ne voient rien de meilleur que ce qu’elles ont, c’est ce qui fait que tout ce qui n’est pas tout ce qu’elles possèdent leur paraît mauvais. Mais la liberté qu’elles condamnent dans les âmes si simples et si innocentes est une sainteté incomparablement plus éminente que tout ce qu’elles croient saint… Ces âmes devenues Dieu agissent en Dieu par un principe d’une force infinie et ainsi les plus petites actions de ces âmes sont plus agréables à Dieu que tant d’actions héroïques des autres qui paraissent si grandes devant les hommes. C’est pourquoi les âmes de ce degré ne se mettent point en peine ni ne cherchent point à rien faire de grand, se contentant d’être comme elles sont à chaque moment…
Oh ! si l’on savait la gloire que ces âmes qui sont souvent le rebut du monde rendent à Dieu, l’on serait étonné et ravi, car ce sont elles proprement qui rendent à Dieu une gloire de Dieu sans penser de lui en rendre, parce que, Dieu agissant en elles en Dieu, il tire de lui en elles une gloire digne de lui.
… Dieu est dans cette âme ou plutôt cette âme n’est plus, elle n’agit plus, mais Dieu agit et elle est l’instrument. Dieu renferme en lui tous les trésors, il les fait manifester par cette âme aux autres. Alors, cette âme qui les tire de son fond connaît qu’ils y étaient, quoique la perte ne lui eût jamais permis d’y réfléchir. Et je m’assure que toute âme de ce degré m’entendra et saura très bien la différence de ces états. Le premier voit les choses et en jouit comme nous jouissons du Soleil, mais le second est devenu lui-même le Soleil qui ne jouit ni ne pense à sa lumière.
Cet état est fort permanent et il n’y a nulle vicissitude quant au fond qu’un avancement plus grand en Dieu. Et, comme Dieu est infini, il peut faire devenir Dieu une âme toujours plus infiniment, et cela en élargissant sa capacité à l’infini…
C’est pourquoi plus ces âmes vivent dans cet état divin plus elles sont agrandies, et leur capacité devient toujours plus immense sans qu’il y ait rien à désirer ni à faire pour ces âmes, car elles ont toujours Dieu en plénitude, Dieu ne laissant jamais un moment de demeurer en elles : à mesure qu’il croît et élargit, à mesure il remplit de lui-116 même — comme l’air : une petite chambre est pleine d’air, mais une grande a plus d’air. Augmentez toujours cette chambre, à mesure, infailliblement quoiqu’imperceptiblement, l’air y entre toujours, de même l’âme se remplit sans changer d’état ni de disposition et sans rien sentir de nouveau, mais jamais la capacité de l’âme ne peut être accrue que par l’anéantissement parce que jusqu’alors elle a une opposition à être étendue…85
.
L’âme donc n’a rien à faire ici qu’à demeurer comme elle est et suivre sans résistance tous les mouvements de son moteur. Tous les premiers mouvements de cette âme sont de Dieu et c’est sa conduite infaillible. Il n’en est pas de même aux états inférieurs si ce n’est lorsque l’âme a commencé à goûter du centre, mais il n’est pas si infaillible et qui garderait cette règle sans être dans l’état bien avancé se tromperait.
C’est donc la conduite de cette âme de suivre aveuglément et sans conduite les mouvements qui sont de Dieu, sans réflexion. Ici toute réflexion est bannie et l’âme aurait peine, même quand elle voudrait, à en faire. Mais, comme en s’efforçant peut-être en pourrait-elle venir à bout, il faut les éviter plus que toute autre chose parce que la seule réflexion a le pouvoir de faire entrer l’homme en lui et le tirer de Dieu. Or je dis que si l’homme ne sort point de Dieu, il ne péchera jamais…
L’âme est établie par état dans son bien souverain, sans changement. Elle est dans la béatitude foncière où rien ne peut traverser ce bonheur parfait lorsqu’il est par état permanent. Car plusieurs l’ont passagèrement, et on l’a passagèrement avant que de l’avoir par état permanent : Dieu donne premièrement les lumières de l’état, ensuite il donne le goût de l’état, enfin il le donne par une notice confuse et non distincte ; puis il donne l’état d’une manière permanente et y établit l’âme pour toujours.
L’on me dira que l’âme étant établie dans l’état, il n’y a rien de plus pour elle. C’est tout le contraire : il y a toujours infiniment à faire du côté de Dieu et non de la créature. Dieu ne divinise pas tout à coup, mais peu à peu, puis, comme j’ai dit, il augmente la capacité de l’âme qu’il peut toujours déifier de plus en plus, Dieu étant un abîme inépuisable86. [117]
[Donnons encore, non comme conclusion, mais plutôt comme un écho, ces trois images, extraites de l’un des « Discours spirituels » de Madame Guyon :]
Il est dit dans l’Écriture (Prov. 30, v. 19) trois choses qui sont excellentes au sujet de l’Intérieur. Il ne peut être mieux comparé, qu’à la voie du serpent dans la pierre ; à celle d’un vaisseau sur la mer, mais comme dit Job (Job 9., v. 26), un vaisseau chargé de pommes ; et à la voie de l’aigle en l’air. Il ne reste aucun vestige de ces trois sortes de voies.
1) La première est des personnes déjà avancées, mais qui sont encore loin de la perfection. Quoique le serpent laisse peu de vestiges du lieu où il a été sous la pierre, on ne laisse pas d’apercevoir un sentier limoneux et luisant. Ce sont les premières âmes, en qui il reste quelques traces de certaines lumières, goûts, sentiments : ces traces sont même presque imperceptibles. Ce qui se discerne le mieux, c’est la vieille peau du serpent qui reste sous la pierre. Cette peau marque que cette personne a travaillé à mortifier ses sens et ses passions d’une telle manière qu’elle en est dépouillée, et revêtue de nouveaux sentiments et des vertus opposées à ses passions dominantes.
2) Le vaisseau laisse bien moins de traces sur les ondes que le serpent sous la pierre ; néanmoins on voit quelque temps comme un sillon sur les flots, qui est la trace qui ne dure guère. Si pourtant ce vaisseau était chargé de marchandises de garde, ces marchandises seraient une marque et une assurance des lieux où il a voyagé ; mais n’étant chargé que de pommes, que l’eau de la mer corrompt, on est obligé à mesure qu’elles pourrissent de les jeter dans la mer, de sorte que le vaisseau arrivant vide, il ne reste ni trace de son passage, ni vestige de ses marchandises. C’est la figure du parfait dénuement de l’âme ; il ne reste point de trace de son marcher qui puisse servir d’appui et d’assurance qu’il ait tenu la route de ces vastes mers et qu’il ait passé ce chemin : il ne paraît rien de sa charge, qui s’est corrompue peu à peu, et c’est cette corruption qui a obligé le divin pilote de jeter la marchandise dans la mer ; enfin cette corruption devient si grande, qu’on est obligé de décharger le vaisseau de tout ce qu’il portait. Il est vrai que la misère que l’âme éprouve est quelque chose de triste pour elle, mais elle éprouve en même temps une [118] chose à laquelle elle ne faisait pas d’abord attention, c’est que plus elle devient misérable, plus elle devient légère ; elle se trouve peu à peu dégagée du poids d’elle-même ; enfin plus sa misère augmente, plus elle devient vide. L’âme ne se trouve plus chargée ni embarrassée ; au contraire elle éprouve un certain vide qui lui a donné de l’étendue et de la largeur. Le vaisseau vide se trouve en état d’être rempli des plus exquises marchandises. Notre âme vide est propre à tout ce que Dieu veut en faire. Heureux vaisseau ! Tu te croyais méprisable et tout honteux de ta charge, tu rougissais dans le secret : c’est néanmoins cette charge pleine de pourriture qui t’a vidé de tout ce qui t’appartenait, et de ce qu’il y avait de plus fort et de plus intime dans l’amour de toi-même. Le fond de cale a été vidé, c’est-à-dire que tu es délivré de la propriété qui te corrompait profondément ; ainsi tu es entièrement vide, net et balayé de ta pourriture. On a cherché dans les endroits les plus reculés, s’il ne restait point quelque pourriture, pour la jeter dans la mer. Te voilà parvenu à une nudité entière !
3) La troisième est la trace de l’aigle dans l’air. Quel est l’œil assez perçant pour en découvrir les vestiges ? Qui peut discerner les voies d’une âme qui se perd dans les airs de la divinité ? Nul yeux, si ce n’est ceux de l’aigle même. Mais que voit cette aigle ? Ce qui est devant elle, et nullement ce qu’elle a laissé. Il n’y a point de sentier, point de trace dans son chemin ; cependant elle ne s’égare jamais. Où loge-t-elle, cette aigle fortunée ? Où se repose-t-elle après son vol ? Sur les rochers : elle fait son nid sur les roches rompues (Job., 39, y. 28), comme dit un autre endroit de l’Écriture, dans les trous de la pierre. Quelle est cette pierre vive et vivante, sinon Jésus-Christ ? Elle se repose en lui. Ceux qui considèrent cette aigle merveilleuse et qui ne voient que des roches rompues, une espèce de débris de cette pierre vive, croient qu’il n’y a rien de bon dans l’aigle, qu’elle n’habite point la pierre vive, puisqu’elle fait son séjour dans les roches rompues. Cependant c’est en Jésus-Christ qu’elle est à couvert, c’est dans son cœur, c’est dans ses plaies, qui sont comme les trous de la pierre, c’est lui-même qui la porte et la cache avec lui dans le sein de son Père87.
À travers les textes multiples de l’anachorète du Val Vert nous parviennent les échos de la plus obscure et la plus lumineuse des aventures : le retour de l’âme à Dieu.
Quel que soit le titre choisi, c’est lui qui le dit et redit dans l’éblouissement de celui qui a perdu la vue à poursuivre la splendeur divine jusqu’à la source d’où elle efflue : « les esprits sublimes ont remonté le courant de cette veine vive jusqu’au fond vivant où la source a son origine. C’est là qu’ils sont liquéfiés et emportés de clarté en clarté, de félicité en félicité » (p. 158-159).
De cette remontée à la cime de laquelle il se tient, il connaît et décrit les degrés que sont la découverte de la ressemblance, de l’union et de l’unité sans distinction ; ce sont les différentes rencontres de l’âme et de Dieu, rencontres dont le mouvement va s’accélérant et s’intensifiant, mais qui reste en quelque sorte toujours identique à lui-même quel que soit le niveau où il s’opère.
« Et à mesure que les dons que le Christ accorde sont plus intimes, que la motion qu’il exerce est plus subtile, notre esprit se livre à des exercices plus profonds et plus savoureux (…). Et c’est là une chose qui se renouvelle [120] toujours. Car Dieu accorde des dons toujours nouveaux et notre esprit revient toujours à l’unité intérieure selon la manière dont Dieu le sollicite et le comble de ses dons ; et dans cette rencontre il reçoit des dons nouveaux qui sont toujours plus élevés. C’est ainsi qu’on grandit sans cesse en vue d’atteindre à une vie plus haute. » (R. 310.)
Que Ruysbroeck parle des douceurs et de l’enlacement de l’âme et du corps, de l’esprit et de Dieu, des tourments de l’union impossible, des violences de la tempête d’amour ou de la béatitude de l’anéantissement, il dit la violence sans cesse croissante d’un feu unique dévorant qui va jusqu’à l’extinction et de l’âme et de Dieu, couronnement de la contemplation « suressentielle ».
Les extraits que nous avons choisis pour illustrer le thème des trois voies et de la non-voie sont tirés des Noces spirituelles. Cet ouvrage date de 1350, il est considéré comme le chef-d’œuvre de Ruysbroeck et lui-même l’a reconnu de son vivant « comme vrai et bon ».
Dans ce texte, Ruysbroeck commente un verset de l’Évangile selon saint Matthieu : « Voyez, l’Époux vient, sortez à sa rencontre. »
Chaque élément de la citation correspond à l’un des mouvements de l’âme vers Dieu, de Dieu vers l’âme :
« Voyez » exprime le dévoilement, la prise de conscience, la gratuité de la grâce.
« L’Époux vient » annonce ce que notre auteur nomme « l’avènement du Christ ».
« Sortez » décrit la réponse de l’âme ou son exercice.
« À sa rencontre » évoque le couronnement, l’union dont le degré dépend de l’intensité de la vision, c’est-à-dire de la grâce.
En usant de ce procédé, Ruysbroeck expose comme au ralenti le déroulement des phases de la vie intérieure profonde, qu’il décrit, selon une distinction traditionnelle, à trois niveaux : vie active, vie « dans le désir de Dieu », vie « dans la contemplation suressentielle ». Mais plutôt qu’à ces trois voies ou plans de la vie spirituelle, c’est au triple avènement intérieur de la vie dans le désir de Dieu et à la contemplation suressentielle « en la lumière divine et selon le mode de Dieu » que correspond, avec une précision parfois très émouvante, ce que le Shivaïsme du Cachemire en particulier désigne comme les trois voies et la non-voie.
L’avènement du Christ est encore appelé « venue de l’Époux », car « cet Époux, c'est le Christ et la nature humaine, c'est l'épouse que Dieu a faite à l'image et à la ressemblance de lui-mcme. » (R. 181.)
Les trois avènements intérieurs concernent les modalités possibles de l’intimité de l’âme et de Dieu à partir de leur rencontre effective, c’est-à-dire à partir du moment où opère ce que Ruysbroeck nomme la lumière surnaturelle par opposition à la grâce qui n’est que prévenante. C’est ce moment précis et particulier que toute tradition vraiment mystique reconnaît être celui de l’accès à l’intériorité, moment avant lequel il ne peut être question de vie mystique véritable.
A partir de ce moment, l’avènement est intérieur, et spirituelle la sortie vers l’Époux, tandis que la rencontre a lieu dans l’union de simple jouissance ; l’homme cesse d’être extérieur, accède à l’entrée « qui le conduira des œuvres à leur pourquoi, des signes à la vérité ».
« C’est ainsi que survient une lumière plus haute de la grâce divine, pareille à un rayon de soleil versé dans l’âme, sans mérite de sa part et sans désir adéquat… Et c’est là une intervention mystérieuse de Dieu dans l’âme, au-dessus du temps, et qui meut l’âme avec toutes ses puissances. Ici prend fin la grâce prévenante et commence l’autre, c’est-à-dire la lumière surnaturelle. » (R. 189.)
Ruysbroeck situe ce moment privilégié à la fin de la vie active, à l ’orée de « la vie dans le désir de Dieu » — couronnement de l’une, début de l’autre — d’où nous tirons les passages sur le triple avènement et ses aboutissements.
L’Époux vient de différentes façons, en effet, selon l’œil qui le voit venir, selon qu’il s’avance vers les « fidèles serviteurs » appliqués aux exercices de la vie active, vers les « amis secrets » adonnés aux exercices intérieurs vers les « fils cachés » qui s’absorbent dans sa contemplation. Le Christ ne saurait s’avancer vers ceux qui restent aveugles, aussi dit-il « Voyez », car « c’est par lui que nous devenons voyants… et cette parole du Christ en nous n’est rien d’autre qu’une infusion de sa lumière et de sa grâce ».
Ainsi l’homme intérieur, animé d’un zèle intérieur, touché et mû promptement par l’irradiation de la grâce peut voir s’avancer l’Époux de trois façons, et à ces trois rencontres il répond de trois manières par des exercices intérieurs qui le conduiront aux différents degrés de l’union. Jacqueline Chambron.
L’avènement particulier du Christ se présente de trois manières chez les hommes qui s’exercent dévotement à la vie intérieure. Et chacun de ces trois avènements élève l’homme à une existence plus haute et à des exercices plus profonds. Le premier avènement du Christ dans les exercices intérieurs, opère du dedans une motion et impulsion sensibles, il attire l’homme avec toutes ses puissances en haut, vers le ciel, et le presse de se tenir en union avec Dieu. Cette impulsion et attraction on la ressent dans le cœur et dans l’unité de toutes les puissances chamelles, en particulier dans la concupiscible. Car cet avènement émeut chez l’homme la partie inférieure et y agit ; il faut, en effet, qu’elle soit purifiée, ornée, enflammée et entraînée vers le dedans. Cette impulsion intérieure de Dieu, prend en même temps qu’elle donne, elle rend à la fois riche et pauvre, bienheureux et malheureux, elle fait espérer et désespérer, elle réchauffe et glace. Les dons et actions qui s’exercent ici en sens contraire, sont ineffables en toutes langues. (…)
La seconde manière selon laquelle se présente l’avènement intérieur du Christ, est d’un ordre plus relevé. Il s’y montre plus hautement semblable à ce qu’il est en lui-même, Il y accorde des dons plus hauts et des lumières plus vives. Elle s’effectue dans le reflux au sein des puissances supérieures de l’âme, parmi l’abondance des dons divins qui affermissent, illuminent et enrichissent l’esprit de multiples manières. Pour autant que Dieu se répand, il exige de l’âme qu’elle s’écoule et puis reflue avec toutes ses richesses vers le même fond d’où provient l’épanchement. Et dans cet épanchement Dieu accorde, Il montre des dons
2
merveilleux. Mais II exige en retour de l’âme qu’elle lui rende tous ses dons, démultipliés, au-delà de tout ce que la créature peut faire. Cet exercice, ce degré d’existence est plus élevé, il atteint à une plus haute ressemblance avec Dieu que le premier, et c’est par là que les trois puissances supérieures de l’âme reçoivent leur ornement.
La troisième manière, selon laquelle se présente l’avènement intérieur de Notre-Seigneur, consiste en une motion ou une touche intérieure ressentie dans l’unité de l’esprit, au sein de laquelle les puissances supérieures de l’âme ont leur existence, d’où elles émanent, où elles font retour, y demeurant toujours unies par le lien de l’amour, et du fait de l’unité de l’esprit dans l’ordre naturel. Cet avènement porte au degré d’existence le plus haut et le plus profond qui soit dans la vie intérieure. C’est par là que, de maintes façons, l’unité de l’esprit reçoit son ornement.
Or le Christ exige dans chaque avènement une sortie particulière de nous-mêmes, notre vie se conformant à la manière de son avènement. C’est pourquoi il prononce spirituellement cette parole dans notre cœur, lors de chaique avènement : « Sortez par vos exercices et toute votre vie, selon la manière dont la grâce et mes dons vous y incitent. » Car d’après la manière dont l’Esprit de Dieu nous touche, nous meut, nous attire, exerce en nous son influence, sa touche même, il nous faut sortir et marcher dans la pratique des exercices intérieurs, si nous voulons parvenir à la perfection. Mais si nous résistons à l’esprit de Dieu par les dissonances de notre vie, nous perdons l’impulsion intérieure et fatalement nous restons à court de vertu.
Ce sont là trois avènements du Christ dans les exercices intérieurs.
Le premier avènement du Christ dans les exercices que le désir inspire, est une motion intérieure et sensible du Saint Esprit qui nous pousse et incite à toutes les vertus. (…)
Le Christ illumine et enflamme les plus basses parties dans l’homme, à savoir son cœur de chair et ses puissances sensibles ; et ceci se produit en moins d’un instant, car l’œuvre de Dieu est vite faite. (…)
De la même manière que le feu, par sa nature et sa vertu, enflamme toute matière prête à s’enflammer, le Christ enflamme les cœurs préparés, libres et élevés, par l’ardeur intime de son avènement intérieur.
Et il dit dans cet avènement : « Sortez par des œuvres conformes au mode de cet avènement. »
De cette ardeur provient l’unité du cœur. Nous ne pouvons, en effet, parvenir à la véritable unité que si l’Esprit de Dieu allume ses feux dans notre cœur. Car le feu rend un, et semblable à lui-même ; et il en va ainsi pour tout ce qu’il peut envelopper et transformer. L’unité consiste à se sentir recueilli intérieurement, avec toutes ses puissances, dans l’unité du cœur. L’unité donne la paix intérieure et le repos du cœur. L’unité du cœur est un lien qui attire ensemble et qui enlace le corps et l’âme, le cœur, les sens et toutes les puissances dans l’unité de l’amour.
De cette unité vient la ferveur intime. Car nul ne peut être fervent s’il n’est en lui-même recueilli et uni. La ferveur intime consiste à se tenir au dedans de soi-même tourné vers son propre cœur, de manière à comprendre et sentir l’opération de Dieu dans l’âme et son allocution intérieure.
… Quand ce clair Soleil qu’est le Christ s’élève dans notre cœur au-dessus de toutes choses et que les exigences de la nature charnelle qui sont contraires à l’esprit, sont bien dominées et réglées avec discrétion, tandis que les vertus sont alors acquises de la manière exposée dans le mode précédent, et que par l’ardeur de la charité, tout le goût et tout le repos que l’on peut trouver dans la vertu sont rapportés à Dieu en offrande d’actions de grâces et de louanges, il s’ensuit parfois une douce pluie de nouvelles consolations intérieures, une rosée céleste de suavité divine. (…) De cette même suavité vient la délectation du cœur et de toutes les
puissances charnelles, de sorte que l’homme se croit enserré du dedans par l’étreinte divine de l’amour. Cette délectation et cette consolation comptent davantage, pour l’âme comme pour le corps, elles leur sont plus savoureuses que tout ce que le monde entier pourrait donner de plaisir, même en supposant qu’on pût être seul à en jouir. Parmi cette délectation Dieu se laisse descendre dans le cœur par le moyen de ses dons, avec tant de consolations savoureuse et de joies, que le cœur déborde intérieurement. À cette occasion, on constate combien sont misérables ceux qui se tiennent en dehors de l’amour. Ce bonheur fait que le cœur se répand sans qu’on puisse le retenir, vu l’abondance des joies intérieures. (…)
Or cet avènement, selon le mode ici décrit, est accordé à des hommes ainsi disposés dès leur début, quand ils se détournent du monde, c’est-à-dire quand ils opèrent une conversion totale et renoncent à toutes les consolations du monde afin d’être tout à Dieu et de ne vivre que pour Lui, bien qu’ils soient encore fragiles et qu’ils aient besoin de lait et de douceurs, non de fortes nourritures, de grandes tentations et du sentiment d’être délaissés de Dieu. (…)
.
De la comparaison avec l’abeille. Je vais vous exposer une modeste comparaison afin que vous ne vous égariez pas, mais que vous sachiez vous gouverner dans cet état. Or il vous faut observer l’abeille et imiter sa sagesse. Elle vit en union avec l’assemblée de ses pareilles, et elle sort, non pas sous la tempête, mais quand le temps est calme et serein et que le soleil donne, se posant sur toutes les fleurs dans lesquelles se trouve quelque suave nectar. Elle ne prend son repos sur aucune fleur ni sur rien qui la délecte par sa beauté ou suavité ; mais elle butine le miel et la cire, c’est-à-dire la douceur et la matière dont s’alimente la claire flamme ; ensuite elle revient à l’unité de l’essaim rassemblé, afin de devenir féconde et de tirer parti de son butin. Le cœur épanoui où resplendit le Christ, soleil de l’éternité, croît sous ses rayons, fleurit et se répand, avec toutes les puissances intérieures, en joie et en douceurs. Or l’homme doit imiter les façons de l’abeille, il doit voler par l’observation, la raison, la discrétion, sur tous les dons et sur toutes les douceurs qu’il lui a jamais été donné de goûter, et sur tous les biens que Dieu a jamais faits, et avec le dard de la charité et du discernement intérieur, il doit faire l’épreuve de toute la diversité des consolations et des biens, sans se reposer sur aucune fleur, à savoir en aucun don ; mais, tout chargé d’actions de grâces et de louanges, il doit reprendre son essor vers l’unité au sein de laquelle il veut prendre avec Dieu son repos et sa demeure pour l’éternité.
C’est là le second mode des exercices intérieurs qui ornent la partie inférieure chez l’homme de multiples façons.
La première opération du Christ, le début même de ce mode, c’est l’attraction que Dieu exerce sur le cœur, sur les désirs, sur toutes les puissances de l’âme ; Il les attire en haut vers le ciel, Il leur recommande de s’unir à Lui (…) il s’agit là d’une sollicitation et intimation intérieures qui pressent le cœur de se porter à sa plus haute unité. (…)
Cette intimation est une irradiation du Christ, Soleil éternel, et elle produit dans le cœur une joie si délectable, elle l’épanouit si largement, qu’il est difficile de le fermer ensuite. (…)
Parfois l’homme peut être élevé au-dessus de lui-même et au — dessus de l’esprit, sans être cependant absolument tiré hors de lui-même, et plongé dans un bien incompréhensible qu’il ne saurait exprimer ou décrire d’une manière adéquate à ce qu’il a vu ou entendu ; car voir et entendre n’est qu’une seule et même chose dans cette opération toute simple, cette simple vision. Et nul autre que Dieu seul ne peut provoquer chez l’homme cette opération, sans intermédiaire, sans la coopération de quelque créature. C’est là ce qui s’appelle le ravissement, par où il faut entendre que l’homme est enlevé à lui-même, emporté au-dessus de lui — même.
Parfois Dieu donne à certains de brèves lueurs dans l’esprit, quelque chose comme les éclairs dans le ciel. C’est ainsi qu’apparaît une courte lueur d’une singulière clarté, laquelle jaillit du sein de la toute simple nudité. En un instant, l’esprit est alors élevé au-dessus de lui — même, et aussitôt la lumière s’évanouit et l’homme revient à soi. Dieu exerce lui-même cette action, et c’est là chose très noble, car ceux qui la subissent en deviennent souvent des hommes éclairés. (…)
(…) Le Christ se cache. Que le Christ se cache et retire l’éclat intérieur de sa lumière et de sa chaleur, c’est la première opération et un nouvel avènement selon ce mode.
(…) Alors l’homme sort et se trouve pauvre, misérable, délaissé. Ici toute tempête, tout transport et toute impatience d’amour s’apaisent ; l’été brûlant se transforme en automne et toute opulence en grande pauvreté (…).
(Mais) de toute déréliction, l’homme doit se faire une joie intérieure, se remettre entre les mains de Dieu et se réjouir de pouvoir souffrir pour la gloire de Dieu. S’il se comporte bien dans cet état, il ne goûtera jamais joie plus profonde ; car rien n’est plus délectable pour qui aime Dieu que de sentir qu’il appartient en propre à son bien-aimé. (…)
Comment le premier avènement prépare le second
Une fois que l’homme est bien purifié, pacifié et rentré en lui — même selon sa partie inférieure, il est en état d’être éclairé intérieurement quand Dieu juge que le temps est venu et qu’il en donne l’ordre. Il peut fort bien aussi recevoir cette illumination au début de sa conversion pourvu qu’il se livre entièrement à la volonté de Dieu, et renonce à toute considération d’intérêt personnel : car tout est là. Mais il lui faut ensuite gravir les voies et les modes qui ont été précédemment exposés, aussi bien dans sa vie extérieure que dans sa vie intérieure, ce qui devrait lui être plus facile qu’un autre qui commence tout en bas son ascension : il a reçu en effet plus de lumières que les autres hommes.
Nous poursuivons en parlant du second mode de l’avènement du Christ dans les exercices intérieurs, par où l’homme reçoit ornement, clarté et richesse dans les puissances supérieures de l’âme. Cet avènement nous le comparerons à une source vive, avec trois ruisseaux. La source d’où s’écoulent ces ruisseaux, c’est la plénitude de la grâce divine dans l’unité de notre esprit. La grâce y demeure essentiellement, selon qu’elle y a son siège, aussi est-elle comparable à une fontaine débordante ; elle s’y exerce en acte selon qu’elle se répand par des ruisseaux dans chacune des puissances de l’âme à la demande de leurs besoins. Ces ruisseaux, ce sont les manières particulières dont Dieu influe et agit sur les puissances supérieures, où par le moyen de la grâce, son action s’exerce de maintes façons.
Le premier ruisseau de la grâce divine que Dieu fait couler dans cet avènement, c’est une pure simplicité qui brille dans l’esprit à l’exclusion de toute distinction. Ce ruisseau prend son origine à la source qui jaillit dans l’unité de l’esprit, il coule vers le bas et irrigue toutes les puissances de l’âme, les plus hautes comme les inférieures, et les élève au-dessus de toute multiplicité qui les occupe encore ; il produit dans l’homme la simplicité, et lui montre et lui procure un lien intérieur dans l’unité de son esprit. C’est ainsi que l’homme est élevé selon la mémoire et délivré de toute suggestion étrangère et de son instabilité. Or le Christ dans cette lumière presse de sortir, selon le mode de cette lumière et de cet avènement.
Ainsi l’homme sort, et constate que, moyennant cette simple lumière répandue en lui, il se trouve ordonné, apaisé, pénétré et fixé dans l’unité de son esprit et de sa mémoire. Ici l’homme est élevé et établi dans un état nouveau, il rentre en lui-même et dispose sa mémoire au dépouillement total, au-dessus de toute intrusion d’images sensibles et au — dessus de toute multiplicité. Ici l’homme possède essentiellement et surnaturellement l’unité de son esprit et s’y installe comme en sa demeure propre et dans l’héritage qui de toute éternité lui revient en personne.
Par le moyen de la charité intérieure, de l’inclination amoureuse et aussi de la fidélité divine, jaillit le second ruisseau de la plénitude de la grâce dans l’unité de l’esprit, et c’est là une clarté spirituelle qui se répand dans l’entendement et l’illumine, avec appréhension de notions distinctes de diverses manières. Car cette lumière fait voir et donne en vérité des notions distinctes en toutes les vertus. Mais tout cela n’est pas en notre pouvoir. En effet, quoique nous possédions toujours cette lumière dans notre âme, Dieu fait qu’elle se tait ou qu’elle parle, 11 peut la montrer ou la cacher, la donner et l’enlever, selon le moment et selon le lieu, puisque cette lumière est à Lui. Et c’est pour cela qu’il opère dans cette lumière comme II veut, quand II veut, pour qui II veut et ce qu’il veut. Les hommes qui la reçoivent n’ont pas absolument besoin que quelques révélations leur soient faites ou qu’ils soient attirés au-dessus des sens et au-dessus de toute sensibilité, car leur vie, leur habitation, leur conversation, leur être même est dans l’esprit, au-dessus des sens et de toute sensibilité ; et c’est là que Dieu leur montre ce qu’il veut et ce dont ils ont besoin, eux-mêmes ou d’autres hommes. Cependant Dieu pourrait, s’il le voulait, priver ces hommes de leurs sens extérieurs et leur montrer intérieurement quelque image inconnue ou des choses à venir, d’une manière ou d’une autre. Or le Christ veut qu’on sorte et marche dans cette lumière, selon le mode de cette lumière.
Or cet homme illuminé doit ensuite sortir et considérer son état et sa vie intérieure et extérieure, se demandant s’il porte la ressemblance parfaite du Christ selon son humanité et aussi selon la divinité. Car nous avons été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Et il doit lever ses yeux illuminés, pour s’attacher à la vérité intelligible par la raison éclairée, puis considérer et contempler, selon le mode des créatures, la très haute nature de Dieu et les propriétés infinies qui sont en Dieu. Car à une nature infinie conviennent des vertus et des œuvres infinies. (…)
Quand l’homme considère ainsi l’étonnante richesse et la majesté de la nature divine, ainsi que la diversité des dons que Dieu répand et offre à ses créatures, il sent grandir en lui l’admiration d’une richesse aussi diverse, d’une telle majesté, de la fidélité sans bornes qu’il garde à ses créatures. Il en résulte dans l’esprit une singulière joie intérieure et une haute confiance en Dieu. Et cette joie intérieure embrasse et pénètre toutes les puissances de l’âme ainsi que l’unité de l’esprit.
Moyennant cette joie, l’abondance de la grâce et la fidélité divine, jaillit et s’écoule le troisième ruisseau dans cette même unité de l’esprit. Ce ruisseau enflamme la volonté à l’instar du feu, il dévore et consume toutes choses, les réduisant à l’unité, puis inonde et envahit toutes les puissances de l’âme, leur conférant l’abondance de ses dons et une singulière noblesse ; il produit enfin dans la volonté un amour spirituel et subtil qui exclut tout effort. (…)
Moyennant le premier ruisseau, qui consiste en une lumière simple, la mémoire est élevée au-dessus des suggestions des sens, placée et établie dans l’unité de l’esprit. Moyennant le second ruisseau qui consiste en une clarté infuse, l’entendement et la raison sont illuminés pour connaître différents modes de vertu, différents exercices et le sens caché des Écritures d’une façon distincte. Moyennant le troisième ruisseau, qui consiste en une chaleur diffusée dans l’esprit, la volonté supérieure est enflammée d’un amour silencieux et dotée de dons abondants. C’est ainsi qu’on devient un homme d’esprit illuminé. Car la grâce de Dieu se présente comme une source dans l’unité de l’esprit, et les ruisseaux qui en découlent produisent dans les puissances un débordement de toutes les vertus. Or la source de la grâce commande toujours un reflux vers le même fond d’où le flot s’écharpe.
L’homme, une fois affermi dans le lien de l’amour, doit établir son séjour dans l’unité de son esprit ; et il doit sortir avec sa raison illuminée et une charité débordante, au ciel et sur la terre, puis considérer toutes choses avec un clair discernement, et enrichir toutes choses avec une juste libéralité et selon l’abondance des dons de Dieu. (…)
Or entendez bien, l’homme doit sortir et considérer Dieu dans sa gloire avec tous les saints ; il doit contempler comment Dieu se répand avec abondance et libéralité, dans l’éclat de sa gloire, se donnant Lui-même parmi d’inconcevables délices au bénéfice de tous les saints, selon le désir de chaque esprit. Puis comment ils refluent eux-mêmes avec tout ce qu’ils ont reçu et tout ce qu’ils peuvent faire au sein de cette même unité surabondante d’où provient toute félicité. Dieu, en se répandant ainsi, réclame toujours un mouvement de retour, car Dieu est une mer qui a son flot montant et son reflux : sans cesse II se répand sur tous ceux qu’il aime, selon les besoins et la dignité de chacun. Puis II reflue, ramenant tous ceux qu’au ciel et sur la terre il a comblés de ses dons, avec tout ce qu’ils possèdent et tout ce qu’ils peuvent faire.
(…)
(…) Telle est la manière selon laquelle Dieu possède l’unité essentielle de notre esprit comme son royaume, agit et laisse déborder ses dons dans l’unité qui est le principe de toutes nos puissances, et dans toutes nos puissances elles-mêmes.
Or considérez avec attention comment nous pouvons poursuivre et posséder l’exercice le plus intime de notre esprit à la clarté de la lumière créée. L’homme, qui est orné comme il convient par les vertus morales dans la vie extérieure et s’est élevé en noblesse par des exercices intimes, jusqu’à jouir de la paix divine, possède l’unité de son esprit, illuminé par une sagesse surnaturelle, laissant généreusement déborder sa charité au ciel et sur la terre ; il remonte et reflue, rendant gloire à Dieu avec révérence, vers le même fond, au sein de la haute unité de Dieu, d’où vient toute effusion ; car chaque créature, selon qu’elle a reçu de Dieu des dons plus ou moins élevés, est plus ou moins disposée à remonter par l’amour et à se porter avec ferveur vers son origine. Car Dieu, par tous ses dons, nous presse de revenir en Lui, tandis que par la charité et la vertu, par notre ressemblance divine, s’affirme notre volonté de faire retour en Lui.
Moyennant l’inclination amoureuse de Dieu et son action intime au plus intime de notre esprit, moyennant d’autre part notamment notre amour brûlant et l’immersion totale de toutes nos puissances en cette môme unité où Dieu demeure, se produit le troisième avènement du Christ dans les exercices intimes. Et c’est une touche intérieure, une motion du Christ dans sa clarté divine au plus intime de notre esprit. Le second avènement dont nous avons parlé, nous l’avons comparé à une source vive à trois ruisseaux. Cet avènement, nous le comparerons à la veine d’eau dans la source, car de tels ruisseaux n’existent pas sans la source ni la source sans une veine d’eau vive. C’est d’une façon semblable que la grâce de Dieu se répand en ruisseaux dans les puissances supérieures, enflammant l’homme et l’incitant à toutes les vertus. Et elle se trouve dans l’unité de notre esprit comme une source : elle jaillit au sein de cette même unité où elle prend naissance, comme une veine d’eau vive jaillissant du fond des richesses divines qui bouillonne de vie et où ne peuvent manquer jamais ni la fidélité ni la grâce. Telle est la touche dont je veux parler. Et cette touche, la créature la subit passivement, car alors s’accomplit l’union des puissances supérieures dans l’unité de l’esprit, au-dessus de la multiplicité de toutes les vertus. En l’occurrence nul autre n’agit que Dieu seul, par une libre initiative de sa bonté, laquelle est la cause de toutes nos vertus et de toute notre félicité. Dans l’unité de l’esprit où jaillit cette veine, on se tient au-dessus de toute opération et de tout raisonnement, sans toutefois que la raison s’efface, car la raison illuminée, et particulièrement la puissance aimante, ressentent la touche, mais la raison ne peut comprendre ni saisir quelque mode ou manière, le comment et l’origine de cet attouchement. Car c’est là une opération divine, la source d’où proviennent toutes les grâces et tous les dons, le dernier intermédiaire entre Dieu et la créature. Et au-dessus de cette touche dans l’essence de l’esprit où règne le silence, luit une clarté incompréhensible, et c’est la très haute Trinité d’où provient l’attouchement. C’est là que Dieu vit et règne dans l’esprit et l’esprit en Dieu.
Ici l’esprit s’élève, par la puissance aimante, au-dessus de toute opération, dans l’unité où se fait sentir la touche, pareille à une source jaillissante. Et cette touche presse l’entendement de connaître Dieu dans sa clarté, elle attire et presse la puissance aimante à jouir de Dieu sans intermédiaire. Or c’est là ce que désire l’esprit aimant au-dessus de toute chose, naturellement et surnaturellement.
Par la raison éclairée, l’esprit s’élève dans une intime considération, sa contemplation et ses considérations se tournent vers le tréfonds de lui-même où se fait sentir cette touche vivante. Ici la raison et toute lumière créée refusent d’aller plus avant, car la divine clarté qui luit d’en haut et provoque cette touche, aveugle par sa présence toute vision créée, du fait qu’elle est infinie. Et tout entendement qui s’éclaire d’une lumière créée se comporte ici comme l’œil de la chauve-souris à la clarté du soleil (…).
.
La clarté divine qui brille d’en haut, repousse et aveugle tout entendement par sa seule présence. C’est ainsi que Dieu se tient dans sa clarté au-dessus de tous les esprits au ciel et sur la terre. Et ceux qui ont affouillé le fond de leur âme, par la vertu et les exercices intérieurs, jusqu’à la source originelle, c’est-à-dire jusqu’au seuil de la vie éternelle, ceux-là sont capables de ressentir la touche. Ici la clarté de Dieu resplendit d’un tel éclat, que la raison et tout entendement refusent de pousser plus avant, ils doivent se résigner à la passivité et céder à cette incompréhensible et divine lumière. (…) La puissance aimante s’efforce toutefois d’aller plus loin, car elle se sent pressée, attirée, autant que l’entendement. (…)
La touche, la motion intérieure de Dieu, excite en nous la faim et le désir, car l’Esprit de Dieu pourchasse notre esprit. Plus la touche est véhémente, plus la faim, le désir se font sentir. Et c’est là une vie d’amour dans ses manifestations les plus hautes, au-dessus de la raison et de l’entendement ; la raison, en effet, est incapable de rien donner ni enlever à l’amour, du fait que notre amour subit l’attouchement de l’amour divin.
19
Dès lors à mon sens il ne saurait jamais plus être question de se séparer de Dieu. (…)
De ce contact mutuel naît la lutte d’amour : au point le plus profond de leur rencontre, au moment le plus intime et le plus décisif de leur visite, chaque esprit est blessé d’amour. Ces deux esprits, à savoir notre esprit et l’esprit de Dieu, deviennent lumineux l’un pour l’autre, et chacun montre à l’autre son visage. (…)
L’homme est alors possédé par l’amour au point d’être obligé de perdre le souvenir de lui-même et de Dieu, et de ne plus rien savoir en dehors de son amour. (…)
Au-dessus il n’existe plus que la vie dans la contemplation de Dieu, dans une lumière divine et selon le mode divin. Dans cet exercice on ne saurait errer ou se laisser tromper : il commence ici-bas dans la grâce et doit durer éternellement dans la gloire.
[Au livre III Ruysbroeck montre comment l’amant intérieur de Dieu qui le possède dans un amour de jouissance parvient à la contemplation suressentielle dans la lumière divine selon la voie de Dieu.]
… Cette contemplation, dit-il, nous met dans une pureté et dans une clarté qui dépassent toute notre intelligence… et nul ne peut y arriver par la science ou par la subtilité, ni par aucun exercice. Mais celui que Dieu veut unir à son esprit et qu’il lui plaît de transfigurer par Lui-même peut contempler Dieu et nul autre ne le peut (…).
… Bien rares sont ceux qui peuvent parvenir à cette contemplation divine à cause de leur propre incapacité ou du mystère de la Lumière en laquelle on contemple. Et c’est pourquoi nul, par sa seule science ou par quelque réflexion subtile, ne comprendra à fond (ces explications), car toutes les paroles et tout ce que l’on peut apprendre et comprendre selon la voie des créatures sont étrangers et loin en deçà de la vérité dont je parle.
Mais celui qui est uni à Dieu et illuminé en cette vérité peut comprendre la vérité par elle-même ; car, comprendre et concevoir Dieu au-dessus de toutes les figures, tel qu’il est en Lui-même, c’est être Dieu avec Dieu, sans intermédiaire ni aucune différence qui puisse s’interposer comme un obstacle.
Je demande donc à tout homme qui ne comprend pas cela et ne l’éprouve pas en l’unité ffuitive de son esprit de ne pas s’en offenser et de laisser les choses être ce qu’elles sont.
Ce que je vais dire est vrai ; et on verrait que le Christ, l’éternelle Vérité, l’a dit Lui-même en son enseignement à maintes reprises, si l’on
21
est capable de le montrer et de l’exprimer clairement. C’est pourquoi qui veut comprendre ceci doit être mort à lui-même et doit vivre en Dieu ; il tournera son visage vers la Lumière éternelle, au fond de son esprit où se révèle sans intermédiaire l’occulte vérité.
Maintenant si l’esprit veut voir Dieu avec Dieu, sans intermédiaire en cette lumière divine, il faut nécessairement trois choses : en premier lieu, il doit être bien réglé au-dehors, en toutes les vertus, et au dedans, aussi dégagé de toute œuvre extérieure que s’il n’en exerçait aucune.
… En deuxième lieu, il doit intérieurement adhérer à Dieu, y appliquant son intention et son amour tel un feu flamboyant qui ne peut jamais plus s’éteindre. Dès qu’il se sent en cet état, il peut contempler.
En troisième lieu, il doit se perdre en une Non-Voie et en une ténèbre où tous les êtres adonnés à la contemplation s’égarent dans la jouissance sans jamais plus pouvoir se retrouver selon le mode des créatures.
Dans l’abîme de cette ténèbre où l’esprit aimant est mort à lui — même commencent la manifestation de Dieu et la vie éternelle ; car dans cette ténèbre s’engendre et resplendit une incompréhensible Lumière qui est le Fils de Dieu, en qui on contemple la vie éternelle. C’est dans cette Lumière qu’on devient voyant ; et cette divine lumière est donnée en la vision simple de l’esprit où l’esprit reçoit la clarté qui est Dieu même au — dessus de tous les dons et de toutes les œuvres créées, dans le repos et la vacance de l’esprit où lui-même s’égare par l’amour de fruition, et reçoit la clarté de Dieu, sans intermédiaire. Et il devient sans cesse cette même clarté qu’il reçoit.
Voyez, cette occulte clarté en laquelle on contemple tout ce qu’on peut désirer selon la vacance de l’esprit, est si grande que l’amant qui la contemple, en son fond où il repose, ne voit et n’éprouve qu’une incompréhensible lumière ; dans la simple nudité qui embrasse toutes choses, il se voit et se sent cette même lumière par laquelle il voit, et rien d’autre.
Comment la génération divine se renouvelle sans interruption en la noblesse de l’esprit.
Devenus voyants, nous pouvons contempler dans la joie l’éternel avènement de notre Époux (…).
C’est une génération nouvelle, une illumination nouvelle qui s’accomplit sans cesse. Car le fond d’où jaillit la clarté et qui est cette clarté même, est vie et fécondité. C’est pourquoi la manifestation de l’éternelle lumière se renouvelle sans interruption au plus secret de l’esprit.
(…) Dieu s’engendre lui-même, seul, à la cime sublime de l’esprit. Et il n’y a ici qu’une éternelle contemplation de la Lumière par la Lumière et dans la Lumière. Et l’avènement de l’Époux est si rapide qu’il est toujours là, demeurant avec son opulence abyssale, et qu’il est toujours en train de venir, en personne, sans cesse nouveau, avec des clartés nouvelles comme s’il n’était jamais venu auparavant.
Car son avènement consiste, hors du temps, en un maintenant étemel, toujours reçu avec de nouveaux désirs et de nouvelles joies.
Voyez î Les délices et les joies que cet Époux apporte en son avènement sont sans fond et sans limites parce qu’elles sont Lui-même.
Aussi les yeux de l’esprit, par lesquels il contemple et fixe son regard sur l’Époux, sont-ils si largement ouverts qu’ils ne se fermeront jamais plus, car la contemplation et ce regard de l’esprit demeurent pour l’éternité en l’occulte manifestation de Dieu. Et la compréhension de l’esprit est si largement épanouie pour l’avènement de l’Époux que l’esprit lui-même devient l’immensité qu’il saisit. C’est ainsi que Dieu est saisi et vu par Dieu, et là toute notre béatitude réside…
… Dans cette clarté, c’est-à-dire dans le Fils, le Père se révèle à lui-même ainsi que tout ce qui vit en lui… C’est pourquoi tout ce qui vit Hans le Père, occulte en l’unité, vit dans le Fils, s’écoulant dans la manifestation et dans le fond simple de notre éternelle image, demeure pour toujours dans la ténèbre, en l’absence de toute voie. Mais la clarté immense qui en rayonne, manifeste et produit selon certaines voies le mystère de Dieu…
Alors tous les hommes, élevés au-dessus de leur état de créature à une vie contemplative, ne font qu’un avec cette clarté divine ; ils sont cette clarté même, et ils voient, ils sentent et trouvent, grâce à cette divine lumière, qu’ils sont eux-mêmes ce fond simple selon leur essence incréée d’où cette clarté sans mesure rayonne, selon la voie divine, et qui dans la simplicité de l’Essence demeure éternellement dans l’Unité sans voie d’accès.
C’est pourquoi les hommes intérieurs adonnés à la contemplation sortiront selon la voie de la contemplation au-dessus de la raison, de la distinction et même de leur être créé, au moyen d’un regard intuitif et éternel, grâce à cette Lumière qui s’y engendre. Ainsi ils sont transformés et ne font qu’un avec cette même Lumière par laquelle ils voient et qu’ils voient…
C’est ici la contemplation la plus noble et la plus utile à laquelle on puisse parvenir en cette vie, car l’homme y reste le mieux maître de soi et le plus libre… il demeure libre et maître de soi dans la vie intérieure et la pratique des vertus…
… Mais si nous étions tirés de cet exil… nous serions plus capables selon notre nature créée de recevoir la clarté, alors la gloire de Dieu nous illuminerait mieux et plus subtilement. Telle est la voie au — dessus de toutes les voies, en laquelle on sort en une contemplation divine et un regard intuitif étemel. Ainsi est-on transformé et transmué dans la clarté divine.
Sur la rencontre divine toujours nouvelle qui a lieu au plus secret de notre esprit parvenu au sommet de la béatitude, Ruysbroeck écrit une page admirable afin de montrer que dans l’embrassement du Père et du Fils nous sommes étreints par l’Esprit au fond de l’éternel amour :
L’embrassement amoureux est en son fond jouissance fruitive et absence de voie, car l’abîme de Dieu est si ténébreux et si dénué de voie d’accès qu’il engloutit en lui-même toutes les voies divines, toutes les opérations et les propriétés des Personnes en l’opulent enveloppement de l’Unité essentielle, et une jouissance fruitive s’accomplit dans l’abîme du Sans-nom.
Ici les transports de la jouissance où (l’esprit) fond et s’écoule dans la nudité essentielle où tous les noms de Dieu, où toutes les voies, toutes les idées et les raisons vivantes qui se reflètent dans le miroir de la divine Vérité, sombrent tous dans la simplicité sans nom, sans voie et sans raison… Car, en cet abîme sans fond de la Simplicité, toutes les choses se trouvent embrassées dans la béatitude fruitive, mais le fond lui — même n’est embrassé par rien, si ce n’est par l’Unité essentielle.
Ici les Personnes et tout ce qui est vie en Dieu doivent se résorber. Ici en effet, il n’y a qu’un éternel repos dans un embrassement fruitif où tout s’écoule dans l’Amour.
C’est là l’Essence sans voie que tous les esprits intérieurs ont choisie pour séjour. C’est là le silence ténébreux où tous les amants se perdent.
Et nous, si nous pouvions nous préparer par les vertus, nous nous dévêtirions de notre vie, nous nous laisserions emporter par les vagues sauvages de cet océan d’où jamais plus aucune créature ne pourrait nous ramener.
Pour le Śivaïsme du Cachemire, la Réalité est l’Essence ou Lumière (prakāsa), la Conscience absolue et ineffable, resplendissant de son propre éclat. En tant que béatitude (ānanda), prise de conscience et pure liberté, elle constitue la source de tout dynamisme et de toute efficience, la manifestation de l’univers à laquelle préside l’énergie (sakti) n’étant que le débordement de la félicité divine
« Comme un roi régnant sur la terre entière, sous l’exultation joyeuse que lui cause sa puissance, peut exercer par jeu les activités d’un fantassin, ainsi le puissant Seigneur, dans sa joie exubérante, se plaît à assumer les formes variées (de l’univers)91. »
En ParamaŚiva — le Tout indifférencié, indicible Śiva est indissolublement uni à l’énergie, mais celle-ci, au [142] cours de la manifestation, paraît se séparer de lui pour assumer des aspects de plus en plus distincts et déterminés. La libre énergie fait surgir les autres énergies qu’elle renferme encore indivises en elle-même, les révélant chacune à tour de rôle : d’abord l’énergie de conscience émerge ; puis s’esquisse la béatitude au sein de l’union de Śiva et de son énergie ; se déploient ensuite les énergies de volonté, de connaissance ; enfin, quand apparaît l’énergie d’activité, les premières ne se trouvent plus que latentes en elle. La libre énergie s’obscurcit pour manifester l’univers, sa manifestation étant son occultation même.
Ces énergies divines, initialement douées d’une parfaite pureté, la perdent peu à peu. L’énergie icchā, désir ou volonté, qui à l’origine n’est qu’acquiescement à la plénitude devient un désir défini ; la connaissance (jñāna) qui n’est que Lumière consciente de Soi apparaît comme une connaissance distincte en sujet et objet ; l’activité (kriā —) de simple ébranlement ou essor en soi-même dans la plénitude du Je absolu92, se déploie en mouvements dispersés et aboutit à l’action asservissante. La vie est alors cristallisée autour du moi, et ce moi, désormais séparé du Tout, perçoit l’univers comme fragmenté en d’innombrables sujets et objets tandis que la diversité de ses états de conscience lui cache l’être unique qu’il est par essence.
Ainsi, jouant au fantassin, le souverain se prend à son jeu. Oublieux de toute souveraineté, sa liberté perdue, il s’attache à son état de simple soldat et s’y emprisonne, en proie à l’impuissance.
Lallesvarî se plaint amèrement :
« Il n’y a ni Toi ni moi, ni contemplé ni contemplation, mais seulement le créateur de l’univers qui s’est perdu dans l’oubli de lui-même… (59). » (Bh., p 17.)
« O mon âme, l’attrait mensonger du monde t’est échu en partage… Hélas pourquoi as-tu oublié la nature du Soi ? (67). » (Bh., p. 21.)
Quelques siècles plus tôt, Utpaladeva insistait sur le terrible paradoxe :
« Ici-bas, dit-il à Śiva, rien n’est séparé de Toi. Il n’y a rien qui ne soit béatitude puisque façonné par Toi. Et cependant ne règnent en tous lieux que différenciation et douleur. Ô demeure un étonnement sans pareil, je Te salue. » (S. U., XVIII, 18.)
De ce douloureux paradoxe, il donne une explication [143] :
« Le collier de perles de Ton amour est hélas 93 plongé dans ma pensée impure et, bien qu’innée, la Splendeur de sa gloire surnaturelle ne rayonne pas. » (XV. 15.)
Et pourtant, à ceux qui l’adorent Śiva offre sa propre Essence lumineuse avec générosité et sans rien garder pour soi :
« Gloire à Toi, Seigneur tout-puissant, maître de l’univers, à Toi qui vas jusqu’à donner ton Soi (ātman). » (XIV. 12.)
Quel est donc le secret de cette adoration ? Comment le fantassin retrouve-t-il sa souveraineté, le collier de perles, sa splendeur surnaturelle ? De la conscience ou de l’activité du fantassin ne peut naître une conscience royale, ni de la pensée instable ou de l’imagination, la conscience du Soi.
Mais que le fantassin rencontre un souverain et le reconnaisse pour tel, ou que la souveraineté surgisse en lui et se révèle spontanément, alors, dans un extraordinaire lâcher prise qui l’arrache à son moi, sa conscience limitée s’abolit dans l’émergence du Soi universel. Dans l’éblouissement d’une libre prise de conscience, il reconnaît le souverain qu’il est, qu’il a toujours été. C’est alors dans la plénitude de la félicité et de la connaissance qu’il jouit de sa souveraineté retrouvée ; il l’exerce pleinement et, pour l’avoir oubliée dans l’exubérance de son jeu, il en sait le prix94.
Ainsi, l’énergie qui manifeste l’univers est aussi, en tant que grâce, l’artisane du retour. Comme le fantassin recouvre [144] la conscience de sa nature royale, celui qui se prend pour un moi isolé et s’y enferme, accède à l’identité au Tout dès qu’il reprend conscience de Soi.
« Le Soi dont la merveilleuse essence est Lumière, Śiva souverainement libre, par le jeu impétueux de sa liberté, masque d’abord sa propre essence puis la révèle à nouveau en sa plénitude, d’un seul coup ou par degrés. Et cette grâce est entièrement indépendante. » Abhinavagupta (Bh., p. 24.)
Suscitant l’univers multiple par la magie de sa force créatrice, Śiva se cache à lui-même ; s’emparant de force du cœur obscur où il demeure, Śiva se révèle à lui-même.
Libre ou enchaîné, il est Śiva toujours identique à lui-même, merveilleux magicien du grand Jeu divin qui englobe l’émission intégrale de l’univers et son retour à la source.
« 330. Le Soi est la demeure permanente de la lumière consciente ; l’ensemble des énergies forme son essence. Cachant sa propre grandeur, il assume l’aspect de l’être asservi.
Le Tantrāloka a précisément été composé pour décrire les formes variées de la délivrance.
331. La connaissance erronée — (simple) défectuosité de la vision — fait voir les choses comme rugueuses et inégales 96 ; par sa faute, la connaissance, en dépit de sa pureté, devient puissance impure.
Mais qu’advienne ce qui est digne d’être connu, tel un [145] collyre oint sur les yeux, et, sitôt la marque d’infamie éliminée, comment subsisterait le moindre soupçon d’impureté ?
332. O Toi qui contiens toutes choses, de force Tu t’empares des cœurs humains et, tel un acteur, Tu t’amuses à cacher sous de multiples détours le Cœur du Soi.
Celui qui te déclare inconscient, le voilà l’inconscient, le non-instruit qui prétend à tort avoir du cœur. En cette inconscience (pourtant) réside sa louange, car en ceci il Te ressemble !
333. Toute impureté évanouie, connaisseurs du suprême et de l’inférieur, ceux qui sont identiques à la Nature réelle de Śiva, les voilà, les maîtres qualifiés pour la recherche mystique. Il est donc bien inutile de leur demander d’expulser au loin la tache de l’aversion. »
Le Śivaïsme est appelé Trika parce qu’il distingue trois plans de la réalité : Śiva, l’Énergie, l’individu. Ces plans correspondent à trois niveaux d’expérience sur chacun desquels prédomine une énergie : le pur Sujet connaissant, tout entier en son acte de volonté, la connaissance où règne naturellement l’énergie cognitive, enfin le niveau de l’objet connu, où s’exerce l’activité.
L’apparition de ces trois énergies divines dans une rapide succession correspond aux trois moments de la manifestation différenciée de l’univers et couvre tout le champ de l’expérience humaine :
« Rien n’apparaît qui ne repose dans la triple énergie consciente s’exprimant par : je veux, je sais, je fais » écrit Abhinavagupta (H. A. p. 13).
Mais les deux premiers moments sont si subtils qu’ils échappent à l’homme ordinaire qui en ignore le processus, car il vit au seul niveau de l’objectivité et de la dualité. Le mystique, au contraire, revient au moment initial, à la prise de conscience de l’ébranlement originel, celui de l’incitation divine, et s’efforce de s’y maintenir en prenant une ferme conscience de son essence.
Les textes Trika comparent souvent l’essence divine à l’océan : « Hommage à l’océan de la conscience Śivaïte, Essence du Sujet conscient ! » dit un verset (M.M. p. 106). Et pour montrer comment Śiva, uni dans la béatitude à l’Énergie, se tourne vers l’univers à naître en un [146] premier instant d’attente, d’expectative ardente, Somānanda propose cette image : « Au moment où, dans une eau tranquille, surgit soudain une violente agitation, on peut noter un frémissement imperceptible quand on y jette un coup d’œil, au tout début, et c’est là l’excitation de l’attente. » (S.D. I., 13-14.)
Le développement de la comparaison peut éclairer les trois moments successifs de la manifestation, sur lesquels se fonde le Trika.
Parfois, sous un plein soleil, la lumineuse étendue de l’océan, profondément calme, s’irise et frémit soudain, l’eau vibre et crépite de lumière (sphurattā) à l’infini, sous le regard qu’éblouit ce scintillement perpétuellement renouvelé.
De même, dans le vide éthéré de la pure Conscience, s’esquisse la volonté (ou le désir initial). Elle émerge, mais ne se distingue pas de la Conscience dont elle ruisselle encore, la prise de conscience reste coextensive à la lumière et tout demeure indivis dans la Conscience comme l’eau et la lumière à la surface du vibrant océan. C’est le moment du premier regard qui saisit l’univers en une prise de conscience globale et souveraine, avant qu’apparaissent connaissance notionnelle et objet connu. En ce premier instant, l’univers encore indistinct du sujet connaissant réside en pleine intériorité, c’est le niveau du Je indifférencié, le lieu de la voie divine.
Puis la surface de la mer ondule, s’enfle et se creuse, la vague se forme, flue et reflue, mais reste indissociable de l’océan parce que prise dans son seul mouvement, un mouvement qui est perçu comme unique malgré la multiplicité des ondulations.
De façon analogue, au deuxième moment, sous la poussée du désir qui se précise, la conscience se trouble ; cherchant à connaître, elle perd la plénitude indifférenciée du Je pour s’emparer de caractères distinctifs ; l’énergie cognitive devient pensée dualisante, distingue sujet et objet, mais c’est à même la pensée, à même la conscience qu’apparaît la forme de l’objet et, comme la vague et l’océan, sujet et objet n’ont encore qu’un seul substrat l’univers est perçu comme manifesté, mais manifesté intérieurement, dans la seule pensée, en tant qu’impression de plaisir ou de douleur. C’est le deuxième moment, c’est le niveau de la connaissance, le lieu de la voie de l’énergie.
Vient un temps où la tempête soulève la mer, les vagues immenses et violentes déferlent une à une, frangées d’écume, giclant et retombant, semblant capter à elles seules [147] toute la force de l’océan dont elles se séparent pour s’abattre et venir mourir sur la grève.
Ceci figure le troisième moment, celui où l’homme voit l’univers comme extérieur et s’éprouve lui-même comme isolé, ballotté à la crête des vagues ou précipité dans leurs rouleaux, désemparé, perdu dans la multiplicité et la violence des flots qui lui cachent l’unité de l’océan et sa profondeur apaisée. À ce niveau, sujets et objets sont nettement distincts, le monde apparaît comme extérieur, comme totalement différencié, l’objet rejeté hors du sujet et de la connaissance. C’est le niveau de l’objet connu, le lieu de la voie de l’activité.
En dépit des aspects variés de sa surface, c’est toujours l’océan que nous contemplons, et sous les multiples modalités de la Conscience l’Essence demeure. Pour retrouver l’Essence, l’individu isolé de la Conscience originelle doit reconnaître son identité à la vague, puis au mouvement unique de l’océan qui sous-tend flux et reflux — soit à l’énergie — et enfin à la mer illimitée — soit à la Conscience indifférenciée.
.
Si les trois énergies divines correspondent aux moments successifs de la manifestation de l’univers, elles forment, en sens inverse, trois voies principales quand l’univers ou la conscience retourne à l’indifférenciation. Ces voies sont donc les modalités du retour à la Conscience originelle, chacune se servant de l’énergie qui la caractérise comme d’un tremplin.
Avec la plus haute des énergies, celle de Conscience, on ne peut parler de voie ; il s’agit donc de pur anupaya, la non-voie. Si l’énergie de félicité s’esquisse, l’accès « sans manière d’être » se ramène à un simple repos dans la béatitude. Si la volonté surnage, la voie éminente de Śiva se présente. Lorsque l’énergie de connaissance domine, la voie est dite de l’énergie ; et si l’activité se manifeste clairement, c’est la voie de l’individu97.
Dans le sens du retour, les énergies se fondent une à une dans l’Essence divine. Lorsque les trois voies se dissolvent dans la félicité, celle-ci atteint sa perfection et la liberté initiale est définitivement recouvrée. [148]
« Tandis que l’Omniprésent révèle à certains sujets conscients sa propre Essence en sa plénitude, à d’autres il la révèle progressivement (I., 140).
La révélation de son Essence — cette nature unique et universellement présente — est pour l’individu la Connaissance suprême. Une autre connaissance, inférieure, offre de multiples aspects. Elle peut se déployer par voie directe (la voie divine) ou par des voies indirectes qui en procèdent et qui se différencient de manières variées (141). »
« Ce qui fulgure immédiatement, en toute évidence, à l’orée de la connaissance dans le domaine de l’unicité, sans pensée différenciatrice, ce domaine de pure prise de conscience globale de soi, est dit voie divine.
Ainsi, les yeux étant grands ouverts, ce qui se révèle intensément et en toute clarté à certains êtres extraordinaires, sans qu’ils aient à viser un but, c’est la nature divine. » [La glose précise que cette voie se caractérise par l’épanouissement ininterrompu de l’énergie de volonté.] (146-147.)
« Si, de façon répétée, par une recherche intellectuelle progressive portant sur une certitude faite de pensées purifiées comme “cet univers est le Soi”, on accède à une prise de conscience de soi globale et indifférenciée, cette voie est dite cognitive (148). »
« Par contre l’efficacité opérant à l’égard de la réalité objective et qui correspond aux opérations de cette connaissance est considérée comme voie de l’activité.
Mais la différence entre ces voies n’en implique aucune quant à la libération, le but étant unique, Śiva même (149).
Les distinctions de voie et de but à atteindre reposent sur une erreur propre à la connaissance grossière inhérente à l’énergie d’activité, qui, engendrant la diversité, est l’unique cause du lien et de la délivrance (145). »
D’une part il est vrai que l’activité parfaitement désintéressée conduit à la libération aussi bien que la connaissance et l’élan d’amour. D’autre part, le cheminement est entièrement différent dans chacune des voies ; mais on peut passer de l’une à l’autre et accéder à la voie supérieure si, en cours de route, la grâce intervient avec abondance. Car tout dépend du degré de la grâce accordée. Ainsi, dans la voie inférieure, la grâce affleure par touches délicates ; déjà plus puissante dans la voie de l’énergie, elle éclaire l’intelligence dont elle fait une raison intuitive et pénétrante. Dans la voie supérieure, la grâce, très intense, jaillit des profondeurs du Soi, de l’intime de l’âme, l’ébranlement qu’elle y imprime est tel qu’il se répand dans la personne entière qui s’en trouve divinisée. Mais dans l’Essence exempte de voie (anupāya) il n’y a plus de grâce, la gloire est seule à régner.
D’après Abhinavagupta, la grâce intense est due à la parole du Maître, la grâce moyenne à cette parole associée à une série de raisons intuitives et à la foi dans les Livres sacrés. À l’aide de ces trois éléments, réunis ou séparés, « les nuages des doutes s’évanouissent et l’on touche les pieds du Tout-puissant pareil au soleil qui dissipe les ténèbres et dont la glorieuse splendeur brille dans le firmament du Cœur ». (T.A. II., 49.)
De la grâce procèdent donc les caractéristiques des cheminements : les initiations, la nature des pratiques, l’effort à fournir, les procédés à mettre en œuvre, la durée de la progression, la conquête plus ou moins définitive de l’objectivité, la libération ou la liberté qui s’ensuit.
Ainsi, celui qui parcourt la voie individuelle ne parvient à la souveraineté qu’après la mort lorsqu’il a intégralement repoussé l’erreur. Auparavant il n’ignore pas sa puissance, mais, par la faute de résidus de l’ignorance, il lui arrive encore, au cours de ses activités — et non point durant le samādhi — de s’identifier à son corps. Pourtant il n’est plus la proie de l’illusion, car il a reconnu sa propre essence, à l’image de l’homme qui, ayant percé le secret d’un tour de magie, n’en est plus dupe alors même qu’il assiste à ses manifestations98. [150]
Celui qui progresse dans la voie de l’énergie par son application à la pratique mystique (bhāvanā) reconnaît l’identité au Seigneur et de son propre corps et de tout ce qui existe. Il jouit des qualités divines en cette vie même, mais il n’obtient pas la plénitude, car il ne réalise totalement le Soi universel qu’à la dissolution du corps, dès que s’évanouissent les limites corporelles et celles du souffle99.
Ces voies différant par l’orientation générale, la fin poursuivie, l’effort engagé, une comparaison va souligner la spécificité de chaque cheminement vers la délivrance ou bien vers la liberté du grand large, l’immensité bhairavienne.
Imaginons une forêt touffue qui cache la mer que, d’un désir plus ou moins ardent, l’on voudrait atteindre. Ignorant le but, l’homme d’action qui a entendu parler de l’océan cherche avec effort (yatna) à se frayer un chemin dans cette forêt : il essaie plusieurs pistes, il abat des arbres, franchit des fossés, contourne des obstacles, revient sur ses pas, se plaît aux sentiers qu’il a ouverts, s’arrête longuement et repart avec courage. Enfin, sa pensée apaisée, ayant découvert un sentier plus direct, il peut ou bien se reposer, heureux et rassuré, ou encore le suivre et entrer dans la voie de la connaissance.
L’homme de discernement qui s’adonne à l’énergie cognitive cherche une bonne voie, mais il hésite à la croisée des chemins et procède de fourche en fourche vers la mer qu’il entrevoit de plus en plus distinctement. S’il rencontre un véritable guide, il ne s’égare plus. Il acquiert peu à peu l’expérience nécessaire pour un choix averti et une pensée éclairée. Il va donc de l’avant avec zèle et ardeur (prayatna).
Dans la voie supérieure de Śiva, celle de l’intention simple et nue, l’être impatient et intrépide, qui du sommet d’une colline a vu la mer, s’y dirige droit, sans dévier, de tout son être, sans chercher à discerner, sans se soucier du chemin, franchissant l’obstacle et guidé par le seul élan de son désir (udyama). Soulevé hors de lui-même, porté à son insu jusqu’à la mer, il s’y plonge sans tarder.
Dans la voie réduite propre à la félicité, point de forêt, [151] point de chemin, on jouit de la fraîcheur et de l’immensité océanique.
Enfin, en l’absence de toute voie, l’infinité de la mer est d’emblée reconnue et l’on s’identifie à la Conscience absolue.
À ces trois voies correspond une triple absorption 101 lorsque, par sa grâce, le Seigneur pénètre dans le cœur du yogin et que celui-ci pénètre dans le Seigneur. Telle est l’absorption, clé de voûte de toute voie.
« Connaissant parfaitement le Soi comme identique au Seigneur et ses énergies de connaissance et d’activité comme non différentes de lui, (le mystique) qui s’adonne à l’absorption sait et fait tout ce qu’il désire, même s’il réside encore dans son corps. » (I. P. v. IV, 15.)
« Cette absorption dans la Réalité, précise Abhinavagupta, est la seule chose qui importe, tout autre enseignement ne tend qu’à ce but. » Mais il ajoute bientôt pour lever toute équivoque : « À la mort du corps, le Seigneur demeurant seul, il n’est plus question d’absorption : Qui pénétrerait-on, où et comment ? 102. »
En effet l’interpénétration de Dieu et de l’âme peut aller jusqu’à leur identification. il s’agit alors de l’absorption parfaite sans voie ni manière d’être103, de l’identité à la Réalité absolue.
La triple absorption est ce qui détermine les trois voies libératrices selon que l’on s’absorbe dans l’énergie en sa source — la volonté — ou dans l’énergie cognitive ou enfin dans l’énergie en son activité déployée.
Un chapitre entier du Tantrāloka, le XXXIV, est consacré à l’absorption en raison de son importance, car elle fut révélée par Śiva lui-même. Ce chapitre, des plus courts, ne renferme que les stances suivantes [152] :
« Le moment est venu d’exposer comment on pénètre dans la Quintessence. (Selon la voie individuelle) après avoir pénétré de plus en plus profondément en l’état divin, qu’on repose paisiblement à proximité de l’Essence. Puis, laissant complètement cette voie, qu’on prenne refuge au séjour de l’énergie. Qu’on parvienne enfin dans la demeure de Śiva où notre propre essence se révèle en toute évidence. Telle est l’absorption graduelle.
Mais qui a le bonheur de jouir de la nature de Bhairaya, source abondante des grands rayons (les énergies divines) irradiant de la Conscience, c’est indépendamment de toute Voie qu’il s’absorbera finalement en son propre Soi éternel, prégnant de l’Essence universelle.
Nous avons là l’absorption dans la Quintessence telle que le Seigneur l’a exposée. »
D’après Abhinavagupta tous les moyens, le samādhi y compris, tendent à la parfaite absorption dite intégrale (samyag āveśana) au cours de laquelle le soi, la pensée, le corps et le monde entier s’engouffrent spontanément dans la Réalité ultime et s’identifient à elle.
Cette divine absorption concerne uniquement un être dégagé de toute préoccupation, 104 car cet être, dit Abhinavagupta, ne se soucie de rien et aucune pensée dualisante ne fonctionne en lui. Alors, grâce à un réveil de grand poids105, s’établit soudain une parfaite mise au diapason avec ce qu’il faut connaître — l’universelle Conscience indifférenciée — et qui atteint immédiatement son plein épanouissement. D’une telle illumination, dit-il, qu’on s’empare aussitôt et pour toujours. Par cette interpénétration de Śiva et de l’adorateur, ce dernier s’identifie à la suprême Essence grâce à Śiva inséparable de sa plus haute énergie. Le moi dépendant s’anéantit dans l’énergie de [153] volonté — source des autres énergies — et la conscience s’absorbe immédiatement en Śiva, sans même recourir au samādhi, en une union aussi spontanée qu’imprévue. « Par-delà toute certitude intellectuelle, la chose digne d’être connue, après s’être épanouie dans un cœur éminemment pur, y demeure permanente ; elle subjugue le Sujet conscient qui se reflète dans le miroir de l’intelligence et, à ce moment, elle se révèle graduellement dans toute sa gloire. » (T.A. I. 172-175.)
Lors de cette totale absorption dans la Réalité, le soi, la pensée, le corps, les objets externes abandonnent leur nature objective et s’identifient au Seigneur. Si, à la mort, cette absorption est parfaite, seul le Seigneur demeure.
L’absorption obtenue en se concentrant (cintā) sur quelque entité par le cœur uniquement, sans aucune récitation, relève de l’énergie.
Le cœur se présente ici sous l’aspect d’intelligence, de pensée et de sentiment du moi dont les opérations respectives sont la certitude, la synthèse et la conviction erronée. En dépit des illusions qu’elle comporte par la faute de ces opérations, cette voie aboutit à la connaissance indifférenciée propre à la voie divine. En effet le vikalpa purifié contient une connaissance et une activité de très grande intensité, mais encore soumises à des conditions limitantes.
Il suffit donc de s’adonner ardemment à dissoudre toutes les limites pour que l’énergie en fulgurant fasse apparaître intérieurement ce que l’on désire, à savoir, l’identité à Śiva.
Cet état d’énergie est à la fois différencié et indifférencié : différencié parce qu’il contient des pensées distinctes, mais indifférencié puisqu’il ne requiert aucun moyen externe comme la récitation et autres pratiques analogues. (T.A. I. 169.)
L’absorption due à la récitation, à l’activité des organes, à la méditation, aux phonèmes, à la concentration sur des points vitaux est nommée à juste titre « individuelle ». (I. 170.)
Abhinavagupta explique : individuelle signifie clairement différenciée. Bien que cette voie consiste en certitude intellectuelle propre à la pensée dualisante, elle aboutit elle aussi à l’indifférencié. [154]
Ces deux dernières absorptions sont donc dirigées vers l’océan de l’indifférencié sans lequel elles n’existeraient pas.
S’il est vrai que la validité de la conscience indifférenciée ne dépend nullement de la pensée différenciée, la voie individuelle permet néanmoins d’accéder à l’indifférenciation de la voie divine ; bien qu’elle commence par la pensée différenciatrice, elle s’élève à l’aide de purifications progressives des pensées jusqu’à l’indifférencié (nirvikalpa).
.
Abhinavagupta donne un exemple de connaissance indifférenciée dans la voie divine d’abord puis un autre, mais dans la voie inférieure :
« Un expert en pierres précieuses évalue à leur juste valeur un grand nombre de pierres même si elles lui sont montrées de nuit et le temps d’un éclair. Une telle pureté de la conscience est due aux pratiques des vies passées ou à la volonté du Seigneur que rien ne restreint. » (184-185.)
Un joaillier peu expérimenté ignore au début la valeur des pierres précieuses ; cependant, à la suite d’investigations réitérées, en utilisant des procédés pour déterminer avec certitude leur valeur, il atteint finalement une connaissance indifférenciée qui se passe de tout procédé. On le déclare alors expert en pierres précieuses. (229.)
« Qui s’élève à l’accès de l’indifférencié, quel que soit le chemin qui permet de pénétrer dans la Réalité, par ce chemin même il s’identifiera à Śiva.
Un cœur très pur dont la lumière éclaire la cime resplendissante, s’identifie à la Conscience, Śiva suprême, grâce à cette lumière même. »
Telle est la véritable voie, expression de l’énergie éminente de la volonté, absorption dite divine qu’expérimenta Sambhunātha (211-213) ainsi que son disciple Abhinavagupta.
.
Comment par rapport à la lumière consciente s’effectue à l’aide des trois voies, la fusion de Dieu, du Soi et de l’énergie universelle ? Puisque la lumière éternelle ne peut être que totale, quelle que soit la voie suivie, l’illumination est donc la même dans chacune des voies ; seuls diffèrent sa puissance, le degré de liberté atteint et sa permanence. On peut donc distinguer état passager, station durable et nature immuable du pur Sujet, ces variations provenant de la manière dont l’expérience mystique dite « Quatrième » (turīya) se répand sur les trois états ordinaires de veille, de rêve et de profond sommeil ; après les [155] avoir bien imprégnés lui seul subsiste, tout état ordinaire ayant pris fin.
L’individu de la voie inférieure découvre rarement le Quatrième état et ne peut reconquérir à volonté une illumination aussi fugitive que l’éclair. Malgré ses efforts il ne réussit à s’y maintenir ni durant le sommeil ni au cours de la veille lorsqu’il s’adonne à l’activité. Au sortir du ravissement, il retombe dans la dispersion, la vision objective reprenant ses droits. C’est que sa conscience empirique individuelle, même si elle est unifiée et apaisée, n’a pas disparu. Soi, énergie et Śiva restent encore distincts, leur fusion étant momentanée et imparfaite.
Dans la voie de l’énergie, en revanche, cette absorption étant plus profonde et plus stable, le mystique perçoit la présence divine non seulement en son cœur illuminé, mais en toutes choses, et bientôt c’est en Śiva qu’il voit et lui-même et les choses. Śiva, l’énergie universelle et son propre Soi fusionnent de mieux en mieux à mesure qu’il verse le Quatrième état, non seulement sur les trois états subjectifs comme dans la voie précédente, mais le fait pénétrer dans le flux et le reflux de la Vie universelle à laquelle il participe désormais. Bien qu’il jouisse fréquemment du Quatrième état et le conserve longtemps, ce n’est encore qu’un état, tandis qu’à l’apogée de la voie divine il n’y a plus de Quatrième état distinct des autres états, mais une unique modalité, la pure Science étant définitivement reconnue comme l’immuable Sujet 106 : en d’autres termes, la compénétration de Śiva, du Soi et de l’énergie est parachevée.
Les traités du système Trika décrivent toujours ces voies à partir de la plus élevée 107 comme une cascade d’efficiences décroissantes à mesure qu’elles s’éloignent de leur source. Si la grâce diminue en intensité, l’effort exigé de l’homme doit augmenter en proportion.
Dans la voie de Śiva, l’efficience (vīrya) est celle du [156] suprême Sujet dont la Conscience est indifférenciée (nirvikalpa) : suprême, elle est à l’origine de toutes les autres et constitue l’efficace de la pratique mystique (bhāvanā) propre à la voie de l’énergie, puis cette efficience, à un degré moindre, devient celle de la méditation, point culminant de la voie de l’individu. Il en va ainsi jusqu’aux dernières pratiques de cette voie.
Mais pour la commodité du lecteur nous suivrons l’ordre inverse en partant de l’homme ordinaire qu’entrave une connaissance limitée. Sur la lumineuse paroi de sa conscience déferlent sans répit les ombres que sont toutes ses énergies éparpillées et agitées, en sorte que, pas un seul instant, il ne prend conscience de Soi. Son expérience extériorisée et fragmentée lui cache en outre l’univers tel qu’il est en son essence, et le Seigneur lui apparaît comme transcendant, extérieur, hors d’atteinte. Il ignore en effet le Quatrième état, l’intériorité subtile de l’absorption parce qu’il est perpétuellement recouvert et voilé par les états grossiers de rêve, de veille et de profond sommeil.
La voie inférieure est à l’intention d’un yogin qui vit dans l’existence morcelée d’ordre sensible, au niveau de la dualité tout en s’efforçant de s’en dégager. Il n’a pas renoncé à toute considération personnelle et reste encore soumis au désir et à ses remous : attraction et aversion. Pour leur échapper, il vise à la juste connaissance de la voie de l’énergie à laquelle cette voie aboutit.
Comme la grâce dont il bénéficie reste faible, il surmonte avec difficulté nombre d’obstacles. Il s’efforce avec courage à mettre fin à une double impureté, celle de l’action en vue de l’utilité, et celle de l’illusion de la dualité ; ces impuretés ne laissent filtrer de la lumière consciente que ce qu’il faut pour les besoins d’une activité limitée.
Il cherche à libérer sa pensée des doutes et des conflits, à apaiser ses tendances centrées sur le moi afin de récupérer puis de déployer une activité noble et désintéressée et de parvenir à sa source, l’énergie divine. Pour ce faire, il développe la concentration aux différents niveaux que sont le corps, le souffle, la voix et l’intelligence ; il s’exerce sur ses organes, récite des formules sacrées, s’adonne à l’articulation [157] sonore, aux exercices de souffle, aux méditations et à des contemplations variées.
Il purifie ainsi ses diverses activités de leurs tendances à la dispersion en demeurant vigilant au cours de toutes ses occupations, dans la veille, dans le rêve et le sommeil profond. Mais comme cette purification ne s’étend pas à ses facultés supérieures ni à ses tendances inconscientes, il ne brisera ses liens qu’après la mort.
Peu à peu il réussit à se détourner de l’extériorité et de sa préoccupation à l’égard des choses. Il découvre avec ravissement la vie intérieure et tout son être s’y épanouit dans la paix et la félicité, sa connaissance devenant limpide et son cœur brûlant.
Mais il ne fait qu’effleurer la Réalité ; ses expériences, aussi extraordinaires soient-elles, sont fugitives, fragiles, et sa dévotion à l’égard de Dieu reste sensible. S’il commence à s’élever au-dessus des contingences, il n’est pas vraiment soulevé hors de son moi individuel.
Nombreux sont en effet les dangers qui le guettent : attraction des plaisirs de ce monde, ou des pouvoirs surnaturels. Manquant de vigilance et d’ardeur, il déchoit facilement du Quatrième état et pour recouvrer paix et stabilité, il doit déployer de grands efforts. En dépit de fréquentes défaillances, si la grâce se montre plus puissante, sa personne tout entière s’imprégnant peu à peu de la paix du Quatrième état glisse insensiblement à l’énergie purifiée puis à l’état de Śiva auquel il devient semblable.
Au départ la démarche purificatrice du yogin relève des organes (karana) parce qu’il va à la conquête de l’expérience totale de la vie mystique, de tout son être, et doué de ses diverses facultés. L’individu étant défini comme « celui que lient ses organes » 108 il appartient à ces mêmes organes de prêter leur concours à sa libération.
Grâce à cette pratique, l’ensemble des objets appréhendés est subordonné à la connaissance ; rempli par elle et se transforme en connaissance. À son tour celle-ci, redevenue limpide et transparente, accède au Sujet connaissant qui perçoit toute chose dans le miroir de la Conscience immaculée109. [158]
Mais dans la voie inférieure, lorsque le yogin reprend contact avec sa propre essence consciente, ses organes sensoriels, son souffle, son intelligence étant purifiés l’aident à accéder au Soi. Abhinavagupta explique de quelle manière dans son Tantrāloka (V. 10-19).
Si l’intelligence orientée vers l’objectivité inconsciente ne cesse de discriminer interdit et admis, dès qu’elle s’absorbe dans la Conscience, elle conduit au recueillement. De même le souffle (prāna) naturellement inconscient et divisé, aussitôt pénétré de conscience devient souffle spirituel ascendant. Le corps inconscient dont l’activité est impure, aussitôt éclairé par la Conscience, s’exprime à travers des organes purifiés.
Ainsi l’ensemble des exercices de la voie inférieure sert essentiellement à écarter le déterminisme qui étouffe la conscience au niveau de l’objet et à dissoudre cette portion d’inconscience qui réside dans le corps, dans le souffle et dans l’intelligence pour ne laisser régner que la Conscience.
L’être doué d’intelligence, de souffle et de corps peut donc en se recueillant transformer ses pensées différenciatrices en une parfaite Conscience.
On peut se demander à ce sujet quelle valeur présente les pratiques du yoga aux yeux d’un Abhinavagupta et de ses maîtres. Leur position est claire, à condition de distinguer avec précision les niveaux de la réalisation : « Les exercices en vue de la libération s’adressent aux êtres qui, agissant sous l’influence de l’attraction et de la répulsion, ne peuvent pénétrer dans l’Essence divine faite de grâce. Restreints par la nécessité, ils ont recours à l’exercice et à des pratiques variées. » (T.S. XVI p. 167-168.)
Nous verrons que dans la voie supérieure de l’énergie, ces disciplines doivent être rejetées y compris le samādhi avec, comme exception, la connaissance issue du discernement, pour la raison qu’elles sont bien incapables de révéler la Conscience.
Quant au yogin à l’intelligence émoussée — contrairement au grand yogin qui se passe de tout intermédiaire pour jouir de la suprême efficience — il doit grimper d’efficience en efficience jusqu’à leur source, à savoir l’absence de pensée discursive. Néanmoins tous les moyens [159] qu’il utilise, s’ils sont exempts d’efficience réelle (vīrya) ne sont pas sans posséder une certaine puissance à l’instar d’un eunuque qui, bien que privé d’efficience virile (vīrya), n’est pas dénué de force comme l’est un cadavre. (T.A. V. 158)
Dès lors les différents membres du yoga s’étendant de la posture aisée jusqu’au samādhi prennent dans certains tantra un sens tout autre que dans les Yogasūtra.
Ainsi l’āsana, défini dans les Yogasūtra comme « une posture aisée et stable grâce à la détente de l’effort et à la mise à l’unisson et qui permet au yogin d’échapper au couple des contraires » (1, 46-48), devient une posture unique pour le Netratantra : « Prendre ses assises à la jonction de l’inspiration et de l’expiration, dans le souffle du milieu, et là, établi en une parfaite vigilance, on s’empare de l’énergie cognitive. » (VIII. 11, 18.)
Le prānāyāma, contrôle du souffle, est dans les Yogasūtra (49-53) une rupture entre le processus d’inspiration et d’expiration ; le mouvement du souffle externe, interne ou suspendu étant réglé quant au lieu, au temps et au nombre devient long et subtil. Le quatrième prānāyāma 110 se réfère aux domaines externe et interne. Alors le voile couvrant la lumière de (la connaissance discriminatrice) diminue peu à peu et la pensée devient apte à se concentrer.
De son côté le Netratantra précise, à un niveau bien supérieur : « Le véritable contrôle du souffle dans la voie de l’intériorité a pour but de mettre fin aux modalités grossières des souffles inspirés et expirés, puis à celle du souffle intérieur pour obtenir la suprême vibration par-delà le subtil. On se tient alors constamment au Centre, sans plus en déchoir, en intériorisant le souffle durant l’ascension de l’énergie udāna connue sous le nom de kundalinī. »
Une telle élévation du souffle intériorisé n’a lieu que chez un yogin en samādhi, parvenu au niveau du pur Sujet conscient.
Ainsi le pranayāma n’apparaît plus comme un contrôle du souffle dans un parfait repos capable de protéger contre les rumeurs du monde extérieur. C’est l’efficience de la Vie, une vie toujours égale à elle-même comme le dit si bien Mahesvarānanda : « Que l’efficience se mette en [160] action ou demeure en repos, pour reconnaître sa propre Réalité, il faut interpréter le contrôle du souffle comme l’abolition des événements extérieurs. » (43). Les événements disparaissent aux yeux du yogin en ce sens qu’ils ne se déroulent plus hors du Soi — ils ne sont plus que le jeu de sa propre puissance.
Pratyāhāra est le retrait des organes. D’après les Yogasūtra (54-55), dès qu’elles ne sont plus en rapport avec leurs objets spécifiques, les fonctions sensorielles suivent pour ainsi dire la nature de la Conscience ; c’est la rétraction dont procède le parfait assujettissement des sens. Dans le Netratantra la rétraction apte à briser les liens qui rattachent au devenir concerne non point les organes en relation avec des objets externes, mais les organes intériorisés devenus infiniment subtils à l’issue du prānāyāma compris comme il se doit. Leurs objets sont des tourbillons de qualités, sons et lumières extraordinaires, surgissant sans cause extérieure, et perçus uniquement par le cœur. « Dès qu’on s’en détourne et qu’on pénètre dans le suprême séjour à l’aide de son propre cœur, c’est ce qui sous le nom de “rétraction” tranche les liens du devenir. »
Quant aux membres supérieurs du Yoga que sont dharana, dhyāna et samādhi, les Yogasutra en donnent la définition suivante : « La concentration est fixation de la Conscience sur un point. La méditation est unification des idées sur ce point. Quand la Conscience se vide pour ainsi dire de sa propre forme, et se manifeste comme la chose en soi, c’est le samādhi, l’absorption. » (III. 1-3.)
Le Netratantra intervertit l’ordre des deux premiers membres, commençant par dire ce qu’est dhyāna au sens de « recueillement » : « La suprême Réalité ne peut être objet de méditation. Ce que les éveillés considèrent comme la véritable méditation au-delà des qualités de la pensée, c’est méditer (se recueillir) sur la suprême Réalité en tant que le (pur Sujet) dont on a l’expérience immédiate. »
Aussitôt le Soi découvert en son propre cœur, le yogin passe à la concentration (dhāranā) : « Dès que le Soi suprême est perpétuellement “fixé” (dhr), une telle “centration” fait obstacle aux liens du devenir. » Par elle on « retient » pour toujours la Conscience suprême.
Succède alors un samādhi d’ordre cosmique : « La Conscience de l’égalité en soi-même et en autrui, dans les éléments et dans le monde entier quand on réalise “je suis Śiva, je suis sans-second”, c’est là ce qu’on reconnaît comme la suprême égalisation, à savoir le samādhi ou absorption dans la Réalité absolue. »
Le point culminant de la voie de l’individu est une méditation qui, intellectuelle d’abord, s’achève en une contemplation d’ordre mystique et conduit à la pacification et au repos du cœur (cittavisrānti).
Le Vijñānabhairavatantra définit ce qu’est la véritable méditation :
« Un intellect inébranlable, sans aspects ni fondement, voici en vérité ce qu’est la méditation, mais la représentation imagée de divinités nanties de corps, d’organes, de visages, de mains, n’offre rien de commun avec la vraie méditation. » (146.)
Et le verset 49 où Śiva s’adresse à la Déesse Énergie : « O Bienheureuse, celui qui, les sens anéantis dans l’espace du cœur, l’esprit indifférent à toute autre chose, accède au milieu de la coupe bien close des lotus atteindra la faveur suprême. »
Car d’après un autre Tantra : « Si la Conscience omniprésente remplit le corps entier, elle a pour résidence éminente l’océan du lotus du cœur. »
Pour qu’on puisse pénétrer dans le cœur, le souffle doit y prendre son repos hors de la portée des sens, entre les deux mouvements des souffles inspiré et expiré. En ce repos, un instant durant, ces souffles s’équilibrent, s’arrêtent, ce qui produit l’ouverture du lotus du cœur. » (P. H. p. 217.)
Abhinavagupta l’explique en détail (T. A., V. 21) :
Qui connaît la Réalité du Soi voit directement cette Conscience dans le cœur en allant de l’extérieur jusqu’à la portion intime, tout comme, écartant tour à tour les pétales de la fleur kadali ayant l’aspect de deux coupes entrelacées, on atteint le centre, l’odorant pollen.
Au cours de cette méditation on progresse du grossier au subtil puis au suprême, sanctuaire du cœur où le Soi resplendit.
Là se révèle la Conscience omnipénétrante, car, précise Abhinavagupta :
« C’est dans la grande fosse sacrificielle appelée “cœur” que brille avec profusion le feu du puissant Bhairava [162] quand on frotte les deux planchettes 111 et qu’on se concentre uniquement sur cette friction qui unifie toute triplicité — lune, soleil et feu, symboles des souffles inspiré, expiré et ascendant, ou de l’objet connu, de la connaissance et du sujet connaissant. À l’aide de la flamme resplendissante de Bhairava — feu ou Sujet pur — douée d’une intense énergie qui s’épanouit au Centre, on réalise toutes les triades des énergies perpétuellement surgissantes comme fusionnant en pleine indifférenciation de sujet, d’objet et de connaissance. » (22-25.)
.
Le yogin réside dans le Quatrième état dès que la dualité n’est plus. À partir de cet état contemplatif, il se tourne vers le monde externe et, par l’entremise de ses facultés purifiées, il commence à percevoir Śiva jusque dans son activité ordinaire. Il s’adonne alors à la pratique de la roue des énergies conscientes :
« Vivre dans l’indifférencié, même quand le différencié se déploie, c’est là le suprême et soudain “rugissement” d’un yogin. » (V. 127.)
« Au moment où le yogin a l’expérience immédiate du Soi indifférencié, rayonnant de lumière consciente, ses organes internes de connaissance — la pensée qui repose en sa propre essence, ainsi que l’ensemble des organes sensoriels qui en dépendent — lui prêtent leur concours pour pénétrer dans le Soi ultime révélé en toute sa splendeur. À ce moment les objets des sens et les impressions de plaisir et de douleur apparaissent avec intensité au yogin qui, enrichi par les rayons de ses organes pleinement épanouis, s’adonne à faire surgir tout cela comme très évident, mais sans la moindre différenciation. Oh ! combien digne de recherche est une telle Réalité ! »
.
Celui qui médite sans interruption sur le processus d’émanation, de permanence et de résorption comme identique à sa propre conscience s’identifie à Bhairava et réalise ainsi le Soi à la lumière de la Roue des énergies conscientes.
À travers la Roue de feu dont le centre est le cœur, le yogin qui a découvert l’intériorité va la répandre dans le monde objectif en un premier moment d’émanation, puis il la manifeste de manière durable en tant que connais [163] sance et la résorbe en tant que sujet connaissant. Pour que cette Roue atteigne sa plénitude indifférenciée, le yogin doit dissoudre les imprégnations de la dualité qui demeurent encore. Il contemple alors ses facultés revêtues de la nature divine, tandis que la roue s’apaise peu à peu et finit par atteindre un calme définitif.
Mais au début le yogin se concentre sur la roue afin de percevoir son tourbillonnement dans ses diverses activités s’il entend un son, par exemple, il doit, inébranlable comme l’axe indivisible planté en plein centre, percer jusqu’au cœur sans perdre conscience de Soi. (M. M. 53.)
Les divers efforts de l’individu cheminant dans cette voie tendent au grand sacrifice où l’ensemble des impressions du monde connaissable est versé en guise d’oblation dans le brasier de la suprême Énergie. Le nectar qui en découle imprègne l’univers de vie et de félicité. « À défaut d’une telle oblation, dit Abhinavagupta, l’univers n’est que tourment. » (V. 66.)
Mais pour offrir ce sacrifice un yogin doit renoncer à son être individuel ; il doit contempler perpétuellement l’énergie divine en son essence plénière comme identique au Seigneur. Car c’est de l’union béatifique de Śiva et de l’Énergie que jaillit l’univers sous forme de nectar, un même et seul nectar qui réside en nous et hors de nous.
Pour que le yogin pénètre dans la suprême Réalité et s’établisse dans l’état par delà appropriation et rejet, il doit, grâce au ravissement éprouvé en sa conscience, percevoir l’univers en son indifférenciation ; et, délaissant le piteux état dû à l’activité intentionnelle tournée vers l’objet en vue de son utilité ou vers ses impressions de plaisir et autres, parvenir au repos de sa propre essence. (74-76.)
La voie de l’individu mène à celle de l’énergie quand, ses organes apaisés, le yogin n’a pas même l’idée de se concentrer sur le prodige inouï qui le ravit :
« Toutes les agitations sensorielles ayant disparu quand il s’unit à la grande et imprévisible merveille, il demeure dans la surabondance au sein du flot des rayons de la roue de ses organes bien unifiés, sans se soucier de rien, et perçoit clairement les choses. La Conscience à laquelle Il accède alors est telle que ses étincelles suffisent à réduire en cendres la demeure du devenir. » (84-85.) [164]
Il commence à entrevoir l’univers en son indifférenciation, transfiguré, reconnu en tant que moelle précieuse de la pure Conscience.
« Ces êtres, dit Abhinavagupta, éprouvent un véritable ravissement jusque dans leurs activités journalières. Ils reposent uniquement dans le Soi. »
Lorsque cette contemplation comporte une pratique et un exercice vigilant, elle ne dépasse pas la voie de l’activité. Avec la voie de la connaissance, l’opération des énergies est spontanée : « Partout où va le yogin, dit un verset, l’ensemble des roues tourbillonne autour de lui comme un essaim d’abeilles autour de sa reine. » (T.A. V. 30.)
À son stade suprême, cette contemplation conduit à la voie divine : « Celui qui, à chaque instant, dissout l’univers dans sa propre conscience et l’émet à nouveau s’identifie pour toujours à Bhairava ; il est libre comme lui d’émettre et de dissoudre l’univers. La Conscience se révèle alors à lui en toute sa gloire. » (V. 36.)
La voie inférieure offre au yogin bien apaisé, et à lui seul, à mesure qu’il découvre la vie intérieure et mystique, des étapes successives de paix et de félicité extraordinaires sans qu’il ait à quitter son cœur pacifié pour entrer en contact avec le monde externe. Il peut à son gré tirer à soi un monde tout vibrant de conscience dans un échange de félicités qui fusionnent en une parfaite unité, culminant en la flamme qui consume toute contingence et toute inconscience. Ainsi l’incomparable Roue aux multiples énergies parfaitement unifiées vibre à une telle rapidité sans laisser de demeurer immuable.
Cette voie comporte aussi une série d’expériences à la fois « signes » du cheminement purificateur et phases de la vibration (spanda) ressenties par le yogin dans les divers centres 112 de son corps subtil. Ce sont : félicités, sauts, tremblement, sommeil spécifique, oscillation de l’ivresse qui ne sont que les réactions d’un yogin à mesure que la Réalité effleure successivement les centres. Aussi longtemps qu’il n’a pas la maîtrise des centres, il supporte difficilement ces touches de la Réalité. [165]
La voie qui met en jeu l’énergie se situe au niveau de la connaissance en tant que moyen de parvenir à l’union. Elle s’adresse à des êtres privilégiés qui, bénéficiant d’une grâce plus puissante que la grâce de la voie inférieure, accèdent à une conscience bien intériorisée et à un cœur illuminé.
Si la voie divine est celle de la nudité et de la transcendance, la voie de l’énergie est celle de la surabondance et de l’immanence. En ceci consiste la grande différence qui caractérise ces deux approches. La voie divine, en effet, concerne uniquement Bhairava, l’essence divine renfermant toutes les énergies fondues et unifiées.
Radicalement opposée, la voie de la connaissance adore un Dieu personnel corrélatif à l’univers, car elle insiste sur les qualités divines comme la majesté, l’omnipotence, l’omniscience… Et ce Dieu nommé Maheśvara, substrat d’innombrables qualités ou énergies, se révèle par ces qualités même lorsque l’adorateur prend intensément conscience de l’une de ces énergies ou d’un grand nombre d’entre elles. « Maheśvara, doué de toutes les énergies, est tout-puissant, libre, car il ne dépend pas pour agir d’une chose qui lui serait extrinsèque. Omniscient, omniprésent, éternel, il possède les énergies de connaissance, de différenciation et d’activité. De multiples façons il manifeste librement ses énergies et, par là, toute la diversité de l’univers. Sa liberté, qui ne diffère nullement de sa nature même, consiste à engendrer la diversité dans l’unité et l’unité dans la diversité. Par son énergie cognitive, il fait surgir simultanément sujet connaissant et objet connu. L’énergie différenciatrice manifeste les reflets que sont individus et choses, non seulement comme séparés de la Conscience absolue, mais encore comme séparés les uns des autres113. »
Abhinavagupta marque la différence entre Paramaśiva — l’absolu — et Iśvara, ce dernier manifestant l’objectivité globale indifférenciée (prameya), sans expression verbale, et identique à la Conscience. Mais en Paramaśiva, point de prameya, le flot des choses étant complètement immergé en lui qui est Conscience et félicité indivises, pure unité caractérisée par le repos dans le Soi.
Jîlî, nous le verrons, fait une distinction analogue entre l’unité de l’Essence et l’unicité divine dont toute qualité relève114. [166]
L’obstacle à l’épanouissement d’une énergie unifiée et libre ne réside plus comme précédemment en des activités dispersées, mais dans la seule pensée à double pôle, le vikalpa — doute, dilemme ou hésitation qui paralysent la prise de conscience de l’unicité et ne permettent pas d’adhérer à la Réalité.
Il faut donc substituer aux notions rigides et desséchées le sentiment vif du réel, en faire d’ardentes convictions, des certitudes indubitables : la pensée purifiée devient alors acérée, efficiente et s’oppose victorieusement aux convictions erronées.
Le yogin commence par dissocier les structures portant sur les connaissances liées au langage et dont dépend l’attachement à l’objet. Il se fore un chemin entre deux idées opposées (vikalpa) et l’énergie qui les alimentait étant récupérée, elle se trouve tellement intensifiée qu’elle efface à son tour la dualité. Ainsi remonte-t-on à la source de l’énergie consciente et l’on secoue les structures du moi jusqu’en leur fondement pour que le Soi, dégagé de toute détermination, recouvre son universalité.
Mais une telle œuvre ne peut s’accomplir tant que subsiste ce qui alimente les doutes et dilemmes, à savoir les prédispositions latentes, les complexes et tendances profondément enfouis, issus d’un lointain passé. Il faut faire remonter à la surface ces résidus afin d’agir sur eux et, par un discernement subtil que soutient l’énergie, les rendre saisissables puis finalement les dissoudre.
Sont ici constamment indispensables zèle, ardeur et vigilance pour purifier la conscience de ses ultimes impressions de dualité.
Cette voie utilise dans ce but une vision lucide, une Raison intuitive (sattarka) bien exercée, apte à discerner le véritable maître susceptible d’enseigner le droit chemin et qui, non seulement assure la libération des liens, mais rend à la connaissance son éclat indifférencié.
« Ceux qui savent, déclare Abhinavagupta, tranchent à la racine l’arbre fourchu de la funeste différenciation avec la hache de la raison intuitive aiguisée au plus haut degré et accèdent à la certitude. » (T. A., IV. 13.)
À l’issue d’une investigation progressive toujours plus subtile, ils ne voient plus que l’unicité tant leur conscience est lucide, dynamique et globale ; l’intelligence, purifiée, leur révèle en pleine évidence l’essence indifférenciée. À ce sommet, le sattarka s’achève en éveil (bodha).
Puisque cette voie tend à la simplicité et à l’indistinc [167] tion, on comprend que toutes les pratiques décrites par les Yogasūtra — prohibitions, postures, exercices du souffle, rétraction des sens et de la pensée, méditation, concentration et jusqu’au samādhi — ne soient d’aucune utilité pour réaliser la Conscience : elles ne servent qu’à éliminer les tendances opposées et, tout au plus, à favoriser le discernement. En effet, toute pratique a pour but d’acquérir ou de perfectionner quelque chose, et la Conscience est parfaite en soi, et déjà toute acquise. Seule la connaissance issue du discernement offre une aide, car « elle consiste en une prise de conscience dynamique d’une extrême acuité et qui va s’intériorisant toujours davantage » (T. A., IV. 86), et finit d’ailleurs par rejoindre la pure science (suddhavidyā).
Abhinavagupta considère le retrait des sens et de la pensée comme un exercice arbitraire et néfaste « qui ne fait que resserrer intérieurement le lien de ce qui n’a jamais été lié », à savoir la libre Conscience (92), tandis que le véritable pratyāhāra consiste à oublier radicalement la libération même, étant donné qu’aucune entrave ne lie les êtres.
À la question : à quoi bon mentionner les membres du yoga s’ils ne servent à rien, Abhinavagupta répond que chacun d’eux fournit une aide pour atteindre le membre supérieur et parvenir finalement au véritable discernement (sattarka). Quant aux membres qui ne concernent que le corps et la conscience individuelle, ils ont pour seule fin de fortifier le corps ou d’obtenir la maîtrise mentale.
Mais ces membres du yoga, y compris les plus élevés, sont absolument inefficaces en ce qui concerne l’essentiel pour la raison que le processus se trouve inversé, car en réalité ce ne sont pas les divers membres qui mènent à la Conscience.
Abhinavagupta déclare :
« Ce qui est bien établi intérieurement dans la Conscience peut, par l’intermédiaire de cette même Conscience, être transmis au souffle, à l’intelligence, au corps sous forme de pritetyâma, etc., non point par le procédé opposé. » (IV. 97.)
Et il cite à ce sujet le Viravalîtantra pour montrer que ce ne sont pas les exercices de souffle qui suscitent l’absorption de la Conscience, bien au contraire : « Par l’absorption de la Conscience, les souffles inspirés et expirés s’immergent en Śiva, pure et simple Conscience, et le soleil de vie parvient au sommet de notre propre Cons [168] cience. Voici ce qu’on appelle la véritable délivrance, en laquelle le contrôle du souffle ne joue aucun rôle. » (T. A. IV 89-90.) Alors toute la dualité se dissout dans le Centre ou voie médiane et le yogin jouit de la lumière consciente. De là, le conseil d’Abhinavagupta : qu’on ne s’adonne donc pas au contrôle du souffle qui ne fait qu’épuiser le corps (91).
.
Ces pratiques ne sont plus, dès lors, que le comportement spontané du libéré vivant et prennent donc un sens entièrement nouveau.
Utpaladeva chantait de même : « La grande fête de Ton Union n’est obtenue qu’en repoussant l’effort de la méditation. Telle est, dit-on, la véritable manière dont adorent les Amants. Qu’elle soit mienne à jamais ! » (S.U., XVII, 4.)
Et al-Hallāj : « C’est Toi mon ravisseur, ce n’est pas l’oraison qui m’a ravi ! Loin de mon cœur l’idée de tenir à mon oraison ! L’oraison… Te dérobe à mes yeux, dès que ma pensée s’en laisse ceindre par mon attention » (Dîw. a. 35.)
La contemplation de la roue des énergies montre comment cette voie, qui est celle des richesses spirituelles les plus élevées, atteint à la simplicité et à l’unité du Soi. Lorsque doutes, actes figés et fluctuations conscientes disparaissent, la roue des énergies perd ses mouvements lents et saccadés, et se met à tourner à une vitesse prodigieuse, dissolvant ainsi les ultimes vestiges inconscients de la dualité. Alors, toutes les énergies purifiées et intensifiées convergent spontanément dans l’unité par delà les distinctions et fusionnent à leur source, le Centre apaisé de la roue. Le yogin habile à se tenir dans le moyeu immobile ne perçoit plus de rayons distincts, la diversité ayant fondu dans l’énergie vibrante et indifférenciée du Soi.
Mais si, se dirigeant vers la périphérie — le monde sensible appréhendé à travers ses organes sensoriels —, son contrôle sur la roue se relâche, la roue ralentit et les multiples énergies réapparaissent, tendant à se cristalliser autour du moi. Il lui faut donc retourner au Centre, en pleine intériorité, puis ouvrir à nouveau les yeux à l’univers sans que son absorption en Śiva ne soit lésée : « Si, à l’aide du Cœur, tu projettes vision et toutes les autres énergies simultanément et de toutes parts sur leurs objets respectifs (couleur, odeur, etc.) en demeurant fermement fiché comme un pilier d’or au milieu même de (tes activités), (169) tu apparais alors comme l’unique, le fondement même de l’univers. » (P. H., sutra 18.)
Vu qu’il n’est pas facile de se tenir là, il faut replonger en soi-même sans se lasser afin que l’état devienne permanent. Le yogin découvre ainsi en son propre cœur une énergie universelle pleine de béatitude et qu’accompagne une efficience sans entrave.
.
Grâce à cette pratique, l’univers ayant pénétré dans la conscience et la conscience dans l’univers, le mystique jouit spontanément d’une véritable adoration : toute son activité n’étant plus qu’adoration, sans préparation du corps, ni de l’attention, ni du souffle et de la parole, les courants différenciés des facultés spirituelles réunies au Centre dans la Conscience divine peuvent se répandre partout sans encourir aucun dommage.
Dès qu’il s’abandonne à la pulsation du Cœur, à son flux et à son reflux, l’alternance asservissante entre les deux pôles opposés — le vikalpa — n’est plus que le jeu divin d’épanouissement et de rétraction auquel participe ce grand yogin qui se tient ferme au Centre immuable du Cœur vivant de l’univers, où tout est nécessairement pur, où tout s’égalise : « Hommage à Lui (Śiva) que contemple l’amant au cœur débordant d’Amour, alors même qu’il se trouve engagé dans les états les plus variés » chante Utpaladeva (XIV, 21).
Extraordinaire est donc l’homme capable d’une telle adoration et qui accède à la Réalité du Soi en sa nature indivise : « L’abeille, et non la mouche, dit Abhinavagupta, apprécie au plus haut degré le parfum de la fleur du keterka ; de même, combien est exceptionnel celui qui, incité par le Souverain, s’éprend de la suprême adoration sans dualité de Bhairava ! » (T. A. IV, 276.)
.
Après avoir tourné en ridicule les divers rites du culte, Abhinavagupta définit ce qu’il considère comme la véritable adoration ne comportant aucune restriction :
« Quant à l’adoration, qu’on l’accomplisse uniquement à l’aide de tout ce qui épanouit la pensée… La moelle de la Conscience n’étant que liberté et la liberté que masse de félicité, les activités d’adoration en vue de s’y identifier sont celles qui dispensent au cœur la joie ; quelles que soient les substances, les qualités, leur nature imaginaire ou réelle, dès qu’elles sont source de joie, elles mèneront au Bien suprême.
« Que, pour vénérer le suprême royaume, l’être éveillé [170] offre le suc que distille l’ensemble des choses, dont la plénitude est due à leur identité à Śiva. C’est là ce que j’ai souvent exprimé en un hymne :
« Reposant dans la Lumière consciente qui flue de la nature ultime, à l’aide de la vision de l’immortel nectar qui fulgure de splendeur, je T’adore, ô Toi qui connais Tes secrets mystiques !
« Aspergeant à tout moment le réceptacle terrestre, je T’adore avec les gouttelettes du suc de mon émerveillement, avec les fleurs spirituelles et innées qui exhalent leurs propres joies.
« Mon Dieu uni à la divine Énergie, je T’adore jour et nuit dans la demeure de (mon) corps, avec la très précieuse coupe de mon cœur débordant du nectar de félicité.
« Ayant jeté de très haut le lourd fardeau de la discrimination et pressé, pour en extraire le suc, le triple univers aux innombrables saveurs et attraits, cet univers ordonné à la machine de la roue du cœur, avec le flot qui s’en écoule — ce suprême nectar de la Conscience destructrice de la naissance, de la vieillesse et de la mort —, c’est avec lui, en guise de suprême oblation, que je T’assouvis nuit et jour, ô Suprême » (T. A. XXVI. 54, 5865).
Les diverses pratiques du culte sont spiritualisées :
« Le véritable culte consiste en l’unification des torrents des modalités différenciées qui s’identifient à la Conscience infinie, libre et immaculée de Bhairava. » (T. A. IV., 122.)
Il n’y a d’autre oblation (homa) que le sacrifice de l’univers entier ainsi que de son propre corps, ses organes, sa pensée et les objets, versés en guise d’offrandes dans le feu de la Conscience ultime, le cœur illuminé faisant office de cuiller sacrificielle. (V. B. vers. 149.)
Plus profondément encore d’après Abhinavagupta :
« Sans aucun combustible, brûle perpétuellement en nous le feu flamboyant de tous les organes sensoriels quand le feu de la Conscience pénètre les modalités de l’univers et que celles-ci s’enflamment toujours davantage, effectuant ainsi l’oblation au feu ». (T. A. IV., 201.)
« Pour ceux qui réussissent à reposer paisiblement dans cette oblation, tout le tintamarre dérisoire du devenir fond spontanément, comme un tas de neige à la saison chaude. » (IV., 277.)
Le renoncement s’effectue ici à même les activités mondaines ; on se détache peu à peu du moi en précipitant les vestiges de la dualité dans le feu de l’énergie consciente. (171)
Mais ce n’est point encore l’abandon total et définitif allant jusqu’à l’anéantissement du moi, propre à la voie de Śiva.
À propos du comportement des renonçants qui cheminent sur la voie de l’énergie, Abhinavagupta donne l’exemple suivant : comme un cheval non entraîné, attaché à un pieu, tourne en rond à travers maints accidents de terrain en obéissant à la volonté du cavalier, jusqu’à ce qu’il soit un cheval bien entraîné, habile à courir en tous lieux, ainsi la conscience, grâce à maints détours — expériences paisibles, effroyables, etc. —, abandonne la dualité et s’identifie à Bhairava (IV. 205-206).
Alors toutes les choses s’égalisent et ne font qu’un : il n’y a plus ni pur ni impur, ni dualité ni non-dualité, de sorte que les diverses pratiques — vœux, initiations, pèlerinages, bains — ne sont ni prescrites puisqu’elles ne mènent pas directement à Śiva, ni défendues puisqu’elles ne peuvent introduire la moindre fissure dans la Réalité indivise (213, 270). Quelle que soit l’activité, il n’y a d’autre obligation que de fixer paisiblement son cœur sur la Réalité, peu importe la manière. Est considéré comme impur ce qui est éloigné de la Conscience, et comme pur ce qui permet de s’identifier à elle (242-243).
Qui veut pénétrer dans la suprême Réalité, qu’il prenne la voie qui lui est la plus proche et délaisse toute autre. Point ici de contrainte, car l’école Trika proclame l’égalité des divinités, des traités, des chemins, tout étant Śiva.
Maître Eckhart, citant une parole de saint Paul : « Tous les hommes ne sont pas appelés à Dieu sur un seul chemin », disait de même : « Si donc tu trouves ton chemin le plus proche, ne passe pas par beaucoup d’œuvres extérieures ni par de grandes peines et privations — en lesquelles d’ailleurs il n’y a tout simplement rien du tout de grand… si tu ne trouves rien de tel en toi, reste tout à fait en paix et ne t’en occupe pas davantage. » (P. 180.)
Cette voie de l’immanence insiste sur l’harmonie d’un monde en lequel s’égalisent intérieur et extérieur et que transfigure l’énergie divine à mesure qu’elle se dévoile comme le pénétrant intégralement. Mais si les limites s’élargissent à l’infini, elles ne tombent pas définitivement pour autant, le mystique ne se perd pas dans l’essence « nue » 115 de la divinité (paramaśiva) ; il reste au niveau des qualités divines inhérentes à l’énergie, telles l’immortalité, la puissance, la majesté… [172]
Le Vijñānabhairava tantra déclare à ce sujet :
« Éternel, omniprésent, sans support, omnipénétrant, souverain de tout ce qui est… Méditant à chaque instant sur ces mots, il en réalise le sens conformément à l’être signifié (Śiva). » (st. 133.)
Bien que différente en ceci de la voie de Śiva, la voie de l’énergie peut y conduire. Abhinavagupta montre comment : « Ceux qui adorent le Seigneur omniprésent en aiguisant leur pensée sur l’un des attributs ou sur tous réunis, se révélant à l’intérieur de leur pensée au préalable purifiée, finissent par reposer dans le substrat des attributs qui les contient en leur totalité indifférenciée. De même, d’un objet, on a d’abord une vision partielle de ses qualités puis une conscience globale et indivise. » (1. 200.) Śiva peut donc être révélé par ses diverses énergies ou par ses qualités, vu que l’énergie est le moyen de s’identifier à Lui : « Selon leur proximité à la Conscience de l’être adoré, les uns embrassent des énergies en nombre limité, les autres en nombre infini. Ce processus relève du chemin de l’énergie propre à la pensée différenciée ; mais il n’y a rien de tel dans la voie divine. » (I. 70-76 et 207.)
Utpaladeva l’exprime clairement en ces vers adressés à Śiva :
« Même si Ton Soi est bondé d’attributs distincts et même s’il est atteint par une gradation de moyens, Il se manifeste pur d’attributs et une fois pour toutes à ceux qui partagent Ton Amour. » (XVI. 2.)
Si le yogin qui parcourt la voie inférieure parvient au seuil de la Raison intuitive et du bon discernement, le présent mystique, grâce à ce discernement, passe par-delà toute connaissance quand, au seuil de la voie divine, jouissant d’une grâce des plus intenses, il est prêt à s’élancer dans l’Un jusqu’à l’Essence, toutes ses énergies étant libérées et harmonisées ; son unique désir échappant au dilemme, à l’hésitation, se montre si intense qu’il entre dans la voie supérieure de l’indifférencié. Mais si le mystique ne bénéficie que d’une grâce moyenne et ne quitte pas la voie de l’énergie, s’il s’attache à la contemplation des attributs divins et s’il possède encore une vue réfléchie sur lui-même, sa conscience personnelle, bien qu’éveillée, ne disparaîtra pas entièrement et l’accès au Cœur universel ne s’effectuera qu’à de rares moments. Après la mort seulement il pénétrera en Śiva et jouira de la gloire universelle.
La voie inférieure a de nombreux appuis : activités des organes, exercices de souffle, énonciation de syllabes, recueillement, etc., tandis que la voie de l’énergie repose sur l’énergie cognitive du mystique qu’elle prend pour tremplin, mais qu’elle ne réussit guère à quitter pour s’élancer définitivement dans l’Un.
La voie de Śiva est une voie sans appui, sans effort, sans recours aux facultés ; c’est la voie du pur désir, de l’intention nue ; elle tend vers Śiva seul, non vers son énergie ou ses attributs, et ne recourt pas à l’énergie afin de s’élancer vers lui. En effet, pour le jñānin qui suit cette voie, la libre énergie de la Conscience est inséparable de Śiva, elle consiste en un acte absolu pris en son initiative qui ne dépend d’aucune condition limitatrice.
Voie de l’indifférenciation (abheda), et donc du vide de distinction, de détermination, de particularité, on la qualifie de nirvikalpa — sans dilemme, sans représentation puisqu’elle est antérieure à la bifurcation du sujet et de l’objet, et donc au-dessus de toute activité personnelle, comme de connaître, de vouloir et d’aimer.
Voie de l’outrepassement, elle s’adresse uniquement à l’être ardent plein d’Amour divin (bhakti) qui n’aspire qu’à l’Essence simple et nue. La grâce dont il jouit est tellement abondante qu’elle l’entraîne sans qu’il puisse discriminer, par-delà toute certitude intellectuelle. Et pourtant c’est en pleine évidence, celle de la Réalité saisie à l’instant même où elle émerge, qu’un puissant bond du cœur l’enlève jusque dans l’Essence unique. Sans vivre ce premier moment, sans se tenir à même l’ébranlement intérieur du cœur, on ne peut jouir d’une conscience vigilante ni s’établir dans l’indifférencié.
Cet élan doit son intensité à ce qu’il ne renferme aucune division. Dès lors il atteint tout, connaît tout, peut tout, la totalité étant essentiellement indivise.
Comme c’est dans l’unicité de cet instant d’élan que tout se joue, on comprend l’importance accordée dans les Śivasūtra à l’essor vers l’Absolu où la voie de Śiva se trouve condensée : « Udyamo bhairava » déclare un de ses aphorismes (I, 5) : « l’élan est la divinité indifférenciée ». Le commentateur précise : « Cet élan est l’émergence de la suprême illumination, le soudain essor de la Conscience sous forme d’une prise de conscience de Soi ininterrompue, de ferveur innée intériorisée. Comme toutes les énergies [174] y fusionnent, cet élan est bhairava — Conscience divine indifférenciée —, car il jaillit chez les êtres débordants d’Amour et doués de vigilance à l’égard de cette Réalité intériorisée. »
À ce haut niveau, indéfinissable est la bhakti, Amour triomphant qui arrache le yogin à lui-même et le précipite dans l’Un. Il n’a rien de l’amour entaché de dualité des voies prédédentes. Sans effusion, c’est en pleine nudité de l’aspiration, un élan de tout l’être vers un Dieu indicible pour ainsi dire aveugle, ce flot d’amour n’est pas sans une vigilance aiguë, non point celle de l’entendement, mais celle d’un cœur ardent qui se tient à même l’ébranlement de la volonté.
Les textes Śivaïtes comparent un tel élan à une flamme dévorante qui jaillit inopinément et consume à jamais toute trace de différenciation ainsi que les derniers vestiges du moi116.
Cet acte, le plus pur qui soit, est toute détente. Aussitôt apparu, il est parfait et livre accès à l’absolu par delà l’engrenage temporel. Soudain, imprévisible, il est semblable à l’éclair qui illumine le firmament, mais dont l’illumination ne disparaît plus. Par lui l’adorateur devient un « libéré vivant » pour lequel samsāra et libération n’offrent guère de différence, car, ayant réalisé son essence de façon définitive, l’esclavage fait place à une totale liberté.
Sa volonté, en effet, est une volonté divine, entière, actuelle, sans effort, sans rien de fortuit ou d’accessoire, une volonté qui est elle-même une nécessité. Elle ne diffère donc pas de l’énergie infinie et souveraine de Śiva. Le terme qui la désigne, icchā, signifie également désir, mais ce désir, saisi uniquement en son incitation, en sa source créatrice, est tellement épris d’absolu que, se tournant d’un bloc vers Śiva dans un élan fougueux, il écarte avec violence toute appréhension dictincte, il est soulevé jusqu’à l’Essence divine indifférenciée, libre de tout attribut, de toute qualité.
Un autre aphorisme des Śivasūtra (1. 13) définit la nature de cette très pure volonté comme l’énergie en sa source, icchā étant qualifiée de jeune vierge, Bien-aimée de Śiva ; vierge, car elle ne peut être que pur Sujet, jamais [175] un objet de jouissance, c’est-à-dire être « pour un autre » ; elle échappe donc à la contamination de la relation sujet-objet. Toute jeune, ingénue, elle folâtre, son jeu consistant à émettre et à résorber l’univers. Parfaitement détachée, elle s’adonne avec ardeur à adorer le Seigneur et à s’identifier à Lui. En réalité, elle n’est autre que la suprême Énergie aussi inséparable du Dieu que les rayons le sont du soleil ou la chaleur du feu.
Parvenu à une semblable union, toutes ses facultés rassemblées au Centre indifférencié, le yogin ainsi établi dans l’énergie infinie et vierge, voit le Quatrième état se répandre spontanément sur les trois autres comme un raz de marée qui inonde toutes les limites et dénivellations. Par la fusion de l’intériorité et de l’extériorité, il atteint l’égalité (samatā) qu’il décèle au sein même de l’élan. L’égalisation, en effet, ne relève plus du grand mouvement conscient de lente nivellation de la voie de l’énergie, elle réside maintenant à la source de la vision, dans le premier regard qui s’oriente vers le Soi ou vers le monde en une légère oscillation qui suffit à tout égaliser et en laquelle le yogin découvre sa glorieuse liberté. Il s’écrie alors avec Abhinavagupta :
« O Seigneur Bhairava, cette Conscience mienne danse, chante, se réjouit grandement, car dès qu’elle a pris possession de Toi, le Bien-aimé, l’accomplissement du sacrifice unique de l’égalité, si ardu pour les autres, lui est aisé. » (H. A., 51.)
Un tel sacrifice dit « de l’égalité » aplanit définitivement la rocailleuse dualité du devenir (samsarā) ; éternel et transitoire, pur et impur, illusion et Réalité, l’univers varié se reflète en tout son éclat dans l’harmonieuse Lumière consciente toujours identique à elle-même.
Le grand yogin recouvre ainsi sa gloire native dont l’expansion engendre un émerveillement qui caractérise les étapes de cette voie quand, du Centre immuable, il contemple toute chose à la lumière de l’unité, sur la paroi du Soi universel.
Un traité déclare en effet : Quand les fidèles connaissent le Soi par le Soi, c’est en leur propre Soi qu’ils éprouvent alors l’émerveillement. Et Ksemarāja précise que le yogin ne cesse de s’émerveiller des prestiges extraordinaires et toujours nouveaux qui affluent en lui dès qu’il pénètre dans la Conscience indivise. Il ne peut se rassasier de la félicité ininterrompue qu’il ressent en lui-même. (S.S.v. I. sūtra 12.) [176]
Rare est le héros dont l’amour au dénuement spontané, libéré de la dualité, rejoint en une fraction de seconde la Conscience indifférenciée en son premier ébranlement et parvient à s’y maintenir. (Bh., 40.)
Cette voie qui commence avec la grâce s’achève donc dans la gloire117. Mais n’est-ce pas à lui-même qu’en définitive le yogin accorde une grâce « de grand poids » 118 qui surgit des profondeurs du Soi, puisque au sein de l’ébranlement de la volonté, incitation divine et élan humain coïncident. À ce degré la grâce, donnée et reçue en un seul mouvement, est pure essence d’indétermination.
.
À la fin du troisième chapitre du Tantrāloka consacré à la voie divine, Abhinavagupta rappelle succinctement la disparition des contingences qui fonde la distinction des différentes voies :
« Les conditions limitatives apparaissent, dit-il, dès que la Réalité, de par sa liberté, se tourne vers l’extérieur :
259. D’après nos Maîtres, l’Essence qui transcende les conditions limitantes (upādhi) est double, soit que ces conditions n’aient pas encore apparu, soit qu’elles aient pris fin.
260. Double également, la manière dont elles cessent paisible ou due à une maturation violente 119 et instantanée que distingue un insatiable appétit pour tout dévorer, tel un feu ardent et ininterrompu.
[D’après la glose, la première dépend d’initiations, de la vénération du maître ; la seconde est un engloutissement intense des conditions limitantes dû au feu de la Conscience. Lorsque les limites n’ont pas encore apparu, il s’agit de la Réalité échappant à toute voie. La disparition progressive des limites a lieu par les voies de l’activité et de la connaissance, la disparition soudaine, par la voie de Śiva.]
261. Cette dernière, celle de la maturation violente, est [177] particulièrement digne d’être enseignée, elle qui se plaît à consumer le combustible du différencié.
262. Toutes les choses jetées violemment dans le feu de notre propre conscience abandonnent leurs différenciations en alimentant sa flamme de leur propre énergie.
263. Dès que la nature différenciée des choses est dissoute à l’aide de cette maturation hâtive, les (organes) divinisés de la conscience savourent l’univers transformé en nectar.
264. Ces organes, une fois assouvis, identifient à leur propre soi le Dieu Bhairava, firmament de la Conscience, reposant uniquement dans le cœur, Lui, la plénitude.
268-269. Celui à qui l’univers — toutes choses dans leur diversité — apparaît comme un reflet dans sa conscience, le voici, le souverain de l’univers. Possédant ainsi une prise de conscience globale indifférenciée et éternellement présente, il est le seul qui soit marqué du sceau de la voie du Seigneur.
[Cette prise de conscience du Je est plénitude, car elle surabonde de toute la diversité de l’univers. Un verset dit à ce sujet :
“Si peu qu’il goûte à cette saveur, celui qui se plaît à une noble conduite autonome, pour lui samādhi, yoga, vœu, parole sacrée, récitation ne sont que poison.”]
271. Qui jouit perpétuellement de cette absorption indifférenciée accède à la nature bhairavienne synonyme de délivrance durant la vie.
276-277. Voyant les divers niveaux de la Réalité réfléchis sans différenciation dans son propre Soi, il atteint la nature de Bhairava. Et lorsqu’il voit en outre Bhairava lui-même se refléter dans le miroir sans artifice et sublime de la Conscience, celui qui n’a plus aucune pensée différenciée devient spontanément Bhairava. »
.
Parvenu à l’état de Bhairava le yogin doit dominer la triple activité d’émanation, de maintien et de résorption par rapport à l’univers :
280. « Tout cela procède de moi (aham, Je), tout est reflété en moi, tout est inséparable de moi. C’est une triple voie que celle du Seigneur. » [178]
De ces trois aspects de la voie divine le véritable adepte du Trika doit devenir le maître :
.
1) Sous forme d’émission créatrice : il prend conscience de façon globale des phonèmes de A à HA au moment où jaillit l’intuition : « cet univers surgit de moi, le Je (aham) ».
283. « Manifestant l’univers en moi-même, dans l’éther de la Conscience, je suis le créateur, immanent à l’univers » : percevoir cela c’est s’identifier à Bhairava.
.
2) Sous forme de maintien, il reconnaît : « Cet univers se reflète en moi. »
284. « Tous les cheminements se reflètent en moi qui suis leur sustentateur » : percevoir cela en toute évidence, c’est s’identifier à l’univers.
Protégeant ainsi l’univers il en devient le maître et participe alors au Bhairava universel. Cet aspect est supérieur au bhairava précédent qu’il ne découvrait qu’en lui-même. À ce stade il le goûte toujours et partout puisqu’il a imprimé sa conscience dans le monde entier.
.
3) Sous forme de résorption, l’adepte prend conscience : « tout cela est moi seul » ; par l’efficience de la formule du Je absolu, il résorbe l’univers en lui-même et pénétrant dans l’état apaisé de l’universel Bhairava, il atteint le Je en sa plénitude.
286. « L’univers se dissout en moi qui suis plein des flammes échevelées de la grande Conscience ». Voir cela c’est trouver la paix.
« Je suis Śiva lui-même, ce feu dévorant qui brûle la demeure aux belles pièces (le rêve) infiniment variées, ce flot de la transmigration. »
Ce troisième aspect de la voie divine étant atteint, le but ultime est atteint.
287. « L’univers en ses nombreuses différenciations surgit de moi, c’est en moi qu’il repose et quand il y est dissous, rien d’autre ne subsiste.
« Celui qui voit l’émanation, le maintien de l’univers et sa résorption comme indivisibles parce que unifiés ainsi, celui-là resplendit, étant parvenu au Quatrième état. »
À ce niveau voies et procédés n’ont plus de sens :
288. « Peu nombreux sont ceux qui, purifiés par le suprême Seigneur, avancent avec confiance sur cette voie suprême où règne la non-dualité de Śiva. »
289-290. « Bain, vœu, purification du corps, concentration (179) de l’esprit, usage des mantra, cheminements, oblation, récitation, samādhi et autres pratiques relevant de la différenciation n’ont pas de place ici. »
Selon les anciens Maîtres :
« En vérité, dès que la Réalité ultime est ardemment désirée, tous les moyens sont réduits à néant. »
Utpaladeva déclare également :
« Seul l’amour est digne d’estime dans la voie sans illusion de Śiva. Ni yoga ni ascèse ni pieux hommage ne mènent à lui. » (I. 16.)
Il priait donc Śiva : « Que seule s’accroisse en moi, à tous moments, l’indicible saveur vivifiante acquise par la manducation répétée de Ta souveraineté et que s’éloigne loin de moi la majesté du yoga et de la Connaissance. » (VIII. 2.)
À quoi distingue-t-on l’être hautement favorisé cheminant sur cette voie ? Le premier signe qui permet de reconnaître celui qui est doué d’une grâce intense est l’amour divin (bhavabhakti) dont il est imprégné. C’est un Maître qui transmet cette grâce directement, sa parole, son exemple suffisent au disciple pour qu’il prenne conscience de sa propre Essence.
« (Le Maître) initié à la voie divine est manifestement en état de transmettre la grâce suprême, mais à une condition : celui qui va le trouver doit être capable de recevoir la grâce d’une manière identique. » De cette manière même, glose Jayaratha, « tout comme un flambeau est allumé à un autre flambeau » (290-291.).
Le terme anupāya est un de ceux qui désignent la suprême lumière consciente, la Réalité incomparable et unique. Dans ce cas, l’a privatif prenant sa valeur de négation totale, on ne peut rien dire.
« En l’absence de toute voie d’accès comment savoir que cette Réalité échappe à toute voie ? Et à ceux pour lesquels elle resplendit spontanément, en vérité, que nous reste-t-il à dire ? »
Mais comme ce terme peut avoir le sens de voie très réduite (alpopāya) ou d’accès sans mode à la réalité, nous pouvons en parler quelque peu.
À ce niveau point de paradoxe, point de jeu divin, point de retour, point de dévoilement, point de libération. [180] Quand tout est conscience, qu’est-ce qui pourrait révéler la Conscience ?
À même cette lumineuse évidence, les êtres immaculés incités par le Maître, reconnaissent aussitôt « le royaume primordial en tant que connaissance incomparable et éternelle ».
À cette voie Abhinavagupta consacre son deuxième chapitre du Tantrāloka : « Śiva, dit-il, ne se manifeste pas grâce aux voies libératrices ; au contraire ce sont elles qui brillent de son éclat. » (3.)
« La quadruple forme mentionnée — les trois voies et la non-voie — que revêt la pure Conscience n’est autre que la nature même de l’Omniprésent, et cet Omniprésent est toujours surgissant. » (4.)
« Puisqu’il resplendit en d’innombrables modalités, certains êtres s’absorbent en lui graduellement et d’autres d’emblée. » (5.)
Mais bien rares sont ceux qui se passent de toute voie.
« … Les êtres immaculés se consacrent à l’inaccessible Conscience bhairavienne exempte de toute voie. » (7.)
« Activité et pratique de yoga ne peuvent servir de voie, car la Conscience ne naît pas de l’activité, c’est à l’inverse l’activité qui en procède. » (8.)
Indépendamment de l’énergie consciente, ils ne sont rien.
« La Réalité de la Conscience resplendit de son propre éclat. Dès lors à quoi bon des procédés logiques aptes à la faire connaître ? Si elle ne resplendissait pas ainsi, l’univers privé de lumière ne se révélerait pas puisqu’il serait inconscient. » (10.)
« Toutes les voies, qu’elles soient internes ou externes, dépendent de la Conscience. Comment serviraient-elles à en révéler l’accès ? » (11.)
« Ô Seigneur ! Ta Réalité est partout présente et immédiatement évidente. Aussi les moyens par lesquels on entreprend de Te trouver ne Te découvriront certainement pas. » (Stance citée par le commentateur.)
« Voie interne, voie externe, tout n’est que la merveilleuse Essence innée de Śiva, sa pure et simple nature lumineuse. » (15.)
Non seulement la concentration et les autres moyens de réalisation, mais également les sensations, les sentiments sont uniquement Śiva. « Qui d’autre pourrait résider en cette suprême Non-dualité faite de pure Lumière et en laquelle moyen et fin n’ont d’autre lien que la Lumière même ? » (181)
En elle tout s’identifie : Śiva, énergie et individu :
« Dualité, différenciation, non-différenciation, ainsi se révèle le Seigneur, Lui, Lumière consciente. En lui bonheur, douleur, servitude, délivrance, conscience et inconscience ne sont que des synonymes désignant une seule et même Réalité, comme cruche et jarre désignent un même objet. » (18-19.)
Et pourtant :
« (Ce suprême royaume) ne comporte ni existence ni non-existence, ni dualité, car il est hors d’atteinte du langage. Il s’affermit sur le sentier de l’inexprimable. Il réside dans l’énergie, mais il est libre d’énergie. » (33.)
Pour les êtres qui vivent en la non-voie et qui en toutes choses ne perçoivent qu’une seule saveur, celle du Soi :
« La ronde des choses, tout en leur demeurant présente, se dissout de tous côtés dans le feu bhairavien de la Conscience. » (35.)
« Pour ces êtres bonheur, douleur, crainte, angoisse, pensées dualisantes fondent complètement dans la seule absorption indifférenciée et suprême. » (36.)
« Pourvus de la hache qui met en pièces toutes les restrictions des traités, il ne leur reste d’autre œuvre à accomplir que celle d’accorder la grâce. » (38.)
Ainsi cette inaccessible Réalité, libre de tout moyen, a pour seule caractéristique l’efficience immédiate de la transmission directe de Maître à disciple120.
Le disciple au cœur très pur reconnaît en pleine évidence le Maître qui, immergé dans la suprême Conscience, lui permettra d’accéder sans moyen d’approche à la Conscience plénière à laquelle il rend hommage en se gardant soigneusement de faire d’elle un objet de connaissance ou d’adoration. Il bénéficie de la plus intense des grâces.
Mais dans la non-voie, au sens strict du terme, par-delà toute grâce, il participe à la gloire divine en laquelle son Maître repose. Il est alors libre et non point délivré, car « Dans l’indifférencié et en l’absence de voie, qui donc est libéré, où et comment ? » (III. 273.)
.
Quelques stances d’Abhinavagupta 121 résument son enseignement sur la Réalité absolue, Incomparable, le Tout vers lequel il n’y a pas d’accès :
« Du point de vue de la Réalité absolue, il n’y a pas de [182] transmigration. Comment alors est-il question d’entrave pour les êtres vivants ? Puisque l’être libre n’a jamais eu d’entrave, entreprendre de le délivrer est vain.
« Il n’y a là que l’illusion de l’ombre imaginaire d’un démon, corde prise pour un serpent qui produit une confusion sans fondement. Ne laisse rien, ne prends rien, bien établi en toi-même, tel que tu es, passe le temps agréablement. (2.)
« Dans l’Inexprimable, quel discours peut-il y avoir et quelle voie différencierait adoré, adorant et adoration ? En vérité pour qui et comment un progrès se produirait-il, ou encore qui pénétrerait par étapes (dans le Soi) ?
« O Merveille ! cette illusion, bien que différenciée, n’est autre que la Conscience-sans-Second. Ah ! tout est Essence très pure éprouvée par soi-même. Ainsi ne te fais pas de soucis inutiles. (3.)
« Lorsque surgit la Conscience en tant que contact immédiat avec soi-même, (alors) le réel et l’irréel, le peu et l’abondant, l’éternel et le transitoire, ce qui est pollué par l’illusion et ce qui est la pureté du Soi apparaissent radieux dans le miroir de la Conscience.
« Ayant reconnu tout cela à la lumière de l’Essence, toi dont la grandeur est fondée sur ton expérience intime, jouis de ton pouvoir universel. » (8.)
… Afin d’adorer le Tout-puissant, cueillez ce lotus du cœur d’Abhinavagupta, épanoui par la lumière des rayons tombés du soleil qu’est le vénérable Sambhunātha.
.
Faisant échec à l’ignorance, source de la servitude, la Connaissance est ici la cause de la libération.
L’ignorance offre deux formes : l’une, intellectuelle, issue de l’intelligence (buddhi) consiste en une absence de certitude ou en une conviction erronée ; l’autre, congénitale, (paurusājñāna) 123 est une pensée dualisante (vikalpa), une limite à l’expansion de la Conscience. C’est elle la cause radicale de la transmigration. Si l’initiation et les [184] autres pratiques peuvent abolir cette ignorance, elles ne peuvent mettre fin à l’ignorance intellectuelle due au manque de détermination124.
L’initiation étant, en effet, union à Śiva et purification des niveaux de la Réalité, elle doit être précédée de certitude quant à ce qu’il faut accepter et quant à ce qu’il faut rejeter.
Essentielle est donc la connaissance intellectuelle faite de détermination ; et, bien exercée, cette connaissance même élimine, elle aussi, l’ignorance congénitale du fait que l’exercice de la conscience à double pôle aboutit en définitive à la connaissance indifférenciée.
De toutes les manières possibles il faut donc parvenir à une connaissance douée d’une parfaite certitude à l’égard de toutes choses dont la nature propre est Śiva, à savoir le Soi identique à la lumière de la Conscience que ne limite aucune pensée dualisante.
Cette connaissance est précédée par celle des textes sacrés révélés par le Seigneur, la seule qui soit capable de libérer de la servitude universelle… à l’inverse de la connaissance prônée par d’autres traditions inférieures qui libèrent seulement de ce qu’elles croient être la servitude.
.
… De tous les textes Śivaïtes, ceux du Trika forment la moelle, et, à son tour, le Trika est la moelle du Mālinīvijayatantra125. Nous ne pouvons exposer tout ce qui y est contenu ; mais comme celui à qui la Réalité des choses n’est pas exposée ne peut être libéré et ne peut libérer autrui, — une telle essence relevant uniquement d’une pure Conscience — nous avons entrepris cet ouvrage afin de parvenir à la fin suprême que vise l’humanité et qui a pour racine une connaissance bien exercée. [185]
L’ignorance est en vérité cause de servitude et les traités la désignent comme impureté. Que se lève la pleine lune de la Connaissance et elle sera toute entière arrachée jusqu’aux racines.
.
Que se lève la Conscience dégagée de toute impureté, et la délivrance est assurée. Par ce traité j’éclaircirai toute la réalité qu’il est nécessaire de connaître.
Ce qu’il faut essentiellement découvrir en tout ce qui existe, c’est la nature propre elle-même sous forme de lumière consciente, principe de toutes les choses, car on ne peut admettre que la nature propre des choses ne soit pas lumière. Cette lumière n’est pas multiple. Ni le temps ni l’espace ne peuvent briser son unicité, eux qui ne possèdent d’autre nature que cette lumière même. Celle-ci est donc unique, c’est la Conscience universelle.
De l’accord unanime, la conscience est la lumière des choses. Il n’existe aucune autre lumière qu’elle. Libre et unique lumière, exempte de par sa libéralité même des limites que sont l’espace, le temps et l’aspect, elle est omnipénétrante et éternelle ; elle-même dénuée d’aspects, elle assume tous les aspects.
L’essence de sa lumière est l’énergie de conscience (cit-sakti). Sa liberté est l’énergie de félicité, son ravissement énergie de volonté, sa prise de conscience globale énergie de connaissance, enfin sa faculté de revêtir tous les aspects, énergie d’activité.
Même unie à ces principales énergies et associée aux énergies de volonté, de connaissance et d’activité, la lumière demeure ininterrompue, reposant en sa propre félicité avec, pour essence, Śiva. C’est elle aussi qui en vertu de sa liberté se montre restreinte et que l’on nomme alors exiguë (anu) ou individu.
Mais voici que par cette liberté elle s’illumine à nouveau elle-même, se révélant comme Śiva, lumière ininterrompue. Et, toujours, par la puissance de sa liberté, voici qu’elle se révèle alors sans l’aide d’une voie d’accès (anupaya) ou bien à l’aide de voies, et dans ce dernier cas les moyens employés sont la volonté, la connaissance ou l’activité ; [186] d’où une triple absorption propre respectivement à Śiva, à l’énergie et à l’individu.
Nous enseignerons ici successivement ces quatre modalités.
Le Soi, merveilleuse beauté de lumière, Śiva, autonome, par l’impétuosité des jeux de sa liberté, cache sa propre essence,
Puis à nouveau il la manifeste en sa plénitude
ou de façon soudaine ou graduellement, et dans ce cas, selon une triple différenciation.
Nous expliquons maintenant l’absorption dans la non-voie.
Lorsque, transpercé d’une puissante grâce, n’ayant entendu qu’une seule fois la parole du Maître, il discerne la Réalité par soi-même, de la manière qui sera exposée, l’absorption en Śiva éternellement présente d’un tel être est indépendante de toute voie.
Si l’on objecte : comment peut-on discerner sans l’aide de raisonnement (tarka) — un des membres du yoga 126 ? On répond : à quoi bon une voie pour parvenir au suprême Seigneur lumineux par lui-même, notre propre Soi ? Une voie ne peut faire acquérir son Essence puisqu’il est éternel, elle ne peut le faire connaître puisqu’il brille de son propre éclat, ni écarter le voile qui l’obscurcit puisqu’aucun voile ne peut le recouvrir ; elle ne peut faire pénétrer en lui, car il n’y a rien qui soit séparé de lui et qui puisse y pénétrer.
Que pourrait donc être une telle voie ? Impossible qu’elle soit séparée de lui dont la volonté propre est cause des diverses productions depuis le temps jusqu’aux moyens de connaissance, de Lui, libre Réalité, masse de félicité, puisque tout ce qui existe ne forme qu’une seule réalité de pure Conscience qui échappe au temps, que ne limite pas l’espace et que ne flétrissent point les contingences, que ne [187] confinent pas les formes, que n’expriment pas les paroles, que ne déploient pas les moyens de connaissance.
C’est Lui-même que je suis, et en moi se reflète le Tout. Celui qui discrimine ainsi de façon définitive acquiert, hors de toute voie, une compénétration éternelle avec le suprême Seigneur. Il n’est plus astreint à rien, ni au mantra, ni à l’adoration, ni à quelque pratique que ce soit.
Le réseau des voies ne peut éclairer Śiva. Comment un pot (de cuivre) ferait-il briller le soleil aux mille rayons ?
Et celui qui d’une sublime Vision discerne cela pénètre instantanément en Śiva par lui-même lumineux.
Si l’on ne peut pénétrer d’une manière indivise et totale dans la Réalité divine dont l’Essence est cette Lumière que l’on vient d’exposer, alors, voyant que parmi les énergies celle qui domine est la liberté, on jouit de l’absorption sans pensée dualisante en Bhairava même127.
En voici l’enseignement : tout ceci, l’ensemble des choses, n’est que reflet dans le ciel de la Conscience. Le reflet a pour caractéristique de ne pas se manifester séparément par lui-même, mais seulement mêlé à autre chose comme le visage dans le miroir, la saveur dans la salive, l’odeur dans l’odorat, l’écho dans l’éther… La saveur et les autres sensations ne sont donc pas la chose originale parce que, à l’inverse de celle-ci, ces reflets sont incapables de produire une série d’effets naturels ; et pourtant, on ne peut dire qu’ils n’existent pas, car ils suscitent des réactions128. [188]
De même que toutes les choses apparaissent comme des reflets, ainsi l’univers en sa totalité se reflète dans la lumière du Seigneur. Si vous demandez ce qu’est alors ce reflet (pratibimba), nous répondons qu’il n’est absolument rien. Mais alors, direz-vous, il n’a pas de cause 129 ? Votre question ne concerne donc que la cause ? Quel rapport celle-ci présente-t-elle avec ce que vous nommez image (bimba), à savoir la chose qui se reflète ? La cause n’est que l’énergie du Seigneur, autrement dit sa liberté. Le Bienheureux a pour Soi le Tout parce qu’il est le support de tous les reflets, et c’est en ce Tout, identique à la Conscience, que se révèle la Conscience absolue ; comme le Tout s’y reflète, (le Seigneur) est le support du reflet universel. Son essence, le Soi universel, ne peut être dépourvue de prise de conscience de Soi 130 car il est inadmissible que ce qui a pour nature propre la Conscience même n’ait pas conscience de sa propre essence. Cette prise de conscience étant absente, il n’y aurait en réalité que pure inertie. Elle n’a donc rien de conventionnel. Pourtant on appelle suprême matrice du son sa relation intime avec l’essence consciente ; en effet, elle « prend conscience » en toute son extension du faisceau des énergies divines qui départissent tout ce qui existe131.
[Abhinavagupta donne un bref résumé de l’émanation des phonèmes :]
[189] Les principales énergies du Seigneur forment une triade : l’Incomparable, la volonté et l’éclosion de la connaissance (unmesa), trois prises de conscience globales, à savoir A, I et U. À partir de cette triade toutes les énergies vont se déployer : la Béatitude ou repos dans l’Incomparable, la souveraineté dans la volonté et une vague qui ondule dans l’éclosion de la connaissance. C’est de cette dernière que l’énergie d’activité tire son origine. D’où les trois prises de conscience Â, Î et Û.
… Puis des combinaisons variées de ces six voyelles procèdent les diphtongues constituant avec elles 16 prises de conscience globales (parāmarsa), et ensuite les consonnes de l’alphabet sanscrit132.
C’est ainsi que le Bienheureux, l’Incomparable, revêt la forme du Seigneur du Tout ; et il n’a qu’une seule énergie, kaulikī « qui engendre la totalité », c’est l’énergie émettrice. Grâce à elle, il se met à vibrer à partir de la béatitude jusqu’à l’émanation externe, les pures prises de conscience phonématiques — groupe des phonèmes, etc. — revêtant, elles aussi, l’aspect de niveaux des réalités externes.
Cette émission est triple : émission de finitude ou état de repos de la conscience empirique, émission de l’énergie qui consiste en Éveil de cette conscience, enfin émission divine ou dissolution de cette conscience133.
L’émission n’est autre que l’énergie du Bienheureux qui engendre l’univers ; si le Tout fait l’objet d’une seule prise de conscience indivise, le Bienheureux est l’Un. Avec deux prises de conscience, il s’agit de l’énergie et de son détenteur…
[Abhinavagupta conclut :]
« Les prises de conscience phonématiques qui alimentent la plénitude de toutes les énergies du Seigneur sont au nombre de douze, les énergies bienheureuses appelées kālikā134. Grâce à un mouvement de flux et de reflux ces énergies ne procèdent que des six prises de conscience que sont les six voyelles, brèves et longues.
Ces pures prises de conscience faites d’énergie se [190] manifestent d’abord à l’étape de Science immaculée puis à celle de l’illusion où elles se différencient clairement les unes des autres et deviennent des phonèmes lesquels, à travers les trois phases de la Parole (supérieure, moyenne et inférieure) accèdent au niveau de la réalité extérieure. Bien qu’ils participent à l’illusion (māyā) et soient pour ainsi dire corporels, ces phonèmes ressuscitent grâce aux pures prises de conscience qui en constituent la vie et, recouvrant toute leur efficience, confèrent alors jouissance et libération.
Celui qui voit son propre Soi comme le parfait repos des prises de conscience phonématiques, comme ce en quoi se reflètent tous les niveaux de la réalité, les êtres, les mondes, acquiert grâce à cette absorption en Śiva indemne de pensée différenciatrice, la liberté en cette vie même : il n’est donc plus astreint aux paroles sacrées (mantra) ni à aucune autre pratique.
Le monde entier resplendit dans le Soi comme l’ensemble (indissociable) de choses variées à l’intérieur d’un miroir.
La Conscience suprême, conformément à sa propre saveur de prise de conscience de soi, appréhende le Tout d’une manière globale — ce que ne fait point le miroir.
Notre propre essence toute entière, vibrant dans le pur miroir de la Conscience, se révèle d’elle-même
Dès que la surface du miroir a été vivement frottée avec le suc de la prise de conscience de Soi.
Quand la pensée dualisante (vikalpa) s’est purifiée progressivement afin de pénétrer dans l’Essence qui vient d’être décrite, on procède à la pratique mystique (bhāvanā) que préparent l’enseignement de bons maîtres et de bons textes sacrés ainsi que la véritable raison intuitive (sattarka). En effet, les gens s’imaginent à tort que leur Soi est asservi, car sous l’influence de la pensée dualisante [191] naît cette imagination, cause du processus de la transmigration.
Mais cette pensée peut être détruite par une (autre) pensée qui lui serait diamétralement opposée et où l’on prendrait conscience : « La pure Conscience ininterrompue par delà toutes les choses limitées est la Réalité ultime, la vigueur du Tout — ce par quoi il vit et respire — c’est le Je même qui transcende l’univers entier et lui est immanent. »
Une telle expérience ne peut surgir chez les êtres aveuglés par l’illusion et qui, en conséquence, ne possèdent pas une véritable raison intuitive. C’est le cas des Visnuites et d’autres sectaires qu’entrave l’attachement à (leurs) textes sacrés et qui ne s’orientent nullement vers un système supérieur en vertu de leur aversion pour la véritable raison, pour l’enseignement de bons textes sacrés et pour de bons maîtres.
Selon le Parameśvaratantra : les adeptes de Visnu, tous tant qu’ils sont, imprégnés par l’attraction des désirs et par une science limitée, ne découvrent pas la Réalité suprême, car ils sont privés de la Connaissance omnisciente.
À l’objection : la suprême Réalité ne sera-t-elle pas alors objet de la pensée dualisante ? on répond : nullement, car lorsque se disperse l’odeur de la dualité, la fonction de la pensée se perd en elle, tandis que la suprême Réalité brille de sa propre lumière sous forme d’Essence universelle. Pour elle, point de pensée dualisante qui puisse lui prêter une aide ou l’exposer à quelque lacune.
.
La véritable raison intuitive en sa forme parachevée surgit spontanément chez un être « initié par les déesses » que transperce une grâce ferme et puissante135. Mais chez tout autre elle est due à l’étude des livres sacrés, au guru, etc. Si le maître a pour tâche d’expliquer les livres sacrés, ces livres, eux, ont pour tâche de faire naître une pensée appropriée, source d’une série de pensées homogènes en laquelle aucun doute ne s’insère.
Faite d’une telle série de pensées, la véritable Raison intuitive (sattarka) est dite « pratique mystique réalisatrice » (bhāvanā), car elle « réalise ou fait être » en la rendant évidente une chose qui, bien que réelle, paraissait irréelle parce que non-évidente. [192]
À part la véritable Raison — cette lumière de la pure Science — il n’y a pas parmi les membres du yoga d’autre voie directe (pour reconnaître) la Réalité. En effet, les disciplines (ascèse, tapas, etc.), les interdictions (la non-nuisance) ou les contrôles de la respiration, tout cet ensemble de moyens porte uniquement sur le connu : Dès lors quel recours apporteraient-ils à l’égard de la Conscience ?
.
La rétraction des organes sensoriels hors de leur domaine ne fait que renforcer ce domaine. Les trois autres pratiques elles-mêmes, en ordre croissant : la méditation, la concentration, le samādhi, qui se développent à mesure qu’on s’y exerce, ne font que conférer au méditant l’identité avec l’objet médité. Mais ici à quoi sert un exercice à l’égard de la suprême Réalité, Śiva, notre nature propre qui existe par soi-même ?... Quel exercice peut-il y avoir quant à l’Essence consciente où il n’y a rien à ajouter, rien à retrancher ?
Si l’on demande : A quoi sert alors la Raison intuitive ? Nous répondons : elle sert à effacer l’odeur de la dualité et à rien d’autre.
Le but de tout exercice, même ordinaire, c’est de manifester dans le corps, etc., la forme désirée et d’éliminer la forme opposée. Mais dans la suprême Réalité, il n’y a rien à retrancher. L’odeur de la dualité elle-même qu’élimine une (pure) pensée dualisante n’est pas une chose en soi qui serait séparée de la Conscience, mais uniquement la non-intuition de sa propre essence.
Voici le sens profond de (cette dernière proposition) : Quand l’Essence qui brille de sa propre Lumière délaisse peu à peu la non-intuition qu’elle avait librement assumée, elle se révèle progressivement : elle tend à s’épanouir, s’épanouit ensuite, pour porter enfin l’épanouissement à son comble ; et, ici encore, c’est que l’Essence du Seigneur (veut) se révéler de cette manière.
Les membres du yoga ne sont donc pas une voie directe (pour parvenir à la Conscience), mais ils peuvent favoriser la véritable Raison intuitive qui est, elle, une voie directe ; n’étant que la pure Science, elle peut être purifiée de plusieurs manières : par le sacrifice, l’oblation au feu, la prière et le yoga.
.
Le sacrifice (yāga) est l’offrande de toutes choses au Seigneur lui-même en vue de renforcer la conviction que tout réside en lui et que rien absolument n’est séparé de (193) lui. D’où, à l’extérieur, l’emploi de substances aptes à réjouir le cœur : offrandes de fleurs, de parfums qui, en raison de leur nature agréable, peuvent pénétrer spontanément dans la conscience : un tel don « fixé » 136 dans le Seigneur étant aisé à pratiquer.
.
L’oblation au feu (homa) est la dissolution de toutes les choses dans le feu de la souveraine Conscience en vue de se convaincre que toutes les choses sont consumées par le feu divin que l’on imagine ardent à les dévorer et qui, finalement, subsiste seul.
.
La prière (japa) est elle aussi une prise de conscience intérieure que la suprême Réalité existe de par sa nature propre sans dépendre de choses différenciées, c’est-à-dire de l’objectivité soit extérieure, soit intérieure, étant donné que ce qui se manifeste consiste en une prise de conscience de l’une ou de l’autre de ces deux modalités.
.
Le vœu (vrata) se ramène à contempler toutes choses — corps, vase — en leur similitude au Seigneur et à avoir la certitude, toujours et partout, de cette similitude sans faire appel à quelque autre voie libératrice ; car, d’après la Nandaśikhā : « le vœu suprême, c’est l’égalité universelle. »
.
Le yoga est une pensée spécifique, un recueillement sur l’Essence de la suprême Réalité, en vue d’affermir à son sujet la conviction que tout n’est qu’éternelle lumière — la conscience de cette suprême Réalité — laquelle, de par son essence, ne dépend pas de la pensée dualisante.
.
Le Seigneur, ici, a pour nature propre la Conscience Plénière, et son énergie n’est autre que cette plénitude. Les textes sacrés la nomment, selon ses fonctions : Totalité, efficience, vague, Cœur, moelle, vibration, gloire ; ou encore : maîtresse de la triade (des énergies), Kālī, celle qui pressure le temps, l’Effroyable, la Jouissance, la Vision, l’Éternelle… car elle demeure dans le cœur des contemplatifs sous tel ou tel de ces aspects. Et si la Conscience se révèle en sa plénitude, c’est grâce à la vision de [194] l’ensemble de ses énergies qui sont innombrables. Que dire de plus ? Les énergies étant proportionnelles au Tout, comment donc pourrait-on en impartir l’enseignement ?
Ce Tout — l’univers entier — est contenu en trois énergies ; par elles le Seigneur soutient, perçoit et éclaire les mondes à partir de la catégorie de Śiva jusqu’à celle de la terre : en tant que Conscience unique et indifférenciée, si son énergie est la suprême śakti ; mais en tant que différenciée et indifférenciée à la fois — tel un éléphant perçu dans un miroir — si son énergie est intermédiaire entre l’aspect supérieur et l’aspect inférieur ; enfin, en tant que différenciée, sous forme d’aspects variés mutuellement distincts, si son énergie est d’ordre inférieur.
Quant à cette Énergie par laquelle le Seigneur engloutit — après l’avoir brassé et unifié en lui-même — ce tout qu’il maintient sous cette triple forme, c’est là son énergie éminente, la Bienheureuse elle-même, qualifiée de « Réalité efficiente des sujets conscients » et de « Dévoratrice qui pressure le temps ».
Ces quatre énergies, grâce à leur liberté, se scindent en trois aspects chacune, devenant ainsi les douze énergies appelées kālī qui forment la roue des énergies de la conscience137.
.
Ainsi sacrifice, oblation au feu, prière, vœu et yoga que l’on vient de décrire ne sont approuvés qu’en hommage au Seigneur ; mais s’il est bon de s’enraciner en chacun d’eux de maintes manières, point ne faut se fatiguer à discerner ce que l’on peut et ne peut pas consommer, ce qui est pur et impur et ainsi de suite, car ce ne sont point là les propriétés mêmes des objets, mais uniquement des constructions fallacieuses de notre part. La pureté, en effet, n’appartient pas à l’essence de la chose, car une chose considérée pure est jugée impure en d’autres écoles.
Toutes les injonctions — prescription ou interdiction — peu importe de quelles écoles ou de quelles écritures elles relèvent (Veda ou les meilleurs des traités śivaïtes) ne peuvent favoriser ni contrarier l’accès à la suprême Réalité.
C’est ce que dit l’ancien Traité ainsi que le Tantrāloka de façon plus développée. [195]
La certitude qu’a l’homme esclave (paśu) d’être privé de la conscience, d’être lié par l’acte karmique, d’être impur et de dépendre d’autrui, doit devenir une très ferme certitude diamétralement opposée.
Alors (pénétré de l’identité) du Soi à la Conscience, du corps 138 au Tout, il sera immédiatement un souverain139.
.
Qu’une telle certitude, objet d’une perpétuelle vigilance, soit acquise par le grand yogin.
Et qu’il ne se tourmente pas de doutes à l’égard de la masse des enseignements puérils conçus par une vision qui porte sur des choses privées de réalité.
Lorsque la pensée dualisante se purifie d’elle-même indépendamment de toute autre voie de libération, sans qu’opère l’être asservi, et qu’elle obtient par la grâce de la pure Science la nature de l’énergie divine, elle dévoile la Connaissance propre à l’énergie dont elle se sert comme voie d’accès. C’est ce que le chapitre précédent a décrit.
Mais quand la pensée dépend pour se purifier d’une autre voie utilisant des formes limitées : intelligence, souffle, corps, objets externes, elle dévoile la connaissance relative à l’individu en atteignant l’état exigu ou infime (anu).
Ici, l’intelligence (a pour domaine) la méditation. Le souffle peut être grossier ou subtil ; le premier, fait d’une poussée ascensionnelle de l’énergie comprend cinq fonctions : inspiration, expiration, souffle égal, souffle vertical et souffle diffus.
Le souffle subtil est désigné par le terme « phonème » (varna) expliqué par la suite.
Le corps réfère à la pratique des organes qui concerne divers points vitaux.
Les objets externes sont les récipients du culte : le champ sacrificiel, le symbole et les autres moyens de vénération. [196]
Nous enseignons maintenant la méditation qui convient au cas présent.
C’est à l’intérieur de la conscience sise en son propre cœur que l’on médite d’abord sur la suprême Réalité immanente à tous les niveaux du réel et brillant de son propre éclat. Puis, toujours en elle, on médite sur la friction unifiante du sujet connaissant, de la connaissance et de l’objet connu sous leur aspect respectif de feu, de soleil et de lune jusqu’à ce que surgisse le feu du grand Bhairava qu’attise le vent de la méditation.
Que l’on imagine ce feu entouré des flammes des douze énergies ayant forme de roue qui étant sorti par l’un quelconque des canaux sensoriels — les yeux par exemple — repose dans la (réalité) extérieure, à savoir l’objectivité.
Puis, grâce à ce repos, qu’on médite d’abord sur cette réalité extérieure en sa plénitude, en tant que lune, comme émanation, puis manifestée en tant que soleil comme durée, enfin dissoute en tant que feu comme résorption. Qu’on médite alors sur la nature du Soi ainsi obtenue comme supérieure à toute autre (anuttara).
De cette manière cette roue parvient à se remplir de toutes les choses externes qu’elle renferme en leur indifférenciation. Qu’on médite ensuite sur cette roue de feu comme agissant de même à l’égard des ultimes impressions résiduelles140.
Quant à ceux qui méditent sans répit sur ce processus des états d’émanation, de durée et de résorption en leur véritable réalité — qui est uniquement conscience de Soi —, s’ils sont bien convaincus que cette conscience n’est autre que la liberté de produire les (divers) états, alors ils s’identifient immédiatement à Bhairava.
Par un tel exercice on acquiert également les pouvoirs surnaturels souhaités.
Cette triade de sujet connaissant, de connaissance et d’objet connu tient d’elle-même son propre éclat, Réalité de toutes les choses — Que le yogin médite sur elle, en lui-même, dans le domaine de la félicité qu’est notre propre cœur. [197]
Qu’il médite sur l’Omniprésent, souverain de la roue des rayons de ces douze grandes énergies, qui, s’extériorisant par les organes sensoriels, suscitent émanation et résorption.
.
Ayant englouti l’ensemble de toutes les choses internes et externes, que le yogin réalise que, reposant ainsi en lui-même et à partir de lui, (cette Roue) se déploie glorieusement.
Au moment d’émettre le souffle on se repose d’abord dans le vide du cœur, puis à l’extérieur dès que sort le souffle expiré (prāna). Ensuite, grâce à la pleine lune ou souffle inspiré (apāna) on saisit l’essence du Soi en tant qu’universelle et l’on perd tout désir pour quoi que ce soit. Alors, quand surgit le souffle égal (samāna) on éprouve un repos grâce auquel la friction unifiante (de tous les aspects de l’existence) s’opère. Enfin quand s’élève le feu du souffle vertical (udāna) on dévore les incitations du sujet et de l’objet, également celles de l’expiration et de l’inspiration, du jour et de la nuit, etc. Dès que s’apaise ce feu dévorant et que surgit le souffle diffus (vyāna), omnipénétrant, on resplendit libre comme lui de toute limitation.
Ces six repos ou apaisements s’étageant du vide au souffle omnipénétrant sont enseignés respectivement comme les sept étapes de la félicité : ce sont, sa propre félicité intime, la félicité complète, la félicité suprême, la félicité du brahman, la grande félicité et la félicité de la Conscience. Quand l’unique Réalité qui ne se lève ni ne se couche les tient recueillies toutes en elle-même, on a la félicité cosmique ou Réalité même de ces intimes apaisements.
Dès lors, celui qui repose à ces étapes de l’ascension du souffle, que ce soit en l’une d’elles, en deux d’entre elles ou en toutes, accède à la Réalité du repos indépendant du corps et du souffle. Ainsi peut-on purifier la pensée dualisante en se recueillant sur cette pratique mystique dite « poussée ascensionnelle du souffle », germe de l’émanation et de la résorption.
.
On distingue cinq états correspondants à chacun de ces repos et proportionnels au degré de pénétration (dans la Réalité) : Tout d’abord une félicité due au contact avec [198] une portion de la plénitude (consciente), ensuite un saut causé par l’impression d’être sans corps l’espace d’un instant ; puis un tremblement quand, sous l’emprise de sa propre puissance, se relâche pour le yogin le sentiment de l’identité à son corps. Vient ensuite un certain sommeil (nidrā) lorsque disparaît toute orientation vers l’extérieur. Enfin dès que cesse la conviction erronée que ce qui n’est pas notre vrai Soi l’est vraiment — notre véritable Soi, lui, le Soi de toutes choses — et que cesse également la conviction opposée que tout ce qui est vraiment le Soi ne l’est pas, alors on éprouve un tournoiement de vibration (ghūrni), une ivresse due à l’apparition de la grande diffusion omnipénétrante (mahāvyāpti).
Ces cinq manifestations correspondent respectivement aux états de veille, de rêve, de sommeil profond, de Quatrième état et de ce qui le transcende… Elles se produisent à mesure que l’on pénètre dans les divers centres : triangle, bulbe, cœur, sommet du crâne et kundalinī dressée.
Dans un tel repos issu de la poussée ascensionnelle du souffle, la suprême vibration (spandana) se manifeste d’une triple manière selon que le connaissable a entièrement disparu, qu’il est en train d’apparaître ou qu’il est parfaitement apparu (dans toute sa gloire).
Ce sont là les trois linga ou symboles, le premier étant ici le cœur de la yoginī (à savoir la Conscience même).
La nature de la vibration primordiale dépend du repos dans l’énergie de l’émission quand surgit l’union intime (de Śiva et de l’énergie) sous forme de rétractions et d’épanouissements (perpétuels).
Assez à ce sujet, car cette absorption reste obscure (à ceux qui ne l’ont pas éprouvée).
Reposant d’abord en sa propre conscience, puis dans l’objet connaissable, qu’on remplisse celui-ci, qu’on le remplisse pleinement.
Et là, en cette plénitude, qu’on se repose en résorbant soudain la distinction du sujet et de l’objet.
Alors, grâce à la diffusion omnipénétrante du souffle, on se repose (à nouveau définitivement). Telles sont, le vide y compris, les étapes de la septuple voie du souffle menant du souffle expiré au souffle diffus ; le déploiement de la veille et des autres états leur est lié.
Qui s’absorbe dans cet exercice accède sans tarder au domaine où l’on prend intensément conscience de l’émanation et de la résorption.
Le phonème (varna) est la résonance suprême (dhvāni) correspondant à une émission inarticulée, non perceptible, qui fulgure à l’intérieur de cette poussée ascensionnelle du souffle. Son essence réside principalement dans les germes de l’émanation et de la résorption. Qu’on s’y exerce assidûment et l’on atteindra la suprême Conscience.
Si, en même temps que le souffle s’élève, on énonce intérieurement les consonnes ou qu’on se les remémore, avec ou sans voyelles, de façons variées, on entre en contact avec la vibration de la conscience, une vibration plénière du fait que les sons ne dépendent pas de conventions arbitraires entre signifiants et signifiés.
Telle est la doctrine secrète des phonèmes.
C’est en prenant contact avec l’incomparable Conscience que cœur, gorge et lèvres (déjà bien unifiés) entre eux, doivent être unis au cœur et aux deux centres supérieurs (le cerveau et celui qui est au-delà).
Selon certains, des sons internes comme « blanc », « jaune », etc., qui surgissent immédiatement à la suite d’une prise de conscience intérieure fulgurante, permettent d’éprouver la conscience en son émergence.
À celui qui bannit tout signifié, fait échec à la démarche de la connaissance et du connu, et grâce à la vibration de la Conscience,
pénètre profondément dans l’égalité, la Conscience se révèle en sa plénitude à travers ce processus des germes syllabiques et des phonèmes groupés.
Chez certains la pensée ne peut atteindre sa plénitude spontanément (comme dans la voie de l’énergie) et a besoin de moyens pour se purifier ; ces moyens sont ici nombreux.
Vu qu’ils s’appliquent à la méditation, au souffle, au corps, aux choses externes, en conséquence on les appelle infimes ou individuels (ānava). Mais de leur diversité on ne peut déduire qu’ils présentent la moindre différence quant à l’ultime accomplissement.
Al-Jîlî ou Gîlî (XIVe-XVe siècle) né dans la région de Bagdad est un descendant du fondateur de l’ordre qadirite. Il vécut au Yémen avec son shaykh et voyagea dans l’Inde.
Kitâb al-Insân al-Kâmil est actuellement son œuvre la plus connue (beaucoup sont encore inédites). On traduit généralement ce titre : « Le livre de l’Homme parfait ». La traduction de Titus Burckhardt « De l’Homme universel » vise à suggérer une perfection sans commune mesure avec celle de l’homme en son conditionnement individuel.
Nous ne dirons certes pas que ce texte, ni que la mystique musulmane en général, propose trois voies. On parle plutôt en Islam de la Voie, ou de la Voie de chacun, car en vertu de l’Unicité divine chaque être a son propre cheminement. Cependant nous rencontrons ici une tripartition très voisine, la distinction en trois degrés de la manifestation. Aussi, tout naturellement, lors du retour à la source, vont apparaître des modalités différentes de la révélation divine sur chacun de ces plans. Nos extraits portant sur ces dévoilements successifs, il faut, pour bien situer ceux-ci esquisser d’abord la dynamique du déploiement, autrement dit :[202]
Dans un condensé de la doctrine d’Ibn « Arabî dont on peut considérer Jîlî comme un libre continuateur, Henry Corbin écrit :
« À la clef de voûte du système, si le terme est de mise, il y a… le mystère d’une pure Essence inconnaissable, imprédicable, ineffable. C’est de cet Abîme insondable que s’éveille et se propage le torrent des théophanies et que procède la théorie des Noms divins. »
Ces théophanies présentent trois degrés : « épiphanie de l’Essence divine à soi-même, dont il n’est possible de parler que par allusion ; une seconde théophanie qui est l’ensemble des théophanies dans lesquelles et par lesquelles l’Essence divine se révèle à soi-même sous les formes des Noms divins, c’est-à-dire dans les formes des êtres quant à leur existence dans le secret du mystère absolu ; la troisième est la théophanie dans les formes des individus concrets, donnant existence concrète et manifestée aux Noms divins141. »
Ainsi, entre le degré suprême de cette pure Essence, non encore qualifiée, dépourvue d’aspects, et le plan inférieur de la vie concrète — le monde tel que nous le voyons — s’étend un vaste domaine intermédiaire qui les relie, où se révèlent les Noms divins et les Qualités qu’ils désignent. Ces aspects divins, dont la pensée n’aperçoit que l’ombre, forment une manifestation relative puisque encore invisible 142 de l’univers. Ici se trouvent les essences incréées des choses créées. Ici, êtres et choses demeurent dans le secret de leur réalité profonde. Ici, l’homme qui se souvient de son origine divine peut retrouver le secret de son existence en s’identifiant aux Attributs divins.
Toute la manifestation est « théophanie », « irradiation » ou « révélation » divine143. Elle se déploie comme une descente à partir de l’Absolu ou Essence par une qualification et une particularisation croissantes, que nous allons esquisser. [203]
« Sache que l’Essence de Dieu le Suprême est le mystère de l’Unité… Elle est trop élevée pour que les pensées la] saisissent. Son fond primordial n’est atteint par aucune sentence de la science, ni par aucun silence qui la tait ; aucune limite, aussi fine et incommensurable soit-elle, ne L’embrasse… » (H. J., 26.)
Au sein même de l’Essence, Jîlî fait une subtile distinction. L’Obscurité divine, Al-’Amâ, la nuée, le Soi divin qui n’est obscur que par excès de lumière, « la Réalité des réalités », constitue le cœur, l’intériorité de l’Essence, sa non-manifestation, tandis que la première approche vers la manifestation (ou extériorité) est l’irradiation de l’Unité, en laquelle l’Essence se connaît comme Unité transcendante sans que rien ne s’y manifeste.
Toujours en Elle, après l’Unité, surgissent deux autres irradiations par lesquelles l’univers à présent se dessine, mais seulement en sa perfection divine, Dieu se révélant en chaque être, en chaque chose, d’une manière unique, et toute cette diversité se fondant en l’Unité. L’Unicité est donc « la Réalité divine de la multiplicité ». En elle, « les Noms, les Qualités et leurs activités se manifestent, mais par égard à l’Essence seulement, non pas en mode séparatif. »
La suite de la manifestation va se dérouler sur un mode nouveau avec une filiation qui remonte non pas à l’Obscurité divine (puisque celle-ci est pure non-manifestation), mais à la Divinité, la notion de Dieu supposant au contraire ce dont Il peut être le Dieu.
En relation avec le Nom suprême al-Lâh, on parle de la Divinité ou Qualité de Divinité 144 (al-ulûhiyah). C’est « la Nature divine qui embrasse toutes les réalités de l’être et les maintient à leurs degrés respectifs ». Elle « englobe et synthétise toutes les affirmations et régit toute Qualité et tout Nom ». Par là, elle est supérieure à l’Unité, car « l’Unité est l’affirmation la plus exclusive de l’Essence pour Elle-même, tandis que la “Qualité de Divinité” est l’affirmation sublime de l’Essence pour Elle-même et pour [204] autre qu’Elle-même », c’est-à-dire envisagée par rapport à son épanouissement dans la manifestation universelle. (3841.)
Après l’Unité et l’Unicité, se révèle la Béatitude-Miséricorde (ar-rahmâniyah) qui suscite à l’existence le « Trésor caché » :
« La première miséricorde que Dieu eut pour les existences fut la manifestation du monde de Lui-même. » En effet, « comme il n’est point divisible, toute chose du monde est [pour ainsi dire] entièrement Lui-même ». C’est donc à Ses réalités essentielles que Dieu prête le nom de créature, et non l’inverse, « afin que se manifestent les secrets de la “Qualité de Divinité” et ses possibilités de contraste. Ainsi Dieu (al-haqq) est, à ce point de vue, la hylé du monde », sa substance première. (51.)
Dieu (ou la Vérité, al-haqq ) réside donc partout et de toute chose Il forme la substance. Selon la belle métaphore145, Il est au monde dans le même rapport que l’eau à la glace.
« C’est le Nom ar-rahmân (le Clément) qui apparaît [dans cette Béatitude] avec tout ce que comporte la Plénitude divine, parce qu’il domine et pénètre les existences et que son principe les régit. »
Immédiatement après, se révèle la Seigneurie qui établit le lien entre Seigneur et serviteur, Créateur et créature.
Si la vérité et la plénitude sont partout, que se passe-t-il donc pour que l’homme en sa condition ordinaire perçoive le monde et lui-même en mode séparatif, limité, contraint ? C’est que chaque nouveau degré qui manifeste l’Excellence développe le précédent et en même temps, comme par une opacification grandissante, le voile. « L’essence est voilée par les attributs, les attributs par les actes, les actes par les êtres du devenir et les impressions146. »
On pourrait peut-être résumer ainsi cette puissante conception : A la cime, une Obscurité tissée d’un excès de lumière au cœur de l’Essence. Puis une irradiation qui est à la fois une révélation, en ce sens qu’elle fait connaître la Réalité divine, et une occultation progressive comme si [205] la lumière visible et éclairante offusquait ce noyau obscur des lumières invisibles.
Dès lors, c’est grâce au retrait de chacun de ces voiles que l’homme, tout entier tourné vers Dieu, pourra quitter sa vision erronée, accomplir le périple inverse et finalement, perdu dans l’Essence, découvrir le secret de la théophanie. « Celui à qui les actes divins se manifestent avec clarté par le soulèvement des voiles que sont les êtres du devenir, celui-là s’abandonne à Dieu en toute confiance ; celui à qui les attributs se manifestent, par le soulèvement des voiles des actes, celui-là trouve en Dieu son agrément et accepte tout de Lui ; celui à qui l’Essence se manifeste, par le dépouillement des voiles, celui-là s’anéantit dans l’unité et il est uni à Dieu absolument147. »
Jîlî distingue non pas trois, mais quatre dévoilements, ceux des Noms et des Qualités relevant également du plan intermédiaire.
T. Burckhardt situe très clairement les Qualités par rapport à l’Essence : « on peut les comparer, écrit-il, à des rayons émanant du Principe, dont ils ne se détachent jamais, et qui illuminent toutes les possibilités relatives… C’est par leur entremise que la Divinité est accessible, sous la réserve pourtant que l’Essence suprême, en laquelle leurs réalités distinctes coïncident, reste inabordable à partir du relatif ;, leur déploiement est symbolisé par le soleil, dont on voit les rayons, mais qu’on ne peut pas voir directement à cause de son éclat aveuglant ». (Doct. 57.)
Si l’Essence est « le mystère de l’Unité » et que l’Unité correspond à « la dimension divine dite de la transcendance », les Qualités relèvent de l’Unicité qui correspond à « l’immanence » ; elles sont les aspects par lesquels Dieu Se révèle dans l’univers et peuvent donc être contemplées — elles ont des couleurs — et goûtées — elles ont une saveur — « tandis que l’Essence est incolore comme la lumière blanche ou plus exactement comme l’obscurité au sein de la lumière » écrit encore T. Burckhardt (H. J., 12). L’Unicité permet d’aller des qualités immanentes à l’univers jusqu’à l’Essence, mais c’est elle aussi qui cache l’Unité de l’Essence. [206]
Jîlî lui-même donne une vue d’ensemble qui situe les étapes de ce jeu progressif des extinctions et des dévoilements divins :
… la perception de l’Essence suprême consiste en ce que tu sais, par voie d’intuition divine, que toi c’est Lui, et que Lui c’est toi, sans qu’il y ait fusion des deux, le serviteur étant serviteur et le Seigneur étant Seigneur… Or, si tu connais cette vérité… — et ce ne sera qu’après « l’écrasement » et « l’effacement » essentiel, le signe de cette intuition consistant en ce qu’il y a d’abord extinction (fanâ) du « moi » par le dévoilement du Seigneur, ensuite extinction de la présence du Seigneur par le dévoilement du secret de la Seigneurie et enfin extinction de ce qui dépend des Qualités par la réalisation de l’Essence, — si donc ceci t’arrive, tu as atteint l’Essence148. » (H. J., 37.)
Il ne faudrait pas croire que les chapitres consacrés au déploiement de la manifestation constituent un exposé de métaphysique théorique. Bien au contraire, c’est l’expérience qui fonde les distinctions ténues et les plus hautes envolées de la pensée.
« Je ne raconte rien dans ce livre, ni de moi-même ni d’autrui, sans que je l’aie éprouvé moi-même au temps où je parcourais en Dieu le chemin de l’intuition et de la vision directe » écrit Jîlî plus loin, dans le chapitre sur le dévoilement des Noms divins, mais il faut l’entendre pour le livre entier. À chaque pas l’expérience vécue est attestée, bien que ce soit avec prudence, subtilité, en usant du paradoxe, voire de la contradiction149. Pour qui la possède « toutes les vérités contradictoires s’unifient dans la Vérité ».
[Le fidèle est ici à ses débuts, encore pris dans son individualité, en face d’un univers multiple et déroutant. Il est enfermé dans un cercle puisque c’est sa vision même des choses qui le rend prisonnier. Une première révélation brise ce cercle : sur le plan de la vie courante, soudain, l’homme plein de foi, mais encore isolé de Dieu voit l’activité humaine remplacée par l’opérer divin. Il découvre que Dieu est le seul acteur véritable, il Le voit à l’œuvre en lui-même, chez autrui, dans le monde. Le bloc de son « moi » est fêlé, déchiré le voile des contingences déterminantes. Et il s’ouvre à l’action divine.]
La révélation de Dieu dans Ses activités correspond à un état contemplatif où le serviteur voit la Puissance divine évoluer dans les choses. Il voit Dieu comme l’auteur de leur mouvement et de leur repos, toute action étant abstraite de la créature et attribuée à Dieu seul. [208] Dans cette contemplation, le serviteur est dépouillé de tout pouvoir, force et volonté propres.
Les contemplatifs participent à cet état spirituel de différentes manières. À certains, Dieu montre d’abord Sa volonté puis ensuite Son action, et le serviteur se trouve ainsi dépouillé de pouvoir, d’action et de volonté. C’est là la contemplation la plus parfaite des Activités divines. À d’autres, Dieu montre Sa volonté, en leur faisant contempler Ses dispositions dans les créatures et l’évolution de celles-ci sous la domination de Sa puissance. Certains voient l’Acte divin à l’instant même où l’action se produit du côté de la créature en sorte qu’ils l’attribuent à Dieu seul ; d’autres contemplent cela rétrospectivement quand l’action s’est déjà manifestée du côté créé…
Or, sache qu’à ces hommes qui contemplent les Activités divines, l’essentiel reste voilé, quelle que soit la grandeur de leur degré spirituel et la clarté de leur vision. Ils ignorent de la Vérité plus qu’ils n’en connaissent, car la révélation de Dieu dans Ses activités est un voile pour Sa révélation dans Ses Noms et Ses Qualités…
La perfection du Nommé se manifeste éminemment par le fait qu’Il se révèle par Son Nom à celui qui L’ignore, en sorte que le Nom est au Nommé ce qu’est l’extérieur à l’intérieur, et sous ce rapport le Nom est le Nommé Lui-même. (30.)
La qualité est ce qui te communique la manière d’être du sujet dont elle dépend… ainsi tu goûtes l’état du sujet au moyen de sa qualité…
La qualité dépend de son sujet, c’est-à-dire que tu ne t’appropries ni les qualités d’autrui ni tes propres qualités et que tu ne les possèdes d’aucune manière, avant que tu saches que tu es le sujet même dont elles dépendent, et que tu réalises que tu es Celui qui connaît… (33.)
Tout Nom et toute Qualité [divins] [sont] contenus dans le Nom Allâh…
En vérité, c’est ce Nom qui communique réellement l’Etre et qui conduit vers Lui ; il est donc comme le sceau du sens universel [l’aspect métaphysique donc supra-209-individuel] de l’homme ; c’est par lui que l’élu de la Grâce s’unit au Clément (ar-rahmân). Celui qui regarde les traits du sceau est avec Dieu par l’entremise de Son Nom ; celui qui les interprète est avec Lui par l’entremise de Ses Qualités ; et celui qui brise le sceau, transperçant ainsi la Qualité et le Nom, est avec Dieu par l’Essence, sans que les Qualités divines lui soient voilées…
Dieu a fait de ce Nom le miroir de l’homme ; quand celui-ci y mire son visage, il y reconnaît le sens de la parole sacrée : « Dieu était et nulle chose avec Lui. » (31.)
[« Celui qui regarde les traits du sceau est avec Dieu par l’entremise de Son Nom. »
Soudain, il voit. Mais il voit d’une vue intensément vécue et bouleversante. En un ravissement, en une « fulguration », le dévoilement d’un Nom confère une connaissance immédiate qui anéantit lu connaissance ordinaire152. Le Nom divin foudroie un aspect limité de l’homme et lui substitue une réalité divine correspondante. Ainsi, lorsque fulgure le Nom l’Ancien des jours, l’existence éphémère du serviteur disparaît et il ne demeure que son éternité dans la connaissance divine.
Les Noms « descendent » les uns après les autres en sorte que Dieu est révélé dans tous ses aspects majeurs par une expérience personnelle éminemment profonde et exhaustive sur son plan.]
Quand Dieu, le Très-Haut, Se révèle à un de Ses serviteurs par un Nom, ce serviteur est ravi hors de lui-même sous les fulgurations du Nom divin, en sorte que, si tu invoques alors Dieu par ce Nom, c’est le serviteur qui te répondra, le Nom divin s’appliquant désormais à lui.
Le premier degré dans cet ordre spirituel, c’est la contemplation de Dieu Se révélant comme Celui-qui-existe (al-mawjûd)153, et ce Nom se rapporte dès lors à l’adorateur même. Par-delà ce degré, Dieu Se révèle d’abord par Son Nom l’Unique, puis par Son Nom Allâh ; à ce point, le [210] serviteur s’évanouit sous l’irradiation divine, sa montagne se fend, et Dieu (al-haqq) l’appelle du haut du Sinaï de sa Réalité essentielle (haqîqah) : « En vérité, Je suis Dieu, il n’y a pas de divinité si ce n’est Moi ; adore-Moi ! » (Coran, XX, 14) ; alors Dieu efface le nom du serviteur et établit à sa place le Nom Allah en sorte que, si tu dis : Allah ! le serviteur te répond : « Je suis à ta disposition ! »
Si le serviteur s’élève plus haut et que Dieu le fortifie et le confirme, après son extinction (fanâ), dans l’état de subsistance (baqâ), Dieu répondra Lui-même à quiconque invoquera ce serviteur ; ainsi par exemple, quand tu dis : « Ô Muhammad ! » c’est Dieu qui te répond : « Je suis à ta disposition ! »
Ensuite, si le serviteur continue son ascension, Dieu Se révèle à lui par le Nom Le Clément (ar-rahmân), puis par le Nom Le Seigneur (ar-rabb), puis par le Nom Le Roi (al-malik), puis par le Nom Le Connaissant (al — 'alîm), puis par le Nom Le Puissant (al-qâdir) ; chacun de ces Noms implique une révélation supérieure à celle que confère le Nom précédent, car Dieu Se communique d’une manière plus parfaite en Se révélant distinctement… Cet ordre est l’inverse de celui qui s’applique aux manifestations de l’Essence à Elle-même, manifestations dont l’excellence diminue de l’universel au particulier… En vertu de cette analogie inverse… l’adorateur épuise les révélations des Noms — dont la Réalité intrinsèque est toujours l’Essence — en subissant chacun d’eux, car chaque Nom divin l’exige à son tour et s’applique à lui comme à son propre sujet…
[Après cette vue d’ensemble, l’auteur envisage des dévoilements particuliers dont voici quelques-uns : J
… Quand l’Essence se dévoile par Son Nom La Vérité, la nature créée du contemplatif s’évanouit, et il ne subsiste que son essence sainte et transcendante.
À d’autres, Dieu Se révèle par Son Nom L’unique (al-wahid) et I1 les conduit à cette révélation en leur montrant l’unité intrinsèque du monde, qui procède de l’Essence divine comme les vagues émanent de l’océan ; ils contemplent la manifestation de Dieu dans la multitude des créatures qui se différencient en vertu de l’Unicité divine ; dès lors, leur montagne se fend : l’invoquant tombe en défaillance ; sa multiplicité se fond dans la solitude de l’Unique ; les créatures sont comme si elles n’étaient jamais, et Dieu comme s’Il ne cessait jamais…
À d’autres, Dieu Se révèle par Son Nom L’Apparent [211] (az-zâhir) ; ils ont l’intuition de la Lumière divine se manifestant dans les choses corporelles, et ils reconnaissent par là que c’est Dieu seul qui apparaît. Or, dès que Dieu Se dévoile comme l’Apparent, le serviteur s’éteint avec toute la création, non-manifestée comme telle, dans la manifestation de l’Être divin.
À d’autres, Dieu Se révèle par Son Nom L’Intérieur (al-bâtin) et ils y accèdent par l’intuition de ce que les choses subsistent par Dieu, qui en est la réalité intérieure. Dès que Dieu Se dévoile comme l’Intérieur, la manifestation du serviteur, projetée par la Lumière divine, s’éteint ; Dieu devient l’intérieur du serviteur, et celui-ci l’extérieur de Dieu…
À d’autres encore, Dieu Se révèle par Son Nom Le Clément (ar-rahmân). C’est que Dieu, Se révélant à eux par Son Nom Allâh, les dirige par Sa propre Essence vers le degré divin suprême… Dans cet état de dévoilement divin, l’actualité spirituelle du serviteur veut que les Noms divins descendent sur lui l’un après l’autre, et qu’il en reçoive selon la mesure de ce que Dieu déposa en lui de Sa Lumière essentielle. Les Noms se succèdent jusqu’à ce que le serviteur reçoive la révélation divine par le Nom Le Seigneur (ar-rabb) ; alors descendent sur lui les Noms de la Personne (an-nafs) divine, qui se trouvent sous la domination du Nom Le Seigneur et qui synthétisent les aspects du divin et du créé, comme Le Connaissant (al — 'alîm), Le Puissant (al-qadîr) et leurs semblables. Leur série aboutit au Nom Le Roi (al-malik) ; lorsque le serviteur reçoit celui-ci et que Dieu Se dévoile à lui essentiellement, tous les autres Noms, dans toute leur plénitude, descendent également sur lui l’un après l’autre, jusqu’au Nom Le Subsistant (al-qayyûm). Quand le serviteur reçoit ce dernier et que Dieu Se révèle à lui par ce Nom, il passe des « dévoilements des Noms divins » aux « dévoilements des Qualités divines ».
[Le dévoilement des Noms divins donne une connaissance immédiate, mais non foncière, fulgurante, mais non définitive. Le Nom Le Subsistant ouvre la voie à une révélation plus profonde et plus durable, celle des Qualités.
« Celui qui interprète (les traits du sceau) est avec Dieu par l’entremise de Ses Qualités. » [212]
Le Sceau est compris maintenant dans sa pleine signification et révèle la nature divine de la vie universelle. Comme les traits du sceau qu’il faut interpréter, les Qualités divines sont des signes qu’il faut vivre en tout son être pour les comprendre. Le serviteur les assimile une à une, progressivement et jusqu’au point de se les intégrer154. Il est touché en sa « totalité », c’est-à-dire dans l’ensemble de ses facultés et même dans les couches profondes de sa personne.
Alors Dieu l’éteint et Se substitue à la créature, laquelle en réalité n’a jamais « rien occupé ». L’ami se surprend à ne plus se retrouver : l’Aimé est seul. Ne règne plus dès lors que la splendeur des Qualités divines — « ô lever de la Beauté éblouissante ! » Telle est ici l’abolition de la dualité, le « but ultime des désirs ».]
Quand Dieu Se révèle à Son serviteur dans une de Ses Qualités, le serviteur plane dans la sphère de cette Qualité jusqu’à ce qu’il en ait atteint la limite par voie d’intégration (al-ijmâl), non par connaissance distinctive, car ceux qui réalisent les Qualités divines n’ont pas de connaisance distinctive si ce n’est en vertu de l’intégration. Si le serviteur plane dans la sphère d’une Qualité, et qu’il la réalise entièrement par intégration [spirituelle], il s’assied sur le trône de cette Qualité, en sorte qu’il se l’assimile et en devient le sujet ; dès lors, il rencontre une autre Qualité, et ainsi de suite jusqu’à réaliser toutes les Qualités divines. Que cela ne te confonde pas, mon frère, car, pour ce qui est du serviteur, Dieu, voulant Se révéler à lui par un Nom ou par une Qualité, l’éteint, annihilant son moi et son existence ; puis, quand la lumière créaturielle s’est éteinte, et que l’esprit individuel est effacé, Dieu fait résider dans le temple créaturiel, sans qu’il y ait pour cela localisation divine, une réalité subtile qui se sera ni détachée de Dieu ni conjointe à la créature, remplaçant ainsi ce dont Il le dépouilla, car Dieu Se révèle à Ses serviteurs par générosité… [Ainsi Dieu] ne Se révèle qu’à Lui-même, bien que nous appelions alors cette réalité subtile divine « serviteur », vu qu’elle en tient la place ; ou bien : il n’y a là ni serviteur ni Seigneur, car s’il n’existe plus de servi-213-teur, le Seigneur cesse d’être Seigneur ; en réalité, il n’y a plus que Dieu seul, l’Unique, l’Un.
La créature n’a d’être que par attribution contingente,
En réalité elle n’est rien.
Lorsque les lumières divines apparaissent,
Elles effacent cette attribution,
En sorte que [les créatures] n’étaient pas ni ne cessaient d’être.
Dieu les éteignit, mais dans leurs essences elles n’ont jamais existé,
Et dans leur extinction elles subsistent…
Lorsqu’elles s’anéantissent, l’Être revient à Dieu ;
Il est alors tel qu’Il était avant qu’elles ne devinssent ;
Le serviteur devient comme s’il n’avait existé,
Et Dieu est comme si jamais rien n’avait cessé.
Cependant, lorsqu’apparaissent les fulgurations divines,
La créature se revêt de la lumière de Dieu et devient une avec Lui.
Il l’éteint, puis Il Se substitue à elle ;
Il demeure à la place des créatures, et cependant elles n’ont jamais rien occupé.
Comme les vagues, dont le principe est l’unité de la mer,
Et qui, dans leur multitude, sont unies par elle ;
Quand elle est en mouvement, ce sont les vagues qui sont elle dans leur totalité,
Et quand elle est au repos, il n’y a ni vagues ni multiplicité.
…
Les hommes participent à cette révélation des Qualités divines selon leurs réceptivités spirituelles, selon la continuité de leur science et la force de leur décision.
Le serviteur auquel Dieu Se révèle par la qualité de la Vie, devient lui-même la vie du monde entier ; il voit l’écoulement de sa propre vie dans tout ce qui existe, corps et esprits. Il contemple les idées comme des formes qui tiennent leur vie de lui-même ; il n’existera pour lui ni formes idéelles — comme les paroles et les actes — ni formes subtiles — comme les esprits — ni formes corporelles dont il ne serait pas la vie, et il sera conscient de la manière dont cette vie émane de lui. Il reconnaît cela directement, sans intermédiaire, par une intuition divine essentielle et mystérieuse. J’étais moi-même dans cet état pendant un certain temps…
À certains, Dieu Se révèle dans la Qualité de la Con-214naissance. Car, Dieu S’étant révélé dans la Vie qui pénètre toute chose, le serviteur savoure, par l’unité de cette vie, tout ce qui constitue la nature des choses ; dès lors, l’Essence Se révèle à lui dans la qualité cognitive, en sorte qu’il connaîtra l’univers entier avec le déploiement de tous ses mondes, de leur origine jusqu’à leur retour dans le principe ; il sait de toute chose comment elle était, comment elle est et comment elle sera… Il a de tout cela une connaissance foncière, principielle et intuitive… [mais cette connaissance se réalise seulement] dans la non-manifestation pure…
À certains, Dieu se révèle dans la Qualité de la Vue. Car, S’étant révélé d’abord par la vision intellectuelle qui pénètre tout, Dieu Se révélera plus particulièrement dans la Qualité de la Vue, en sorte que la vue du serviteur deviendra l’organe de sa connaissance ; il n’y a dès lors ni science divine ni science créaturielle qui ne soit l’objet de la vision de ce serviteur ; il voit les êtres tels qu’ils sont dans la non-manifestation pure ; cependant — chose étrange — il les ignore dans sa conscience extérieure… [En effet il] ne participe pas dans sa nature créée à ce qu’embrasse sa nature divine ; il n’y a donc pas de conjonction ; j’entends que ce qu’il réalise dans son état non-manifesté n’apparaît dans sa conscience « objective » que d’une manière accidentelle, et pour certaines choses seulement que Dieu lui manifeste par générosité155. Le serviteur qui réalise l’Essence, par contre, connaît le monde objectif par sa réalité non-manifestée, et il connaît la non-manifestation « objectivement » ; il convertit donc l’un dans l’autre…
À d’autres, Dieu Se révèle par la Qualité de la Parole ; dès lors, les êtres existent par la parole du serviteur. Dieu, disions-nous, Se révèle d’abord à son serviteur par la Qualité de la Vie, puis Il lui fait connaître, par la Qualité cognitive, le secret de la Vie divine en lui, puis Il la lui fait voir, puis entendre ; c’est alors que le serviteur « parle » par la force de l’unité de sa vie, en sorte que les êtres existent par sa parole. En même temps il est conscient, d’une manière non temporelle, de ce que ses paroles ne s’épuiseront jamais…
Chez certains, la manifestation de la Parole divine est accompagnée de tourbillons de lumière. [215]
À d’autres sera dressée une chaire de lumière.
D’autres voient une lumière dans leur intérieur, la Parole émanant de cette lumière…
D’autres encore voient une forme spirituelle qui leur adresse la parole…
À certains de ceux qui sont élevés jusqu’à « l’Arbre-Lotus de l’extrême Limite », il sera dit : « Mon ami, ton moi est Mon Soi ; tu es l’essence de Lui, et Lui n’est autre que Moi. Mon ami, c’est par Mon œuvre que tu es déployé, et par Mon unicité que tu es différencié, mais l’œuvre que tu es Me déploie, et ton ignorance Me couvre. Je suis ton but ; Je suis à toi, non à Moi ; tu es Mon but ; tu es à Moi, non à toi. Mon ami, tu es le point que la circonférence de l’existence a pour centre, en sorte que tu es l’adorateur en elle et l’adoré en même temps. Tu es la lumière ; tu es la manifestation ; tu es la beauté et l’ornement ; tu es comme l’œil par rapport à l’homme et comme l’homme par rapport à l’œil [ou à l’essence : al — 'ayn]. »
… Ô terme des espoirs, but ultime des désirs,
Quoi de plus doux et de plus réel pour moi que Tes paroles !
O Kaaba de la réalisation… ô lever de la beauté éblouissante ;
Nous nous sommes rendus à Toi, nous T’avons institué gérant du royaume de notre être.
Tout ce monde-ci et l’au-delà sont à Ta disposition.
Si ce n’était pour Toi, nous ne serions pas,
Et si ce n’était pour moi, Tu ne serais pas.
C’est ainsi que Tu es et que nous sommes ;
Et la Réalité essentielle ne se perçoit pas.
C’est Toi que nous visons par le Glorifié, le Riche,
Et c’est Toi que nous visons par l’indigent, — et il n’y a pas d’indigence !
[C’est bien ici le domaine des illuminations et des ravissements, c’est aussi celui des phénomènes extraordinaires et des « pouvoirs »156.]
Parmi ceux qui réalisent la Parole divine, certains entendent les choses cachées ; ils ont donc connaissance des événements avant qu’ils n’arrivent, soit qu’ils le sachent en réponse à leurs questions, — et c’est ce qui se produit [216] le plus souvent —, soit que Dieu les prévienne de Sa seule initiative.
D’autres… demandent des miracles, et Dieu les en comble, afin qu’ils aient une preuve de Lui quand ils reviennent à leur conscience corporelle tout en gardant intègre leur attitude envers Dieu…
[Mais après tant de merveilles, voici que al-Jîlî rapporte une expérience personnelle de total dépouillement, prélude à la révélation de l’Essence qui va être évoquée au chapitre suivant.]
À d’autres… Dieu Se révèle par la Qualité de la Toute-Puissance, en sorte que les choses se constituent dans le monde non-manifesté par la volonté du contemplatif… C’est dans cet état que j’ai entendu le bruit de la Cloche [que le Prophète entendit lors de la révélation] ; alors ma composition fut dissoute, mes contours disparurent et mon nom s’effaça. J’étais, sous l’emprise intense qui me saisit, comme un vieux froc qui est accroché sur un haut arbre et qu’un vent puissant emporte lambeau par lambeau. Je ne pus voir objectivement que des éclairs, du tonnerre, des nuages dont pleuvaient des lumières et des océans dont les vagues étaient de feu. « Les cieux et la terre se serraient les uns contre les autres », et je me trouvais dans les « ténèbres sur des ténèbres ». La Puissance ne cessa de m’arracher une faculté après l’autre, et de transpercer un désir après l’autre, jusqu’à ce que la Majesté divine me foudroyât et que la Beauté suprême jaillît par le chas d’aiguille de l’imagination ; alors se desserra, dans l’aspect suprême, le serrement de la Main droite. Aussitôt les choses vinrent à l’existence ; l’obscurité cessa, et après que l’arche se fût assise sur le mont Jûdî157, on entendit crier : « O vous, cieux et terre, venez à Nous bon gré ou mal gré ! Ils répondirent : nous venons obéissants » (Coran, XLI, 10).
[Le dévoilement des Qualités malgré toute sa grandeur constitue encore un voile, car il relève du plan sensible ou distinct. Plus profondément encore, et [217] obscurément cette fois, un autre dévoilement a lieu pour celui qui est prêt à quitter tout accomplissement particulier et à se quitter soi-même intégralement.
« Celui qui brise le sceau, transperçant ainsi la Qualité et le Nom, est avec Dieu par l’Essence, sans que les Qualités lui soient voilées »
Lorsque l’Essence fulgure, les attributs ne sont ni un voile, ni voilés, « ils sont essentiellement l’Être absolu ». Et cette réalisation, simple et souveraine, est telle que toutes les précédentes apparaissent comme errance ou « dispersion ».
Rares sont les initiés qui parviennent au dévoilement de l’Essence, dont la possibilité même n’est pas reconnue par des écoles moins mystiques.]
C’est de la pureté du vin que jouit l’Essence en toi ;
Toute union hors d’Elle n’est que dispersion.
Elle Se dévoile transcendante à l’égard de toute description,
Sans analogie et sans qu’il y ait en Elle de relations.
Comme le soleil levant efface la lueur des planètes,
Alors qu’elle subsistent en principe par lui,
Elle est ténèbres sans jour et sans crépuscule,
Mais en dehors de Sa demeure la troupe erre dans le désert.
Que de limites insurpassables se montrent à la caravane qui tend vers Elle !
En sorte qu’elle reste perplexe à Son égard et n’en saisit pas les caractères.
Cachés sont les sentiers vers Elle, ni contours ni science ne La trahissent.
Elle refuse l’intimité ; Ses beautés orgueilleuses La défendent.
Un chemin couvert, effacé et étroit mène vers Elle ;
C’est à l’écart que le voyageur illusionné s’arrête.
Comme l’ignorance, Elle nivelle les sciences des mondes ;
Dans Son sein, guidance et égarement se valent.
Jamais l’intellect n’en vainc la pureté pour s’y mêler ;
Jamais la pensée ne flaire Son parfum enivrant.
Le feu qui guide reste ignorant de Ses sentiers ;
La lumière sûre n’éclaire pas Ses chemins.
Le plus perplexe des perplexes La démontre le plus clairement ;
Car ils ne vivent pas en Elle ni ne meurent.
Ses qualités se noient dans l’Océan de Sa gloire,
Sans mourir elles meurent dans Son fond.
Rien ne répond à la question : qu’est-Elle ?
Ni nom ni attribut ; l’Essence est trop sublime pour cela.
.
Sache que l’Essence (adh-dhât) signifie l’Être absolu dans son dépouillement de tout rapport, relation, assigna-
tion et aspect. Ce n’est pas que tout cela se situe en dehors de l’Être absolu, au contraire, tous ces aspects et ce qu’ils impliquent sont contenus en Lui. Ils ne s’y trouvent ni individuellement ni comme rapports, mais ils sont essentiellement l’Être absolu. Celui-ci est l’Essence pure dans laquelle ne se manifestent ni noms ni attributs ni relations ni rapports ni rien d’autre. Dès qu’il s’y manifeste quelque chose, l’aspect dont il s’agit est attribué à ce qui supporte cette manifestation et non pas à l’Essence pure, puisque le principe de l’Essence est précisément la synthèse des réalités universelles et individuelles, des assignations et des rapports, synthèse qui est à la fois leur subsistance et leur disparition sous l’emprise de l’Unité de l’Essence. Lorsqu’on envisage dans Celle-ci une qualité ou un nom ou un attribut quelconque, c’est toujours en vertu de tel point de vue que cette qualité existe et non pas dans l’Essence comme Telle. Pour cela nous disons que l’Essence est l’Être absolu158…
Par « ceux qui ont réalisé l’Essence » on entend les hommes en qui demeure la réalité subtile divine, dans le sens où nous disions que Dieu, lorsqu’Il Se révèle à Son serviteur et qu’Il en éteint l’individualité, établit en lui une réalité subtile divine qui, elle, peut être de la nature de l’Essence ou de la nature des Qualités divines. Quand elle est de la nature de l’Essence, la constitution humaine [où elle demeure] sera l’être unique parfait, le support universel… le Sceau de la Sainteté… Aucune chose ne lui est cachée, et ceci parce que la réalité divine subtile, qui demeure dans ce saint, est essence pure, libre de toute condition divine ou créaturielle, en sorte que rien ne l’empêche d’accorder à chaque degré des existences divines ou créées la réalité qu’il a. Car ce qui pourrait empêcher l’essence de s’identifier aux réalités n’est qu’une condition quelconque, divine ou créaturielle qui lui serait imposée ; or, aucune contrainte n’existe, puisqu’elle est essence pure…
Si les hommes de Dieu n’étaient pas individuellement exclus du dévoilement de l’Unité (ahadiyah), et à plus [219] forte raison du dévoilement de l’Essence, nous pourrions parler de l’Essence en décrivant d’étranges états de révélation et en donnant de merveilleuses preuves divines essentielles, pures de toute apparition ou interférence des Noms et des Qualités ou de toute autre chose. Ces preuves, nous les sortirions des trésors cachés de la Non-Manifestation au moyen de clefs non manifestées, et nous les étalerions, moyennant des expressions subtiles et mesurées, sur la face évidente de la conscience « objective », afin que les serrures des intelligences s’ouvrent par ces mêmes clefs, et que le serviteur glisse à travers les chas d’aiguille de la Voie vers le paradis de l’Essence que voilent les Qualités divines, et que protègent les lumières et les ténèbres159.
« Dieu guide vers Sa lumière quiconque Il veut ; Dieu donne des symboles pour les hommes, et Dieu connaît toute chose » (Coran, XXIV, 35).
[Cette allégorie est donnée au début du livre de Jîlî pour illustrer l’Essence. Le lecteur en saisira sans doute mieux la signification à la fin de nos extraits.]
L’Oiseau saint160 vola dans l’étendue illimitée de cette atmosphère vide, en exaltant Dieu par sa totalité dans l’air de la sphère suprême161 ; alors il fut ravi hors des existences et transperça les Noms et les Qualités par réalisation et vision directe. Puis il plana autour du zénith de la non-existence, après avoir traversé les étendues du devenir et de ce qui précède les temps ; alors il Le trouva nécessairement, Lui dont l’existence n’est pas sujette au doute et dont l’absence n’est point cachée. Et lorsqu’il voulut retourner au monde créé, il demanda qu’un signe de reconnaissance lui fût donné ; et il fut écrit sur l’aile de la colombe : « En vérité, ô Toi, talisman162, qui n’est ni quiddité ni nom, ni ombre ni contour, ni esprit ni corps, ni qualité ni désignation ni signe, — à Toi appartiennent [220] l’existence et la non-existence, et à Toi le devenir et ce qui précède les temps ; — Tu es non-existant comme Essence, existant dans ta Personne163, connu par Ta grâce, absent selon le genre ; Tu es comme si Tu n’avais créé que des métaphores et comme si Tu n’étais que par façon de parler ; Tu es l’évidence de Toi-même par la spontanéité de Ton langage ; je viens de Te trouver Vivant, Connaissant, Voulant, Puissant, Parlant, Ecoutant et Voyant164 ; j’ai embrassé la Beauté et j’ai été transpercé par la Majesté ; j’ai sondé par Toi-même les modes de l’Infinité ; quant à ce que Tu as imaginé en affirmant l’existence d’un autre que Toi, il n’est pas là, mais Ta Beauté resplendissante est parfaite ; et à qui ces paroles sont-elles adressées, est-ce à Toi, est-ce à Moi ? Ô Toi qui es absent là, nous T’avons trouvé ici ! »…
Ensuite il fut écrit sur l’aile de l’oiseau vert avec la plume à l’encre de soufre rouge165 :
« En vérité, la Grandeur est feu et la Science est eau et la Force est air et la Sagesse est terre, éléments par lesquels se réalise notre essence unique [le “joyau singulier”]. Il y a pour cette essence deux dimensions, dont la première est le non-commencement et la seconde la non-fin, et deux désignations, dont la première est Dieu et la seconde la créature, et deux attributions, dont la première est l’éternité et la seconde le devenir, et deux noms, dont le premier est le Seigneur et le second le serviteur. Elle a deux faces : la première est apparente, c’est le monde, et la deuxième est intérieure, c’est l’au-delà ; et elle a deux principes : le premier est la nécessité et le second la possibilité166 ; et elle a deux rapports : selon le premier elle est absente pour elle-même et existante pour ce qui est autre qu’elle-même, et selon le second elle est absente pour ce qui est autre qu’elle-même et existante pour elle-même167. Il y a d’elle deux connaissances, la première concerne d’abord son affirmation nécessaire, ensuite sa négation ; la [221] seconde concerne d’abord sa négation, ensuite son affirmation nécessaire168. Sa conception implique un point d’erreur ; car il y a dans les symboles des déviations et dans les allusions des détournements de leur sens : à toi la prudence, ô oiseau, en gardant cet écrit qu’un autre ne lira pas ! »
Et l’oiseau ne cessa de planer dans ces sphères, vivant en la mort, impérissable dans l’anéantissement ; enfin, déployant ses ailes, il promena son regard, le tourna et le retourna, mais il ne le vit pas sortir de lui-même, ni aller vers une nature étrangère à la sienne ; que l’oiseau plongeât dans l’océan, qu’il en ressortît, qu’il en bût, qu’il s’enivrât ou qu’il désirât plus encore, rien qui lui parle et rien qui soit absent de lui. « Perfection absolue » est devenu l’expression qui s’applique réellement à lui-même, car il ne saisit pas les bornes d’une de ses qualités ; les Noms de l’Essence et les Qualités divines lui appartiennent en vertu d’une assimilation réelle ; … il jouit pleinement des possibilités inhérentes à ses qualités, et il n’y a pourtant point de chose qui lui appartienne entièrement dans sa forme individuelle ; il possède toute la liberté d’évoluer dans son lieu et dans son monde et il est en même temps limité par ses stations169…
[Cette page est empruntée au chapitre sur l’Obscurité divine, placé avant les dévoilements. Peut-être pouvons-nous pourtant la proposer comme conclusion.
Nous avons vu que l’Obscurité divine est le cœur caché de l’Essence, sa non-manifestation, tandis que le torrent des Noms, des Qualités et de leurs activités en procède, apparemment accompagné d’une occultation progressive, à laquelle les dévoilements portent remède. Mais ce ne sont là que nos approches distinctives.] [222]
Dieu, toutefois, est trop sublime pour qu’Il Se cache à Lui-même par quelque manifestation, ou qu’Il Se manifeste à Lui-même hors quelqu’état d’occultation ; mais Il Se trouve éternellement dans les états d’occultation, de non-manifestation ou de manifestation qui découlent de Son Essence, de même qu’Il possède toujours Ses activités, Ses aspects, Ses rapports, relations, Noms et Qualités, sans qu’Il Se change ou Se transforme… Il reste en Lui-même éternellement tel qu’Il était avant qu’Il ne Se manifestât à nous. Or, quels que soient ces modes, Son Essence n’assume jamais qu’un seul état de révélation (tajallî), à savoir celui qui Lui est essentiel, en sorte qu’Il n’a qu’une seule irradiation (tajallî) qui, elle, ne possède qu’un seul nom, et auquel ne correspond qu’une seule qualité ; car en tout, il n’existe qu’un seul, exempt de toute multiplicité ; c’est Lui qui Se révèle à Lui-même à tout jamais, ainsi qu’Il S’est révélé de toute éternité…
C’est cet état de révélation unique qui Lui est exclusif, en sorte que la créature n’y participe jamais… toutes les autres révélations ne sont qu’un reflet du ciel de cette révélation suprême, ou une goutte de son océan ; tout en étant réelles, elles s’annihilent cependant sous la puissance de cette révélation essentielle qui est exclusivement à Dieu en vertu de Sa connaissance de Lui-même, tandis que les autres révélations sont à Dieu en vertu de la connaissance d’autrui…
[Mais en ce degré, Jîlî efface aussitôt les termes qu’il vient d’employer et qui]
ne confèrent pas de sens valable, car l’Obscurité divine ne comporte aucun rapport de non-manifestation, ni l’Unité aucun rapport de manifestation.
Sache que tu es à l’égard de toi-même dans un état d’obscurité… tu es une essence cachée dans une obscurité ; n’as-tu donc pas appris que Dieu est ton essence et ton ipséité ? Or, tu n’es pas conscient de ce qui est éminemment ta réalité ; tu es donc à l’égard de toi-même dans l’obscurité, bien que, sous le rapport de la réalité divine, tu ne sois pas voilé à toi-même, car le principe de cette réalité veut qu’elle ne soit pas inconsciente d’elle-même ; il s’en suit que tu es divinement révélé à toi-même et en même temps, de par ta nature créée, inconscient de ta réalité divine ; tu es donc simultanément manifesté et caché à toi-même. C’est là un de ces symboles « que Dieu formule pour les hommes », et que ne comprennent que les connaissants. [223]
[Le dévoilement de l’Essence est comparable à la Voie de Siva par son instantanéité, par l’élan, par le complet dépouillement de soi et l’absolu dépassement de toute forme. Et cette unique révélation de Dieu à Lui-même au cœur caché de l’Essence, absolument ineffable, évoque, nous semble-t-il, la « non-voie ».]
À André Préau
Les textes ci-dessous sont les commentaires en prose et en vers de dix peintures faites en Chine par un moine bouddhiste Ch'an (ou, comme disent les Japonais, Zen) de l’école de Lin Chi (en japonais Rinzai), nommé K'uo an (en japonais Kakuan). Ils remontent à la Dynastie Sung, c’est-à-dire approximativement au Xe ou au XIe siècle de notre ère, époque où Zen atteignit son apogée, tandis que déclinaient les autres sectes bouddhistes. Avant K'uo an un maître Zen nommé Ch'ing chu (en japonais Seikyo) avait déjà illustré par une série de six peintures symboliques (où la vache tenait aussi le premier rôle) les étapes du progrès spirituel telles qu’il les concevait. À chaque peinture la vache devenait plus blanche et à la sixième, elle disparaissait complètement172. [225]
Rappelons brièvement que le Bouddhisme Ch'an 173 ou Zen, qui est toujours vivace non seulement en Chine, mais aussi au Japon, est le rameau principal dans ces pays de la branche Mahāyāna. C’est le produit de l’élaboration par les Chinois de la grande doctrine bouddhiste de l’Illumination : un bouddhisme psychologique, pratique, humoristique, taoïste presque, très fermement et sincèrement attaché à l’idéal bouddhiste, mais très tolérant — et aussi peu formaliste que possible quant aux moyens à employer pour arriver à l’illumination personnelle, au Wu ou Wu tao (en japonais satori) qui se suffit à soi-même. Zen se définit : l’art de voir clair dans sa propre nature. Il pose en principe que ce n’est pas par des moyens proprement intellectuels que nous pouvons comprendre la vérité de l’Illumination. Nous avons en nous-mêmes ce qu’il faut pour nous libérer : une faculté d’intuition qui nous met en mesure de comprendre et de saisir directement les grandes vérités qui donnent pleine satisfaction à notre exigence spirituelle fondamentale. Contrairement à la plupart des autres écoles bouddhistes, Zen ne distingue pas à proprement parler d’étapes successives à travers lesquelles tout religieux devrait nécessairement passer pour atteindre la pleine réalisation personnelle de l’Illumination. Il estime que cette réalisation est un acte instantané, comme la glace qui prend, et qu’il n’y a pas d’échelons distincts dans le progrès spirituel. Néanmoins, en fait, Zen est bien obligé de reconnaître qu’on peut pénétrer plus ou moins profondément dans la vérité de la doctrine qu’on saisit — ou plutôt par laquelle on est saisi — et, si « abrupt » que soit Zen (on distingue en Chine les doctrines abruptes et les doctrines progressives), la lumière qu’il apporte à l’esprit ne se réalise pas tout d’un coup. Un texte comme [226] celui qui est ici traduit le montre d’ailleurs clairement, et il serait intéressant de comparer les étapes du développement spirituel Zen telles qu’elles sont décrites ci-dessous avec celles qu’on trouve chez les mystiques chrétiens ou musulmans. Bien qu’authentiquement bouddhiste, comme l’a montré M. Suzuki, l’esprit Zen semble aussi proche des vieux maîtres taoïstes que du Bouddha lui-même.
La traduction ci-dessous a été faite en utilisant le texte anglais qu’a donné M. D. S. Suzuki dans ses intéressants Essays in Zen Buddhism (Londres, 1927). Les sinologues pourront en vérifier l’exactitude en se reportant au texte chinois reproduit dans le même ouvrage174.
Elle ne s’est jamais égarée et à quoi bon la rechercher ? Nous ne sommes pas intimes avec elle parce que nous avons trahi notre nature la plus profonde. Elle est perdue, car nous nous sommes laissé abuser par les sens trompeurs. Notre maison s’éloigne de plus en plus, et toujours des chemins de traverse et des carrefours embarrassants. Le désir de gagner et la peur de perdre brûlent comme du feu ; les idées de bien et de mal, de vrai et de faux, de juste et d’injuste, s’avancent en bataillons.
Seul dans une contrée sauvage, perdu dans la jungle, il cherche, il cherche, il cherche !
Rien que les eaux qui se gonflent, les montagnes lointaines et le chemin qui n’en finit pas
Épuisé et désespéré, il ne sait pas où aller,
Il entend seulement les cigales du soir qui chantent dans les érables. [227]
À l’aide des Sutras et en étudiant les doctrines où il est arrivé à comprendre quelque chose, il a trouvé les traces. Il sait maintenant que les choses, si nombreuses soient-elles, sont d’une seule substance et que le monde extérieur est un reflet du Soi. Pourtant il n’est pas capable de distinguer ce qui est bon de ce qui ne l’est pas, son esprit est encore embrouillé dans les questions de vérité et de fausseté. Comme il n’a pas encore passé la porte, on dit de lui provisoirement qu’il a repéré les traces.
Au bord de l’eau, sous les arbres, éparses sont les traces de la vache perdue.
Les bois odorants s’épaississent — a-t-il trouvé le chemin ?
Quelque lointaines et reculées, au-delà des collines, que soient les contrées où la vache erre à l’aventure,
Son mufle atteint le ciel et rien ne peut la cacher.
Il trouve le chemin en prêtant l’oreille. Tous ses sens étant harmonieusement réglés175, il voit dans l’origine des choses. Quoi qu’il fasse, elle est manifestement là. C’est comme le sel dans l’eau et l’éclat dans la couleur. (C’est là, mais ce ne peut être distingué séparément.) Quand son regard sera convenablement dirigé, il trouvera que ce n’est rien autre chose que lui-même.
Là-bas perché sur une branche un rossignol chante gaiement ;
Le soleil est chaud, la brise caressante souffle à travers les saules verts du rivage ;
La vache est là toute seule, nulle part elle n’a de place pour se cacher ;
La tête splendide décorée de cornes majestueuses, quel peintre pourrait la reproduire ? 176. [228]
Après avoir été longtemps perdu dans la solitude, il a fini par trouver la vache et a mis la main dessus. Mais, à cause de l’accablante pression du monde extérieur, il trouve que la vache est dure à surveiller. Constamment elle soupire après les gras pâturages. La nature sauvage est toujours déréglée et refuse absolument de se laisser subjuguer. S’il désire se l’assujettir complètement il doit se servir libéralement du fouet177.
De toute l’énergie de son âme, il a enfin pris possession de la vache
Mais que sa volonté est sauvage, que ses forces sont ingouvernables !
Parfois elle monte fièrement sur un plateau,
Quand tout à coup la voilà perdue dans un défilé impénétrable et plein de brouillard.
Quand une pensée s’ébranle, une autre la suit, et puis une autre — ainsi est éveillée une suite interminable de [229] pensées. Par la lumière de l’esprit, tout ceci se change en vérité ; mais le faux s’affirme quand la confusion prévaut. Les choses nous oppressent non à cause d’un monde extérieur, mais à cause d’un esprit qui se déçoit lui-même. Ne lâchez pas la corde de ses naseaux, serrez-la bien, et ne vous permettez aucune indulgence.
Ne vous séparez jamais du fouet et du licou,
De peur qu’elle ne s’égare dans un monde de corruption
Quand elle est convenablement gardée, elle devient pure et docile,
Même sans chaîne et rien ne l’attachant, elle vous suivra d’elle-même.
La lutte est finie ; gain et perte, ça ne l’intéresse plus. Il fredonne un air rustique de forestier, il chante les simples chants d’un gamin de village. S’installant sur le dos de la vache, ses yeux sont fixés sur des choses qui ne sont pas de la terre. Même si on l’appelle il ne tournera pas la
tête ; même si on veut le séduire il ne restera plus en arrière.
À cheval sur la vache, il revient tranquillement chez lui ;
Enveloppé dans le brouillard du soir, comme le son de la flûte s’éteint mélodieusement !
Chantant un refrain, battant la mesure, son cœur est rempli d’une joie indescriptible !
Qu’il est maintenant un de ceux qui savent, est-il besoin de le dire ?
Les choses sont une et la vache est symbolique. Quand vous savez que ce n’est pas du piège ou du filet que vous avez besoin, mais du lièvre ou du poisson, c’est comme l’or séparé de sa scorie, c’est comme la lune émergeant des nuages. Un seul rayon de lumière sereine et pénétrante [230] brille, un son majestueux se fait entendre dès avant les jours de la création.
Monté sur la vache il est enfin de retour chez lui.
Mais voici qu’il n’y a plus de vache, et avec quelle sérénité il est assis tout seul !
Bien que le soleil rouge soit haut dans le ciel, il semble être encore tranquillement endormi ;
Sous un toit de chaume, à côté de lui, son fouet et sa corde gisent, inutiles.
Toute confusion est mise de côté et la sérénité seule prévaut ; même l’idée de sainteté est absente. Où est le Bouddha ? où n’y a-t-il pas de Bouddha ? il ne s’appesantit pas sur ces questions, il passe rapidement sur elles. Quand il n’existe plus aucune forme de dualisme, un homme, eût-il mille yeux, ne réussit pas à découvrir une lucarne dans un mur. Une sainteté devant laquelle les oiseaux offrent des fleurs n’est qu’une dérision.
Tout est vide, le fouet, la corde, l’homme et la vache : Qui a jamais contemplé l’immensité du ciel ?
Sur la fournaise incandescente, pas un flocon de neige ne peut tomber :
Quand on en est arrivé là, manifeste est l’esprit de l’ancien maître178.
Depuis le tout premier commencement, pur et sans tache, il n’a jamais été touché par la corruption. D’un œil calme il regarde la croissance et le dépérissement des choses qui ont une forme, cependant que lui-même demeure dans la sérénité immuable du détachement. Quand il ne s’identifie pas avec des transformations magiques, qu’a-t-il [231] à faire d’artifices de discipline personnelle ? L’eau coule glauque, la montagne trône violette. Assis à l’écart, il observe les choses qui changent.
Revenir à l’Origine, être de retour à la Source — voilà déjà un faux pas !
Il vaut bien mieux rester chez soi, aveugle et sourd, simplement et sans faire d’embarras.
Assis dans sa hutte il ne prend pas connaissance des choses du dehors,
Regardez l’eau qui coule — où ? personne ne le sait ; et ces fleurs rouges et fraîches — pour qui sont-elles ?
La porte de son humble chaumière est fermée et les plus sages ne le connaissent pas. Aucun reflet de sa vie intérieure ne peut être saisi ; car il va son chemin à lui sans suivre les pas des anciens sages. Portant une gourde il va au marché, appuyé sur un bâton il revient chez lui. On le trouve en compagnie de buveurs de vin et de bouchers. Lui et eux sont tous changés en Bouddhas.
Poitrine et pieds nus, il va sur la place du marché ;
Couvert de boue et de cendres, comme il sourit largement !
Pas n’est besoin du pouvoir miraculeux des dieux,
Un simple contact de sa main, et voyez ! les arbres morts se couvrent de fleurs.
K'UO AN
Le buffle 179 peut apparaître comme l’énergie universelle consciente et lumineuse par elle-même. Elle nous est trop intime pour que nous puissions déceler sa présence, entraî — [232] nés que nous sommes par nos désirs et l’attrait du monde extérieur.
L’homme ordinaire en butte à l’hostilité de la nature cherche en vain le buffle loin de chez lui jusqu’au jour où, ayant épuisé force et raison dans ce qui n’en finit pas, il renonce, perdu, vaincu… Il peut alors entendre le chant des cigales dans les érables, premier frémissement, écho lointain, mais révélateur : quelque part le buffle existe… même s’il se cache ! (I.)
Il va donc continuer à le chercher, mais ailleurs et autrement. Il s’appuie sur les textes sacrés, il apprend que rien ne peut cacher le buffle puisque l’énergie souveraine remplit ciel et terre et il en devine quelques traces dans l’épaisseur des bois odorants. (II.)
Mais les signes extérieurs, tirés d’une science par ouï-dire laissent tout à coup la place au buffle : il est partout, comment s’en tenir aux traces ? L’homme dont les sens sont apaisés, capable d’écouter avec attention, l’entend : le son pénètre en lui, le chant du rossignol, la brise caressante, tout est imprégné de sa présence diffuse. (III.)
Ne peut-on reconnaître ici l’apaisement de la voie de l’activité ?
La bête indomptée qu’est sa propre énergie remplit l’homme d’admiration. Mais il ne peut conserver l’intériorité qu’il vient de découvrir en une subite illumination tant que ses énergies ne sont pas canalisées, tant que le buffle reste un objet à connaître, à saisir.
Comment dès lors, perdre le sentiment de l’objectivité et se reconnaître soi-même comme source de cette énergie encore si sauvage et indomptée, en d’autres termes, comment ne plus seulement l’entendre ou la voir, mais « l’être » réellement ?
En s’éveillant, notre propre énergie nous déborde, nous envahit puissamment, balayant tous les supports. De là, les grands efforts requis pour s’emparer du buffle et le dompter. Aussitôt les forces sensibles et les désirs subjugués, l’homme pénètre dans la voie de l’énergie. (IV.)
Les pensées en se suscitant l’une l’autre en une série sans fin 180 constituent notre véritable esclavage, mais grâce à une vigilance sans défaillance et à une ardeur brûlante elles forment, naturellement, sur un même thème une continuité de plus en plus subtile. Sous le contrôle du fouet et du licou, du discernement et du zèle, l’énergie devient [233] une et docile, le buffle suit l’homme spontanément l’énergie illuminative est dès lors parfaitement conquise. (V.)
Maître de son énergie radieuse et puissante l’homme rentre en sa propre demeure, son être intime ; pour lui tout est résolu, il n’y a plus de dualité, rien ne peut le détourner de sa joie profonde et simple d’enfant, car tout est cette paix au cœur de laquelle il se perd. Il ne reviendra plus en arrière. Le brouillard du soir et le son de la flûte qui s’éteint mélodieusement évoquent l’indifférencié, prélude au nirvikalpa de la voie supérieure. Le moi va s’évanouir peu à peu. Tout est douceur et sérénité dans la nature comme dans son cœur. (VI.)
Lorsqu’il oublie le buffle, son énergie ne lui sert plus de tremplin, l’homme a pénétré dans la voie divine ; il a délaissé tout instrument, moyen, expédient, le fouet et la corde gisent inutiles. Le contingent s’est évanoui, seule la substance demeure : lièvre, poisson et l’or. Le monde n’a pas disparu, il est là, présent en son essence. L’homme entend le son majestueux d’avant la création qui diffère complètement du beuglement des débuts. Il retourne chez lui, à l’origine, au premier instant : son être entier est apaisé et comme endormi. (VII.)
Alors l’homme aussi s’évanouit, c’est l’anéantissement de la voie divine à son achèvement : tout est vide (VIII).
Il parvient à la Non-Voie. Est-ce un retour à l’origine où tout est égal ? Non, c’est déjà un faux pas, car il vit dans l’instant éternel, dans le sans pourquoi, le sans cause. (IX.)
À la dixième étape, les arbres morts se couvrent de fleurs au simple contact de sa main. Seule son efficience le trahit ; c’est un maître qui répand ses dons, mais son apparence est celle d’un homme ordinaire que rien ne distingue du commun des mortels : telle est la Non-Voie.
LILIAN SILBURN
Les orthodoxies, les perspectives, les points de vue, les termes varient à l’infini d’un auteur à l’autre et pourtant à travers les différences, l’identité fondamentale de l’expérience permet de dégager avec clarté ce qui, en définitive, caractérise chacune des voies.
C’est à la lumière des vues et des formules puissantes de Maître Eckhart qu’il nous a paru intéressant de récapituler ces caractéristiques. Non que Maître Eckhart fasse quelque part un exposé méthodique des voies telles qu’elles ont été reconnues par les auteurs que nous avons cités, mais parce qu’on retrouve, mis en valeur avec force à un endroit ou un autre de ses sermons, les aspects essentiels de chacune des voies : la transformation de l’activité, celle de la raison ainsi que le vide actif de la volonté.
Dans l’un de ses sermons cependant, à l’occasion des rois mages, il est fait allusion à trois venues du Christ :
1 ) Comme Roi d’Amour : le Christ vient dans la vie active et dans le cœur de l’homme.
2) Comme lumière intelligible : cette venue a lieu à l’intérieur de l’homme.
3) Comme libérateur dans la vie contemplative. [236]
En fait c’est à la troisième voie que s’intéresse surtout Maître Eckhart, celle où la relation âme Dieu fait place à la seule divinité.
On peut citer un autre passage où il évoque trois chemins en Dieu : « trois chemins sont ouverts à l’âme en Dieu. Le premier est : chercher Dieu dans tout le créé avec une activité multiple, avec un désir dévorant. C’est celui qu’avait en vue le roi David quand il dit : “en toutes choses j’ai cherché le repos.”
« Le second est un chemin sans choix ni guide, libre et pourtant nécessaire : il consiste à être ravi d’une façon sublime et céleste au-dessus de notre moi et de toutes choses, sans volonté ni représentation préalable. Il suffit qu’il n’y ait plus de consistance dans l’être… »
Eckhart cite le cas de Saint-Pierre ravi au-dessus de toute distinction « à la périphérie de l’éternité ». Mais, dit-il, il ne se tenait pas « dans l’unité elle-même, où l’on voit Dieu dans Son propre esprit ».
« Le troisième chemin s’appelle « chemin » et pourtant on reste chez soi ; il consiste à voir Dieu sans intermédiaire dans son être propre. Ici le Christ Bien-Aimé nous crie : « je suis la voie, la vérité et la vie » (P [etit]. 248-249.)
On reconnaît ici ce que nous appelons la non-voie, l’accès sans intermédiaire de l’intériorité la plus libre. Et si dans cette énumération il n’y a pas de place pour la voie de la connaissance, Maître Eckhart n’en ignorait pas pour autant les modalités, comme nous le verrons plus loin.
À propos de la voie de l’activité, tous les auteurs décrivent l’apaisement du cœur individuel : le voile de la multiplicité des désirs se dissout.
« Tiré vers l’intérieur du cœur sans que l’on sache d’où cela vient ni ce que c’est » dit Ruysbroeck, on s’y rassemble, on y demeure. Dieu n’est plus perçu comme un objet extérieur ni comme un concept, mais comme une Présence vivante. De cette découverte, éveil de la Conscience, naît le feu divin sans lequel il n’y a ni purification ni amour. Absorbée par cette présence nouvelle, l’âme découvre « l’exercice intérieur », vit, dans la ferveur des élans sensibles, les joies et les tourments d’un cœur qui s’ouvre à l’amour et redoute tout ce qui le détourne de ce « je-ne-sais-quoi qui ravit et enlève ». [237]
On a toutefois du mal à s’établir dans l’état de souvenance ininterrompue qui assure la progression dans cette voie ; on s’extériorise sans cesse et on risque de s’attacher à l’agrément des états intérieurs.
Seule la partie sensible se purifie, la dualité demeure, le moi n’est pas anéanti. C’est l’activité qui est le support de la transformation, elle s’imprègne peu à peu de la paix du cœur. Comme l’assure al-Kharraz : « celui qui dans son cœur, a contemplé Dieu, délaisse tout ce qui n’est pas lui, et ressent une grande lassitude de toute autre chose. » (Kh, 76.)
Avec la découverte de l’intériorité cessent l’agitation des efforts multiples et les épuisements stériles, on entre dans la chose la plus inattendue, mais aussi la plus secrètement désirée : le repos ; on entend enfin « chanter les cigales » 5, on découvre la pente naturelle qui ramène au centre, on dispose d’un courant pour être porté. Découverte enivrante et bouleversante qui suspend tous les mouvements antérieurs. Il n’y a plus qu’à se laisser conduire au fleuve d’abord, à la mer ensuite. Mais cette délivrance du multiple et de la dispersion entraîne un renversement complet de l’attitude intérieure : on doit renoncer progressivement à l’effort personnel et volontaire, perdre toute initiative, laisser les choses se mettre à leur place.
Ascèse plus rude qu’il n’y paraît pour certains, si l’on en juge par les atermoiements de ceux qui renâclent et préfèrent au repos du cœur leurs œuvres, leur mérite et leurs vertus.
Au cours lent et sinueux du ruisseau qui s’écoule doucement, mais librement vers le fleuve, ils préfèrent le tracé artificiel et rectiligne du canal fait de main d’homme, qui va, emprisonné entre les rives du « pourquoi » et du « comment », au rythme contrôlé de ses écluses ; ils opèrent par eux-mêmes, ils s’accrochent à leur but, ignorant la pente de la grâce.
Mais il est quelques ruisseaux, pour reprendre l’image de Madame Guyon, qui coulent paisiblement en suivant avec souplesse et détente les méandres qui conduisent au fleuve. [238]
Tels ces ruisseaux, certains hommes s’installent d’instinct dans la direction du courant, allègrement débarrassés des exercices extérieurs dont la vanité leur est définitivement révélée, ils découvrent la supériorité des exercices intérieurs pour y renoncer ensuite et comprendre que la seule œuvre vraie est d’aimer et de laisser Dieu rayonner à travers soi sans travail, dans l’activité de tous les jours, selon que l’exigent les nécessités de la vie ordinaire.
.
Madame Guyon dans le Moyen Court développe l’image du vaisseau qui doit renoncer à ses rames au fur et à mesure qu’il est entraîné vers le large par les vents et les flots. Elle montre ainsi l’inutilité des efforts personnels dès qu’opère du dedans la motion divine.
“Lorsque le vaisseau est au port, les mariniers ont peine à l’arracher de là pour le mettre en pleine mer ; mais ensuite ils le tournent aisément du côté qu’ils veulent aller. De même, lorsque l’âme est encore dans le péché et dans les créatures, il faut avec bien des efforts la tirer de là, il faut défaire les cordages qui la tiennent liée ; puis, travaillant par le moyen des actes forts et vigoureux, tâcher de la tirer au-dedans, l’éloigner peu à peu de son propre sort ; et, en l’éloignant de là, on la tourne au dedans qui est le lieu où l’on désire voyager.
« Lorsque le vaisseau est tourné de la sorte, à mesure qu’il avance dans la mer, il s’éloigne plus de la terre ; et plus il s’éloigne de la terre, moins il faut d’effort pour l’attirer. Enfin on commence à voguer très doucement, et le vaisseau s’éloigne si fort qu’il faut quitter la rame qui est rendue inutile. Que fait alors le pilote ? Il se contente d’étendre les voiles et de tenir le gouvernail.
“Étendre les voiles, c’est faire oraison… Tenir le gouvernail, c’est empêcher notre cœur de s’égarer du droit chemin, le ramenant doucement et le conduisant selon le mouvement de l’esprit de Dieu qui s’empare peu à peu de ce cœur, comme le vent vient peu à peu enfler les voiles et pousser le vaisseau. Tant que le vaisseau a le vent en poupe, le pilote et les mariniers se reposent de leur travail. Quelles démarches ne font-ils pas sans se fatiguer ? Ils font plus de chemin en une heure, en se reposant de la sorte et en laissant conduire le vaisseau au vent, qu’ils n’en feraient en bien du temps par tous leurs premiers efforts. Et s’ils voulaient alors ramer, outre qu’ils se fatigueraient beaucoup, leur travail serait inutile et ils retarderaient le vaisseau.
“… En agissant de cette manière, nous avancerons beaucoup plus en peu de temps par la motion divine qu’en toute autre manière par beaucoup de propres efforts.” (Chap. XXII, §§ 7-8.)
Avant de pénétrer dans l’intériorité, l’homme vit dans la multiplicité et la dualité. Dieu reste pour lui un objet ou un concept, aussi toutes les formes de son activité sont-elles dites « extérieures » et demeurent-elles étrangères à la véritable vie intérieure ou contemplative. Il est donc inutile de compter sur quelque exercice d’aucune sorte, d’acquérir mérites ou vertus en vue d’obtenir l’illumination, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, aucune forme de l’activité humaine ne peut déterminer l’apparition de la grâce, quelle que soit la noblesse du but auquel elle est ordonnée.
Ceux qui cherchent quelque chose avec leurs œuvres, ceux qui agissent pour un « pourquoi », ce sont des serfs et des mercenaires, dit Maître Eckhart, aussi conseille-t-il :
«... N’aie rien en vue par tes œuvres, ne te représente d’avance aucun pourquoi ni dans le temps ni dans l’éternité, pas plus une récompense terrestre que la béatitude éternelle. Car toutes les œuvres que tu accomplis poussé par un tel dessein, en vérité elles sont toutes mortes ! Oui, si j’osais le dire, et je vais tout de même le dire : même si c’était Dieu que tu eusses en vue, les œuvres que tu fais dans cette intention, je le dis véridiquement, elles sont toutes mortes, elles sont maladives, elles sont un néant ! Et elles ne sont pas seulement rien, mais par elles tu corromps aussi de bonnes œuvres ! » (P. 283.)
Maître Eckhart ne cesse de répudier l’attitude de ceux qui utilisent leurs œuvres comme des moyens pour obtenir un bénéfice spirituel quelconque.
À s’appliquer aux œuvres, on est plus rempli d’elles « que de Dieu pour lequel on les accomplit » souligne Ruysbroeck.
.
Pris par le souci de bien faire, on perd toute disponibilité en nourrissant l’attachement à soi-même. Il est donc vain de recourir aux moyens quels qu’il soient ; loin de permettre d’avancer, ils font obstacle. On ne saurait dire les choses plus clairement que ne le fait Eckhart :
« J’ai affirmé autrefois et je l’affirme encore : tous les exercices extérieurs ne font guère avancer les choses. Ils ne sont bons qu’à subjuguer la nature qui est encore indocile. Mais il faut bien vous pénétrer de ceci, que toutes les œuvres extérieures que quelqu’un peut pratiquer peuvent bien subjuguer la nature : mais elles ne peuvent pas vraiment la tuer. Pour la tuer, il faut des œuvres spirituelles ! Or, on trouve beaucoup de gens qui, dans l’intention de faire les choses bien, ne font par là que s’attacher davantage à eux-mêmes — au lieu de se renoncer. Et je dis en vérité que ces gens, tous tant qu’ils sont, se trompent ! Car leur conduite s’oppose à la raison humaine, aux soins de la grâce et aux témoignages du Saint Esprit. Ceux qui voient leur salut dans les pratiques extérieures, je ne veux pas dire carrément qu’ils se perdent, mais ils n’arriveront pas à Dieu sans beaucoup de purgatoire ! Car ils ne suivent pas Dieu, puisqu’ils ne s’abandonnent pas eux-mêmes, ils suivent les ténèbres dans lesquelles ils se tiennent. On ne peut pas plus trouver Dieu dans les exercices corporels qu’on ne peut le trouver dans le péché ! Néanmoins de telles personnes, qui se chargent de tant de ces pratiques extérieures, sont très estimées aux yeux du monde. Et cela vient de la ressemblance. Car les gens qui ne comprennent rien qu’aux choses des sens, ont en grande estime ce qu’ils peuvent saisir par les sens. Un âne sait toujours en apprécier un autre ! » (p. 304-305.)
.
N’y a-t-il pas là de quoi faire réfléchir ceux qui de nos jours empruntent à l’Orient toutes sortes d’exercices corporels — du corps et du souffle — susceptibles, pensent-ils, de les conduire au satori ou à la libération ?
.
Il est aisé de comprendre, d’après ces aperçus, comment la vertu associée au mérite n’a qu’une portée morale, religieuse ou sociale et constitue, elle aussi, un obstacle et un écran pour qui veut autre chose. Les affirmations se multiplient à ce sujet :
Dans sa glose au Stavacintamani, verset 92, Ksemaraja explique :
« Souveraineté pour le yogin doué de pouvoirs parfaits, connaissance pour le savant, renoncement pour l’ascète et vertu pour le partisan du “dharma” ne peuvent que voiler l’accès immédiat à la divinité. C’est en transcendant ces quatre aspects du yoga que ceux qui aspirent à l’immuable réalité peuvent trouver le refuge unique, Shiva. »
Abou-Yazid Al-Bistami déclare aussi :
« Ceux pour qui le voile qui les sépare de Dieu est le plus épais sont : l’ascète, par son ascèse même, le dévot, par sa dévotion, le Docteur de la Loi, par sa science. » (Kh. 68.)
Sari Al-Saqati met en demeure :
- « Quelle est la route pour parvenir jusqu’à Dieu ? »
- « Si tu veux l’adoration du bon serviteur, à toi de jeûner et d’observer fidèlement les prescriptions de la loi religieuse.
« Si tu veux Dieu lui-même, laisse de côté tout ce qui n’est pas lui, et tu parviendras jusqu’à lui. » (Kh. 57.)
Ainsi toutes les œuvres de vertu, tous les exercices extérieurs, pour Ruysbroeck, pour Eckhart, comme pour tous les mystiques doivent prendre fin un jour.
Est-ce à dire qu’ils sont totalement inutiles et faut-il simplement et purement les éliminer ou les condamner ? Non, il faut seulement comprendre qu’ils n’ont qu’un rôle préparatoire et auxiliaire, qu’ils sont sans commune mesure avec la vie intérieure, que s’« ils orientent vers Dieu » comme le dit Eckhart, ils doivent être immédiatement abandonnés dès que Dieu est là !
Eckhart dit encore : « toutes les œuvres extérieures sont instituées et prescrites pour que, par elles, l’homme extérieur soit orienté vers Dieu… ou en d’autres termes : quand Dieu veut accomplir son œuvre, qu’il le trouve alors prêt et n’ait pas besoin de le retirer d’abord de choses lointaines et grossières… Quand l’homme au contraire se trouve disposé à la vraie intériorité, qu’il laisse hardiment tomber toute chose extérieure, fussent même ces exercices auxquels tu te serais lié par vœu et dont ni pape ni évêque ne pourrait te délier !... Quelque fermement qu’un homme puisse être lié à toutes sortes de choses, s’il pénètre dans la vraie expérience intérieure il est affranchi d’elles toutes ! Aussi longtemps que l’expérience intérieure dure, et durât-elle une semaine, un mois ou un an, un moine ou une religieuse ne perd pas son temps : Dieu, dont il est prisonnier, doit répondre pour lui. » (P. 58-59.)
.
C’est pourquoi « Dieu n’aime pas l’œuvre qui est extérieure, que le temps et l’espace limite, qui est étroite, que l’homme peut empêcher et combattre, qui s’épuise et vieillit avec le temps et l’habitude. Mais l’autre œuvre, intérieure, c’est d’aimer Dieu… et par elle est déjà accompli tout ce que l’homme, avec sa volonté pure et entière, veut et peut faire en matière de bonnes œuvres. » (Cogn. 91.)
Une telle œuvre n’est pas absorbée par le temps et par [242] l’espace : resplendissant nuit et jour, elle chante la gloire de Dieu.
Mais il disait aussi : « une seule œuvre reste à l’homme en toute justice et propriété : c’est de s’anéantir lui-même. » (Cogn. 94.)
En fait pour atteindre la vertu en sa perfection l’âme doit être ravie au-delà des vertus, « être libre de toute vertu » et vivre dans un état où la bonté en sa totalité est devenue si naturelle à l’âme que celle-ci n’est pas seulement en possession des vertus, mais que la vertu en fait partie intégrante ; alors l’âme est vertueuse non par nécessité, mais par nature innée. À ce degré elle a franchi et transcendé tout besoin des vertus lesquelles lui sont devenues intrinsèques. Elle est parvenue au but que les vertus ne faisaient que lui indiquer, à l’effusion du Saint Esprit. Tel est le fruit de la vertu181.
Mais « aussi longtemps que l’homme, en tant que serf de lui — même, maintient encore son moi dans la forme de sa vertu, il ne peut goûter ni récolter le fruit de la vertu : il ne contemplera jamais le Dieu des Dieux dans Sion. Ce qui signifie : une vision sans voiles — avec le regard de l’unité — de l’essence divine. Mais la vertu, vous pouvez en être persuadés, n’est jamais arrivée à cette vision !
« Maintenant on pourrait se demander si alors on ne devrait pas plutôt renoncer à la vertu. À cela je réponds : non ! Il faut la pratiquer, mais non la posséder ! Ceci seulement est la vertu parfaite : que l’on s’en tienne quitte. » (P. 306.)
Si l’on porte ses œuvres devant soi comme une offrande à Dieu dans la vie vertueuse, dans la vie en Dieu elles nous suivent182, et « le fruit en reste notre pâture et notre breuvage à jamais », si l’on en croit Ruysbroeck. (R. 174.)
La véritable vertu est l’effet naturel de la vie intérieure et non sa cause ou son origine. Pour cela elle doit être saisie dans ce fond primitif où elle est une avec la nature divine. Mais comment savoir si l’on possède la vertu « dans son essence et dans son fond » ? Eckhart répond : « on le reconnaît à ceci : quand elle est notre premier mouvement, quand on la met en action sans préparation de la volonté… quand, pour ainsi dire, elle se fait d’elle-même, par pur amour et sans un pourquoi. Alors on l’a réellement et avant on ne l’a pas ! » (p. 190.)
En rendant concrète et vivante la présence de Dieu ou du Soi au plus intime de nous-mêmes, l’entrée dans le cœur sur la voie de l’activité nous libère des efforts volontaires et nous révèle le secret de l’amour qui seul vivifie et féconde toutes nos actions.
Une fois qu’on a goûté à la douceur de cette présence, tous les moyens sont spontanément rejetés comme inutiles, car ils détournent du seul acte vivant, le recueillement, où unifié, apaisé, on savoure Dieu en soi-même dans des états mystiques, ou états d’oraison, nombreux et variés qui caractérisent cette voie et que l’on désigne comme « exercices intérieurs », car ils naissent de la grâce. Cet état de recueillement imprègne la personne, s’insinue dans les organes, les opérations intellectuelles, les sentiments, la respiration. On n’a plus qu’une envie, se tourner vers l’intérieur, vers le silence qui nourrit cette paix nouvelle et inespérée.
C’est le moment bienheureux où l’on découvre la supériorité des exercices intérieurs sur l’activité extérieure. On sait alors comme Angélus Silesius que « le fou est affairé » et que « toute l’œuvre du sage, dix fois plus noble, est d’aimer, de contempler, de reposer ». (V, st. 363.)
On comprend qu’aucune œuvre ne peut avoir de saveur… si elle croît à l’écart de ce rameau de la grâce divine » (R. 187), qu’il faut être touché par Dieu « intérieurement, au plus intime de l’âme, oui dans son tréfonds » parce que « là seulement est la vie. C’est pourquoi ne vivent aussi que les œuvres que tu accomplis en vertu de l’impulsion venant du fond de ton âme » précise encore Eckhart. (p. 284.)
On éprouve l’ivresse qui fait renoncer au comment et au pourquoi, on chante avec Rûmî : « Celui qui est enivré et qui a échappé au “comment” et au “pourquoi”, où se trouve-t-il ? » (O. 412.)
.
En ouvrant le cœur, la ferveur intense caractéristique de cette voie risque parfois de l’emprisonner dans l’agrément et la recherche d’un Dieu sensible. Or, comme l’abeille qui va de fleur en fleur sans jamais y demeurer, il faut savoir goûter tous les dons sans se reposer sur aucun.
Dans le langage imagé d’Eckhart, « il est des gens qui veulent contempler Dieu de ces yeux mêmes dont ils regardent [243] une vache et ils veulent aimer Dieu de la façon même dont ils aiment une vache. Tu aimes la vache à cause du lait et du fromage et de ton propre avantage. Ainsi se comportent toutes les personnes qui aiment Dieu pour de la richesse extérieure ou pour de la consolation intérieure… tout ce vers quoi tu diriges ton effort, aussi bon soit-il, si ce n’est pas Dieu en lui-même, ce ne peut jamais être qu’un obstacle pour toi devant la suprême vérité. » (Sch. 191-2.)
Alors, bientôt, l’âme qui a vraiment faim de Dieu ressent obscurément l’insuffisance de ses premiers états spirituels, devine qu’elle doit y renoncer si elle veut s’approcher plus près encore et comprend que les effusions du cœur et leur recherche ne sont pas, en réalité, supérieures à la vie quotidienne :
« Celui qui s’imagine, dans l’intériorité, le recueillement, la douceur et les états particuliers, avoir plus de Dieu qu’au coin du feu ou à l’écurie ne fait pas autrement que si tu prenais Dieu, lui enroulais la tête dans un manteau et le fourrais sous une table. Car celui qui cherche Dieu dans les modes prend les modes et laisse Dieu qui est caché en eux. » (Pf. 66.)
Ainsi on peut dire, toujours avec Maître Eckhart : « L’œuvre intérieure la plus infime est plus haute et plus noble que la plus grande œuvre extérieure. Et pourtant : même l’œuvre intérieure la plus noble doit être dépouillée, si Dieu doit être purement et simplement présent à l’âme. » (P. 32.)
.
C’est pourquoi « en vérité, l’homme ne peut rien offrir de plus agréable à Dieu que le repos. Dieu ne se préoccupe absolument pas et n’a pas besoin de jeûnes, de prières et de toutes les pénitences comparativement au repos. Dieu n’a besoin de rien sinon qu’on lui offre un cœur en repos ; il opère alors dans l’âme de telles œuvres secrètes et divines qu’aucune créature ne peut l’y aider ni les voir. » (Anc. S. III., 11.)
Sur la voie de l’activité, l’on comprend et l’on vit la nécessité, l’efficacité de ce repos, de cet abandon qui seul permet à la grâce d’opérer, à l’amour de tout transformer. L’amour transforme l’homme en ce qu’il aime et seule cette transformation change la nature de ses actes sans qu’il ait à en modifier l’objet.
Vaines les œuvres extérieures, vains les états intérieurs [245] seul compte l’hameçon de l’amour. Là encore, écoutons le maître rhénan :
« Dieu ne nous guette avec rien tant qu’avec l’amour. Car il en est avec l’amour tout à fait comme avec l’hameçon du pêcheur. Le pêcheur ne peut s’emparer du poisson que quand il l’a au bout de son hameçon : s’il a mordu alors il est acquis au pêcheur ; il a beau se retourner et se débattre, le pêcheur le tient tout à fait à sa merci… » Et celui qui est pris par l’amour, « ce doux fardeau, il s’avance et se pousse par là vers son but, plus près qu’avec tous les exercices et les pénitences corporelles qu’un homme pourrait assumer… Celui qui a trouvé ce chemin, qu’il n’en cherche pas d’autre ! Qui est accroché à cet hameçon est pris tout entier : les pieds et les mains, la bouche, les yeux, et le cœur et tout ce qui est à l’homme, il faut que tout cela soit la chose de Dieu… Qui est pris dans ce filet, qui marche dans ce chemin, à quoi qu’il s’occupe et s’adonne, c’est l’amour qui le fait, c’est exclusivement son œuvre — qu’il fasse quelque chose ou qu’il ne fasse rien, cela n’a aucune importance ! Le plus minime accomplissement, la plus petite affaire qu’il traite, est, pour lui comme pour tous les autres hommes, plus profitable et plus fructueux et plus agréable à Dieu que les occupations de tous les hommes qui peuvent bien être sans péchés mortels, mais lui sont inférieurs en amour…
C’est pourquoi attend seulement cet hameçon, ainsi tu seras saintement prisonnier, et plus tu seras prisonnier, plus tu seras délivré. » (P. 67.)
Selon Saint Jean de la Croix, « il faut commencer par peigner la chevelure depuis le sommet de la tête si nous voulons qu’elle soit lisse ; et toutes nos œuvres doivent être commencées du plus haut de l’amour de Dieu si l’on veut qu’elles soient pures et claires »183.
Ainsi, « dans l’amour tous les exercices sont louables ». Il suffit de vivre cette simple découverte pour que disparaissent à jamais tous les dilemmes, tous les faux problèmes suscités par les œuvres ou l’ascèse.
Bien qu’ils ne conduisent pas à l’efficience de la voie divine où Dieu agit librement dans l’âme anéantie, les premiers états de recueillement propre à la voie de l’activité ont néanmoins le pouvoir d’éloigner toutes choses de l’âme qui, absorbée par l’expérience intérieure, devient [246] sans s’en rendre compte indifférente à ce qu’elle cherchait et prisait autrefois par-dessus tout. Aux premières étincelles de l’amour divin, les choses tombent d’elles-mêmes sans effort ni ascèse, et l’acte d’amour renouvelé dans l’intime du cœur imprègne de paix et de douceur les diverses formes de l’activité qui va s’élargissant, pour devenir souple, harmonieuse et désintéressée, même si le moi ne disparaît pas encore, même si cette transformation se fait progressivement et demande une application à ses débuts, comme l’illustre, une fois encore un exemple tiré celui de l’apprentissage de la lecture — proposé par Maître Eckhart.
Eckhart montre comment avec abnégation, application et une conscience éveillée, agissante, l’homme doit apprendre la solitude intérieure en toute compagnie et saisir son Dieu en dedans des choses184.
« Tout comme quelqu’un qui se propose d’apprendre à écrire. S’il doit jamais devenir maître dans cet art, par ma foi ! Il doit s’exercer beaucoup et souvent… s’il persévère seulement dans son application il apprend cet art et en devient maître ! Naturellement, il faut d’abord qu’il pense séparément à chaque lettre et se la représente exactement, ce qui ne va pas sans peine. Plus tard, une fois qu’il a la connaissance de son art, il écrit d’une plume alerte avec ardeur… et encore qu’il ne pense pas en permanence aux lettres, mais à toute espèce de choses, il n’en accomplit pas moins sa tâche en vertu de son art.
« Ainsi l’homme qui jouit de la présence divine doit aussi rayonner sans aucun travail, il n’a pour tâche que de se dépouiller simplement de tous les éléments étrangers, et une fois pour toutes rester vide des choses. Ici aussi il faut au commencement une application d’esprit et un attentif travail préalable, analogue au tracé de l’a b c pour l’écriture : mais finalement l’homme doit être pénétré par son objet divin, informé par la forme de son Dieu soigneusement entretenu et chéri dans son cœur, et être avec tout son être si enraciné en lui que Dieu, présent, rayonne en lui sans aucun travail. » (P. 166.) [247]
Cette voie est de transition, transition entre le monde différencié de la voie individuelle et l’Essence indifférenciée de la voie divine. Elle opère le passage de la conscience individuelle à la Conscience universelle par les phases de l’union à un Dieu personnel doué d’attributs.
Sur cette voie surabondent les dons, les grâces, voire même les pouvoirs surnaturels, car l’énergie y est purifiée.
On y vit dégagé, détaché de tout objet, on y renonce aux représentations, aux images, à l’attachement profond au moi, à ses vertus, pour se tourner vers Dieu seul, mais on garde « un certain esprit propre » comme le souligne Ruysbroeck, ou l’on reste, selon Madame Guyon, propriétaire de ses vertus, car le cœur est immensifié, universalisé, mais le moi n’est pas encore anéanti.
C’est la voie de la purification et de l’unification des énergies parfaitement intériorisées. Apaisées et rassemblées grâce au repos du cœur, elles convergent et forment un courant puissant que suscite l’intensité de zèle ardent, nourri de discernement.
L’adorateur, éclairé par la raison intuitive, prend appui sur les qualités ou attributs divins pour se confondre avec son Dieu dans un acte brûlant d’adoration qui est l’activité essentielle de ce chemin. Il voit l’énergie divine partout répandue, il contemple Dieu dans l’univers.
Si la dispersion de l’activité constituait l’obstacle de la voie inférieure, c’est à la pensée dualisante que la grâce met ici un terme. La subtilité du discernement s’associe au zèle pour opérer une percée vers Dieu, en laquelle ardeur et discernement se fondent en prises de conscience fulgurantes, mais répétées où l’amour se fait vigilance pure.
38
Maître Eckhart dit de l’esprit, entendu comme « une expérience intérieure de la vérité qui vivifie » :
« C’est lui que tu dois épier avec zèle et subtilité, et ce qui peut en rapprocher le plus, c’est cela, avant tout autre chose, que tu dois suivre. Tu dois avoir un cœur qui s’élève, non un cœur qui s’abaisse vers la terre, un cœur brûlant-dans lequel pourtant règne une paix silencieuse inaltérable. » (P. 60.)
La vigilance du cœur se substitue à tous les exercices de la voie précédente. [248]
C’est sur cette voie que la raison se transforme — la purification s’effectuant précisément sur toutes les représentations et les raisonnements discursifs qui s’y rattachent. Une fois purifiée et éclairée, elle se substitue à tous les exercices antérieurs pour devenir une voie directe et opérer le passage de la pensée différenciée à la conscience indifférenciée.
Comment cela se peut-il puisque, nous l’avons dit et répété, il est inutile d’espérer en la raison pour accéder à la vie intérieure ou pour introduire l’activité de Dieu en l’âme ?
Maître Eckhart, dans son sermon De la naissance éternelle, ayant posé la question de savoir « si cette naissance peut être facilitée à l’homme par la médiation de choses qui se rapportent, il est vrai, à Dieu, mais sont introduites de l’extérieur par les sens, par des représentations de Dieu comme celles-ci : que Dieu serait bon, sage, compatissant, où d’autres énonciations que la raison peut trouver sur Dieu » y répond en ces termes :
« Ne t’imagine pas que la raison puisse croître et s’élever jusqu’à pouvoir connaître Dieu. Mais, si Dieu doit luire divinement en toi, aucune lumière naturelle ne peut, pour cela, t’être utile de quelque manière : elle doit d’abord devenir un pur rien et renoncer à elle-même, alors Dieu peut rayonner au-dedans avec sa lumière. Tout ce à quoi tu as renoncé il le ramène avec lui, et mille fois plus ; et en outre une nouvelle forme qui tient tout fermé en soi. » (P. 61-62.)
Ainsi, loin d’être irrationnels comme on les en accuse parfois, les grands mystiques s’appuient au contraire sur la raison, et développent cette faculté dont ils connaissent la grandeur ; ils savent distinguer ses formes limitées de ses formes transfigurées et l’utiliser dans ses activités les plus subtiles et les plus efficaces, car ils sont les seuls à lui donner un objet à sa mesure.
Dans un beau sermon intitulé Comme une étoile du matin, Eckhart déclare : « La raison est le temple de Dieu, c’est là qu’il habite et brille d’un éclat ininterrompu ! Nulle part Dieu n’est davantage chez lui que dans le temple de la raison… » (P. 126.)
Maître Eckhart dit aussi dans un autre de ses sermons :
« L’objet de la raison et son point d’attache est l’essence et non le contingent, mais la simple essence est pure en elle-même. » (P. 56). [249]
Cependant, avant de se perdre au-delà d’elle-même dans son véritable objet qu’est l’Essence, la raison renonce à soi, est transfigurée par la grâce et, comme le dit Maître Eckhart, « s’approprie le divin ».
L’analyse que proposent généralement les mystiques permet de comprendre cette transformation de la raison. Ils observent en effet plusieurs aspects de son activité : d’une part, la faculté de distinguer d’une conscience ordinaire qui sait et qui juge — raison raisonnante et ses opérations intellectuelles, raison d’une conscience prisonnière de l’alternative qui s’applique aux distinctions des objets séparés ; d’autre part, une connaissance immédiate et directe. Maître Eckhart nomme l’une rationale, c’est la première des puissances inférieures, et l’autre intellectus, c’est la seconde des puissances supérieures ; toutes deux doivent être entourées d’un anneau « doré à l’or de l’amour divin » illuminées par la grâce.
« La première s’appelle la faculté de distinguer, rationale ; mets-lui au doigt un anneau d’or, la lumière, afin que que ta distinction en tout temps hors du temps soit irradiée par la lumière divine…
« L’autre s’appelle la raison, intellectus. On la compare au Fils. Mets-lui également un anneau d’or, la connaissance, afin que tu connaisses Dieu en tout temps. Comment cela ? Tu dois le connaître sans image, sans moyen, sans similitude. » (Pf., 319-320).
Le passage de l’une à l’autre s’opère grâce à l’activité de la raison dite intuitive qui, mystiquement éclairée, subtile, spirituelle, se dirige de plus en plus vers l’intérieur. En elle s’allient en quelque sorte la simple discrimination et le discernement mystique, car alors s’exerce la raison relevant d’une conscience purifiée, tournée vers l’intérieur, apte à percevoir plus finement parce que peu à peu dégagée des contingences.
Orientée vers l’intérieur, la raison unifie les modalités de la connaissance, ce qui met en branle et intensifie l’énergie.
Il est particulièrement intéressant d’observer comment, dans cette voie, l’intériorisation de la raison et la purification de l’énergie sont liées par une dialectique subtile. En s’intériorisant, la raison libère l’énergie de l’entrave des alternatives, des contradictions, des dilemmes ; elle se fait intuitive et globale, ne s’applique plus aux objets eux-mêmes, mais aux modalités de la connaissance. Contrairement à la connaissance indifférenciée, elle garde encore en [250] elle l’ensemble des éléments distincts, mais non cristallisés, saisis dans une suite homogène, comme le dit si bien le Tantrasara185, et non plus séparés en leurs aspects contradictoires. Aux doutes paralysants liés à la faculté de distinguer se substitue ainsi une vue globale unifiée, s’ouvre un aperçu, saisie immédiate, source de certitude, but unique vers lequel les énergies convergent dans une conviction ardente.
Les énergies affluent avec d’autant plus de force qu’ici, la certitude et l’orientation unique se tournent vers Dieu et Dieu seul :
« Mais la meilleure pénitence — par laquelle on fait vraiment de grands progrès — consiste en ce qu’on se décide à se détourner complètement de ce qui, en nous, n’est pas absolument Dieu et divin, et du monde entier ; et en ce que nous nous tournions résolument, en échange, vers notre Dieu bien-aimé, dans un don de nous-mêmes à toute épreuve, de sorte que notre pensée et nos désirs soient vivement tendus vers lui. » (P. 178.)
Toujours selon Eckhart, l’homme alors « est détaché de tous les liens et son imagination est orientée à l’intérieur, vers l’objet de son amour, vers Dieu. — Comme quand quelqu’un a une soif ardente, une grande soif. Il fait sans doute autre chose que de boire, il peut aussi penser à d’autres choses. Mais quoi qu’il fasse, où qu’il soit et dans quel dessein que ce soit, l’image de la chose à boire ne le quitte pas, aussi longtemps que sa soif dure. Et plus sa soif est grande, plus intérieure, présente et continuelle devient l’image de la chose à boire. » (P. 165.)
.
Dans l’intensité de l’ardeur orientée vers Dieu seul, l’ensemble des tendances convergent spontanément vers le centre, s’unifie en un seul courant qui emplit l’univers après avoir rompu la digue des énergies individuelles séparées, balayant tout sans distinction à la manière dont les pluies torrentielles ruisselant des montagnes s’accumulent dans la vallée pour entraîner, niveler, égaliser toutes choses en un fleuve unique qui emporte tout vers la mer.
Grâce à cette unification des tendances imprégnées de raison éclairée, l’énergie se dégage, s’intensifie, s’amplifie, les limites de la conscience s’élargissent à l’infini dans un univers dynamique, surabondant, où tout fond, tout coule, tout vit. [251]
On voit Dieu en toutes choses, et ces moments heureux sont décrits comme ceux de l’union à Dieu, que l’on attêint à travers les transports et les élans que suscitent les attributs ou qualités :
« Shiva est partout présent, comme le feu dans le bois, le beurre dans le lait ; sa présence cachée apparaît quand on les baratte par dévotion, adoration. » (Siddhânta).
Pour atteindre cette lumière, en effet, le fidèle doit sans cesse, avec un zèle spontané, par-delà effort et vouloir ordinaires, renouveler ses immersions dans le divin, car s’il l’atteint, il ne peut s’y maintenir ; il retombe dans des états mystiques élevés, mais qu’il lui faut transcender : il jouit des qualités divines, non de la plénitude de l’Essence.
Il vit encore dans une certaine dualité que seul fait disparaître l’acte d’adoration, à l’occasion duquel adorateur, adoré, et adoration ne font qu’un. C’est la vie de l’union, non celle de l’unité, et, comme le dit Ruysbroeck à propos des amis secrets, « ils rencontrent néanmoins en cette union la différence et la dualité qui les séparent ».
.
C’est pourquoi l’on doit, sur cette voie, s’exercer sans cesse à l’égalisation en faisant éclore l’intériorité dans l’extériorité et en reployant l’extériorité dans l’intériorité sans jamais quitter l’intériorité, car on ignore à ce niveau l’unité et l’égalité spontanée de la voie divine.
Les Shivaïtes nomment cette pratique kramamudra 186 c’est le premier mouvement que décrit Maître Eckhart :
« Quand un homme s’est intériorisé et n’a plus de représentations ni de confusion, il doit en tout temps, en tous lieux et en toute société chercher et trouver Dieu. Non pas qu’il faille s’évader de son intériorité, ni la renier. Au contraire « c’est en elle, avec elle et par elle qu’on doit apprendre à agir de telle manière qu’on décharge l’unité dans la réalité, et qu’on introduise la réalité dans l’unité, et que l’on s’habitue ainsi à être actif dans l’inaction… » (p. 194.) [252]
Contrairement aux deux voies précédentes, la voie divine est une voie de l’instantanéité, elle relève d’une grâce intense, et c’est la voie de l’accès sans retour.
Al-Hallaj décrit avec autant de lyrisme que de précision le passage de la voie de l’énergie cognitive (1 à 3) à la voie divine de l’Amour ou de la volonté (4-10) :
“(1) mon regard, avec l’œil de la science, a dégagé le pur secret de ma méditation ; (2) Une Lueur à jailli, dans ma conscience, plus ténue que toute conception saisissable, (3) et j’ai plongé sous la vague de la mer de ma réflexion, Me glissant comme se glisse une flèche. (4) Mon cœur voltigeait, emplumé de désir, juché sur les ailes de mon dessein, (5) Montant vers celui que, si l’on m’interroge, je masque sous des énigmes sans le nommer. (6) Au terme (de l’envol), ayant outrepassé toute limite, j’errais dans les plaines de la Proximité… (8) Je m’avançais pour faire ma soumission, vers Lui, tenu en laisse au poing de ma capitulation ; (9) et déjà l’amour avait gravé de Lui, dans mon cœur, au fer chaud du désir, quelle empreinte ! (10) Et l’intuition de ma personnalité me déserta, et je devenais si proche (de Lui) que j’oubliais mon nom.” (Dîw. b. 1617.)
.
Dans l’âme vide de tout objet, de toute représentation, de tout appui, où le pur désir de Dieu au cœur de la volonté virginale bondit hors du temps, Dieu se saisit lui-même dans une attraction si forte, dans une grâce si intense qu’elle anéantit âme et Dieu : de ce double anéantissement, source de l’unité, jaillit la « vie suressentielle de l’Essence » où tout se perd.
Dans cette voie sans appui ni moyen, dans cette voie de la pure volonté, point de discrimination, point de transports pour un Dieu personnel qu’on adore sans cesse, auquel on s’identifie en contemplant la grandeur divine de ses attributs ; on se tient à la racine du désir de Dieu, désir vide d’images ou de désir morcelés, car « l’amour envers Dieu, dit Angélus Silesius, ne consiste pas en suavités ; suave n’est qu’un accident ; il consiste en essence ». (A.S. V, 305.)
.
Sans objet, sans énergie pour tremplin, sans connaissance, [253] cette voie est celle de la nudité, du désir pur, indivisible paisible et unitaire : elle est en un mot la voie du Désir divin.
Dans l’âme ainsi dépouillée, “Dieu opère sans intermédiaire et sans image, dit Maître Eckhart. Plus tu es libre d’images, plus tu es prêt à recevoir son action, et plus tu es tourné vers l’intérieur et oublieux, plus tu es proche de lui. À ce sujet Denys exhortait son disciple Timothée en lui disant : « Cher fils Timothée, tu dois, l’esprit libre de soucis, prendre ton essor au-dessus de toi-même et au-dessus des puissances de ton âme, au — dessus de tout mode et de toute essence, dans la silencieuse obscurité cachée, pour arriver à une connaissance du Dieu inconnu supra divin ! Il faut pour cela un détachement de toutes choses : il répugne à Dieu d’être opérant parmi toutes sortes d’images. » (P. 41-42.)
C’est dans l’intime de la volonté que Dieu opère ainsi : quand l’âme s’est, avec sa raison, approprié le divin, celui-ci est à son tour repassé à la volonté” précise maître Eckhart. (P. 71.)
Il affirme encore qu’à un certain point de vue la volonté a une supériorité sur la raison, sa mission est plus noble :
« elle est l’objet des largesses du souverain Bien, de Dieu même. Que reçoit-elle, ? La grâce, et dans la grâce le bien suprême lui-même… c’est un signe infaillible de cette lumière de la grâce, quand un homme de mouvement de la libre volonté quitte les choses temporelles pour se tourner vers le souverain Bien, vers Dieu. Voyez ! Nous devrions l’aimer d’avoir accordé à l’âme un don si élevé : quand elle a déjà fait tout ce qu’elle peut faire, la volonté a encore, dans sa particularité, la liberté de prendre son essor et de parvenir de l’autre côté, dans la connaissance qui est Dieu même. Seul cet essor élève l’âme sur le sommet de la perfection. » (P. 70-71.)
Mais il importe de bien saisir à quoi correspond cette faculté, ce lieu privilégié de l’action divine. C’est, pourrait-on dire, la cime de l’âme, par-delà intention, raison, vouloir propre, Dieu peut être reçu « sans voie, nu, comme il est en lui-même » selon l’expression d’Eckhart. À ce que ce dernier nomme voluntas on peut faire correspondre le terme sanskrit icchâ qui désigne à la fois le désir pur, l’intention simple, la volonté, mais une volonté qui n’a rien d’un vouloir, car elle est sans choix délibéré. Dans la voie divine ce terme désigne une orientation [254] fondamentale vers Dieu, un instinct essentiel, source de tout dynamisme, en lequel amour, désir, connaissance, vides de tout objet, trouvent leur unité. À ce propos Ruysbroeck parle de « veine de la source vive » Madame Guyon de retour au centre, ou de foi nue. Tauler définit cette tendance foncière au retour à l’origine à l’aide d’un vocable lourd de sens et en conséquence intraduisible, « gemuete », sorte d’attrait profond, source des autres puissances de l’âme ; plus essentiel qu’elles, il leur imprime sa propre direction, mais bien qu’orienté inévitablement vers Dieu, il peut s’en détourner et se laisser attirer par les créatures.
Dans la source la plus intérieure, en Dieu, jaillit une noble volonté qui appartient à l’âme, dit Maître Eckhart. C’est la plus haute des puissances demeurant dans la pureté de l’âme séparée du temps et de l’espace. Mais « qu’elle s’incline vers les êtres créés, elle s’écoule avec eux dans le rien ». Pourtant « si elle se détourne d’elle-même et de tout le créé, en un clin d’œil, pour retourner dans sa source, là elle se tient dans sa vraie et libre nature et elle est libre ». (Pf. 67.)
.
Ibn’ Arabi situe l’amour « intégral » au sommet de son échelle des demeures de l’âme et l’identifie à la volonté. Les sûfî appellent cette noble faculté « al himmah » et la définissent comme « l’absorption complète de la volonté humaine par l’attraction divine ».
Dans une telle faculté, l’attraction divine opère directement sans intermédiaire sous la forme d’une grâce intense, touche divine décisive qui la transfigure à jamais :
La troisième des puissances supérieures187 “se nomme la volonté, voluntas. On la compare au Saint Esprit. Tu dois lui mettre un anneau d’or qui est l’amour dont tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu sans amabilité c’est-à-dire non pas parce qu’il est aimable, car Dieu n’est pas aimable ; il est au-dessus de tout amour et de toute amabilité. « Comment dois-je aimer Dieu ? "... Tu dois l’aimer comme il est : ni Dieu, ni esprit, ni personne, ni image ; mieux : comme un pur, clair et limpide Un, à part de toute dualité…” (Pf. 320.)
La volonté, illuminée par l’amour, prend son essor, bondit hors du temps. C’est le moment où, comme le dit Angélus Silesius :
« l’Amour est la plus rapide des choses : il peut, par ses propres moyens, être au ciel le plus haut en un instant. » (A.S. V, 302.) — énoncé simple qui évoque l’essor définitif de l’âme sur cette voie.
Dans la force unitive de la volonté, élan et incitation divine se rejoignent, se confondent pour arracher l’âme au temps et ce, dans le surgissement du premier instant selon le Shivaïsme cachemirien, ou en se rendant au premier mouvement selon Madame Guyon.
Les images d’éclair, de bond, d’envol se multiplient pour dire l’efficience unique de l’élan aveugle caractéristique de la voie divine. « La volonté nue et soulevée, dit Ruysbroeck, est imprégnée par un Amour abyssal comme le fer l’est par le feu. »
Et Maître Eckhart : « tout ce que l’âme est capable de produire, cela doit être contenu dans l’unité simple de la volonté : et la volonté doit se répudier et se jeter vers le Bien suprême et s’y attacher, sans en démordre ! Mais qui s’attache à Dieu, il devient — ainsi parle saint Paul — un esprit avec lui ». (P. 96.)
Sur cet élan, cette impulsion, Eckhart révèle une vérité que l’homme ordinaire comprendra difficilement, « une vérité toute nue, sortie directement du cœur de Dieu. » : « Là, dans la percée, dit-il, je me tiens libre de ma volonté en la volonté de Dieu, libre de la volonté de Dieu et de toutes ses œuvres et de Dieu lui-même. Je suis au-dessus de toutes les créatures et je ne suis ni Dieu ni créature… Là je reçois une impulsion qui m’emporte au-dessus de tous les anges… ce que je reçois dans cette percée, c’est que Dieu et moi, nous sommes un. Là, je suis ce que je fus188, là je ne crois ni de décroîs car je suis là une cause immuable qui meut toutes choses. » (Pf. 284.)
Denys fait une brève allusion à l’âme qui « unie à la forme divine par l’inconnaissance, se jette dans un élan aveugle sur les rayons de la lumière inaccessible ». (D. 105.)
N’est-ce pas cet élan que chante Saint Jean de la Croix dans ce très beau poème189 : [256]
« Poursuivant un élan d’amour,
non dépourvu d’espérance, je volai si haut, si haut
que j’atteignis la proie.
.
Pour que j’atteignisse
cet élan divin
il me fallut tant voler
que de vue je me perdisse ;
encore en cette extrémité
je défaillis dans mon vol,
mais l’amour fut si haut
que j’atteignis la proie.
.
Quand je montais plus haut,
ma vue fut éblouie,
et la plus forte conquête
dans la nuit s’accomplissait,
mais comme l’élan était d’amour
je fis un bond aveugle et obscur
et m’élevai si haut, si haut
que j’atteignis la proie.
.
Plus j’arrivais dans les hauteurs
de cet élan si sublime,
plus abaissé et accablé190
et abattu je me trouvais ;
je dis : nul ne saurait atteindre,
et je m’abattis tellement, tellement
que je fus si haut, si haut
que j’atteignis la proie.
.
D’une étrange manière
je passai mille vols en un vol,
car espérance de ciel
obtient autant qu’elle espère ;
je n’espérais que cet élan
et ne fus à court d’espérance,
car j’allais si haut, si haut
que j’atteignis la proie. »
.
Eckhart, citant une parole de l’Évangile, insiste [257] également sur la simultanéité de l’abaissement et de l’élévation : « Il doit “s’abaisser”… Et il doit “être élevé” ! Non pas comme si cet abaissement était une chose et l’élévation une autre : mais le plus haut sommet de l’élévation se produit justement dans le plus profond abîme de l’abaissement. Plus la vallée est profonde, plus la montagne est élevée… La profondeur et la hauteur sont une seule chose ! C’est pourquoi plus un homme peut s’approfondir, plus il s’élève… En somme tout ce qui est essentiel en nous repose exclusivement sur un anéantissement. » (P. 194.)
À l’image de bond, de saut, d’envol, se rattache le thème de l’instant. Tous deux soulignent le caractère vertical de l’élan qui, spontané, imprévisible, indépendant de tout acte ou contingence, échappe à tout effort, à toute durée, puisqu’en un éclair il livre accès à l’éternité, ou ramène l’âme à Dieu comme disait Maître Eckhart :
« L’âme dans laquelle Dieu doit naître, le temps doit lui avoir échappé et elle doit avoir échappé au temps, elle doit prendre son essor et se tenir parfaitement immobile dans cette richesse de Dieu… Alors l’âme connaît toutes choses et les connaît dans leur perfection ! » (p. 14.)
Pour prendre son essor il suffit que la volonté se quitte elle-même et se détourne de toutes choses, ne fut-ce qu’un instant. En ce seul instant, l’homme sans attachement ni appropriation, échappant à la durée « avec son avant et son après », touche Dieu, dans l’élan de sa liberté virginale recouvrée. ^
Ainsi, le « sceau » de cette voie est l’instant, que ce soit celui qui fulgure dans l’accès décisif à la vie divine ou celui de « l’actuel maintenant perpétuellement renouvelé » dans lequel l’homme libre exerce sa souveraineté, comme nous le verrons plus loin.
Selon Rûmî :
« Si l’on n’est pas marqué par l’amour du sceau de l’instant, on s’égare comme le chameau sans marque et sans bride. » (0.974.)[258]
Cette voie, nous l’avons déjà dit, et celle d’une grâce intense. Maître Eckhart précise à ce sujet :
« Quant à la façon dont l’âme s’y prend pour arriver à sa plus haute perfection et splendeur, voici : Un maître dit : Dieu est par la grâce porté et planté dans l’âme ; de là jaillit en effet une divine fontaine d’amour qui ramène l’âme en Dieu… et voici que la divine fontaine d’amour commence à déborder dans l’âme, en sorte que les puissances supérieures se déversent dans les inférieures, et les inférieures dans l’homme extérieur… si bien que toute son action est spiritualisée… la divine fontaine d’amour ruisselle sur elle, l’arrache à elle-même et l’introduit dans l’essence sans nom, dans sa source, en Dieu. » (P. 71.)
Dans la fournaise de l’amour divin porté à son apogée, « dans l’état d’amour éperdu », le feu de la grâce et la flamme d’amour du fidèle ne font qu’un en une telle intensité que s’ouvre l’accès à la nature divine sans moyen ni intermédiaire.
« Dieu place lui-même la flèche, Dieu tend lui-même l’arc, Dieu lâche lui-même le coup : c’est pour cela qu’il est si bien tiré » dit simplement Angélus Silesius (VI, 154.) Tandis que le Shivaïsmc du Cachemire affirme : « l’élan est l’absolu (bhairava) »191.
Dieu agit librement dans l’âme vide et l’âme est vide parce que Dieu agit.
« Plus l’âme est parfaitement nue et pauvre, moins elle a de créature, plus elle est vide de toutes choses qui ne sont pas Dieu, et plus alors elle saisit Dieu purement, est davantage en Dieu, une avec Dieu… et elle voit Dieu face-à-face… » (Eckhart,. Pf. 430.)
La rencontre, la compénétration est si totale entre l’âme et Dieu qu’on ne peut toucher l’un sans toucher l’autre :
« L’homme qui se serait ainsi entièrement évadé de lui-même, en vérité, il serait si complètement établi en Dieu que si on voulait le toucher il faudrait d’abord toucher Dieu » dit encore Eckhart. (P. 173.)
À vrai dire, on ne peut plus parler de rencontre, car ici la plénitude divine se substitue au contingent : « Celui qui, dans son cœur, a contemplé Dieu… disparaît en découvrant la Magnificence du Dieu Très — Haut, et, dans son [259] cœur, rien ne reste sauf Dieu lui-même disait Abou — Sa’id Al-Kharraz. (Kh., 76.)
Et Angélus Silesius :
« Quand vient le parfait, l’imparfait se détruit : l’humain passe, quand je suis déifié. » (V. 356.)
.
Dans ce contact immédiat avec Dieu, on peut dire que l’âme n’est plus par la grâce, mais est elle-même la grâce. À ce niveau c’est à soi — même qu’on accorde la grâce, comme l’écrit Abhinavagupta.192
Maître Eckhart fait à plusieurs reprises allusion au contact immédiat avec Dieu d’une âme sans détermination qui a pris son essor au — dessus d’elle-même :
“Quand donc l’âme est encore sur le point de prendre son essor au-dessus d’elle-même et d’entrer dans un néant d’elle-même et de son activité propre, alors elle est « par la grâce ».
Par contre être soi-même “la grâce”, cela signifie que l’âme s’est réellement surmontée et vaincue elle-même et est arrivé de l’autre côté, qu’elle se tient toujours seule dans sa pure absence de détermination193 et ne connaît absolument qu’elle-même — comme Dieu… Tant que l’âme est encore en état de se connaître et de se comporter comme une créature et une chose naturelle, elle n’est jamais devenue elle-même “la grâce” — mais elle peut bien être “par la grâce”.” (p. 153.)
C’est que la grâce enlève à l’âme sa propre activité et sa propre nature :
« Quand l’âme est dépouillée de son essence propre et qu’il n’y a plus que Dieu seul qui voit son essence, ce n’est qu’alors qu’elle contemple, connaît, saisit Dieu avec Dieu lui-même. Il faut, dit un grand docteur, que nous connaissions et saisissions Dieu avec son essence propre, en sorte qu’à vrai dire ce soit lui qui le fasse… mais personne, ici, dans cette temporalité, ne peut comprendre selon son propre sens comment de cette façon l’âme tout à la fois saisit et est saisie, à moins qu’il ne soit entièrement abîmé en soi : en une pure aperception de la nature divine — où l’entendement humain n’a jamais pénétré. » (p. 146.)
Ainsi par-delà toute action intérieure et extérieure, l’âme [260) se perd dans l’unité de l’essence dont la grâce intense de cette voie révèle ce que Maître Eckhart nomme l’accès secret194 :
Référant à un dictum d’Augustin : l’âme a une entrée secrète dans la nature divine où toutes les choses s’anéantissent pour elle, Eckhart ajoute : « cet accès, seul un détachement absolu l’offre sur terre ; au sommet de son détachement l’âme devient par connaissance sans connaissance, par amour sans amour et par illumination obscure. » (Traité IX)
« Si, là, dit-il, elle savait encore quelque chose d’elle-même… si elle savait encore quelque chose de Dieu, elle le sentirait comme une imperfection ! Au-delà de toute connaissance elle doit sucer en elle l’essence incompréhensible — elle par grâce, comme le Pcre en vertu de sa nature… elle doit se résorber d’elle-même et ainsi pénétrer dans l’Essence pure, et là, se soucier de toutes choses aussi peu que quand elle sortit de Dieu… Elle doit s’anéantir si complètement en tant que moi qu’il ne reste rien de plus que Dieu, oui, en sorte que Dieu la surpasse en éclat comme le soleil fait de la lune, et qu’avec la même Toute-puissance de pénétration que lui, elle débouche dans toutes les éternités de la divinité : où dans un courant étemel Dieu s’écoule en Dieu. » (p. 151.)
On trouve également dans une Ode (499) de Rûmî :
« sois anéanti, anéanti à toi-même, car il n’est pas de plus grand crime que ta propre existence. »
La prière d’un sûfî, Abd as -Salam ibn Mashish, prend ici tout son sens : « Verse-moi dans les mers de l’unité, retire-moi des bourbiers de l’union, et noie-moi dans l’essence de l’Océan de la Solitude divine, afin que je ne voie ni n’entende ni ne trouve ni ne sente que par elle… » (H. J. 6.)
Si dans la voie inférieure, le fidèle s’appuie sur la ressemblance, si dans la voie de la connaissance, il jouit des privilèges d’une union profonde, dans la voie divine il s’émerveille de la disparition de toute marque de séparation : c’est la voie si pure et si légère ou s’anéantissent [261] toutes les distinctions et en particulier la distinction de l’âme et de Dieu, tous deux s’évanouissant dans la mer sans sillage de l’Essence.
.
« Et c’est pourquoi l’âme dit : il n’y a plus pour moi aucun Dieu et de même que pour moi il n’y a plus personne de déterminé et de particulier, de même je ne suis non plus une âme pour personne. » (Eckhart, p. 147.)
C’est ici le véritable anéantissement, c’est ici que la Divinité engloutit le Dieu personnel. 11 faut renoncer, pour Dieu même, à Dieu et à toute notion de Dieu :
« Ici l’âme perd tout, Dieu et toutes les créatures. Ceci semble extraordinaire qu’il faille que l’âme perde aussi Dieu ! J’affirme : en un sens il lui est même plus nécessaire, pour devenir parfaite, de perdre Dieu que la créature ! Toujours est-il qu’il faut que tout soit perdu, il faut que l’existence de l’âme soit établie sur un libre rien ! C’est d’ailleurs l’unique dessein de Dieu que l’âme perde son Dieu. Car aussi longtemps qu’elle a un Dieu, qu’elle connaît Dieu, qu’elle sait quelque chose de Dieu, elle est séparée de Dieu… et c’est le plus grand honneur que l’âme puisse faire à Dieu qu’elle l’abandonne à lui-même et se tienne vide de lui. » (p. 307.)
Telle est la mort mystique la plus profonde de l’âme sur la voie qui conduit à la divinité, car cet anéantissement débouche sur l’essence divine.
.
Mais que dans cette mort profonde l’âme attire et entraîne Dieu, les audacieuses formules de Maître Eckhart l’expliquent :
“Que Dieu soit « Dieu », de cela je suis une cause ! Dieu tient son être de l’âme : qu’il soit la divinité il le tient de lui-même. Car, avant que les créatures n’existassent, Dieu n’était pas non plus Dieu ; mais il était bien la divinité, car cela il ne le tient pas de l’âme. Si donc Dieu trouve une âme annihilée — une âme qui (par le moyen de la grâce) est devenue un néant de personnalité et d’action propre, Dieu opère en elle (au-delà de toute grâce) son œuvre étemelle et l’élève par là hors de son existence de créature. Mais par là Dieu s’anéantit lui-même dans l’âme, et ainsi ne subsiste plus ni “Dieu” ni “âme”.” (P. 154.)
Et Angélus Silesius, dans un distique célèbre, fait écho : « Dieu ne vit pas sans moi, je sais que sans moi Dieu ne peut vivre un clin d’œil. Si je deviens néant, il faut qu’il rende l’âme. » (I, 8.) [262]
Ce thème de Dieu corrélatif à la créature revient fréquemment chez les sûfî : Ibn Arabî écrit : “Dieu dit à Abraham : nourris donc de Dieu sa création… Car ton être est une brise qui se lève, un parfum qu’il exhale. Nous lui avons donné de se manifester par nous, tandis qu’il nous donnait (d’exister par Lui). Ainsi le rôle est partagé entre Lui et nous.” (Im. 99)
« S’il nous a donné la vie et l’existence par son être, je lui donne aussi la vie, moi, en le connaissant dans mon cœur. » (99.)
Il chantait aussi les liens étroits qui unissent adoré et adorateurs :
.
« Il me loue et je Le loue :
Il me sert et je Le sers.
Par mon existence je L’affirme ;
Et par ma détermination je Le nie.
C’est lui qui me connaît alors que je Le nie ;
Puis je Le reconnais et je Le contemple,
Où est donc son indépendance, alors que je Le glorifie et je L’aide ? » (Sag. 74.)
.
Mais au seuil de l’unité divine, adoré et adorateur doivent également s’évanouir. Il n’y a d’accès ni pour l’un ni pour l’autre au château fort de l’âme où Dieu pénètre et demeure « selon qu’il est un et simple ».
Ce double anéantissement consomme ce que Maître Eckhart nomme détachement. Tel est le creuset secret de cette voie, il opère la transformation essentielle d’une façon si définitive que les mystiques déclarent bienheureuse une telle mort à laquelle s’allie la plénitude dans une simultanéité hors du temps. C’est là le sort bienheureux de celui dont le moi est anéanti.
S’il est vrai que le moi s’estompe, s’efface au cours des absorptions répétées, s’il est vrai qu’on le perde de vue, c’est en un instant qu’il se dissout à la manière d’une feuille de papier brûlé, tout noirci, qui garde encore un moment sa forme avant de se désagréger en cendre au premier souffle d’air, sans laisser le moindre résidu.
Qu’on ne voie pas là un événement, un » satori’ ; c’est comme si rien ne s’était passé, comme si rien ne se passerait désormais, de sorte que l’anéantissement n’a ni sens ni existence pour qui l’a vécu.
Ainsi, par-delà les distinctions, les attributs et les paradoxes de tous ordres, l’âme anéantie naît à la vie divine : elle découvre la plénitude du Je, perçoit l’unité de Dieu et de l’univers dans le miroir divin, et participe en toute égalité au libre mouvement de l’activité divine.
Mais au cœur même de l’unité, il n’y a plus d’attributs, il n’y a plus d’activité, rien ne sépare de Dieu. Seule subsiste dans sa plénitude le « Je » divin, “car à l’état de l’Unité aucune mention de « toi » ou de “lui” ne saurait se référer.” (H. J. 41).
Là encore nous observons tout à la fois et la diversité des auteurs et la convergence de leurs vues.
Al-Hallâj proclamait :
“Je suis « Je » et il n’y a plus d’attributs ; je suis “Je” et il n’y a plus de qualification. Mes attributs, en effet (séparés de ma personnalité) sont devenus une pure nature humaine, cette humanité mienne est l’anéantissement de toutes les qualifications spirituelles, et ma qualification est maintenant une pure nature divine.
“Mon statut actuel c’est qu’un voile me sépare de mon propre “moi”. Ce voile précède pour moi la vision, car, lorsque l’instant de la vision se rapproche, les attributs de la qualification s’anéantissent : “je” suis alors sevré de mon moi ; je suis le pur sujet du verbe, non plus mon moi, mon “je” actuel n’est plus moi-même”195.
Maître Eckhart exprime la même chose : lorsque l’être est divinisé, ne demeure que le « Je » :
«... le mot « Je » désigne la pureté nue de l’être de Dieu qu’il est en lui-même, sans tous les êtres d’accompagnement196 qui rendent étranger et lointain.” Le mot latin « ego » n’est propre qu’à Dieu seul dans son unité. Lui seul Dieu est, « hors de lui et sans lui rien n’est en vérité… il n’existe pas de séparation entre Dieu et toutes choses… Il leur est plus intime qu’elles ne le sont à elles-mêmes… Il ne doit pas non plus exister de séparation entre l’homme et toutes choses, c’est-à-dire que l’homme n’est rien en lui-même et s’est absolument aliéné de lui-même… C’est pourquoi, dans la mesure où tu n’es pas séparé de toutes choses, dans cette mesure tu es Dieu et toutes choses, car la Déité de Dieu consiste en ce qu’il n’y a pas de séparation entre lui et toutes choses. » (Anc. S. Vol III, p. 119).
Pour qui accède à la conscience vivante et indivise de la voie divine, comment peut se présenter la totalité d’un univers perçu à la fois comme réel et irréel ? Une même illustration marque ici encore nos mystiques d’un cachet commun :
Hamzah Fansûri déclare :
« L’Essence de Dieu et son Être sont Un, son Être et l’être de l’univers sont un ; l’être de l’univers et l’univers sont un, à l’instar de la lumière qui change de nom, mais point de réalité : pour la perception extérieure, elle est une et pour l’œil de la perception intérieure, elle est une aussi. Ainsi est l’être de l’univers, en relation avec l’Être de Dieu — il est un — car l’univers considéré indépendamment n’existe pas. Son existence extérieure n’est qu’apparence et non réalité. Ainsi, l’image dans le miroir, bien que possédant une forme ne possède pas de véritable existence ». (Antho. 249-250.)
Écrivant à propos de la Sagesse de l’Amour éperdu dans le Verbe d’Abraham, Ibn Arabî montre l’univers qui, en son infinie diversité, réside en Dieu, le divin miroir :
C’est en Dieu que nos formes nous apparaissent « de sorte, dit-il, que les êtres se manifestent les uns aux autres en Dieu, s’y reconnaissent les uns les autres et s’y distinguent l’un de l’autre »197. [265]
Denys disait à propos des distinctions qu’au sein de la totale Déité, elles sont indivisibles et unifiées à l’intérieur de l’unité. (D. 89.)
Le monde vu à l’intérieur d’un miroir est également un des thèmes favoris des Shivaïtes du Cachemire. Le Padukodaya célèbre en ces termes l’indicible énergie consciente du Seigneur « en laquelle se manifeste la Beauté de l’Unique indivisible » :
« La grande Illumination qui renferme en son sein l’univers se nomme Splendeur. Pleine de conscience, elle indique la voie. C’est elle l’unicité de l’essence divine. Comme un reflet, le monde fait de sujet connaissant et d’objet connu se révèle en elle — écran lumineux — à la manière d’une ville dans un miroir.198 »
Dans la Paramarthadvadasika, Abhinavagupta recourt à cette même analogie :
« Quelles que soient les apparences manifestées à la Conscience, on les atteint en moi, suprême firmament ; car ces rayons qui sont en elle (en leur spécificité), c’est en moi qu’ils brillent indifférenciés dans la Splendeur éternelle. » (H. A. 68. v. 10)
Avec plus de hardiesse, Angélus Silesius ira jusqu’à proclamer :
« Moi-même dois être soleil, je dois de mes rayons peindre la mer sans couleur de toute la Déité. » (I. 115)
À propos de l’identité de Dieu, de l’univers et de l’homme, Maître Eckhart affirme de façon répétée :
« Dieu est égal en toutes choses et toutes choses sont égales en Dieu. » (P. 92.). Et encore : « Dieu donne à toutes choses également et telles qu’elles émanent de Dieu, elles sont toutes égales ; oui, les anges et les hommes et les créatures émanent de Dieu, égaux en leur premier surgissement. Celui donc qui se saisirait des choses en leur premier surgissement, les saisirait toutes égales. À ce point égales dans le temps, elles le sont encore plus dans l’éternité, en Dieu. Si l’on prend une mouche, en Dieu, elle y est plus noble que l’ange le plus élevé l’est en lui — même. » (Sch. 201-202.) [266]
Angélus Silesius ne manque pas d’y faire écho à sa manière simple et lapidaire :
« En Dieu tout est Dieu. Le moindre vermisseau n’est en Dieu pas moins que ne sont mille dieux. » (II, 143.)
Tous les mystiques qui découvrent cette voie s’émerveillent de la grande égalisation de Dieu, du Soi et de l’univers qui se révèle spontanément et qui a pour fruit la liberté de l’activité divine, car nul autre n’agit que Dieu seul :
« Rien dans le juste n’a la permission d’être actif que Dieu seul : rien ne peut te toucher de l’extérieur ni t’inciter à agir, » dit Maître Eckhart. (p. 284.)
Dans le premier jaillissement où toutes les choses sont égales, l’homme détaché se tient impassible ; il n’a plus à s’efforcer d’égaliser intériorité et extériorité :
« Son intérieur et son extérieur ne sont autres que l’existence d’Allah », d’après le Traité de l’unité (42.)
À ce niveau d’expérience, le juste se livre indifféremment à toutes les formes d’activité comme le suggère l’image du gond à laquelle recourt Maître Eckhart :
« À la porte appartient le gond dans lequel elle tourne. Je compare la planche de la porte à l’homme extérieur et le gond à l’homme intérieur. Si la porte est ouverte ou fermée, la planche de la porte se meut bien ici et là, mais le gond reste immuable en un seul lieu et n’est pas touché par le mouvement. Il en est de même ici. » (p. 25.)
Vivant au cœur de l’unité, dans ce que les Shivaïtes appellent la samatâ et Maître Eckhart l’impassibilité, un tel homme jouit librement de l’univers multiple.
« Et de même qu’aucune multiplicité ne peut disperser Dieu, de même rien ne peut non plus disperser cet homme, ni le diversifier : il est un dans l’un, ou toute diversité est unité, inviolable unité. » (P. 164.)
Dans cette inviolable unité, il vit, émerveillé, le perpétuel renouvellement du monde à l’unisson de l’activité divine qui :
« À chaque instant réduit un monde à néant
et façonne un autre semblable à sa place. » (Antho. 247.)
Dans la voie divine, en effet, il y a surabondance et profusion d’une vie jaillissante, spontanée, sans interruption, en laquelle acte absolu et quiétude coïncident. [267]
À ce haut niveau la vie est saisie en son surgissement, dans son instantanéité199, instant actuel, sans attache ni au passé ni à l’avenir. Dans cet instant fusent perpétuellement gratuité et liberté hors du devenir.
Nous avons vu que chez Eckhart la pure activité productrice en laquelle seul l’Un agit se présente d’abord comme un bouillonnement intérieur propre à la vie divine, avant Xebullitio ad extra ou action créatrice proprement dite.
Comme pour les Shivaïtes, cette opération intérieure est toujours achevée, toujours en acte. Elle est selon Eckhart « toujours nouvelle » toujours présente, car début et fin ne comportent aucun intervalle : Dieu engendre son Fils unique dans l’éternité. Le Fils naît éternellement en Dieu et continue à naître aujourd’hui même. Il en est ainsi de la naissance du Fils dans l’âme. Cette génération éternelle se produit en ce monde dans l’instant intemporel à la limite du temps et de l’éternité.
Ainsi celui qui accède au sommet de la voie divine vit, « frais et libre », dans cet instant où tout jaillit et s’anéantit sans cesse. Dans cet étemel présent de la création, à la fois au repos et en activité, il jouit souverainement de la liberté divine.
Au cœur de la non-voie toute parole, tout énoncé cesse ; mais il importe cependant de la nommer, car elle fonde, elle couronne et annule la grande aventure mystique.
Il faut se tenir à son seuil, en effet, pour voir définitivement expirer toutes les idolâtries des voies et des moyens. Grâce, accès secret, passages et transformations, tous ces jalons de la vie mystique se révèlent non seulement vains, mais sans existence.
Il n’y a pas de naissance pour qui est né.
Il n’y a pas de devenir pour qui est.
Il n’y a pas d’anéantissement pour ce qui n’est pas.
Dans la voie divine — voie de la grâce intense — quelque chose s’accomplit encore : amour, connaissance, contemplation jouent un rôle ; il n’en est pas de même dans la non-voie :
« Certains maîtres veulent que l’esprit saisisse sa béatitude dans l’amour, d’autres qu’ils la saisissent dans la contemplation de Dieu. Mais je parle autrement et je dis : il ne la saisit ni dans l’amour ni dans la connaissance ou “contemplation”. On va aussitôt demander : la contemplation de Dieu n’est-elle pas le lot de l’esprit dans la vie éternelle ? Oui, et non ! Dans la mesure où il est déjà né il n’a plus les yeux levés vers Dieu. Ce n’est que dans la mesure où il est encore en train de naître qu’une vision de Dieu lui revient. Mais la béatitude de l’esprit ne gît pas là où il est seulement en train de naître, mais là où il est né : là où il vit, là où le Père vit, dans la fermeture et dans la pure absence de détermination de Y essence divine. Détoume-toi de toutes choses et saisis — toi, nu comme tu es, dans l’essence. » (P. 286.)
Point de devenir dans l’immuable réalité :
On ne peut connaître l’Essence qu’en s’identifiant à elle ; cette identification qui élimine toute distinction est une simple prise de conscience :
« Une union à Dieu au sens de devenir un avec Dieu, [269] cela n’existe pas ; ce qui existe c’est la prise de conscience du fait existant, à savoir que le mystique est un avec Dieu » dit Ibn’ Arabî, (Arb. 117.)
S’élevant contre la compénétration réciproque de Dieu et de l’âme, Ibn’Arabî précise : « Il n’entre pas en toi et tu n’entres pas en Lui… Je veux dire que tu n’existes absolument pas, et que tu n’existeras jamais ni par toi-même ni par Lui, dans Lui ou avec Lui. Tu ne peux cesser d’être, car tu n’es pas.24 » Ainsi l’idée même d’anéantissement est
24 Traité de I « Unité, p. 25. Eckhart disait également : « Toutes les créatures sont un pur néant. Je ne dis pas qu’elles sont petites ou n’importe quoi : elles sont un pur néant. » (Sch. 162.)
60
« suprême idolâtrie ». D’autre part, on ne peut cesser d’être, car “ce que tu crois être autre qu’Allah n’est pas autre qu’Allah… Tu Le vois et tu ne sais pas que tu Le vois. Du moment que ce mystère a été dévoilé à tes yeux, que tu n’es pas autre qu’Allah, tu sauras que tu es le but de toi-même, que tu n’as pas besoin de t’anéantir, que tu n’as jamais cessé d’être… Un exemple : un homme ignore quelque chose, puis il l’apprend. Ce n’est pas son existence qui s’est éteinte, mais seulement son ignorance… ne pense donc pas qu’il est nécessaire d’éteindre ton existence, car alors tu te voiles avec cette même extinction, et tu deviens toi-même (pour ainsi dire) le voile d’Allah200.”
On ne peut rien dire de la Réalité incomparable (anuttara). Si Abhinavagupta en donne un exposé, c’est pour faire comprendre à quel point rien n’y peut livrer accès. Même le désir d’accéder à l’Essence libre de toute voie, même l’incitation qu’un maître donne à un disciple impliquent encore différenciation et limite ; rien de cela ne concerne cette insurpassable Réalité qui réside partout, jusque dans les états ordinaires201.
C’est qu’aucun moyen, aucune voie ne peuvent servir à révéler la Conscience : “ceux qui désirent discerner directement cette Essence à l’aide d’une voie ne sont en réalité que des sots qui, pour voir le soleil, cherchent (à s’emparer) d’une luciole.” (T.A. III. 14.) [270]
Un poète musulman, Rûmî, s’écriait de même :
.
« Partout se trouve l’Ami dévoilé,
présent dans la manifestation, ô toi doué de vision !
Tu recherches une chandelle en plein soleil,
Le jour est si brillant, et tu restes dans les ténèbres de la nuit !
Si tu échappes à cette obscurité, tu apercevras l’univers tout entier orienté de lumière.
Tel un aveugle, tu cherches un guide et un bâton,
tandis que devant toi la route s’étend, plane et claire ! »
(Antho. 260.)
.
Dans une belle ode (828) il se sert de la même métaphore :
.
« Place devant le soleil la chandelle ardente
Et vois comme son éclat disparaît devant ces lumières :
La chandelle n’existe plus, la chandelle s’est transmuée en lumière.
… Le ruisseau court à la recherche de l’océan ;
Il se perd quand il est noyé dans l’océan.
Tant que la recherche existe, le cherché n’est pas connu ;
Quand l’objet de la recherche est atteint, cette recherche devient vaine.
Donc, tant que la recherche existe, cette quête est imparfaite,
Quand la recherche n’est plus, elle acquiert alors la suprématie. »
.
Avec la recherche doivent s’évanouir progressions et voyages.
Sur la lumière qui est Dieu, Maître Eckhart cite une parole de Saint-Paul : « Dieu réside dans une lumière à laquelle personne ne peut parvenir », car, ajoute-t-il, « vers Dieu il n’est pas d’accès. Celui qui s’élève encore et croît en grâce et en lumière n’est jamais encore parvenu en Dieu. Dieu n’est pas une lumière qui croît ; il faut en croissant être parvenu à lui. Dans la croissance on ne voit rien de Dieu. Pour que Dieu soit vu, il faut que ce soit dans une lumière qui est Dieu lui-même… Tout le temps que nous sommes engagés dans l’approche, nous n’y parvenons pas. » (Anc. s. III, 75.)
Contrairement à ceux qui prennent la route, toujours en voyage, et ne s’arrêtent que pour repartir, l’Egyptien Dhou’l Noun s’adresse ainsi à Dieu :
“Nous avons renoncé à ce voyage… [271]
… Nous avons fait agenouiller nos montures devant le seuil de Ta maison.” (Kh., 52.)
Un docteur du Maghreb disait à ce même Égyptien :
«... Si tu es venu pour Le chercher, là même où tu t’es mis en marche 11 se trouvait en personne. » (Antho. 126.)
Dans un même esprit, Rûmî révélait à ces éternels voyageurs :
“Vous êtes en réalité des anges mêmes si vous avez un corps
humain.
Mille chambellans et pages vous attendent
Prêts à vous servir, pourtant vous êtes en route et en voyage.
… J’ai prononcé mille paroles en vain, et le but à chaque instant se cache davantage. Combien peu vous êtes doués ! (O. 954.)
Doué l’est au contraire celui qui est apte à découvrir qu’il n’y a pas de voie.
Ces témoignages divers conduisent naturellement aux formules lapidaires et paradoxales qui nient voies et chemins : elles fascinent sans éclairer si l’on ne comprend qu’elles ne peuvent être prononcées à bon escient que par celui qui a fait le chemin ; loin de nier l’expérience, elles l’énoncent au contraire dans sa plénitude et sa pureté.
À quelqu’un qui lui demandait : « Quel est le chemin qui mène à Dieu ? » al-Hallâj répondit :
‘Chemin ? Tout chemin va de l’un à l’autre. Or, nul autre n’est avec Moi… et il récita :
« Est-ce Toi, est-ce moi ? Cela ferait deux dieux.
Loin de moi, loin de vous la pensée d’affirmer “deux” !
.
Un être, le Tien, s’exprime au fond de mon non-être, toujours.
Prétendre ajouter mon tout au Tout serait une double illusion :
.
Où donc est Ton essence par rapport à moi, que je puisse la voir
Puisque déjà mon essence a visiblement dépassé le Où ?’ (Al-H., 137.)
.
De son côté Rûmî proteste : ‘… Si tu dis : “je vais en [272] avant”, non, il n’est pas de chemin pour avancer.’ (O. 425.)
Nasrâbâdhi déclarait d’une manière plus pittoresque :
« Dieu est jaloux, et une marque de Sa jalousie est qu’il ne fraye vers Lui aucune autre route que Lui-même. » (Al-H., 74.)
D’une façon plus elliptique encore : le Tao te king :
‘La voie qui peut être parcourue n’est pas la véritable voie (tao).’
On trouve dans le Traité de l’Unité : ‘« Celui qui arrive », est Lui, “Ce à quoi on arrive” dans l’union est encore Lui. Aucun autre que Lui ne peut se joindre à Lui ou arriver à Lui. Aucun autre que Lui ne se sépare de Lui. Quiconque peut comprendre cela est tout à fait exempt de la grande idolâtrie.’ (39.)
.
Dès qu’il n’y a plus de voie, tout n’est que Béatitude et pure Conscience.
Évoquant la merveilleuse montée qui conduit à la lumière inconditionnée et sans accès, Maître Eckhart insiste sur l’imperfection de toute voie : ‘Tout ce par quoi je connais Dieu, aussi minime et pur soit — il, doit être écarté. Même la lumière qui est vraiment Dieu en tant qu’elle joue sur mon âme, lui est étrangère. Je dois la prendre dans son jaillissement… et même alors, si je la prends là où elle jaillit, je dois être libéré de ce jaillissement et la prendre telle qu’elle plane en elle-même.
« Et pourtant je dis : il ne faut pas qu’il en soit ainsi. Je ne dois la prendre ni dans son contact202, ni dans son jaillissement203, ni quand elle plane en elle-même204 ; ce ne sont là que des voies, et Dieu doit être pris comme voie sans voie205, car en lui il n’y a pas de voie. Saint Bernard dit : “Qui veut Te connaître ô Dieu, doit te mesurer sans mesure”’206.
On constate l’accord unanime des mystiques sur ce point :
Si Abhinavagupta commence l’exposé des voies par la Non-Voie, étant donné qu’elle contient toute réalité, toute efficience et que d’elle dépendent entièrement voies et moyens207, Ruysbroeck achève, lui, la plupart de ses écrits par des pages d’une étrange beauté qui célèbrent « l’abîme sans fond où règne la Béatitude dans la lumière simple de l’Essence ». Il n’est guère d’œuvre où ne revienne, lancinant, le terme clé de sa mystique prise à son sommet : Wise, dans wiseloes, onwise, sonder wise, sans voie, ni manière d’être, car nul chemin ne mène à cet incommensurable abîme.
« Sur le chemin de la Conscience, dit Abhinavagupta, ceux que la grise poussière tombée des discours des logiciens n’a pas aveuglés, s’absorbent dans le Souverain quand ils réalisent leur identité avec lui. Et c’est en lui qu’ils plongent toutes choses : cruche, corps, souffle vital, impressions affectives et jusqu’au non-être. » (T.A. III, 49.)
Ainsi l’univers entier, sous ses multiples aspects, réside en l’Essence anupâya que n’entache ni forme ni temporalité et, dès que tout s’y perd, seule demeure la pure béatitude.
Afin d’illustrer que « toutes les choses sont tout en tout et unes dans le tout » selon la formule d’Eckhart, et qu’elles se dissolvent dans la réalité sans voie où tout devient anupaya sans manière d’être, les Shivaïtes emploient une image significative :
« Une fois tombés dans une mine de sel, le bois, les feuilles, les pierres et les autres objets se transforment en sel. Ainsi, les choses tombées dans le Soi conscient ne sont plus que Conscience. » (T. A. II, stance citée aux verset 35.)
Maître Eckhart, faisant lui aussi allusion à cette lumière de la conscience, se servait d’une même illustration :
« Si l’on voyait dans cette lumière un morceau de bois, ce serait un ange et il serait doué d’intelligence, il serait pure intelligence dans cette pureté première, qui est la perfection de toute pureté. » (Pf. 286.)
C’est en effet la suprême Profondeur, la pureté originelle où toutes choses sont unité :
« L’or, la pierre, l’os et tous les brins d’herbe ne sont tout ensemble qu’un seul et même être dans l’origine première. » (Pf. 334.)
D’une façon plus nette encore il rejoint Abhinavagupta quand il dit à propos de l’inaccessible Lumière en laquelle Dieu demeure : [274]
‘Tout ce qui approche cette Lumière, la lumière le consume et le transforme sa nature divine. De même, tout ce qui est absorbé dans l’Essence se change en Essence.
Nous avons vu que les maîtres shivaïtes distinguent la non-voie, au sens strict, de l’accès très réduit : la première étant conscience absolue et le second béatitude. Il semble bien que maître Eckhart propose lui aussi l’accès à la béatitude comme la forme ultime de l’activité de l’âme puisque « pour arriver en elle-même », il faut qu’elle s’aperçoive « comment elle et Dieu ne sont qu’une seule béatitude, un seul royaume qu’elle a donc finalement trouvé sans le chercher ». (P. 310.)
Cette béatitude ne repose ni sur l’amour ni sur la connaissance, mais sur ‘quelque chose d’où fluent la connaissance et l’amour ; cela ne connaît ni n’aime comme les autres puissances de l’âme. Celui qui sait cela sait en quoi réside la béatitude. Cela n’a ni avant ni après, n’attend rien qui lui advienne, car cela ne peut ni gagner ni perdre… Ce « quelque chose » jouit lui-même de lui-même selon le mode de Dieu’. (Anc. s. II. 147.)
L’expérience de cette béatitude consiste en la jouissance de toute la plénitude de l’essence divine :
« Dieu seul, dit-il, est bienheureux — en lui-même. Et toutes les créatures qu’il doit rendre bienheureuses, il faut qu’elles le soient avec la même béatitude et de la même manière que Dieu… L’esprit s’avance au — delà de toutes les essences, oui, au-delà de sa propre essence éternelle… et avec le Père prend son essor jusqu’à l’unité de l’essence divine, où Dieu se saisit comme quelque chose de pur et simple ! Dans cette expérience l’esprit ne reste plus créature, car il est lui-même Ta béatitude’ : il est une seule essence, une seule substance avec la divinité, et c’est en même temps sa propre béatitude et celle de toutes les créatures. » (p. 156 157.)
À ce niveau d’expérience la béatitude échappe à toute comparaison, elle l’emporte sur les plus grandes joies humaines comme sur les félicités mystiques qui la précèdent, parce que d’une autre nature : seul l’éprouve celui dont le moi est anéanti.
.
C’est à Ruysbroeck qu’il appartient de suggérer avec le [275] plus de vigueur et de poésie son caractère exceptionnel. Il s’attache toujours, il est vrai, à décrire avec une précision concrète les différents degrés de la félicité intérieure qu’il surprend dans ses aspects particuliers chaque fois que la disparition ou l’évanouissement d’une distinction la fait surgir sous une forme nouvelle.
Mais de la ‘béatitude fruitive, « substantielle » et sans voie qui règne dans l’essence’, il proclame la nature incomparable : elle déjoue l’imagination de l’être intériorisé qui goûte la douceur et les félicités passagères d’un cœur apaisé.
Elle dépasse les béatitudes propres à la connaissance208, celles qui accompagnent les dons divins de conseil et d’intelligence, accordés aux êtres ayant acquis la ressemblance avec Dieu :
« Quant à tous ceux qui ont senti l’attouchement intérieur, dont la raison est éclairée, et qui éprouvent l’impatience de l’Amour, et à qui sont montrées les profondeurs sans mode, ils sont introduits par la jouissance intérieure dans la suressence divine. Défaillant sans cesse dans la lumière, ils trouvent leur repos dans la jouissance au milieu des solitudes sauvages ou Dieu se possède dans la jouissance209. »
Lorsque Dieu fait don de la raison éclairée, il confère la ressemblance, mais là où il unit, il accorde le repos et la jouissance. Et dès qu’il y a unité dans l’essence et dans l’abîme, il n’est plus question de donner ou de recevoir. Quand il appelle à l’union, c’est la Splendeur illimitée.
Au-delà d’une telle jouissance Ruysbroeck situe la jouissance propre au don divin de « sagesse savoureuse » accordée au sommet de l’esprit intériorisé, et qui pénètre l’intelligence et la volonté selon leur degré d’intériorité. Ce don relève de la voie suprême, car il consiste en un ébranlement, une touche dans l’unité de notre esprit, qui est le réservoir de toutes les grâces et de tous les dons ; là, c’est l’intermédiaire le plus intime entre Dieu et nous, entre le repos et l’action, entre le temps et l’éternité.
La saveur y est sans mesure et sans fond ; elle se répand du dedans au dehors et pénètre l’âme et le corps même jusqu’au sens le plus intime, en se révélant comme une sorte de « toucher sensible », Cette saveur incompréhensible n’est autre que l’amour de Dieu, l’Esprit Saint qui orne la volonté intériorisée dans l’unité des puissances [276] suspendues en Dieu afin que l’âme puisse goûter et savoir combien Dieu est grand. « Cette saveur est si immense qu’il semble à l’âme que le ciel et la terre et tout ce qui vit en eux doivent se fondre et s’anéantir en ce goût infini. Une telle félicité est au-dessus et au-dessous, au-dedans et au dehors, elle embrasse et sature complètement le royaume de l’âme210. »
La béatitude fruitive surpasse même ce que dans le Livre de la plus haute Vérité, Ruysbrocck nomme « well-behagen », contentement divin211 en lequel se renouvellent sans relâche la grâce, la gloire et tous les dons de Dieu se déversant sur le ciel, la terre et sur chaque être individuellement ; et de cette éternelle satisfaction de soi qui enveloppe les élus dépendent ciel et terre, vie, activité de tous les êtres, et qui a lieu dans un étemel maintenant, au-delà du temps, au sein même de l’unité. (Ch. 7.)
Quand Ruysbroeck distingue deux sortes principales de béatitude correspondant à la différence entre Dieu et la déité, entre opération et repos, la béatitude fruitive est encore loin au-dessus de la béatitude selon la distinction de l’unité féconde des personnes, leur fond propre éternellement opérant et qui est la plus haute des voies. La béatitude de fruition tient, elle, à l’effacement de toute voie et à l’écoulement des personnes dans l’unique Essence divine212.
Ceci se produit à l’intérieur de la lumière simple, abyssale et sans mode, cette lumière devenant l’unité de jouissance de Dieu et de toutes les âmes aimantes. Là, toute jouissance est achevée et rendue parfaite dans la Béatitude essentielle. C’est le repos étemel, la ténèbre sans voie.
Dans le Miroir du salut éternel, Ruysbroeck se plaît à évoquer une jouissance « sauvage et déserte comme un égarement où il n’y a ni mode, ni chemin, ni sentier, ni repos, ni mesure, ni fin, ni commencement, ni rien qu’on puisse exprimer par les mots ni montrer. Et c’est notre béatitude simple à tous, cette essence divine, et notre suressence au-dessus de la raison et sans raison. » (Maeterlinck,. p. LXXIII. »
À propos de la plus haute union sans distinction, Ruysbroeck écrit dans le Livre de la suprême Vérité (ch. XII) que “les hommes illuminés sont engloutis dans l’abîme [277] sans accès d’une insondable béatitude… Cette béatitude est tellement unique et dépourvue de voie (wiseloes) qu’en elle toute contemplation essentielle, tendance et distinction s’évanouissent, car par cette fruition tous les esprits élevés fondent et s’anéantissent dans l’Essence de Dieu qui est la Suressence de toutes les essences. Ils tombent dans une solitude et une ignorance sans fond où toute lumière devient ténèbre, où les trois Personnes font place à l’unité et demeurent sans distinction dans la fruition d’une béatitude essentielle…”
C’est ainsi que Ruysbroeck est conduit à préciser la grande différence qui existe entre la clarté des saints et la plus haute clarté en laquelle on puisse parvenir en cette vie, car seule l’ombre de Dieu éclaire notre « sauvage désert » intérieur tandis que sur les cimes de la terre promise il n’y a point d’ombre. Et pourtant le même soleil et la même clarté brillent sur notre désert et sur les hautes montagnes ; mais les saints étant dans un état translucide et de gloire reçoivent la clarté sans intermédiaire… quant à nous, nous marchons dans cette ombre de Dieu. Pour ne faire qu’un avec la splendeur du soleil nous devons sortir de nous-mêmes dans la Non-Voie ; alors le soleil nous entraînera avec nos yeux aveuglés, jusque dans son propre éclat où nous serons un avec Dieu. (La Pierre étincelante, ch. XI.)
Mais quels que soient les sommets intérieurs qu’atteignent les grands mystiques, ils ne séparent jamais la vie mystique de la vie ordinaire. C’est toujours à travers elle qu’ils s’efforcent d’atteindre l’expérience ultime et, une fois qu’ils y sont parvenus, c’est à même cette vie quotidienne qu’ils en goûtent les effets dont ils font bénéficier ceux qui les entourent.
Loin de fuir la condition humaine, ils sont, réellement, les seuls à en connaître toutes les dimensions, à lui donner toute sa mesure et à la maîtriser dans tous ses aspects. Comme l’observe M. Maeterlinck :
« On oublie trop souvent que toute certitude est en eux seuls » (p. VIII.)
Parlant de l’homme parfait, de l’homme juste, de l’homme commun ou du libéré vivant, chaque tradition [278] s’efforce de dire à sa façon l’humaine simplicité de cet être divin.
Un et simple comme Dieu, dirait Maître Eckhart, il ne laisse paraître aucun indice de richesse intérieure, bannissant tout ce qui pourrait suggérer le caractère exceptionnel de son expérience. Aucun pouvoir, aucune pratique dévotionnelle, voire mystique, ne le désignent au regard d’autrui. Être surpris en extase ou en samadhi est pour lui, au contraire, une marque de faiblesse ou d’imperfection. Établi dans la béatitude divine, par delà grâce et gloire, il s’adonne à ce que Ruysbroeck nomme « vie commune » : vie dans laquelle activité et contemplation sont un même exercice :
« L’homme noble adonné à la vie commune… s’écoule par toutes les vertus, à l’instar de Dieu qui s’écoule par tous ses dons ; cependant il demeure dans une éternelle jouissance et se tient avec Dieu au-dessus de tous les dons. »
Pour l’homme qui pratique la vie commune dans toute sa noblesse, l’activité divine se déploie dans la simple activité de la vie ordinaire :
« Qu’il marche, mange ou s’adonne à ses occupations, dit Abhinavagupta du libéré vivant, il savoure un nectar d’immortalité ; il n’est rien qui soit distinct de lui, tout est du substrat de la plénitude indifférenciée. » (P.S. 54.)
À même la béatitude foncière, il satisfait aux exigences des affaires temporelles. Ses désirs propres étant ensevelis en Dieu, cette béatitude ne peut jamais plus être troublée et reste ignorée des autres.
Paisible, ce mystique vit simplement, ne cherche rien de plus que ce qui lui est proposé ; subvenant à ses besoins et à ceux de sa famille, se contentant d’être comme il est, il assume sans restriction ni choix les activités et les fonctions de la vie humaine qui s’offrent à lui.
Il n’use d’aucun pouvoir pour se soustraire ou soustraire son corps aux lois de l’humaine condition. Pourquoi userait-il d’une force pour aller à l’encontre de ces lois, lui qui vit affranchi de toutes les dépendances dans une liberté infinie ? Il peut se prêter à toutes les limites, puisqu’il échappe à toutes.
Il ignore devoir, chagrin ou peur, car il n’y a ni perte ni destruction dans la Réalité ultime, toutes les imprégnations inconscientes ayant été détruites. Pour lui rien ne commence ni ne finit, il n’est surpris par aucun lieu, par aucun moment ni par aucune manière d’être. Jamais lié ni [279] séparé, il se livre à ses occupations avec une légèreté immaculée.
Son inaltérable autonomie déjoue toutes les imitations. Seul il est apte à jouir de la vie, dit Abhinavagupta. Il ne s’étonne ni ne s’émerveille, mais goûte en toutes choses le pur suc de l’effusion divine dont il rend perceptible la surabondance à qui décèle sa liberté infinie.
Unique, il se veut toujours égal à tous, n’accepte ni faste ni privilège. Tel l’aigle qui se cache dans les roches nues, méprisé par les regards grossiers, il garde secrète sous ses apparences modestes la plus puissante des efficiences : celle de l’amour le plus pur. Attentif, il partage les émotions, les souffrances de ceux qui l’entourent apportant à tous indistinctement le réconfort de sa compassion transparente. Il suffit de s’asseoir près de lui pour que peines et inquiétudes s’évanouissent, la réalité de son amour révélant tout naturellement le caractère illusoire de la souffrance individuelle.
Ordinaire pour l’homme ordinaire auquel il est voilé, il se découvre au mystique qui l’a reconnu, au fur et à mesure que ce dernier progresse. S’il fait « fleurir les arbres morts », il l’ignore, laissant toujours planer le doute sur l’efficacité de son acte, dissimulant les miracles dans les surprises toujours possibles de la nature.
Et si les dimensions de son humour sans limites vous laissent un jour interdit, bousculant vos convictions misérables, vous rirez avec lui de votre propre débâcle, séduit par sa gaieté, sa douceur inépuisable et son incomparable courtoisie.
[Abréviations relatives aux textes cités, extrait de Hermès 3, « Le Maître Spirituel selon les traditions d’Orient et d’Occident »].
A.S. = Angelus Silesius. Pèlerin chérubinique. Traduit, préfacé et commenté par Henri Plard. Aubier, Paris, 1946. La référence est donnée aux livres et aux stances.
Cogn. = Louis Cognet. Introduction aux mystiques rhéno‑flamands. Desclée, Paris, 1968.
D. = Oeuvres complètes du Pseudo-Denys l’Aréopagite. Traduction, préface et notes par Maurice de Gandillac. Aubier, Paris, 1943.
Anc. = Maître Eckhart. Introductions et traduction de Jeanne Ancelet-Hustache. Paris, Le Seuil. Traités, 1971 ; sermons vol. I, 1974 ; vol. 2, 1978 ; vol. 3, 1979.
Evans = Meister Eckhart. Transl. C. de B. Evans, London, Watkins, 1956, vol. I.
P. = Oeuvres de Maître Eckhart. Traduction de Paul Petit. Gallimard, Paris, 1942.
Pf. = Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts. Band 2 : Meister Eckhart. Hrsg. Franz Pfeiffer. Leipzig, 1857. Reprint : Scientia, Aalen, 1962.
Sch. = Maître Eckhart ou la joie errante. Sermons allemands traduits et commentés par Reiner Schürmann. Denoël, Paris, 1972.
G. = Jeanne Marie Bouvier de la Mothe-Guion. Les Opuscules spirituels. Introduction de Jean Orcibal. Olms, Hildesheim, 1978 (Reprint de l’éd. de 1720).
Maet. = L’Ornement des Noces spirituelles de Ruysbroeck l’Admirable, traduit du flamand et accompagné d’une introduction, par Maurice Maeterlinck, Bruxelles, 1900.
R. = Ruysbroeck. Oeuvres choisies. Traduites du moyen-néerlandais et présentées par J.-A. Bizet. Aubier, Paris, 1946.
R. w. = Jan van Ruusbroec. Werken. Ed. P.P. Reypens, van Mierlo, Poukens, Stracke, Schurmans. Malines, 2e édition. 1944-1948. 4 vol.
Wyn. = The Adornment of the spiritual Marriage. The Book of Truth. The sparkling Stone. By Jan van Ruysbroeck. Transl. by C.A. Wynschenk dom. Watkins, 1951.
Les œuvres qui suivent à l’exception du Tantrasāra sont traduites et présentées par Lilian Silburn, publiées par l’Institut de Civilisation indienne et diffusées par E. de Boccard, Paris.
Bh. = La Bhakti. Le Stavacintâmani de Bhattanârâyana. 1964. Réimp. 1979.
H.A. = Hymnes d’Abhinavagupta. 1970.
H.K. = Hymnes aux Kālī. La Roue des énergies divines. 1975.
M.M. = La Mahārthamañjarî de Mahesvarānanda avec des extraits du Parimala. 1968.
P. H. = Pratyabhijñahrdaya, éd. et traduit par Jaideva Singh ; Banarsidas, Bénarès, 1963.
P.S. = Le Paramārthasāra d’Abhinavagupta. 1957. Réimp. 1979.
S.S.v. = Les Śivasûtra et la Śivasūtravimarsinî de Ksemarāja. 1980.
T.S. = Le Tantrasāra d’Abhinavagupta. Traduction inédite ici même des cinq premiers chapitres.
V.B. = Le Vijñāna Bhairava. 1961. Réimp. 1976.
Même éditeur, même diffusion :
P.T. = Parātrisikālaghuvrtti de Abhinavagupta. Texte, traduction et notes par André Padoux. 1975.
En sanskrit :
I.P.v. = Īsvarapratyabhijñāvimarsini de Abhinavagupta. Kasmir Series of Texts and studies, 22 et 33.
S.D. = Śivadrsti de Somānanda avec le commentaire d’Utpaladeva. Srinagar 1934, K. S. 54.
S. U. = Śivastotrāvalī de Utpaladevācharya, avec le commentaire de Ksemarāja, éd. par Rajanaka Laks — mana, Chowkhamba Sanskrit Series, Bénarès, 1964.
T. A. = Tantrāloka de Abhinavagupta, avec le commentaire de Jayaratha. 12 vol. Srinagar-Bombay, 1918-1938. K.S.
Antho = Anthologie du Soufisme par Eva de Vitray-Meyerovitch. Sindbad, Paris, 1978.
Arb. = A. J. Arberry. Le Soufisme. Traduction J. Gouillard. Collection Documents spirituels. Cahiers du Sud, Paris, 1952.
Doct. = Introduction aux Doctrines ésotériques de l’Islam. Par Titus Burckhardt. Alger-Lyon, 1955. Rééd. Dervy-livres, 1969.
al-H. = Akhbar Al-Hallâj. Recueil d’oraisons et d’exhortations du martyr mystique de l’Islam. Par Louis Massignon. Vrin, 1957, 3e éd.
Dîw. a = Le Dîwân d’AI-Hallâj. Trad. Louis Massignon. Journal asiatique, janvier-mars 1931.
Dîw. b = Hoceïn Mansûr Hallâj. Dîwân. Trad. et présenté par L. Massignon. Collection Documents spirituels. Cahiers du Sud, Paris, 1955.
H.J. = De l’Homme universel. Par « Abd Al-Karîm Al-Jîlî. Traduit de l’arabe et commenté par Titus Burckhardt. Alger-Lyon, 1953.
Im. = L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn « Arabî. Par Henry Corbin, Flammarion, Paris, 1958. Rééd. 1976.
Kh. = René Khawam. Propos d’Amour des Mystiques musulmans. Éd. de l’Orante. Paris, 1960.
O. = Odes mystiques de Mawlânâ Djalâl-od-Dîn Rûmî. Traduction et notes par Eva de Vitray-Meyerovitch et Mohammad Mokri. Ed. Klincksieck, Paris, 1973.
Sag. = La Sagesse des prophètes. Par Muhyi-d-dîn ibn « Arabi. Traduction et notes par Titus Burckhardt. Albin Michel, Paris, 1955.
Un. = Le Traité de l’Unité, dit d’Ibn « Arabî. Trad. Abdul-Hâdi. In Le Voile d’Isis, janv.-fév. 1933. Repris et attribué à Al-Balabanî, Éditions Orientales, Paris, 1977.
L’expérience spirituelle est bien plus une expérience de plénitude qu’une expérience de vide ; pourtant l’une n’est pas possible sans l’autre, la vie mystique étant constituée par une alternance ininterrompue de vides et de pleins qui vont s’approfondissant de concert.
Avant d’entrer dans cette vie nouvelle, on ne peut imaginer ni se faire quelque idée, même approximative, du vide mystique, car on voit seulement des reflets de surface, jeux de lumières et d’ombres sur un écran qui n’offre qu’une illusion de profondeur ; mais dès que l’on aborde la vie réelle, l’écran s’évanouit, une troisième dimension se présente soudain, tout se creuse, s’approfondit, l’espace s’ouvre à l’infini, devient ce domaine immense dans lequel vacuité et plénitude prennent un sens parce qu’elles touchent à l’être substantiel.
Ainsi le vide donne relief et intensité aux êtres et aux choses qu’il enveloppe, il les situe à leur juste place et permet leur vivante interpénétration. Vide ou énergie vacuitante, pénétration et plénitude dépendent donc les uns des autres et engendrent une manière très nouvelle d’éprouver et de comprendre. Dès que les cavernes de l’entendement et de l’imagination sont vacantes, l’essence divine se révèle ; mais on pourrait aussi bien dire qu’une chose indicible s’infuse constamment dans l’intime de l’être et le vide de son contenu ; trop subtile pour être appréhendée, elle produit l’impression d’une étrange vacuité ; reconnue ensuite, elle devient plénitude ; trop puissante, elle cause ivresse, extase et ravissement. Mais à leur tour, des états qui ont d’abord fulguré comme plénitude apparaissent comme vide une fois dépassés.
En fait le vide mystique est d’une richesse inépuisable. Les pages qui suivent ne peuvent en donner que quelques aperçus, illustrés par des impressions vécues de nos jours et par des expériences très vivantes de grands mystiques d’autrefois. [16] 217.
Mon but est de souligner l’importance du vide dans l’expérience spirituelle de tous les âges et de tous les pays sans prétendre aucunement à une étude de mystique comparée.
Il a paru nécessaire de consacrer une première partie à définir certaines modalités du vide, qui se retrouvent d’un bout à l’autre de la vie mystique, avant d’aborder les vacuités qui en caractérisent les diverses phases.
Le terme « vide » prête à équivoque. Il faut donc distinguer le vide mort et stérile de la concentration volontaire du vide spontané, vivant, qui apporte des énergies. Le premier vide mental acquis par un effort intense et persévérant vise à l’inhibition ou à l’arrêt de la pensée ; c’est un vide ponctiforrne où la conscience se resserre et se rétrécit sur un point. Par contraste avec cette vacuité rigide, figée, fermée sur soi que caractérise la contraction, le second vide, mobile et fluide où la conscience se relâche, s’élargit, est « ouverture », car il n’a pas de limite.
On peut encore préciser : si dans le vide-concentration le moi est actif et le vide immobile, dans le vide spontané au contraire, le moi est passif et le vide dynamique.
Je fabrique le premier, j’accueille et reçois le second.
Le vide mental dont les adeptes du hathayoga sont souvent victimes n’a rien du véritable samādhi. Il ne conduit jamais à la plénitude ; en fait il ne mène à rien si ce n’est à faire échec au véritable vide.
Ruysbroeck dénonce ce' vide absolu' où demeurent sans connaissance et étrangers à toute vertu certains hommes qui se prennent pour des saints et s’adonnent au recueillement habituel au-dessus des images sensibles :
«... On rencontre d’autres hommes qui… au moyen d’une sorte de vide, de dépouillement intérieur et d’affranchissement d’images, croient avoir découvert une manière d’être sans mode et s’y sont fixés sans l’amour de Dieu. Aussi pensent-ils être eux-mêmes Dieu… Ils sont élevés à un état de non-savoir et d’absence de modes auxquels ils s’attachent ; et ils prennent cet être sans modes pour Dieu. » 218.
[17] D’après un maître tibétain :
« La cessation du processus de la pensée peut être pris à tort pour la quiescence de l’esprit infini qui est le but véritable. »219.
Les bouddhistes chinois eux aussi mettent en garde contre la « concentration » qui, s’accompagnant d’activité mentale et d’effort, vise à s’emparer de la vacuité :
« S’il en est qui, accroupis, figent leur esprit pour entrer en concentration, fixent leur esprit pour regarder la pureté… ramassent leur esprit pour avoir l’expérience intérieure, toutes ces pratiques font chez eux obstacle à la bodhi (éveil). »220.
Houei-neng disait aussi :
« Fixer son esprit et contempler la pureté, c’est une maladie et non pas du dhjāna. Quel progrès fait-on vers l’absolu en astreignant son corps à rester longtemps accroupi ? »221.
La même erreur se renouvelle d’ailleurs tout au long de la voie : après ceux qui figent leur esprit pour saisir la concentration, d’autres mettent leur esprit en mouvement, le contemplent et « saisissent la vacuité », à moins qu’ils ne s’identifient à elle. Certains, ayant passé par-delà erreur et éveil « sans pénétrer leur nature foncière, demeurent dans le non-être et se confient à la vacuité » (p. 46).
Par contraste avec le vide passif issu de l’activité mentale, le Vide mystique ne résulte jamais d’un effort, on ne peut pas même le provoquer ; il s’établit soudain, sans qu’on le cherche, sans qu’on le désire. En conséquence les maîtres des disciplines les plus diverses, chrétiens, Indiens, musulmans et autres font dépendre ce vide de la grâce, pur don gratuit et indéterminé. En agissant, la grâce commence par précipiter qui la reçoit dans le vide ou ce que l’on appréhende comme tel lorsque l’agitation a pris fin. En effet la grâce est infiniment délicate, elle pénètre [18] de façon trop intime, trop silencieuse pour qu’on la décèle. Perçue ou conçue, elle n’aurait rien de suprême. Sens, mémoire, imagination, pensée, intuition ne peuvent l’appréhender ; mieux encore, dès que la grâce s’infuse dans les profondeurs du Soi, ces facultés se trouvent privées de leurs activités. N’éprouvant rien, on se croit vide :
« Si l’effort tendu vers une tâche, un devoir à accomplir est anéanti, l’ignorant imagine que lui aussi est réduit à rien. Il n’en est pas de même quant à la Réalité intériorisée, siège de l’omniscience : elle ne peut jamais être anéantie, puisqu’elle est la seule chose que l’on puisse percevoir » (Spandakārikā, I, 15-16).
Plus tard les effets de la grâce, devenus sensibles, se manifestent clairement.
À l’inverse de la vacuité d’ordre mental où l’on s’efforce de lâcher prise en vue de faire le vide, ici c’est le vide qui permet de lâcher prise : les plongées dans le vide, semblables à des morts répétées, dégagent de l’emprise du moi et des choses tandis que les liens tombent d’eux-mêmes. Par la voie d’indifférenciation, ce vide dynamique va anéantissant et consumant tout ce qui n’est pas l’essentiel ; il supprime la dualité moi et non-moi et livre accès à l’immensité et à la liberté.
S’il peut être qualifié de dynamique, c’est moins à cause de son pouvoir destructeur que de la vibration qui en forme le trait distinctif. Pas de vibration sans un vide préalable et pas de vide fécond sans vibrations. En effet, sitôt les mouvements grossiers disparus, la vibration se fait sentir.
Les mystiques vivantes non les spéculations sclérosées reconnaissent toutes l’importance de la vibration dans une expérience vécue, vibration signifiant toujours une certaine prise de conscience subtile qui permet de franchir les états de vacuité. Les çivaïtes du Cachemire la nomment spanda, sphurattā et en font la pierre angulaire de leur système. C’est aussi le zikr du cœur et de l’intime des sūfī, l’ébullition du pèlerin russe. Or, la vibration qui apparaît dès le début est très importante ; plus on avance dans la vie mystique et plus cette importance s’affirme. C’est au sommet de la vie spirituelle que nous conduit saint Jean de la Croix lorsqu’il compare l’Esprit-Saint à un feu d’amour pénétrant d’abord l’âme pour la purifier ; flamme destructive et douloureuse qui engendre le vide durant la Nuit spirituelle, elle prend ensuite l’aspect d’une « vive flamme d’amour » :
« Plus l’âme est purifiée dans sa substance et ses facultés… plus aussi la Substance divine l’absorbe d’une manière profonde, subtile et élevée dans sa divine flamme. Durant l’absorption de l’âme dans la Sagesse, l’Esprit-Saint met en mouvement les vibrations glorieuses [19] de sa flamme. L’âme resplendit au-dedans des Splendeurs de Dieu. Les mouvements de cette flamme divine sont des vibrations, des jets de flamme que l’âme transformée en flammes n’est pas seule à produire. Elle le fait conjointement à l’Esprit-Saint. »222.
Par cette vibration, le mystique échappe à l’écueil du vide stérile et passif, véritable piège pour qui manque d’ardeur et se refuse à sortir des limites de l’ego. Afin de rendre la conscience vibrante et, de ce fait, vigilante, certains maîtres sūfī accumulent des vibrations dans le cœur de leur disciple en remplissant son souffle d’une énergie qui, selon leur expression, « l’électrifie ». Le souffle vibrant se répand peu à peu dans le corps et, lorsque la personne est entièrement pénétrée de vibrations, elle est mûre pour la surconscience de l’éveil du Soi.
Notons enfin une autre différence fondamentale entre ce vide et le simple vide mental : il s’accompagne de plénitude, soit que plein et vide alternent, soit qu’ils coexistent, des vides de durée variable parsemant un fond ininterrompu de plénitude apaisée, ou inversement, un fond de vacuité se trouvant jalonné de moments de plénitude.
Outre le vide dû aux efforts de la concentration, il existe des vides mystiques, quiétudes inertes, bonnes en elles-mêmes parce que favorables au dépouillement de l’esprit, mais qui deviennent de dangereuses erreurs si l’on s’y attarde. De grands mystiques comme Ruysbroeck mettent en garde contre elles : il condamne ceux qui, repliés sur eux-mêmes, demeurent assis, immobiles et oisifs, pensant s’évanouir à eux-mêmes en s’enfonçant dans un repos naturel et dans un vide intérieur total :
« Ce repos n’est pas chose permise, dit-il, car il engendre en l’homme aveuglement et ignorance ainsi qu’un affaissement sur soi-même dans l’inaction. Une telle tranquillité est oubli de Dieu, de soi-même et de toutes choses… elle est exactement le contraire du repos surnaturel qui consiste à se fondre d’amour, avec un regard nu, dans l’incompréhensible Clarté. Et ce repos en Dieu, plein de recherche, plein d’ardeur — qu’on poursuit de plus en plus après l’avoir trouvé, dépasse le repos de la simple nature, autant que Dieu l’emporte sur toutes les créatures. »223.
La quête d’une paix toujours nouvelle n’est pas la stagnation dans un état que dénoncent aussi les bouddhistes chinois du Grand Véhicule [20] :
« Les Çrāvaka cultivent la vacuité, demeurent dans la vacuité et sont liés par elle. Ils cultivent la concentration, demeurent dans la concentration et sont liés par elle. Ils cultivent la tranquillité, demeurent dans la tranquillité et sont liés par elle… »224.
Les philosophes çivaîtes du Cachemire distinguent eux aussi deux sortes de vide : l’un çūnya, vide proprement dit, et l’autre anākhya « indicible », vide fécond entre tous.
Le premier vide, qui efface momentanément la dualité du corps et du monde extérieur, n’a pourtant rien d’un néant puisqu’il renferme des vestiges de la dualité, attachement au moi et aux êtres ou aux choses, dont on n’a pas connaissance en temps ordinaire parce que trop enfouis, mais qui émergent à certains moments difficiles. Est un adepte du vide (çūnyapramātri), nous le verrons, celui qui y demeure conscient. Par contre, un tel vide sera mort et stérile pour qui y perd toute conscience. Sur le plan cosmique, de même, le Sujet universel, conscient du Vide transcendant et total, a rompu sa relation avec l’univers diversifié, on le nomme en conséquence anāçritaçiva.
Le second vide, mais peut-on en toute rigueur le désigner ainsi ? c’est' l’indicible' qui constitue en dernière analyse l’essence indifférenciée de la Conscience ; bien qu’insaisissable, on ne peut le nier puisqu’on en a en quelque sorte conscience. Il correspond au Rien dynamique sur lequel je m’étendrai plus loin. Comme le vide précédent, il se présente à des niveaux différents de l’expérience mystique ; mais si la Réalité qui se dévoile à ces niveaux est la même, elle varie pourtant en intensité, en expansion, en libre spontanéité. Le monde, qui était ignoré et parfois repoussé dans le vide proprement dit, se trouve ici assimilé par la conscience dès que les vestiges de la dualité, notions erronées et attachements, ont disparu. Le yogin peut dès lors appréhender le monde tel qu’il est, en jouir, le conquérir puis s’en détacher. Sa certitude est absolue du fait qu’il adhère parfaitement au Réel, indicible et certitude (pramiti) se montrant toujours indissociables.
Abhinavagupta 225 ne s’intéresse qu’à « l’indicible » et considère avec méfiance le vide (çūnya) dont il connaît trop les pièges. Il refuse même de l’utiliser comme un moyen d’accès vers l’Indifférencié.
Cependant une ancienne école çivaïte, le Krama, lui accorde une certaine importance à condition de le dépasser, car s’il offre de réels dangers [21] pour qui, manquant de courage et d’audace, s’y enlise, il permet néanmoins de lâcher prise : le yogin ne se cramponne plus au moi ni aux choses, et découvre la tranquillité, l’absence de dispersion et un silence apaisé. Nous verrons aussi que la coagulation des doutes et des difficultés s’effectue dans ce vide et qu’il mène à la fonte propre au vide indicible.
En outre il se présente naturellement aux moments essentiels de la progression : le mystique ne peut en effet parvenir à un niveau supérieur sans quitter le niveau inférieur et, cette transition étant vécue comme un vide, il demeure plus ou moins inconscient entre un domaine dépassé et un autre non encore exploré qui s’instaure lentement, de nature plus subtile que le précédent, et que seule une intuition fine et bien exercée peut discerner. La pensée ne sait plus que penser, la volonté que désirer, le cœur qu’aimer, les facultés n’éprouvant donc que vacance.
À ces deux sortes de vide (çūnya et anākhya) président deux énergies divines opposées que nous allons envisager successivement : le vide passif se rattache à l’énergie divine de négation et d’exclusion (apohanaçakti) qui délimite l’Essence une et indéterminée ; le vide dynamique infiniment précieux, « l’indicible », relève de l’énergie accueillante, la grâce, qui unifie et fait fondre les différenciations. L’énergie d’exclusion écarte, repousse, nie (apoh) et engendre le vide en cachant la plénitude originelle : elle cristallise et exclut en cernant ou en traçant des limites là où « il n’y en a guère. Cette énergie, partout à l’œuvre dans les états de veille, de sommeil et dans les diverses vacuités, transforme la vibration consciente de haute fréquence le spanda en un mouvement ralenti, oscillant entre les deux pôles du sujet et de l’objet ; elle fait du grand souffle indifférencié de vie cosmique (prānana) le mouvement alternant, en constant déséquilibre, de l’inspiration et de l’expiration. La vibration naturellement apaisée n’est plus qu’agitation et l’homme, pris dans l’étau d’un déterminisme à double pôle, ne peut se fixer dans l’Un. Ainsi l’énergie d’exclusion détermine alternative et doute 226 : tout exclut tout, non seulement dans le temps, mais dans l’espace. Si la pensée dualisante propre à la veille se calme, les souffles s’équilibrent, s’unifient en un seul point et deviennent le souffle égal (samāna) de l’homme profondément endormi ou demeurant dans un vide mystique passif tel un cocon où s’arrête l’impact du monde ; mais, au sortir de ce vide, oscillation et [22] alternative réapparaissent sans avoir perdu leur emprise. Ainsi ce vide horizontal ne peut à lui seul donner accès à une réalité supérieure.
Un Tantra faisant allusion à l’énergie d’exclusion qui agit par cristallisation déclare :
« Celui qui apprend de la bouche d’un maître ou des livres sacrés ce que sont l’eau et la glace, n’a plus de devoir à accomplir, cette présente naissance sera pour lui la dernière. »227.
La Réalité est en effet comparable à une eau vive éternellement jaillissante que l’énergie coagulante transforme en glaçons. L’eau continue à couler, mais l’homme de désir, afin de s’en emparer, la transforme aussitôt en un morceau de glace, car son moi rend inerte tout ce qu’il touche. La grâce, au contraire, permet de percer entre les glaçons et d’atteindre l’eau vive en plongeant dans le vide ineffable, vide dynamique et vertical, par contraste avec le vide passif horizontal de l’énergie d’exclusion. À la grâce correspond un souffle différent, issu du samāna équilibre des forces en un point et nommé udāna parce qu’il s’élève tout droit. Ce « feu central » fait fondre les glaçons de la multiplicité en suscitant une vibration de plus en plus subtile dans les divers centres du corps, à mesure qu’il se creuse un passage vers le sommet du crâne.
La conscience fine et délicate, coulée vivante et non plus cristallisation stérile, recouvre sous l’influence de la grâce sa vibration initiale, spanda primordial ou Vie cosmique, dans laquelle tous les souffles ne forment qu’un. Au souffle udāna répond l’extase libre de notions (nirvikalpasamādhi) et le vide dynamique d’une paix lucide et consciente. Des profondeurs insondables de ce vide indicible l’acte jaillit comme une flèche, instantané, sans devenir et imprévisible parce que spontané.
Est qualifié de roi parmi les yogin l’être audacieux qui délaissant d’un coup tout support, se détournant des moyens qui lui servirent à faire le vide, ne s’attache pas même à Çiva conçu comme l’objet de sa contemplation. Il est tellement épris d’unité et d’absolu que, dans son élan fougueux vers Çiva, il écarte brusquement les altematives et se forant dans l’entre-deux un passage voie interstitielle ou indicible vide il se précipite dans le domaine du milieu (madhyamapada) qui n’est autre que sa propre essence, origine dont toute chose rayonne. [23]
Il s’y installe définitivement et, de là, il répand sur les extrêmes qu’il avait repoussé, la lumière resplendissante du Centre. Puis, Centre et extrêmes unifiés en une seule clarté s’évanouissent, la pensée illuminée s’effaçant devant l’indestructible lumière.
Le yogīndra jouit alors de la liberté absolue découverte au cœur de l’univers dès qu’il échappe à l’engrenage inexorable du temps et du déterminisme causal, vivant dans un instant éternel.
Ainsi quelques êtres d’exception n’ont pas à franchir laborieusement les vides étagés ou samādhi passifs ; non retenus par doutes et fluctuations, irrésistiblement attirés vers le Centre, ils s’élancent de vide indicible en vide indicible tant est grande leur impatience et parfaites leur foi et leur certitude.
Certains Chrétiens tel l’auteur du Nuage d’Inconnaissance préconisent la percée dans l’entre-deux. À un jeune ami qui, hésitant entre jeûne et nourriture, silence et conversation, solitude et compagnie, lui avait demandé conseil, ce maître anonyme répondait en espérant qu’il ne serait pas « assez ignorant pour se lier par des vœux contrefaits à de pareilles singularités », car, sous couleur d’une sainteté qui ne serait en fait qu’un « pieux esclavage », il n’y aurait là que « destruction définitive de cette liberté du Christ qui est le vêtement spirituel de la plus haute sainteté. . . ». [24]
Et voici quel était son enseignement :
« Lorsque tu vois que ces pratiques peuvent avoir un usage bon ou mauvais, je t’en prie, laisse-les toutes les deux, car c’est le mieux que tu puisses faire si tu veux rester doux et simple (meak). Et laisse aussi les considérations et la curiosité de ton esprit qui veut savoir laquelle est préférable. Mais agis plutôt ainsi : mets l’une dans une main et l’autre dans l’autre, et choisis quelque chose de caché entre les deux, et qui, une fois obtenu, te permettra, en toute liberté d’esprit, de te saisir de n’importe laquelle des deux, selon ton propre gré et sans encourir aucun blâme.
« Tu me demanderas alors ce qui est caché là, et je te répondrai : c’est Dieu Dieu pour qui tu dois te taire s’il te faut te taire ; pour qui tu dois parler s’il te faut parler ; pour qui tu dois jeûner s’il te faut jeûner et manger s’il te faut manger.., et ainsi de suite… Car le silence n’est pas Dieu et la parole n’est pas Dieu… et il en est de même pour toutes ces paires d’opposés. Dieu est caché entre les deux, et aucune opération de ton âme ne peut le trouver, mais seulement l’amour de ton cœur. »228.
Ce choix de Dieu, réalisé en écartant les extrêmes pour passer entre eux, se fait à l’aide du trait acéré et aveugle d’un amour ardent, lequel ne manque jamais son but. Puis, quand on a découvert Dieu dans l’entre-deux, on le découvre dans les extrêmes ; que l’on jeûne ou mange, peu importe, la plénitude ne varie guère : « Choisis-le donc et tu parleras tout en gardant le silence, tu seras silencieux tout en parlant ; tu mangeras tout en jeûnant et tu jeûneras tout en mangeant et ainsi de suite. » Tel est aussi le sens de la « voie du milieu » enseignée par les Bouddhistes Mahāyāna : « ne pas s’attacher à la vacuité et ne pas saisir la non-vacuité, voilà l’illumination subite ». La vérité du chemin du milieu c’est seulement, d’après Chen-Houei, voir l’absence de pensée229.
Mais par-delà encore, dès que les extrêmes être et non-être, vue interne et vue externe sont à jamais abolies, le chemin du milieu, lui aussi, disparaît : l’esprit n’étant plus prisonnier ni de la quiétude, ni de la distraction n’est que vacuité. En l’absence de pensées erronées, l’Éveil à son tour s’évanouit. C’est à cela que nous reconnaissons notre esprit propre, c’est là l’égalité d’esprit ultime (samatā).
Alors le mystique « plongé dans une quiétude constante, atteint l’immense, l’illimité, le permanent et l’immuable. Pourquoi cela ? À cause du caractère insaisissable de la pure substance de notre nature propre… »230.
Ces modalités du vide une fois définies, voyons comment on peut caractériser les diverses vacuités qui jalonnent l’itinéraire mystique.
Ruysbroeck distingue trois degrés élevés de la rencontre divine : le premier degré est un repos d’amour pur et essentiel. Le second, un sommeil en Dieu lorsque l’esprit se perd lui-même sans savoir ni qui, ni où, ni comment. Le dernier degré dont on peut encore parler, celui où l’esprit mort et éperdu plonge dans la ténèbre, un avec Dieu sans différence ni distinction, c’est la profondeur de l’abîme dans lequel il doit mourir en béatitude et revivre en vertus, c’est à dire actif dans la vie ordinaire, accomplissant spontanément ce que Dieu veut et comme il le veut231.
Suivant un plan analogue, mais en envisageant le vide par rapport aux niveaux de conscience et d’inconscience, j’étudierai d’abord les vides du dénuement, associés à la conscience ou à une demi-conscience ; puis [25] les vides totalement inconscients qui mènent au Rien ; enfin le Rien et son efficace, c’est-à-dire, sur un fond permanent d’inconscience, connaissance et activité revenues, mais transfigurées.
Ce vide s’établit en trois étapes : détachement apaisé à l’égard du monde et du moi la conscience se vide de son contenu habituel ; « coagulation » des doutes qui purifie la subconscience ; nuit spirituelle qui s’attaque au « sentiment et à la connaissance nue de l’être propre », l’ego s’effaçant à son tour.
En ce premier vide, le Soi est saisi dans son intimité apaisée ; le cœur repose dans la douceur d’un calme vide et silencieux ; les préoccupations s’évanouissent comme par magie ; on y jouit sans se lasser de la simplicité de sa nature, de l’essence nue de son être. On y est conscient, mais sans faire acte de conscience.
Les bouddhistes désignent par le terme dhyāna « la quiétude foncière et l’absence d’activité mentale » et la considèrent comme le « véritable samādhi de l’esprit » par contraste avec « la concentration du moi (intéressé) » 232 où subsistent effort et activité mentale. Par suite de cette concentration (samādhi), il n’y a plus de distinctions (vikalpa). Vacuité et quiétude originelles : voilà l’illumination subite233.
En effet, c’est en ce vide que le mystique s’exerce inconsciemment à une appréhension subtile, son intuition devient ténue, délicate, la fine pointe de son esprit s’aiguise et il parvient à s’emparer de l’acte jaillissant et à vivre l’instant à mesure qu’il surgit. Plus tard, ce même vide s’approfondit au point de permettre un « agir sans agir » dès qu’attachements et artifices ont disparu.
Les mystiques comparent cette phase au sommeil, yoganidrā des Indiens, état crépusculaire entre l’agitation de la veille et l’inconscience du sommeil sans rêves. Bien qu’exempt de pensée (nirvikalpa) on ne doit pas le confondre avec l’extase sans pensée dualisante à laquelle d’ailleurs il peut conduire lors de l’illumination de la Conscience. [26]
Le yogin plongé en ce sommeil, ayant tout oublié, jouit d’un état que les Upanishad décrivent comme la gaine de félicité. C’est probablement à cette même félicité qualifiée de totale (nirānanda) que fait allusion Abhinavagupta : elle apparaît dans le vide au moment de l’arrêt complet du souffle234.
Tantôt surnage seule une connaissance obscure se détachant sur un fond de vacuité, tantôt une impression d’activité si connaissance et désir se sont évanouis. Les uns n’éprouvent aucun sentiment agréable. Les autres ressentent un plaisir qui dépend du souffle devenu égal au moment où inspiration et expiration s’apaisent dans la vacuité du cœur, hors d’atteinte des sens et de la pensée. Généralement, corps et monde extérieur demeurent à peine perceptibles, à l’arrière-plan.
L’auteur du Nuage d’Inconnaissance dans son Épître à la direction intime (ch. VI) conseille de n’éprouver aucune confusion à s’endormir dans une aveugle considération de Dieu tel qu’il est, puis il ajoute :
« Et c’est à juste titre que l’on compare cette œuvre au sommeil, car de même que, dans le sommeil, cesse l’usage des sens corporels afin que le corps puisse se reposer en nourrissant et fortifiant la nature corporelle ; de même, dans le sommeil spirituel, les vaines recherches de nos esprits égarés, les raisons imaginaires, sont tout à fait paralysées et réduites à néant, afin que l’âme simple puisse dormir doucement et se reposer dans la contemplation aimante de Dieu tel qu’il est, en nourrissant et fortifiant pleinement la nature spirituelle. »235.
Sainte Thérèse d’Ávila appelle un tel repos' sommeil des puissances' :
« Je dis sommeil, écrit-elle, parce qu’il semble, en effet, que… l’âme est comme endormie ; elle ne dort pas complètement et elle ne se sent pas non plus éveillée. »236.
Les taoïstes aussi font grand cas de la paix dans le vide, état indéfinissable où l’on arrive à s’établir. Quelqu’un demanda à Lie-tzeu :
« Pourquoi tenez-vous le vide en si haute estime ? Le vide, répondit Lie-tzeu, ne peut être estimé pour lui-même, mais pour la paix qu’on y trouve… Si l’on veut être sans nom, rien ne vaut le silence, rien ne vaut le vide. Par le silence on atteint ses demeures. Mais celui qui prend, celui qui donne perd ses demeures » (ch. I).
Et Tchoang-tzeu disait que pour se laisser aller au fil de l’évolution universelle et devenir un vrai sage, il suffisait d’oublier les êtres, d’oublier [27] le Ciel, de s’oublier soi-même. Par cet universel oubli, l’homme s’identifie au Ciel (ch. XII).
De façon concise, les maîtres taoïstes dégagent les traits distinctifs de ce premier vide : paix, silence, découverte de ses propres assises et oubli s’étendant à tout.
Voici maintenant quelques témoignages modernes à ce sujet :
« Durant quelques années j’ai vécu dans un état crépusculaire : effacées les modalités ordinaires de la conscience : impressions sensorielles, désirs, images, souvenirs. Ma pensée ne fonctionnait guère. Si une idée même insignifiante se présentait, elle m’accablait d’un poids insupportable. J’avais perdu tout intérêt à l’égard de mon corps et de mon entourage. Je demeurais des heures sans bouger, sans cligner des paupières, savourant chaque seconde à la fois, sans me soucier ni du passé ni de l’avenir ; j’étais infiniment heureux et ne faisais jamais aucun projet, moi précédemment si actif et incapable de rester un seul moment tranquille. Je gardais juste assez de conscience pour effectuer les tâches immédiates et indispensables, mais de façon automatique et lente, dans l’oubli perpétuel et une grande vacance.
Je n’entrais pas dans ce vide de temps à autre, j’y vivais, tout en côtoyant sans cesse la plénitude, car m’enfonçant soudain dans un vide plus profond, j’émergeais dans la plénitude, vide et plénitude constituant un cycle déterminé.
Je me mouvais comme en un rêve, dans un univers ouaté, estompé, errant pendant des heures, marchant très vite ou très lentement, voyant sans voir et à quelques pas devant moi, juste ce qu’il fallait pour éviter l’obstacle, mais sans reconnaître les passants ni pouvoir formuler une parole. La conscience qui surnageait en ces états variait selon les heures : tantôt je ne percevais que ma propre respiration si légère dont la douceur m’enchantait. Le plus souvent j’éprouvais une vibration continue procédant du cœur. À d’autres moments j’avais l’impression de flotter, allégée de tout poids, dans une immensité sans limites. Vacuités légères, transparentes… vacuité opaque, vacuités à perspectives infinies qui amènent la conscience à se dilater divinement.
Tantôt n’affleurait en ce vide qu’une impression ténue de félicité dont je ne pouvais dire si elle était continue ou sujette à interruption. Tantôt s’imposait uniquement une conscience uniforme dégagée de toute spécification, celle de mon immuable essence. »
Après ce récit d’ordre général, portant sur une expérience de longue durée, voici des exemples d’approfondissement du vide au cours de moments d’absorption, tels qu’une autre personne les rapporte :
« Juin. Je prends conscience d’un feston de petites pensées légères qui frémit sur le bord de ce fond de grand vide. Je prends conscience au-dessous : c’est un frissonnement de jubilation impalpable. Je regarde plus profond encore : fine, à peine perceptible, mais puissante, vibration [28] au tréfonds du cœur. C’est elle la source. (J’ai pris conscience dans le but de répondre à votre question, normalement je serais restée dans un vécu direct sans ces prises de conscience qui toutefois, le vide étant bien établi, n’ont rien dérangé. Elles-mêmes sont d’ailleurs fines et subtiles, et surtout comment dire ? Elles n’engagent pas l’ego : elles fusent et retombent sans le provoquer à réaction, car il dort d’un grand sommeil peut-être est-ce cela le fond de grand vide : le sommeil de l’ego qui entraîne la disparition de son champ habituel.)
« Juillet. Je m’abandonne au vide qui fait le désert autour de moi : plus de jardin ni de soleil… qui fait le désert en moi : plus de perception, pas même cette quête obstinée… qui fait un désert de moi, immensément, longuement. Mais voici que le vide s’est mué en félicité : au centre, au cœur de l’immense, quelque chose palpite et irradie, alors, peu à peu, presque insensiblement, tout mon être, si vide que je ne le sentais plus, se trouve envahi de paix, de joie et de douceur, le corps lui-même éprouve un bien-être souverain. En fait « paix », « joie » sont des aspects que j’isole, pour les besoins du langage, d’une totalité insécable, ce ne sont que des images d’approche, car l’impression est spécifique, indicible et foncièrement une.
« Printemps 1968. Pendant une grande partie de la nuit, samadhi d’une texture toute nouvelle et d’une ineffable délicatesse. Comme à chaque nouvelle étape, le vide change de qualité ou ce qu’on prend pour le' vide “, c’est-à-dire un vidage de tout l’humain ou ce qu’on prend, à chaque nouvelle étape, pour « tout » l’humain. Plus ce vide se creuse, plus ce qu’il révèle est beau, inouï. Chaque fois c’est inattendu. Chaque fois c’est une merveille plus grande qui apparaît comme l’ultime vérité, l’ultime félicité. J’en prends une fine conscience qui pourrait ne pas avoir lieu, et par moments je prends une légère conscience de l’anéantissement, point trop, car si cette dernière durait ou se précisait, la félicité risquerait de s’atténuer. »
Remarquons au passage cette expérience assez peu fréquente de plénitude et d’anéantissement simultanés.
Une sensation de vertige accompagne souvent les états de vide ; elle peut même atteindre une grande intensité :
« Hier soir, dans mon lit, impression fantastique de vertige, comme si j’étais lancée en tous sens pendant une ou plusieurs minutes, violemment. Plus aucun point d’appui ni de référence : on ne sait plus si l’on a la tête en haut ou en bas ni s’il y a des côtés. À cette impression assez effrayante, je me suis abandonnée avec confiance, car j’ai compris de suite qu’elle était d’ordre mystique. »
On pourrait insister sur la plénitude de ces apaisements, pourtant leur valeur dépend du vide de plus en plus profond qu’ils comportent ; ce vide, en effet, non seulement permet l’éveil et ouvre la voie à la plénitude, mais il joue aussi un rôle de transformation radicale bien que [29] progressive, qui concerne la personne entière. Là, et uniquement là, tout se défait, tout change, là de nouveaux germes sont semés, croissent et s’épanouissent. Vacuité et subtilité s’approfondissent simultanément.
Dès le début, la pensée est touchée : préjugés, erreurs, étroitesses tombent ; une ample vision unifiée de l’homme et de l’univers se fait jour, se précise, supprimant angoisse et confusion. Plus tard, cette connaissance elle-même, intuitive certes, mais encore à double pôle, s’effacera à son tour devant la pure révélation du Soi, qui comble l’esprit plus qu’aucune connaissance ne peut le faire.
Sur le plan du cœur, la sensibilité et l’intuition s’affinent, les sentiments se décantent ; la passion ardente, la jalousie à l’égard de l’être aimé, le besoin de possession se calment et font place à une tendresse affectueuse où subsiste un certain attachement. Puis, lorsque les résidus du sentiment sensible et égoïste ont disparu, le sentiment qui demeure est si profond que le mystique en est à peine conscient ; il chérit l’aimé plus que lui-même puisque, sans hésitation, il se sacrifie pour lui. À ce stade il ne sent plus son amour, il ne le proclame plus, mais ses actes en portent témoignage. L’amour véritable commence ici, dans l’oubli du moi et de l’autre : plus de retour sur soi, plus d’objet séparé ; identifié à l’aimé, comment pourrait-il dire « j’aime » ? Comment pourrait-il penser à celui qui réside dans l’intime de son être, se confond à sa substance ? Alors, que l’aimé vive ou meure, qu’importe ! Ainsi le cœur est vraiment vide, il n’a plus ni passion, ni émotion, ni attachement. Quelque chose qui ressemble à l’amour le remplit, ou plutôt il n’est plus qu’amour.
Sur le plan de la volonté, il se passe une évolution parallèle à celle du cœur. La volonté n’est plus tendue vers ses satisfactions habituelles et cesse d’osciller sans fin entre prendre et rejeter ; elle s’assouplit et se dégage, orientée vers un seul but, obscur il est vrai. La vacuité porte ici sur l’intentionnalité, ce que l’Inde appelle arthakrijākāritva, ou « préoccupation prévoyante » de Heidegger, c’est-à-dire la préoccupation de l’homme pour son individualité en tant que telle. L’ego une fois éliminé, le Je profond se dévoile, libre des tourments vis-à-vis de soi et des autres, caractéristiques de l’ego.
Ainsi, l’attitude générale à l’égard de la vie se modifie, mais pour que pensée, cœur, volonté, activité soient réellement purifiés, il faut que le vide, s’étendant aux couches du subconscient, recéleur des conditionnements auxquels nous obéissons d’ordinaire, opère (après une phase d’affleurement au niveau conscient) leur dénouement puis leur effacement, selon un processus que je nommerai « coagulation », en empruntant ce terme à l’école çivaîte Krama. Peu de mystiques échappent à ce travail [30] dramatique et douloureux. Le vide spontané présente en effet deux pôles de coloration opposée : l’un, qui vient d’être envisagé, tend vers la félicité ; aussitôt les préoccupations disparues, les tendances fusionnent dans un bonheur apaisé et très pur où l’on se sent léger et libre ; l’autre, dont l’étude va suivre, s’accompagne d’un sentiment d’abolition, ayant pour tonalité angoisse et tension pour la première phase, et désespoir implacable pour la seconde. L’ego est alors en travail.
Le système Krama fait allusion à la coagulation dans ses hymnes à la déesse Kālî 237 et la désigne par le terme rodhana. Lorsque le yogin pénètre dans le vide, il est à son insu la proie de tendances et vestiges obscurs et sans objet, ensemble de craintes, de doutes, d’habitudes de penser, d’attachements sournois, ainsi que des impressions subtiles déposées par les événements passés. Ces résidus inconscients, imprégnations (vāsanā et samskāra) constituent des obstacles épars et informes auxquels le yogin ne peut s’attaquer ni durant la veille, où son activité trop tendue ou trop dispersée les recouvre, ni durant le sommeil sans rêve, faute d’une attention vigilante, ni non plus durant les rêves, où la coagulation s’effectue, mais partiellement et de façon fugace, sans la prise de conscience qui facilite le dénouement des nœuds. Même dans les états mystiques conscients et apaisés, il ne consent pas à coaguler ses doutes et à faire face à ses difficultés de peur de retomber dans le devenir et ses soucis. En conséquence, sorti de l’absorption paisible, il redevient esclave de ses habitudes et ne progresse pas. C’est donc uniquement dans un vide spécifique, à demi conscient et comparable au sommeil, que les résidus prendront consistance, et pour celui-là seul qui vit dans la quiétude et qui a un maître averti. Étant donné le désencombrement des tendances grossières de la veille, quand pensées, distractions, sentiments s’atténuent, la coagulation peut se faire. Alors les doutes et les problèmes se réveillent et sont dragués jusqu’à la surface en vue de les mieux détruire. Le yogin coagule l’ensemble des résidus sur un point vital : jalousie, peur de la mort, etc., où son être tout entier se ramasse dans la lutte, bloqué avec intensité sur un seul doute devenu une véritable obsession.
Signalons ici plusieurs dangers : s’il n’a pas de maître, les forces inconscientes qu’il éveille peuvent le dépasser ; si, d’autre part, la coagulation dure indéfiniment, il n’échappe plus à la vacuité, le bloc forme [31] un obstacle invincible et, l’élan se trouvant brisé, le yogin s’enlise dans un vide stérile chaque fois qu’il se concentre ; ou encore, si la fonte s’effectue avant que la coagulation ne soit achevée, des cristallisations demeurent et le yogin devra recommencer, en des circonstances souvent défavorables.
C’est donc au moment précis où la coagulation atteint sa maturité que la fonte doit se produire spontanément. Avec un bon maître, coagulation et fonte se succèdent sans arrêt : le disciple concrétise doutes, alternatives, en fait un bloc, et dès que celui-ci a fondu, l’élan se renouvelle, la vie s’écoule librement et un grand progrès a lieu. Puis il recommence, mais à un niveau plus profond et plus subtil jusqu’à ce que son subconscient soit entièrement purifié.
Pour faire fondre l’obstacle des doutes, et par un vide devenu vibrant parvenir au vide indicible, il faut, d’après un texte sacré, l’élan aveugle d’un tourbillon (bhramavega) sans aucune discrimination, l’adepte portant à son paroxysme toute son énergie en vue de la ranimer et de la faire vibrer. Si la pensée surgit, la fonte sera interrompue.
Le système Krama 238 préconise de son côté de méditer sur la roue des énergies qui a pour moyeu le Cœur ou le Soi, Centre à partir duquel elle se meut très vite en tourbillonnant et se déploie en plusieurs cercles : pensée et organes sensoriels pour parvenir à la périphérie où le mouvement ralentit. Puis à nouveau s’effectue le retour vers le centre, à mesure que la vibration recouvre sa haute fréquence. Le déploiement correspond à la coagulation des alternatives, le reploiement à leur fonte. Afin de détruire les traces inconscientes et résidus de l’objectivité, l’adepte doit évoquer la roue sous son aspect grossier, c’est-à-dire tirer vers l’extérieur, ou la périphérie, les ultimes obstacles pour qu’ils se manifestent en toute leur puissance. Lorsqu’il en a pris une claire conscience, la roue, dans sa rotation de plus en plus rapide, entraîne les résidus vers le centre et les dissout. Le méditant ne perçoit plus alors ni objets, ni connaissances, le mouvement même semblant aboli tant la roue tourne vite, les différenciations happées par le Centre le Soi parfaitement révélé. La fonte achevée, le mystique pénètre en une fraction de seconde dans le Vide indicible.
Ce processus de coagulation et de fonte (rodhana et dravana de l’école Krama) est connu également du Bouddhisme Mahāyāna, qui le transmit par l’intermédiaire des Chinois aux maîtres du Zen ; il prit alors la forme du koan. [32]
Lorsque la coagulation est déjà bien avancée, s’étant effectuée sur des obstacles particuliers, le mystique n’est plus arrêté par aucune entrave détectable ; son être maintenant unifié et purgé, ne se présente plus qu’un empêchement : cet être même. Alors une nouvelle et demière coagulation reste à faire.
N’est-ce pas à cela que fait allusion l’auteur du Nuage d’Inconnaissance quand il recommande de se livrer constamment à la considération et à la contemplation aveugle du péché ramassé en un bloc, sans examiner tel ou tel péché en particulier ?
“... tu dois toujours sentir le péché comme une masse horrible et fétide, tu ne sais quoi, entre toi et ton Dieu ; et cette masse n’est autre que toi-même. Et tu dois considérer qu’elle est unie et congelée avec la substance de ton être, pour ainsi dire sans distinction » (ch. 43).
L’évocation du péché où le moi apparaît comme une charge pesante doit être ininterrompue, ainsi que la désolation spirituelle qui l’accompagne et dont dépend l’oubli de soi et de toutes les créatures :
« Si le sentiment et la connaissance nue de ton être propre étaient détruits, tous les autres obstacles le seraient du même coup » 239 (ch. 44).
La parfaite affliction spirituelle est donc pour le mystique « de savoir et de sentir non seulement ce qu’il est, mais (bien) qu’il est » 240 (ch. 44).
Il faut alors « une très grande tranquillité et une disposition, tant du corps que de l’âme, tout à fait saine et pure » (ch. 41), et le cri inlassable : « péché, péché ! » est « d’autant meilleur qu’il reste dans le pur esprit, sans aucune pensée particulière et sans être prononcé » (ch. 40).
La vigilance centrée sur l’oubli de soi-même et dans le désir de perdre le sentiment de sa propre existence doit se faire dans une sorte de vide ensommeillé et non dans la tension du corps et de l’esprit : « demeure assis tranquillement comme pour dormir, tout absorbé et plongé dans l’affliction » (ch. 44).
Ici comme dans le système Krama, semble-t-il, la coagulation est soumise à plusieurs conditions : elle doit d’abord s’effectuer dans le vide, pensée et sentiments habituels étant supprimés afin d’être mieux saisis en leur source ; quand toute manière de connaissance et de sentiment à l’égard des créatures a disparu, « l’œuvre » 241 que veut ce livre – [33] ébranlement soudain, élan nu et pur qui jaillit avec force vers Dieu s’accomplit dans l’oubli de soi et d’autrui, et dans le dégoût de tout ce qui n’est pas Dieu.
C’est donc « un aveugle élan d’amour » qui délivre du péché le pesant fardeau de soi-même obstacle à l’union définitive ; élan aveugle, car s’il était clair il relèverait de la pensée discursive, et lucide, il se confondrait avec l’extase ou vide indicible des çivaïtes.
Lorsque l’affliction s’intensifie au point de s’attaquer au « sentiment de l’être nu », elle se confond avec les tourments de la nuit mystique.
Certains êtres n’ayant nul besoin de coaguler le doute vont directement de la félicité apaisée à la vacuité qui consume comme un feu dévorant. Comme ils n’ont pas perdu leur calme impassible, le vide leur semble d’autant plus pénible à supporter : en effet, ce qui était repos dans la plénitude devient immobilité dans un vide sans fond où ne règnent que nausée, impuissance et silence implacable. Tant que les pensées déferlent en une course éperdue, aucune joie, aucune douleur ne vous atteignent vraiment, de multiples distractions vous en tirent sans répit. Mais dès que l’on entre dans ce vide et son dénuement, ne peuvent subsister que bonheur parfait ou nuit de la mort.
Une grave erreur serait de confondre ce vide avec un retour à l’état normal précédant la découverte de l’intériorité, ce qui causerait seulement une détresse ordinaire. Le vide qui s’agrandit d’un coup et engloutit tout est d’une autre nature, il vous laisse désemparé, suspendu entre deux univers : l’un le monde que l’on a depuis longtemps quitté, l’autre, ce domaine illimité et obscur où l’on avance à tâtons, sans comprendre. Phase essentielle dans un total dépouillement intérieur, il dure de longs mois et même des années, c’est le « deshacimiento », « défaisance » de l’ego, purification passive si bien décrite par saint Jean de la Croix dans la Nuit obscure.
Si l’on ne peut en donner la moindre idée à qui ne l’a pas traversée, on peut essayer de déterminer son champ de mort : l’anéantissement n’épargne rien, le monde entier n’offre aucun intérêt, il semble vide, plus même il se défait en une constante annihilation contre laquelle on ne peut se défendre. Nul plaisir des sens ne vous attire, ni la musique ni la poésie tant aimées, ni les plus beaux paysages ; soucis et maladies vous laissent indiiférent. On n’aspire qu’à la mort.
Les facultés unifiées dans la paix à l’étape précédente sont désormais [34] paralysées ; elles ne veulent ni ne peuvent fonctionner, toutes également touchées et au même moment : mémoire, imagination, pensée se vident, d’où un oubli rongeant ; les idées se font rares et traînantes et l’on est comme précipité dans un gouffre dans lequel on perd pied sans pouvoir se raccrocher à l’armature protectrice des notions et des habitudes mentales. Le cœur est aride, sentiments et désirs le quittent. La volonté ne veut qu’une seule chose qui lui échappe et dont elle ne sait rien. Incapable d’accorder un regard à quoi que ce soit, on se sent dénué de tout, faible et inintelligent, égaré dans d’épaisses et lourdes ténèbres. Le moi se prend en dégoût. Mais ce sentiment d’indignité n’est pourtant pas d’ordre moral, car il ne s’y mêle aucune culpabilité ; plus profond encore, il tient à l’être même.
C’est ainsi que le mystique est dépouillé de toutes manières de comprendre et d’aimer, dans l’unité d’une profonde vacuité et dans la certitude du néant, un néant qui le mine sans répit ; il ne peut qu’attendre sans le moindre allégement, solitaire et indifférent, dans l’ennui et la misère intérieure.
Ce vide spécifiquement mystique, au cours duquel l’homme traverse la nuit spirituelle et supporte la destruction de son moi sans être lui-même détruit, doit se distinguer de cas en apparence voisins, mais en fait opposés. D’abord le vide intérieur du faux sage d’occident, vu à travers la littérature moderne ne relève même pas de l’annihilation de l’ego ; le moi exalté se défend et se drape dans son expérience d’absurdité, d’où une attitude cynique et sceptique. Les nuits, dont romans et essais contemporains 242 offrent des exemples, ne correspondent en aucune manière à la réalité que vit le mystique. Celui-ci n’a pas de lutte, d’angoisse, de doute, il est tellement au-delà ; il ne cultive ni n’exploite sa douleur bien que pas une seconde il n’y échappe. La vie ordinaire continue pour lui sans que ses amis s’aperçoivent de rien, car il ne paraît pas abattu ; il garde un sens de l’humour toujours prêt à fuser, à la façon d’un condamné à mort qui plaisante en dépit de son désespoir.
En second lieu, et ce cas illustre les graves dangers auxquels s’expose la destruction de l’ego, l’expérience spirituelle peut avorter si le processus s’arrête à mi-chemin. Que la première étape de pacification n’ait pas été assez poussée, et le mystique stagne dans le vide ; s’il n’a pas un maître capable de l’en tirer, il lutte alors pour rattraper ce qui lui échappe, d’où un état de vide terne et sans issue. [35]
Enfin la mélancolie offre un cas d’altération pathologique de l’ego qui peut, de l’extérieur, prêter à confusion avec la véritable nuit spirituelle. Pour le mélancolique tout s’effondre, y compris ses forces physiques ; dans une complète asthénie, la pensée ralentie, immobile et figé, il se concentre sur sa douleur et ressasse son indignité. Il se sent éminemment coupable, car il a perdu l’estime de soi en cela son ego n’est pas anéanti, mais dévalorisé, d’où l’aspect dramatique et spectaculaire de son deuil. Le temps arrêté, rien d’heureux ne peut plus se passer pour lui. Il reporte rétrospectivement son état actuel dans le passé et annule tout ce qu’il y avait de positif dans sa vie ; il n’y voit rien de bon, persuadé qu’il a toujours été coupable et malheureux. Le suicide que certains de ces malades commettent, loin de réaliser le dépouillement de l’ego, constitue l’acte égoïque suprême, une autopunition intense.
Le mystique au contraire a eu précédemment une longue expérience fondamentale de paix, de plénitude et de repos complet ; il possède la stabilité, ses tendances sont unifiées. Il sait qu’il a eu autre chose et se souvient, quoiqu’il ne puisse imaginer son bonheur passé. Même submergé par le sentiment de sa propre indignité, il ne doute pas, ne vacille pas. D’autre part, ce qu’il a perdu n’est pas l’estime de soi, c’est le divin, et tout au long de la nuit il reste branché, aimanté sur la Réalité éprouvée auparavant et qui n’a pas vraiment disparu bien qu’il se sente douloureusement privé de contact avec elle. Impuissant il assiste à la mort du moi, sans drame, sans autopunition, sans jamais se complaire à sa douleur. Il ne souffre d’aucun épuisement, ni d’asthénie, ni d’insomnies, s’adonnant sans goût à une activité normale.
Une autre différence est à noter : à l’inverse de ce qui se passe chez le mélancolique, le mystique, une fois la nuit achevée, découvre une plus grande plénitude, le calme est plus profond, le détachement plus complet. Il conserve le souvenir précis de cette vacuité et reconnaît combien elle lui fut précieuse ; comprenant son sens et sa valeur, volontiers il y retournerait : sans elle pas de mort totale à soi-même ni de véritable plénitude. Il faut être vidé de l’accessoire multiple pour être rempli de l’unique essentiel. Mais cet essentiel, on ne peut le reconnaître au début parce que trop délicat, insolite, et indifférencié ; on éprouve donc seulement le vide qu’il creuse afin de s’y loger.
Précisons enfin que pour le mystique, c’est le maître qui, sous l’influence de la grâce, précipite à un certain moment son disciple dans le vide et la nuit, et lui encore qui l’en tire dès que le vide a fait son œuvre ; il veille sur lui, inaccessible et silencieux, sachant combien cette phase importante comporte de dangers. [36]
Un tel détachement n’est pas à la portée de l’homme sans une intervention directe de Dieu ; lui seul, soutient Tauler, peut purifier l’esprit créé en l’arrachant à tout ce qui n’est pas l’absolue ténèbre et en le transportant au-dessus de l’être jusque dans l’Esprit incréé de Dieu. Au chemin lumineux Tauler oppose ainsi le chemin obscur des épreuves :
« Les hommes qui sont conduits par ce chemin ne doivent rien boire qui puisse produire en eux une ivresse, comme c’est le cas de ceux dont nous venons de décrire la joie… (Ils) sont mis et poussés sur un étroit chemin, où tout est sombre et sans consolation, où ils ressentent un insupportable tourment, et qu’ils ne peuvent pourtant point quitter. De quelque côté qu’ils se tournent, ils ne trouvent que profonde misère, désert, désolation, ténèbre. C’est là qu’ils doivent entrer et s’abandonner au Seigneur sur ce chemin aussi longtemps qu’il lui plaît. Et enfin le Seigneur fait comme s’il ne savait rien de leur tourment : c’est une insupportable indigence et un profond délaissement, et pourtant ils doivent s’y abandonner… »
Il dit encore : « Ces hommes sont dans la plus vraie, la plus profonde pauvreté, et dans un complet renoncement à eux-mêmes. Ils ne veulent, ils n’ont, ils ne désirent rien d’autre que Dieu et rien de ce qui concerne leurs nécessités personnelles. Il leur arrive souvent de travailler dans la nuit, c’est-à-dire dans l’abandon, dans la pauvreté, dans d’épaisses et lourdes ténèbres, dans l’absence de toute consolation, si bien qu’ils ne trouvent aucun appui, qu’ils ne rencontrent ni ne goûtent aucune lumière, aucune chaleur. »243.
Ruysbroeck décrivant, dans le Livre de la plus haute vérité (ch. VII), le terrible mal et la sombre misère de l’homme à qui Dieu se cache, insiste sur la liberté et l’égalité d’esprit que confère la Nuit. Si l’homme abandonne librement, et sans tristesse de cœur, sa volonté propre et laisse faire Dieu, le ciel remplira bientôt pour lui l’enfer. Alors, que la balance de l’Amour monte ou s’abaisse, tout désormais lui semblera égal et il demeurera toujours libre et impassible.
Au sortir de la nuit, l’âme est établie en une telle paix qu’elle est comme silencieuse et endormie. Elle jouit de plus en plus souvent de précieuses inconsciences échelonnées tout au long de l’itinéraire mystique et qui peuvent durer de quelques secondes à plusieurs heures.
On ne doit pas les confondre avec le sommeil sans rêve ni le sommeil [37] spirituel (yoganidrā) : il arrive que, les yeux ouverts, on garde l’attitude inconfortable de l’instant où l’inconscience vous a surpris : debout, le verre aux lèvres par exemple. Un vacarme qui vous tirerait du sommeil ne peut vous rendre à la conscience ordinaire. Quelques minutes de cette inconscience reposent mieux qu’une nuit d’un profond sommeil.
Le vide porte sur une suppression totale de la conscience normale et du sentiment de notre propre existence. La pensée s’est tue, la conscience et la félicité mystiques des débuts se sont endormies ; quelque chose dont on ne sait rien, mais plus subtil et plus large a pris leur place ; une énergie spécifique flue spontanément sans faire retour sur elle-même, ni se diviser en un sujet et un objet. Plus de durée vécue, tout se passe à un autre niveau. Le mystique perd le sentiment du temps écoulé, ne sachant si le vide a duré une seconde ou quelques heures, tandis que dans le sommeil il conserve un sens approximatif du temps. Autre chose à noter : avant de revenir à la conscience normale, il parcourt des stratifications celles de ses expériences mystiques antérieures lui permettant d’évaluer de quelles profondeurs il remonte. Mais il ne se souvient pas clairement de ce qui précéda ce retour, l’acte de mémoire ne pouvant s’effectuer dans un tel vide.
Sur ce retour je livre un témoignage moderne :
« L’absence de tout Avant, et la conscience pure de là.
Le vide absolu où vibrait cette pure présence de rien.
En ce vide le bondissement retenu
l’étonnement fasciné par l’arrêt du temps
l’immobilité mi-close de l’étonnement
l’absence annulant l’étonnement de l’absence qui pourtant s’y love.
Conscience de rien.
L’oubli de moi, la conscience annulante de cet oubli
la joie sans fond de cette annulation
la stupéfaction de la joie
l’annulation intensifiante de cette stupéfaction par son identité à l’évidence et la dissolution incessante de cette annulation, de cette stupéfaction, de cette joie, de cet oubli dans le jaillissement perpétuellement immobile d’être là.
Pur de tout passé, vierge même de la conscience de cette pureté, absolument arrivant ici.
Mais d’où ?
La question à peine effleurant la fluidité la fit trembler et ébranla le temps.
En un rien de temps, le temps de maintenant, celui de l’écriture, une distance infinie se détendit à partir d’un asymptotique zéro et [38] je touchai la première escale à peine un léger choc, la mère de la toute enfance, un sourire ensoleillé
un saut, un deuxième jet plus lent, la femme apparut, celle de la rencontre originelle
et à peine touchée,
encore une trajectoire à la courbure plus douce, un tour de l’invisible manège et je suis amené enfin à moi, le fil entier en quelques secondes s’est déroulé, toute la mémoire de moi retrouvée de cette existence et un dernier voile où un arrêt encore était tapi s’écarte sur le souvenir de quelque chose de sablonneux, une douceur coalescente qui prit avec précaution le nom de “hier” en chutant avec mollesse sur le “maintenant”.
La familiarité alors se réveilla, pourtant éblouie, ruisselante, férocement heureuse.
Mais je puis dire autrement. Voici :
Coup de conscience absolument pure. Un là indicible.
Choc nu : “quelque chose” a disparu ou “manque”, mais quoi ?
Choc encore, plus intense, ondes centrifuges : c’est “l’avant” qui n’est pas là. Il devait y avoir un “avant”. Mais toute trace en est absente. Ce n’est que la conscience de l’oubli d’un “avant”.
Un vide surgit : béance de l’avant. L’“avant” est là, mais vide vide de quoi ?
Or du fond de ce vide, une remontée étrange s’éprouve : moi, c’est moi moi pur, sans mémoire, sans passé. Maintenant je suis là et c’était donc moi qui avais disparu ? Un soupir profond réintègre toute présence familière, et sans effort enfin, comme un immense soulagement, une déception très douce, tout est revenu en deux petits coups jusqu’à la soirée d’hier…
Note. C’est maintenant, dans l’écriture, qu’est dit : “Au début, il n’y avait pas d’avant”. Le pur commencement ne se sait pas commencement. Mais il le devient immédiatement dès qu’un quantum de temps “apparaît” pour le constituer comme commencement. De ce côté-ci, cela apparaît comme moment originel. Mais de l’autre ? Il n’y a pas d’autre côté.
Dès que du temps se fut écoulé (et je ne veux pas dire par là que cet écoulement fut en quoi que ce soit une “cause”), la pure conscience-de-là prit figure d’un “éveil”, d’un commencement incompréhensible. Aucune succession, aucune causalité (ceci est tautologique) n’est à être mise ICI.
L’oubli portait sur le Moi. Pourquoi écrire maintenant le et M majuscule ? C’est qu’il est difficile d’écrire : “moi”, j’avais disparu.
QUI, en effet, éprouva ce qui est écrit ici, QUI s’en souvient ? Aucun truquage, aucune contorsion stylistique ne viendront à bout de la réponse qui s’impose grammaticalement : c’était moi. » [39]
Un second témoignage fait état d’une inconscience prolongée que les bouddhistes désignent par le terme « asamjñîsamāpatti », c’est-à-dire extase spontanée et dépourvue de notions et d’images puisque l’activité mentale n’y a plus cours :
« Un jour, je me souviens, mon corps demeura inerte durant des heures. Puis, au sortir de ce vide totalement inconscient, la vie reprit peu à peu et, me semblait-il, au niveau des molécules. C’était un malaise effroyable, une souffrance jamais éprouvée. »
Une autre personne, après une inconscience de plusieurs heures dans la journée, note au réveil :
« Une impression étrange, mon corps est si lourd, si enfoncé dans le lit, comme un roc, presque au-dessous de moi que je me demande s’il est mort ou vivant. Réveil rapide pourtant. »
Mentionnons aussi une absorption quasi instantanée : le regard devient fixe, les yeux grands ouverts, on voit sans voir, abîmé dans le Soi.
Grâce au vide du dénuement, le « je » façonné et impur (que l’Inde nomme ahamkāra), après avoir perdu ses possessions, est détruit ; puis, le « je » naturel et profond qui demeurait encore, meurt à son tour dans la Nuit. Néanmoins l’anéantissement n’est pas complet tant que le mystique n’a pas obtenu la nudité essentielle en s’immergeant dans le « Je » universel. Pour parvenir à ce niveau cosmique, les traces d’attachement et d’habitudes ancestrales qui subsistent dans son inconscient doivent être détruites, à l’aide d’une vacuité nue, aveugle, qui l’amènera au Rien.
Cette vacuité, issue de la ferveur et du détachement, apporte un apaisement bien supérieur au vide de la quiétude, et l’inconscience y atteint une profondeur ineffable. Vide mystérieux, infus, qui s’accomplit au tréfonds de l’âme et dont on sort plein de force et de vibrations. Parallèle aux autres vides, mais plus essentiel qu’eux, il s’instaure d’abord en présence d’un maître et dure alors une demi-heure. Le moi commence par résister, il a peur, et pendant quelques minutes, le disciple se refuse à plonger dans les ténèbres, préférant s’agripper à de menus soucis. Mais, après un temps, il s’adonne spontanément à des plongées répétées et se vide ainsi de tout ce qui est relatif et déterminé, perdant de vue et soi-même et le monde. Peu à peu il se plaît dans ce vide, et quand il y vit de façon permanente, il est parvenu à l’absorption ininterrompue dans le maître, que les sūfī nomment fanā’ du shaykh.
Ainsi, à force de plonger dans le torrent qui l’entraîne à une allure vertigineuse il ne sait où, son moi s’use peu à peu et, un jour, sans qu’il [40] sache comment ni pourquoi, il se sent englouti dans un océan sans rivage. À son grand étonnement, il n’est plus nulle part, il n’est plus personne.
Sous l’effet d’absorptions de plus en plus fréquentes, cette riche inconscience deviendra un fond permanent sur lequel se détachera plus tard la conscience éveillée. Mais au début on ne peut jouir des deux simultanément.
Cette inconscience en laquelle tout se noue correspond à la « connaissance non -connaissante » d’Eckhart. Les mystiques chrétiens y voient l’opération de Dieu dans l’âme. « Au milieu du silence me fut dite la parole secrète. » Maître Eckhart commente ainsi :
« Maintenant tu demanderas : Qu’opère donc Dieu sans image dans le fond et essence de l’âme ? Je ne suis pas en état de savoir cela, car les puissances de l’âme ne peuvent percevoir qu’en images… Cela leur demeure caché. Et c’est ce qui leur est le plus salutaire… L’ignorance les attire comme vers quelque chose de merveilleux et les lance à sa poursuite ! Car l’âme sent bien que c’est, mais ne sait pas… ce que c’est. »244.
L’âme reçoit en effet un message secret qu’elle ne peut déchiffrer tant il est lourd de sens, subtil. La pensée s’efface aussitôt qu’elle cherche à s’en emparer. Néanmoins il s’imprime de telle sorte dans la substance de l’âme que rien ne pourra ébranler la certitude de sa vivante présence.
Dans le Château de l’âme, sainte Thérèse se préoccupe elle aussi de l’inconscience propre à l’oraison d’union, union si intime avec Dieu qu’elle transforme complètement l’âme en Dieu :
« Toutes nos puissances sont endormies, dit-elle, et même profondément endormies par rapport à toutes les choses du monde et à nous-mêmes. Et en vérité, l’âme est comme privée de sentiment durant le peu de temps que dure cette oraison d’union ; et le voudrait-elle, il lui serait impossible de penser. Aussi elle n’a pas besoin d’user d’artifice pour suspendre son entendement. Si elle aime, elle est dans un tel sommeil qu’elle ignore comment elle aime ni ce qu’elle voudrait. Enfin, elle est comme complètement morte au monde pour vivre davantage en Dieu ; voilà pourquoi c’est une mort délicieuse. »
La sainte différencie avec précision cette oraison d’union du « sommeil des puissances » éprouvé dans la demeure précédente où l’âme « tant qu’elle n’a pas une longue expérience, se demande avec anxiété ce qui a eu lieu. Était-elle dans l’illusion ? Était-elle endormie ? Est-ce une faveur de Dieu ?... Mille doutes l’envahissent »245. [41]
Au contraire, dans l’oraison d’union, nul doute ne peut subsister, elle est souverainement certaine que Dieu opère en elle sans que personne ni elle-même puisse troubler son action :
« Vous voyez cette âme que Dieu prive complètement d’intelligence pour mieux imprimer en elle la véritable Sagesse ; elle ne voit, ni n’entend, ni ne comprend rien durant le temps de cette oraison… Dieu s’établit lui-même dans l’intime de cette âme, de telle sorte que, quand elle revient à elle-même, elle ne saurait avoir le moindre doute qu’elle n’ait été en Dieu et que Dieu ait été en elle… Mais me direz-vous, comment l’âme a-t-elle vu ou compris cette faveur, puisqu’elle ne voit ni ne comprend ? Je ne dis pas qu’alors elle l’a vue, c’est ensuite qu’elle s’en rend parfaitement compte. C’est une certitude qu’elle possède et que Dieu seul peut donner. »246.
Il existe aussi dans la sixième demeure un ravissement où l’âme a des lumières et des connaissances concernant Dieu :
« Cela semblera impossible, écrit-elle, car si les puissances et les sens sont tellement suspendus que nous pouvons dire qu’ils sont comme morts, comment l’âme peut-elle se rendre compte qu’elle comprend un tel secret ? J’avoue que je l’ignore, et peut-être qu’aucune créature ne saurait le dire. »247.
Un problème analogue se pose quant au souvenir : si l’âme ne se souvient plus ensuite de ces hautes faveurs, quel profit en retire-t-elle ? À cela sainte Thérèse répond : « Bien que l’on ne puisse expliquer ces faveurs, elles demeurent parfaitement gravées dans le plus intime de l’âme, et l’on n’en perd jamais le souvenir. Mais, ajouterez-vous, si elles n’ont aucune image qui les représente, et si les puissances ne peuvent les comprendre, comment peut-on s’en souvenir ? Moi non plus je ne le comprends pas. »248. Quant à l’effet extraordinaire de cette oraison, il consiste en un
« tel oubli de soi que l’âme semble véritablement n’avoir plus d’être… Elle est tellement transformée qu’elle ne se reconnaît plus. Elle ne songe plus qu’il doit y avoir pour elle un ciel, une vie, un honneur propre, parce qu’elle est tout entière occupée à la gloire de Dieu… Ainsi non seulement, elle ne se préoccupe pas de ce qui peut arriver, mais elle est sous ce rapport dans un oubli tellement étrange que, je répète, il semble qu’elle n’est et qu’elle voudrait n’être rien en rien… »249. [42]
Afin de parvenir à ce degré élevé d’oraison, l’âme selon la comparaison de Thérèse d’Ávila a dû s’enfermer comme le ver à soie dans un cocon étroit et obscur qu’il a filé lui-même. C’est là qu’il meurt au monde, là qu’il perd ensuite sa vie de ver afin de renaître papillon 250 :
« O puissance de Dieu, dit-elle, qui pourra exprimer l’état de l’âme après cette union durant laquelle elle a été abîmée dans la grandeur de Dieu et si étroitement unie à lui pendant quelques instants : je dis “quelques instants”, car le temps à mon avis n’arrive jamais à une demi-heure. Je vous le dis en toute vérité, cette âme ne se reconnaît plus. Il y a la même différence entre son état passé et son état actuel qu’entre ce ver à soie difforme et le petit papillon blanc. »251.
D’après saint Jean de la Croix, inestimables sont les biens qu’impriment dans l’âme la communication silencieuse de Dieu et les onctions très mystérieuses et délicates de l’Esprit-Saint qui infusent secrètement dans l’âme richesses et grâce sans qu’elle y prenne part, sans même qu’elle le comprenne alors : « … Elle se sent blessée et ravie avec tendresse et suavité sans savoir par qui, ni d’où, ni comment. »252. Sur cette transformation de l’âme en Dieu, au terme de l’anéantissement, Suso écrit :
«... Ici l’esprit est dépouillé de cette obscure lumière qui l’avait accompagné suivant le mode humain depuis la révélation de ces choses. Là, il en est dépouillé, car il se trouve lui-même, proprement autre, différent de ce qu’il comprenait de lui-même, suivant le mode de la lumière qui lui était donnée auparavant… et il est ainsi dénudé et dépouillé de tout mode, dans l’absence de mode de la simple essence divine. »
Plus loin, après avoir bien précisé que l’âme « ne devient pas Dieu par nature », il ajoute :
« Il faut dire malgré tout que, dans cet anéantissement, qui suit cette absorption d’elle-même, l’âme voit disparaître son incertitude étonnée, en cette perte où elle est dépouillée de son être propre en l’être absolu, par son inconscience d’elle-même. »253. [43]
L’inconscience de ces profondes immersions permet donc l’anéantissement par lequel se parachève le dénuement. Mais il est impossible de classer de pareilles réalisations. En effet, si le vide du dépouillement qui fait du mystique un homme « pauvre et nu », les absorptions inconscientes durant lesquelles il est réduit à rien sans même le savoir, l’anéantissement en Dieu et l’accès au Rien sont des expériences très précises et nettement distinctes pour celui qui les éprouve, elles ne constituent pas des phases strictement successives : l’une peut s’amorcer avant que la précédente ne soit terminée ; plusieurs progressent de façon parallèle et l’on a souvent un éclair des accomplissements futurs. Ne nous en étonnons pas, car, l’expérience spirituelle conduisant à l’intemporel et à l’indifférencié, tout est là à tout moment : on a donc grand-peine à établir des étapes comme si elle évoluait dans le temps. En outre, dès que le mystique vit dans le Rien ne demeurant nulle part les vacuités antérieurement traversées tendent à se confondre pour n’en faire plus qu’une : dans l’oubli du moi et de toutes choses, dans l’oubli de l’oubli lui-même, il se perd constamment dans un abîme dont il ne sait rien.
Pour ces diverses raisons, il ne faut pas chercher un ordre rigoureux dans les extraits qui suivent.
Et d’abord, en survol, l’itinéraire des anciens maîtres et poètes sūfī :
Abou-Sa’id Al Kharraz dit du serviteur que Dieu choisit pour compagnon fidèle :
«... Lorsque le regard de ce serviteur tombe sur la Majesté et la Magnificence, ce dernier reste sans lui-même. Alors le serviteur devient (une parcelle) du temps anéanti… »254.
Ibn'Atā'Allāh décrit ainsi l’anéantissement (fanā’) :
« L’homme disparaît de lui-même, il ne sent rien des apparences extérieures de ses membres, ni du monde extérieur, ni de ce qui se passe en lui ; il disparaît de tout cela, et tout cela disparaît de lui, fuyant vers Dieu d’abord, en Dieu ensuite. »
Louis Gardet explique : « Vers Dieu d’abord, c’est le fanā' ; en Dieu ensuite, c’est-à-dire le sujet disparaît de la disparition elle-même, c’est le fanā' du fanā'… Abolition, annihilation du sujet empirique pour que le “je” profond “subsiste” en Dieu. Perte de tout par le retrait et [44] l’esseulement radical… pour que tout soit redonné selon la suprême Réalité. »255.
« Mais l’anéantissement de soi n’a de valeur que si le regard s’en détourne pour se porter vers l’état de subsistance en Dieu (baqā »). » « La crainte de Dieu se situe au moment où nous sommes anéantis et consiste à repousser toute complaisance à l’égard de notre propre fana » ; cette complaisance lui rendrait pour nous une valeur positive qui masquerait la seule valeur positive en soi : la subsistance en Dieu (baqā »). On ne peut accéder jusque devant l’essence divine que par la pure négativité de l’anéantissement personnel. »256.
Par-delà encore anéantissement et son oubli, par-delà permanence en Dieu, le saint se tient dans l’égalité sans houle, c’est ce que veut dire Abou’l-Hasan Al-Nouri :
«... La route de ceux qui sont anéantis est celle où leur anéantissement s’accomplit en leur Bien-Aimé, qui est l’objet de leur Espérance. La voie de ceux qui demeurent est celle où leur permanence tient à sa permanence à Lui. Cependant celui qui s’élève au-dessus des deux états d’anéantissement et de permanence, il n’y a plus pour lui ni anéantissement, ni permanence. »257.
L’auteur du Nuage d’Inconnaissance, à cette étape, condense son enseignement en deux mots : « nulle part » et « rien » :
« Car nulle part corporellement, c’est partout spirituellement… j’aimerais mieux n’être nulle part corporellement, luttant avec cet aveugle rien, que d’être un si grand seigneur que je puisse, lorsqu’il me plairait, être partout corporellement…
« Laisse ce partout et ce quelque chose, pour ce nulle part et ce rien. Ne t’inquiète point si ton intelligence ne peut appréhender ce rien, car assurément je ne l’en aime que mieux. Il est en lui-même si précieux qu’elle ne peut l’appréhender. Ce rien, on l’éprouve plutôt qu’on ne le voit, car il est tout aveugle et pleine ténèbre pour ceux qui ne l’ont pas encore beaucoup contemplé… Une âme en l’éprouvant est plus aveuglée par l’abondance de lumière spirituelle qu’on ne l’est par les ténèbres ou le manque de lumière physique. Qui donc l’appelle “rien” ? C’est assurément notre homme extérieur, non l’intérieur. L’homme intérieur l’appelle “Tout”, car par lui, il lui est donné de comprendre toute chose, corporelle ou spirituelle, sans en considérer aucune en particulier » (ch. 68). [45]
Et Walter Hilton :
« C’est donc une bonne obscurité et un rien très riche qui apportent à l’âme tant d’aise spirituelle et une aussi calme douceur. Je crois que David entendait cette Nuit ou ce rien lorsqu’il disait : “J’ai été réduit à rien et je ne l’ai pas su”. C’est-à-dire la grâce que notre Seigneur Jésus a envoyée dans mon cœur a tué en moi et réduit à rien tout amour du monde et je n’ai pas su comment. Car ce n’est pas par mon travail ni par ma propre volonté… mais par la grâce… »258.
Un témoignage moderne va établir clairement la distinction entre « vide » et « rien ». Il comporte trois expériences dont les deux premières se réfèrent au vide et la dernière au Rien : d’abord un rêve de vide, sorte d’appel de l’abîme 259 et le lendemain, en état de veille, son accomplissement sous la forme d’un anéantissement de soi, perçu comme libération et félicité. Dans la troisième expérience, lors d’un état mystique profond et en la présence du maître (présence spirituelle et non corporelle), fulguration du Rien :
« L’expérience de l’abîme a été précédée d’un rêve : j’étais plaqué contre la paroi d’une cage d’escalier me donnant l’impression d’un trou sans fond, dans lequel j’allais basculer. Aucune crainte ni angoisse, le réflexe pourtant de rester accroché pour ne pas tomber.
« Le jour suivant, étendu et éveillé, j’ai ressenti la présence en' moi' d’un gouffre analogue à celui du rêve : même appel à lâcher prise, mais accompagné du désir d’y tomber.
« Dans cet espace intérieur qui n’était pas celui du corps physique, je tombais avec un sentiment de lâcher prise dans une sécurité totale et un parfait abandon. Détente de tout l’être, impression de nœuds se déliant. Cela se faisait par vagues, avec légèreté, délice, n’en finissant plus de tomber, remontant même pour mieux redescendre.
« Un mois après, expérience très différente, sans rien de spatial : durant la nuit, dans un demi-sommeil, d’abord quelques ondes de félicité très fines et délicates et pourtant très fortes, localisées au cœur : la présence du maître à peine esquissée, un éclat de rien, absolument rien, cri d’effroi, réveil complet.
Éclat de rien lié à cette présence et pourtant indépendant d’elle. Si je me centre sur l’expérience même du rien : entre cette présence et je rien, je vois les deux faces d’une même chose sans épaisseur : l’espace entre le maître et le rien étant plus nul encore que le rien lui-même. Le cri d’effroi, jailli de la contiguïté pure entre le maître et le rien lequel avait brusquement disparu par le rien tient à cette brusque [46] révélation : le maître étant cela, rien, toute chose et moi-même sommes également “rien”. N’est-ce pas ce dont j’avais eu seulement l’intuition, quelques années auparavant, lorsque j’écrivais :
Au cœur de l’être vibre le vide
Et au cœur du vide, le rien.
Après, quand j’ai senti que c’était l’Absolument Rien qui m’avait fait reculer d’effroi, je me suis jeté contre si peu que ce soit je me suis lancé dessus (contre, dans ?) et naturellement la riposte est instantanée : il n’y a même pas deux temps pour cela. C’est déjà au-delà de la transfiguration du monde, au-delà de l’unité nirvāna-samsāra ; celle-ci est le fond sans fond au cœur duquel jaillit cet élan de fusion. Le but lui-même a disparu.
Si l’on n’a pas peur, à partir de là, frénésie, élan absolu, désir impérieux de ne faire qu’un, mais je n’ai pas le pouvoir de refaire cet élan.
Et c’est un “rien très riche” puisque l’appel est si impérieux qu’on obtient aussitôt la réponse. »
Le récit suivant révèle comment une autre personne, après de longues années d’expériences de vides, accède définitivement au Rien ceci n’est qu’un exemple de ce qui se passe tout au long de la vie mystique : l’état, au début à peine supportable une seconde, finit par s’installer. Le Rien devient alors un fond permanent dans lequel baigne le mystique260.
« J’eus d’abord un rêve : des voleurs s’efforçaient de me dérober un trésor enfoui dans les souterrains de ma demeure ; j’en ignorais la nature et jusqu’à l’existence, mais je pressentais pourtant son inestimable valeur et je le défendais, pour moi et les miens, refusant de quitter la place. Tirée du rêve, je conservai la certitude que j’avais depuis toujours un tel trésor et qu’il me serait bientôt révélé ; mais à toute idée que je m’en forgeais, mon cœur répondait “non”, car lui, savait. Mon maître, à qui je confiai ce rêve, me dit : “Effectivement, le trésor est là, et vous êtes sur le point de le découvrir ; mais un obstacle s’interpose encore.”
« Quelques jours plus tard, peu de temps avant de le quitter, mon maître me fit asseoir en face de lui. Après une profonde absorption, en revenant à la conscience, quelle ne fut pas ma stupéfaction : il n’y avait rien et dans le Rien, je n’étais plus. Impression étrange, illimitée. Pourtant, depuis près de vingt ans, j’avais traversé bien des vides : vides inconscients, mort douloureuse et même un anéantissement total. Maintenant, c’était différent, il n’y avait pas d’annihilation, de dépouillement, ni même de vide, puisque vide signifie toujours vide de quelque chose ; il fallait dire “rien” toutes les vacuités antérieu [47] rement éprouvées fondues en une seule, insaisissable et définitive, car je n’en sortis plus.
À mon maître qui me demandait comment je me sentais, je répondis : “Où suis-je ? Nulle part, me semble-t-il !” et avec un sourire indéfinissable il acquiesça : “Oui, nous ne sommes plus nulle part.” À partir de ce jour, les rives escarpées, changeantes, prodigieuses, entre lesquelles fluait précipitamment le fleuve de ma vie, s’évanouirent. Il n’y eut plus que l’immensité de la mer. Extases et phénomènes extraordinaires firent place à une paix simple, inébranlable et à un très grand silence : rien en moi, rien au-dehors, rien en Dieu. Une fluide harmonie où ne demeure qu’un ineffable indéterminé.
Le trésor une fois découvert, bien des choses me furent révélées. Et d’abord je pris conscience du rien dans lequel vivait mon maître. Je compris aussi que “rien” est la condition de toute efficience, et en particulier de la plus haute de toutes, la transmission de maître à disciple, et c’est pourquoi la transmission ne s’enseigne pas. En effet, c’est en “rien” et grâce à “rien” que le maître suscite le “rien” en son disciple, en lui encore que la grâce se transmet, puisque là seulement, elle ne rencontre pas d’obstacle. »
Les œuvres de Ruysbroeck contiennent des pages superbes sur l’abîme, le Rien, la solitude immense de la divinité :
«... L’homme a été créé de rien. C’est pourquoi il poursuit ce rien, qui n’est nulle part, et, dans cette poursuite, il s’écoule si loin de lui-même, qu’il perd sa propre trace ; plongé dans la simple essence de la Divinité, comme dans son propre fond, il s’en va mourir en Dieu. » 261.
Dans l’Ornement des noces spirituelles, il dégage trois actes essentiels de la rencontre sans intermédiaire entre l’homme intérieur et Dieu :
« De l’Unité divine rayonne en lui une simple lumière et cette lumière lui révèle : ténèbre, nudité, rien.
Dans la ténèbre il est enveloppé et il s’enfonce dans une chose sans modes où il est perdu comme quelqu’un qui s’égare.
Dans la nudité il est destitué de sa lumière propre et de la faculté de discerner les choses, et pénétré par une simple lumière, transfiguré.
Dans le Rien, toutes ses activités défaillent et il est vaincu par l’activité de l’Amour abyssal de Dieu. »262.
Et voici, par lui encore, la description des êtres nus, irrésistiblement attirés par l’Amour divin qui, de l’intérieur, les invite à l’Unité [48] :
« Les hommes éclairés, d’un libre esprit, sont ravis plus haut que la raison, jusqu’à la vision nue et sans images. C’est là que l’Unité divine appelle éternellement : et avec une intelligence nue et vide d’images, ils dépassent toutes les œuvres, toutes les pratiques, toutes les choses enfin, et atteignent au sommet de l’esprit. Là, leur intelligence nue est entièrement pénétrée d’éternelle Lumière comme l’air est pénétré par la lumière du soleil. La volonté nue et ravie est transformée et pénétrée par l’amour sans fond comme le fer par le feu. Et la mémoire nue et ravie se sent enclose et établie dans un abîme 263 sans formes. »264.
En une inspiration hardie Maître Eckhart affirme un double anéantissement : anéantissement de l’âme pour laisser la place à Dieu et anéantissement de Dieu en l’âme :
« Là où finit la créature, là commence l’être de Dieu. Tout ce que Dieu te demande de la façon la plus pressante, c’est de sortir de toi-même dans la mesure où tu es créature, et de laisser Dieu être Dieu en toi. La moindre image créée qui se présente en toi de quelque manière que ce soit est tout aussi grande que Dieu. Pourquoi ? Parce qu’à la totalité divine elle barre le chemin qui mène à toi… Sors en totalité de toi pour l’amour de Dieu, et Dieu sortira entièrement de Lui-même pour l’amour de toi. Et quand ils sont sortis tous deux, ce qui reste alors, c’est l’unité simple » 265 (p. 144).
Il dit autre part :
« Si tu pouvais t’anéantir toi-même, ne fût-ce qu’un instant ou même moins de temps qu’un instant, alors tout cela t’appartiendrait en propre qui réside dans ce mystère incréé du dedans de toi-même » (p. 231).
Bien plus, l’amour à l’égard de Dieu, la connaissance de Dieu, la jouissance de l’âme en Dieu doivent, elles aussi, disparaître :
« On peut trouver étrange l’affirmation que l’âme doive perdre jusqu’à Dieu… Pour que l’âme devienne parfaite, à plus d’un égard, il lui est plus nécessaire de perdre Dieu que de perdre la créature. Il faut, il est vrai, que tout soit perdu, car la place de l’âme doit être dans un libre néant. Le dessein bien arrêté de Dieu, c’est que l’âme perde Dieu. En effet, tant que l’âme a encore un Dieu, connaît un Dieu, a la moindre notion d’un Dieu, elle est encore éloignée de Dieu. C’est pourquoi c’est le désir formel de Dieu de s’anéantir Lui-même dans l’âme afin que l’âme se perde elle-même… Et le plus grand honneur [49] que l’âme puisse faire à Dieu, c’est de l’abandonner à Lui-même et de s’affranchir de Lui.
« C’est dans ce sens qu’il faut entendre la mort la plus intime de l’âme, celle qui lui permet de devenir divine » (p. 248).
Dans l’Introduction aux Traités et sermons de Maître Eckhart, M. de Gandillac explique : « On verra que dans sa prédication, notre auteur va parfois jusqu’à décrire la conscience de l’union à Dieu comme le dernier empêchement à la parfaite Béatitude, en sorte que l’Homme noble devra “se libérer de Dieu même”, c’est-à-dire précisément de toute connaissance de Dieu, et non pas même, selon la tradition dionysienne, pour que cette “inconnaissance” soit une “plus haute connaissance”, mais pour que le Vide absolu se fasse dans l’âme » (p. 17).
En des pages magnifiques, Maître Eckhart décrit la pauvreté intérieure à laquelle s’applique la parole de l’Évangile : « Heureux les pauvres en esprit. »
« Celui-là est un homme pauvre qui ne veut rien, ne sait rien, n’a rien. » Il ne veut rien, pas même accomplir sciemment la volonté de Dieu, car celui qui veut accomplir la volonté de Dieu « a encore une volonté… et ce n’est point là la véritable pauvreté » (pp. 254-255).
« Est un homme pauvre celui qui ne sait rien… il faut qu’il soit à tel point vide de tout savoir qu’il ne sache, ni ne connaisse, ni ne sente que Dieu vit en lui » (p. 256). « C’est dans ce sens, dis-je, que l’homme doit être affranchi et libre de Dieu, afin qu’il ne sache, ni ne connaisse que Dieu agit en lui… Dieu ne connaît, ni ceci, ni cela. C’est pourquoi Dieu est dépouillé de toutes choses et c’est pourquoi Il est Lui-même toutes choses. Celui qui est pauvre en esprit doit être dépouillé de tout savoir propre, de telle sorte qu’il ne sache absolument rien ni de Dieu, ni de la créature, ni de soi-même. D’où la nécessité pour l’homme d’aspirer à ne rien savoir, à ne rien connaître des opérations divines » (p. 257).
Mais la pauvreté la plus intime, la plus vraie, est par-delà le dépouillement de toutes choses, des créatures, de soi-même et de Dieu ; il ne doit rester en l’homme de lieu où Dieu puisse opérer :
« En effet, si Dieu trouvait l’homme en cette pauvreté, c’est sur soi-même qu’Il devrait exercer son opération et Il serait Lui-même le lieu de son opération, précisément parce qu’II est celui qui opère en Lui-même. Ici, dans cette pauvreté, l’homme retrouve l’être éternel… » (p. 258).
« Nous disons donc que l’homme doit être tellement pauvre qu’il ne soit pas un lieu et n’ait pas en lui un lieu où Dieu puisse opérer. Tant que l’homme conserve encore en lui un lieu quelconque, il conserve [50] aussi quelque distinction. C’est pourquoi je prie Dieu de me libérer de Dieu » (p. 258).
Et même jusque dans ses actes, l’homme pauvre doit être détaché, vide et libre, et pour cela il doit vivre « sans avant ni après », c’est-à-dire dans le moment présent en une éternelle reprise :
Car « il y a dans l’âme un Fond secret d’où découlent la connaissance et l’amour ; ce quelque chose ne connaît pas et n’aime pas ; ce sont les puissances de l’âme qui connaissent et qui aiment… Ce Fond secret n’a ni passé ni futur, il n’attend rien qui puisse s’ajouter à lui, car il ne peut ni gagner ni perdre » (p. 256).
Et Eckhart citant un « maître païen », probablement Proclus ou le Pseudo-Hermès :
« Dieu est quelqu’un dont le néant remplit le monde entier, et son quelque chose n’est nulle part. C’est pourquoi le quelque chose de Dieu n’est point trouvé par l’âme, tant qu’elle n’a pas été réduite à néant, en quelque lieu qu’elle se trouve, créée ou incréée… » (p. 249).
Dans un autre sermon, il déclare à propos de l’homme dont le temple intérieur brille d’une très pure lumière :
« Si l’âme entre alors dans la lumière sans mélange, elle est transportée en son Rien, et, dans ce Rien, elle est tellement loin de son moi créé que sa puissance propre ne lui suffit plus à la ramener à son moi créé. Mais alors Dieu, lui qui n’est pas créé, saisit le Rien de l’âme et accueille cette âme en lui-même. L’âme a osé s’anéantir et ne peut plus maintenant retourner d’elle-même en elle-même, aussi loin qu’elle soit sortie d’elle-même, avant que Dieu ne se soit saisi d’elle. Il doit nécessairement en être ainsi » (p. 120).
Aussitôt l’âme anéantie, et Dieu aussi en elle anéanti c’est-à-dire les plus hautes valeurs auxquelles elle eut accès dans l’oubli de la voie et de son aboutissement, par-delà anéantissement et permanence, une vie nouvelle s’instaure, vie fluide et déliée, perdue dans l’Immense et l’universel.
La conscience libérée de ses entraves, doutes et hésitations, récupère ses facultés précédemment suspendues, paralysées, plus tard interdites, stupéfiées et enfin endormies durant de profondes immersions : alors [51] absolue devient sa certitude, gratuits et spontanés ses actes qui jaillissent du rien et y retournent, aussitôt oubliés. Ces actes étant en effet inconditionnés ne collent pas à un moi, n’obéissent plus aux impulsions du désir ni à de faux impératifs ; exempts de projet, ils n’entraînent pas inquiétudes et tourments et ne troublent jamais la tranquillité. Le mystique sans cesse disponible, affranchi des nombreuses tâches qui l’assaillaient jadis et séjournant à demeure dans l’immensité vide et silencieuse, a l’impression de ne rien faire ; pourtant son activité est plus grande encore que dans le passé.
Plus extraordinaire que des pouvoirs miraculeux est ce surgissement des activités ordinaires hors du rien d’où elles tirent une puissance et une liberté sans commune mesure avec l’ordinaire. En voici la raison : affranchi du temps et de l’espace, le mystique vit en pleine vibration originelle (spanda), source de toute connaissance ou activité, dans l’acte intérieur, indivisible et complet simple élan, mais toujours prêt à exploser en une gerbe d’actes énergiques et libres qui se manifestent dans l’espace et dans le temps. Il mène alors une vie normale sans extases, son être étant entièrement tissé d’extase, mais actes et pensées ont pour fond une vivante inconscience : il pense sans penser, agit sans agir, connaît au sein d’une véritable inconnaissance. Et ce fond indifférencié est pour lui infiniment plus précieux que les manifestations qui se jouent en surface. Il ne perd donc pas contact avec lui, même durant le sommeil.
Diverses sont les modalités de sa « connaissance dans l’inconnaissance » : tantôt il sait d’une manière intuitive et globale sans trop savoir qu’il sait, mais il agit avec promptitude comme s’il était averti des événements futurs. Tantôt il voit clairement, en se tenant dans le vide, jusqu’aux moindres détails, ce qu’il désire connaître et cela seulement.
Aucun système autant que le Taoïsme n’a mis l’accent sur le Vide et son efficace ; pour montrer que toute efficience sort du vide, le Lao-tzeu 266 donne des exemples bien connus d’objets dont l’utilité se réduit à leur creux, à leur vide :
Bien que trente rayons convergent au moyeu
c’est le vide médian
qui fait marcher le char.
L’argile est employée à façonner des vases,
mais c’est du vide interne
que dépend leur usage. [52]
Il n’est chambre où ne soient percées porte et fenêtre
c’est donc le vide encore
qui permet l’habitat.
L’être a des aptitudes
que le non-être emploie (XI).
De même un être est efficace en tant seulement qu’il est vide, et ce vide se traduit par le non-agir. Tchoang-tzeu déclare au sujet des anciens sages : « Ils se tenaient sur l’abîme et se promenaient dans le néant. »267. Pour eux tout suit alors son cours naturel.
Il recommande encore :
« Faites du non-agir votre gloire, votre science… Le non-agir n’use pas. Il est impersonnel… Il est essentiellement un vide. Le surhomme n’exerce son intelligence qu’à la manière d’un miroir. Il sait et connaît, sans que s’ensuivent ni attraction ni répulsion, sans qu’aucune empreinte persiste. Il est en conséquence supérieur à toutes choses et neutre à leur égard. »268.
Non-agir, non-intervention, qui se ramènent en définitive au Tao « par qui tout se fait, bien que lui-même n’agisse pas », ne sont qu’un rayonnement spontané. À propos du Tao, M. Granet écrit : « Sa règle unique est le wou wei, la non-intervention. On pense certes qu’il agit… mais en ce sens qu’il rayonne inlassablement une sorte de vacuité continue. »269. Ainsi du sage impassible et autonome il est dit :
« … Serait-ce parce qu’il est sans moi
son moi par là se parachève (VII).
...........
Entre ciel et terre
On dirait d’un soufflet
Vide et pourtant inépuisable
Plus il peine et plus il exhale
Il n’est mots si nombreux qu’ils le puissent sonder
Mieux vaut se tenir au milieu (V)270.
Ce milieu est d’après une note du traducteur 271 « méfiance à l’égard des extrêmes », comme pour les çivaïtes.
On trouve encore dans le Lao-tzeu [53] :
“… Seul le rien s’insère dans le sans-faille
À quoi je reconnais l’efficace du non-faire.
La leçon du non-dire
l’efficace du non-faire
Rien ne saurait les égaler (XLIII).
… Décroître encore décroître
jusques à non-agir
Par non-agir rien qui ne s’accomplisse.
Tout abdiquer c’est gagner l’univers… (XLVIII).
................
Le Sage connaît sans bouger
Sans voir comprend
Sans agir œuvre (XLVII).
Voici maintenant selon Lie-tzeu la connaissance du Sage parfait :
« Sous une apparence corporelle, Nan-kuou-tzeu cache la perfection du vide, ses oreilles n’entendent pas, ses yeux ne voient pas, sa bouche ne dit mot et son esprit ne pense plus. Son extérieur est toujours impassible. »272.
Mais Tchoang-tzeu va plus loin : le Sage qui a pénétré jusqu’au Tao, « à la fois vide et paix, non-agir et silence, moteur de l’évolution cosmique », a identifié son action à la sienne :
‘Se tenant à l’origine, à la source, uni à l’unité, il connaît… par intuition dans le Principe (Tao)… Il voit dans les ténèbres du Principe ; il entend le verbe muet du Principe. Pour lui, l’obscurité est lumière, le silence est harmonie. Il saisit l’être au plus profond de l’être, et sa raison d’être… dans le Tao. Se tenant à cette hauteur, entièrement vide et dénué, il donne à tous ce qui leur convient. Son action s’étend dans l’espace et dans le temps.’273.
Et Lie-tzeu précise :
‘Keng-Sang était, dit-on, capable de voir et d’entendre sans se servir de ses yeux et de ses oreilles ; il explique comment : « mon corps est uni à mon centre, le centre est uni à l’énergie, l’énergie est unie à l’esprit et l’esprit est uni au non-être ». Une chose si menue soit-elle, un ton à peine perceptible,… s’ils me concernent, me sont infailliblement connus, mais j’ignore s’il s’agit d’une perception des sens ou d’une connaissance instinctive : tout ce que je sais, c’est que cette connaissance me vient spontanément.’274. [54]
Ainsi, pour les taoïstes, vacuité signifie tranquillité profonde et inébranlable. Est le possesseur du Tao celui qui peut transmuer toute chose selon son désir. Alors et alors seulement, il peut conduire les autres au Tao275.
« N’est-il pas évident, dit Tchoang-tzeu, que vide, paix, contentement, non-agir, silence, vue globale et non-intervention sont la racine de tout bien ? Qui a compris cela… pourra régner, comme un roi, sur la destinée des hommes ; ou, comme un Sage, sur leurs esprits. »276.
Il ajoute ensuite au sujet des anciens souverains :
« Leur pensée s’étendait à tout, sans qu’ils pensassent à rien ; ils voyaient tout en principe, sans rien distinguer en détail ; leur pouvoir, capable de tout, ne s’appliquait à rien. » 277.
Richard de Saint-Victor s’étonnait lui aussi :
« De façon merveilleuse, nous souvenant nous ne nous souvenons pas, voyant nous ne voyons pas, comprenant nous ne comprenons pas, pénétrant nous ne pénétrons pas. »278.
R. Otto dit de l’âme telle que la conçoit Maître Eckhart :
‘Ainsi, dépouillée de son essence propre, comme Dieu seul est encore son essence, elle saisit Dieu par Dieu lui-même. Alors elle entend sans parole, elle voit sans lumière. Alors son cœur est sans fond, son âme sans conscience, son esprit sans forme, sa nature sans essence. Ayant dépassé toute connaissance rationnelle qui pourrait lui fournir sa force propre, elle est parvenue à la puissance « obscure » du Père dans laquelle toute différence logique expire. Sans parole : car elle est une saisie intérieure dans une expérience spontanée. Sans lumière, car elle est une pure conscience, sans détermination…’279.
Les bouddhistes chinois du grand Véhicule font de l’absence de pensée ou « esprit de non -demeure » le pivot de l’enseignement ésotérique qu’ils reçurent de l’Inde, non-demeure équivalent pour eux à vacuité ultime (p. 74). L’esprit n’étant plus incité par alternative et bipartition (vikalpa) ne prend appui sur rien et « ne demeure nulle part » (p. 15) ; autrement dit, dès qu’il se soustrait aux deux pôles propres à la connaissance discursive de « mise en relation », il atteint le vide de l’entre-deux. [55]
L’absence de pensée consiste alors en une vue totale, indéterminée (nirvikalpa), qui ne rejette ni ne retient280. Elle ne signifie donc pas ignorance et inaction, bien au contraire : « C’est grâce à une connaissance sans distinctions que le Tathāgata est capable de distinguer toutes choses. Comment, s’il avait un esprit pourvu de distinction, les distinguerait-il ? » (p. 68).
Plus précisément encore, l’esprit de non-demeure se caractérise par « l’absence de pensée » ainsi définie : « L’absence de pensée, c’est au sein de la pensée, demeurer sans pensée. »281. « Lorsque l’esprit n’est plus que vacuité, on est capable de voir, d’entendre, de percevoir et de connaître, mais au milieu de toutes ces impressions, on reste dans une vacuité et une quiétude constantes… On n’est pas lié par le bien ou par le mal. »282. « Que l’on soit en marche, debout, assis, couché, l’esprit reste inébranlable et il est, à tout instant, vacuité et insaisissable » (p. 109).
La pensée affranchie de sa dialectique d’écartèlement, ne prenant plus appui sur ses notions et souvenirs, se renouvelle d’instant en instant ; intuitive et immédiate, elle jaillit spontanée et fibre :
« L’absence de pensée c’est la pensée instantanée et la pensée instantanée, c’est l’omniscience »283. Un moment suffit donc pour qu’il y ait Éveil : En une pensée instantanée, tous les obstacles sont réduits à néant (p. 78).
Pour Maître Eckhart, également, « si la volonté se détourne d’elle-même, ne fût-ce qu’un instant, elle retrouve aussitôt sa véritable liberté, et dans cet instant elle rattrape tout le temps perdu » (p. 145).
L’absence d’activité mentale ne veut pas dire non plus inaction, pour les bouddhistes, puisque « dans l’immobilité de ce qui est ainsi par soi-même, il y a activité de mouvement inépuisable » (p. 106).
Bien que l’on n’ait plus ni pensée, ni réflexion, ni recherche, ni acquisition : ‘Lorsqu’on est plongé dans la quiétude constante… (on possède) une activité de réponse (aux sollicitations des êtres) qui est illimitée. L’activité avec vacuité constante, la vacuité avec activité constante, l’activité avec absence d’être, voilà la vacuité absolue. Dans la vacuité sans non-être il y a l’être transcendant que constitue le Savoir mystique ; c’est la mahāprajñā’ (p. 107). [56]
À un interlocuteur qui l’interrogeait sur la vacuité et la non-vacuité, le maître Chen-Houei répondait :
« Le caractère insaisissable de la substance de l’absolu s’appelle vacuité. Mais lorsqu’on est capable de voir cette substance insaisissable et que l’on est alors plongé dans une quiétude constante, on possède des activités nombreuses comme les grains de sable du Gange. C’est pourquoi on parle de non-vacuité » (p. 58).
À la fin de l’Ornement des Noces spirituelles, Ruysbroeck ramasse en un puissant raccourci les thèmes que je me suis efforcée de dégager ; il montre comment, à partir du vide, de la perte de soi et de la nudité d’esprit, surgissent le discernement intuitif, l’action, la liberté dans la vie intérieure et dans la vie extérieure :
« On ne peut contempler Dieu par Dieu lui-même, sans intermédiaire, dit-il… si l’on ne s’est perdu soi-même dans l’indétermination sans chemin et dans une ténèbre où tous les contemplatifs errent dans la jouissance, sans jamais plus se retrouver eux-mêmes selon le mode de créature. C’est dans l’abîme de cette ténèbre où l’esprit aimant est mort à lui-même, que commence la révélation de Dieu… C’est là que luit la lumière incompréhensible ; et en elle on devient voyant… Cette lumière divine est donnée à la simple vision de l’esprit, là où il reçoit la clarté qu’est Dieu Lui-même… dans le vide où l’esprit s’est perdu par amour… Voyez, cette mystérieuse clarté dans laquelle on contemple tout ce que l’on peut désirer dans la mesure du vide de l’esprit est telle par son immensité que le contemplatif aimant n’aperçoit et ne sent en son propre fond qu’une Lumière incompréhensible. Et dans la simple Nudité qui enveloppe toutes choses, il se sent identique à cette lumière grâce à laquelle il voit. »
Et plus loin il précise que le contemplatif voit Dieu et toutes choses sans distinction, d’un simple regard, dans la divine clarté. Et c’est la plus haute des contemplations puisque l’homme reste maître de soi et libre dans sa vie intérieure et dans la pratique des vertus.
À maintes reprises Ruysbroeck insiste sur la nécessité de posséder simultanément amour intérieur et activité extérieure : c’est en un seul et même exercice qu’il faut trouver le repos et l’action, aller vers Dieu avec un amour intense en une éternelle activité et, en Dieu, entrer dans un éternel repos. Résider en Dieu tout en sortant vers les créatures par un universel amour :
«... Éternellement nous demeurerons en Dieu, débordant toujours au-dehors et rentrant sans cesse au-dedans. C’est par là que nous posséderons véritablement la vie intérieure dans toute sa perfection. »284. [57]
En de très beaux vers Ruysbroeck chante les êtres unis à Dieu :
« Avec Dieu ils flueront et reflueront,
Possédant et jouissant, ils iront vides,
Ils travailleront et pâtiront,
puis se reposeront en sécurité dans leur superessence.
Ils sortiront et rentreront et trouveront leur nourriture.
Enivrés d’amour, ils s’endormiront en Dieu dans une lumineuse obscurité. »285.
Fondus dans la vie universelle, ils jouissent selon Abhinavagupta d’un esprit égal et peuvent s’adonner librement, dans l’ineffable vide, au mouvement primordial de la vie : expansion et retrait. Ils se tiennent dans l’élan, à la jonction du repos et du mouvement, de l’unité et de la multiplicité, du dedans et du dehors, ou d’après une image de maître Eckhart, dans le gond de la porte : qu’elle s’ouvre ou se ferme, le gond ne bougera pas. Lui aussi insiste sur l’activité intérieure : il convient que l’homme apprenne à collaborer avec Dieu, en exerçant activité intérieure et extérieure, en travaillant avec son intérieur, par lui et en lui et qu’il prenne l’habitude d’être actif tout en gardant l’esprit entièrement libre286.
C’est parce qu’ils ont découvert la source d’une activité inépuisable, après avoir renoncé à l’agir propre, que des mystiques intensément vivants comme Ruysbroeck, Eckhart, Abhinavagupta condamnent avec une telle véhémence les adeptes de la vacuité passive qui tournent le dos à la vie et à son dynamisme, l’expérience de l’acte spontané et efficient leur faisant totalement défaut :
« Unifiés dans le vide aveugle et sombre de leur être propre, ils s’y croient un avec Dieu, et ils prennent cela pour la béatitude éternelle… au-dessus de ce repos essentiel qu’ils possèdent, ils ne sentent ni Dieu ni diversité. La lumière divine ne s’est pas manifestée à eux dans leurs ténèbres parce qu’ils ne l’ont pas recherchée avec un amour actif et une liberté surnaturelle. »287.
En effet tout est là, ils sont dépourvus de liberté et ne peuvent surmonter cette attitude erronée qui remonte à leurs premiers pas dans la vie spirituelle. Tragique est donc leur position, d’où la mise en garde que leur adressent ces grands génies de la mystique. Ce qu’ils ignorent et repoussent ainsi, c’est la caractéristique même de la vie : l’acte, sa sponta [58] néité, son efficace et sa merveilleuse liberté dans le flux et le reflux d’une vie divinisée288.
L’homme devenu le « réceptacle du grand Vide » 289 jouit d’une efficience miraculeuse qui va jusqu’à transmettre paix, félicité et efficacité elle-même. S’il jette un regard en arrière, il ne voit plus trace du chemin parcouru. C’est que, selon Jean de la Croix :
« les voies par lesquelles l’âme s’achemine vers Dieu sont aussi secrètes et cachées pour le sens de l’âme que pour celui du corps les sentiers dans la mer ». Le prophète royal parlant à Dieu dit de ce chemin de l’âme : « Tes Splendeurs ont brillé sur la rondeur de la terre et l’ont éclairée… Ta voie se trouve dans la mer et tes sentiers en de nombreuses eaux, et tes pistes ne seront point connues » (Ps. 76, 19-20).
Ainsi demeurent inconnus les pas de Dieu dans les âmes qu’il conduit à la perfection de la sagesse290.
Et Çankara dans son commentaire à la Māndukhyopanishad :
« Celui qui est le Soi de tout être et le salut de tout être, les célestes eux-mêmes sont déconcertés au sujet de sa voie, à la poursuite de la trace du sans-trace, de même qu’on ne retrouve pas le chemin de l’oiseau dans l’éther » (IV, 82).
Selon les bouddhistes chinois aussi, insaisissable est la substance du chemin, on ne peut la comparer à rien ; dépourvue de connaissance, d’éveil et d’activité de rayonnement, elle est sans intérieur, ni extérieur, ni milieu, sans concentration ni distraction, elle est absence de pensée, absence de réflexion. On ne peut donc l’éprouver291. Ruysbroeck dit de la Jouissance où tous les saints sont engloutis :
« Cette jouissance est sauvage et déserte comme un lieu perdu : on n’y voit ni modes, ni chemin, ni sentier, ni retraite, ni mesure, ni fin ni commencement, ni rien qui puisse se rendre ou exprimer en paroles quelconques. »292.
Telle est encore la non-voie (anupāya) des Çivaîtes du nord, tel le tao qui désigne indistinctement voie et but [59] :
« Le tao est fuyant et insaisissable
Et pourtant il est quelque chose
il contient une sorte d’essence perpétuelle
très vraie qui comporte l’efficience. »293.
Maître Eckhart déclare de son côté ;
« Tout ce qui a être est suspendu dans le “non”. Et ce non est en même temps un si inconcevable quelque chose que tous les esprits du ciel et de la terre sont impuissants à le saisir et à le scruter. »294.
Ainsi par l’oubli des mille riens qui encombrent le chemin, par le chemin indifférencié de la vacuité, l’homme réduit à rien se fond dans l’ineffable Rien, l’Indifférencié dont il faut tout nier. En fait nul chemin n’y conduit puisque nul ne sort du Tout indéterminé. Il n’y avait donc rien à atteindre, tout étant éternellement présent.
Et maintenant, par-delà et en deçà de ce que je viens d’écrire, l’abîme : cet abîme dont on ne peut jouir de façon permanente qu’après avoir traversé dénuement, anéantissement et Rien. C’est la simple et indicible Réalité, ni vide, ni plénitude bien que participant des deux, à cause de son immensité légère, frémissante de vie. On la dit « fond sans fond » fond sur lequel tout se détache et pourtant sans fond parce que insondable, infini. Douceur inexprimable, paix, béatitude, pure jouissance dans laquelle il ne reste aucune place pour l’inconscience, ni pour l’illusion, car le monde qui y baigne ne paraît pas un mirage. Même douloureux, il est éprouvé comme parfait. Tout est ainsi et ne peut être autrement. Le mal a disparu. Aucun problème ne se pose. Patrie retrouvée et qui ne fut jamais perdue, elle ne suscite ni étonnement ni émerveillement ; mais que l’on ait pu vivre autrefois dans une si monstrueuse folie, voilà l’étonnement !
C’est encore la liberté prise en sa source et non plus, comme précédemment, les actes qui en jaillissent ; gratuité libre dans laquelle tout perd sa nécessité et son déterminisme. Liberté inséparable de connaissance, amour et béatitude, ces trois confondus dans la simplicité. On ne peut comparer ce bonheur aux félicités ressenties au début de la vie mystique [60] puisqu’il est immense, cosmique, bien qu’aucune parole ne puisse les discerner.
Tout est là simultanément : l’abîme, réceptacle vivant duquel à chaque instant tout sort et tout retourne, n’est pas vide et pourtant il ne contient rien, en ce sens qu’il absorbe inlassablement dans son indifférenciation primordiale particularités et distinctions, plaisirs et douleurs qui se perdent en lui tels de légers flocons de neige qui voltigent sur la mer et s’y dissolvent, sans laisser la moindre trace.
Ce fond tranquille et inexprimable ne se refuse donc à aucune description imagée :
Le Lao-tzeu compare le tao à un « bol vide que l’usage ne comble, un sans fond dont toute chose tire son origine » (strophe IV).
De façon plus mystérieuse, Tchoang-tzeu :
« La lumière diffuse demanda au néant de forme (l’être infini indéterminé, le principe tao) : existez-vous, ou n’existez-vous pas ? Elle n’entendit aucune réponse. L’ayant longuement fixé, elle ne vit qu’un vide obscur, dans lequel, malgré tous ses efforts, elle ne put rien distinguer, rien percevoir, rien saisir. Voilà l’apogée, dit-elle ; impossible d’enchérir sur cet état. Les notions de l’être et du néant sont courantes. Le néant d’être ne peut être conçu comme existant. Mais voici, existant, le néant de forme… C’est là l’apogée, c’est le Principe ! »295.
Il déclare encore :
« Lao-tzeu dit : Infini en lui-même, le Principe pénètre par sa vertu les plus petits des êtres. Tous sont pleins de lui. Immensité quant à son extension, abîme quant à sa profondeur, il embrasse tout et n’a pas de fond. »296.
Maître Eckhart insiste sur l’Essence nue de la Divinité, le fond sans fond de la totale Déité, Déité vide et sans modalité « qui ne donne ni ne reçoit » : « Elle est, dit-il, aussi pauvre, aussi nue et aussi vacante que si elle n’était pas. Elle n’a pas, elle ne veut pas, elle n’a pas de besoin, elle n’opère pas, elle n’engendre pas… »297.
Pourtant l’abîme, le « grundelos grunt » fond sans fond du divin exerce une attirance irrésistible ; Eckhart écrit au sujet de l’âme :
« Bien qu’elle n’arrête pas de s’enfoncer dans l’unité de l’essence divine, elle ne peut cependant jamais toucher le fond. C’est l’essence parfaite de l’âme qu’elle ne peut sonder le fond de son créateur. Pourtant [61] on ne doit plus parler d’“âme”, car dans l’unité de l’essence divine elle a laissé son nom. Elle ne s’appelle plus âme, elle s’appelle essence sans mesure. » « Le surplus de bien qui doit en outre rester pour elle (en sus de ce qu’elle saisit chaque fois) dans l’éternité en sorte qu’elle ne soit pas capable de le pénétrer, c’est justement cela l’abîme qui l’attire et dans lequel elle tombe éperdue, éternellement. »298.
Les çivaîtes mettent l’accent sur Bhairava, l’effroyable engloutisseur, Conscience universelle qui absorbe tout dans son indifférenciation. C’est à lui-même, feu dévorant, qu’il fait offrande de l’univers en un grand sacrifice :
« Lorsqu’on verse en oblation dans le Feu sacrificiel ce réceptacle du grand Vide les éléments, les organes, les objets etc. y compris la pensée, voici la véritable oblation dans laquelle la conscience fait office de cuiller sacrificielle. »299.
Il ne s’agit pas ici de dénuement, mais d’une surabondance de béatitude ; la conscience illuminée, servant d’intermédiaire entre le monde diversifié et le vide dynamique de la Conscience ultime, jette sans répit dans le Feu cosmique toutes les différenciations à mesure qu’elle en jouit.
Ruysbroeck situe au sommet de la vie mystique l’amour et la jouissance dits de fruition (ghebruken) c’est-à-dire jouissance de Dieu même. Et c’est un amour de feu : « Le terrible et immense amour de Dieu qui veut consumer tous les esprits aimants et les engloutir en lui-même. »300.
Dans le Royaume des Amants, il montre comment l’âme pénétrée, envahie par cet incompréhensible amour vient à la jouissance :
« La jouissance est si grande que Dieu et tous les saints, ainsi que tous les hommes excellents y nagent et y fondent en des profondeurs sans modes, c’est-à-dire dans la nescience où ils se perdent pour l’éternité ; mais c’est en plongeant ainsi dans cet abîme pour s’y perdre, qu’on goûte la jouissance suprême… À l’instar des Personnes divines qui à tout instant s’absorbent dans l’essence abyssale et débordent dans la jouissance… ainsi l’homme adonné à la vie commune doit se tenir au sommet de son esprit… entre la jouissance et l’action, toujours suspendu essentiellement par un débordement de jouissance, et sombrant dans son néant, c’est-à-dire dans les ténèbres de la divinité. C’est là la jouissance suprême de Dieu et de tous les esprits. »301. [62]
Afin de préparer l’homme au royaume de Dieu, Ruysbroeck donne la comparaison suivante :
« Imaginez-vous, si vous voulez, une mer immense faite de flammes ardentes et blanches, où brûle la création réduite en feu ; ce feu est immobile, il brûle sur lui-même. L’amour essentiel se possède ainsi, dans la paix brûlante, jouissance de Dieu et des élus, au-dessus de toute forme et de toute pensée. »302.
Évoquant le psaume :' l’abîme appelle l’abîme' (XLI, 8), il précise :
«... L’abîme de Dieu appelle l’abîme, à savoir tous ceux qui sont unis à l’esprit de Dieu par l’amour de fruition. Cet appel, c’est l’inondation d’une clarté essentielle. Et cette clarté essentielle, nous enveloppant d’un amour insondable, nous amène à nous perdre nous-mêmes et à nous écouler dans la ténèbre farouche de la Divinité. »303.
Enfin il célèbre ainsi l’inépuisable et indescriptible Simplicité de l’abîme, asile où reposent éternellement les esprits d’amour :
« Or l’abîme sans chemin de la divinité est si ténébreux et si inconditionné qu’il engloutit en lui-même tous les chemins divins, les activités et les attributs des (trois) Personnes dans le magnifique embrassement de l’unité essentielle ; et la fruition divine s’accomplit dans l’abîme de l’Ineffable. Ici l’esprit trépasse dans la béatitude de fruition, il fond et s’écoule dans la nudité essentielle où tous les noms de Dieu, toutes les conditions et toutes les images qui se reflètent dans le miroir de la Vérité divine sombrent dans la Simplicité sans nom de l’essence, dans le sans chemin où nulle raison n’a prise.
« Or dans cet abîme insondable de la Simplicité, toutes choses sont embrassées dans la béatitude fruitive. Mais l’abîme lui-même ne peut être embrassé par rien si ce n’est par l’Unité essentielle. C’est en lui que doivent se résorber les personnes divines et tout ce qui vit en Dieu, car il n’y a ici que repos dans l’embrassement fruitif du flot de l’amour… C’est là le ténébreux silence dans lequel vont se perdre tous les amants. »304.
Lilian SILBURN.
(en collaboration avec Henri Chambron)
Si l’on cherche quelle acception Saint-Jean de la Croix donne au mot « vide », on découvre l’abondance et la variété des emplois qu’il fait de ce terme. Le vide désigne en effet pour lui : au sens restreint, les formes spécifiques de purification de la mémoire, (oubli, abolition du souvenir et de l’espoir selon la vertu d’espérance) et, en un sens étendu, le processus de purification des facultés en général, c’est à dire, outre la mémoire, la volonté et l’entendement ; enfin l’état obtenu par cette purification : l’absence de l’Aimé et les tourments qui en découlent, ou le désir d’amour qui préfigure son rassasiement. Mais il se révèle rapidement que le passage répété et en apparence ondoyant d’un emploi à l’autre, loin d’être un hasard de vocabulaire, jaillit au contraire de la réalité du mouvement de l’élan mystique qu’il décrit.
Pour Saint Jean de la Croix, en effet, l’expérience intérieure du vide est étroitement liée au caractère progressif de la transformation de l’âme « dans la simple et pure sagesse divine », le naturel disparaissant dans l’âme embrasée d’amour, « le divin lui est aussitôt infusé d’une manière naturelle et surnaturellement pour qu’il n’y ait pas de vide dans la nature ». (M.C. II, ch. 15) Cette infusion constante du divin se substituant au naturel soumet l’âme aux différents états de vide qui se succèdent, s’engendrent les uns les autres, chacun étant à la fois effet du précédent et condition de réalisation du suivant.
Ainsi, à travers les différentes descriptions que Saint Jean de la Croix fait des états de vide et les justifications qu’il en donne, nous nous perdons dans l’immense désert de la solitude, nous nous enfonçons au cœur du silence, nous parcourons les sentiers des grandes eaux et des nuées, mais surtout, nous surprenons, dans ses exigences et ses effets, le commerce amoureux de l’Époux et de l’Épouse, de l’âme et de la divine flamme d’amour qui l’investit pour la transformer en elle. Que l’âme se vide de tout le créé, qu’elle soit vidée d’elle-même, se plaigne d’être abandonnée ou gémisse d’amour, c’est toujours le même feu qui la pénètre d’un mouvement unique puisque toujours identique à lui-même dans sa forme et toujours nouveau parce que nourri, chaque fois, des effets qu’il vient d’engendrer.
L’âme qui aspire à l’union divine commence par se vider de tout attachement à la créature est au créé. Saint Jean de la Croix ne cesse de proclamer la nécessité absolue de ce vide : « L’âme qui ne parvient pas à la pureté requise par sa capacité, n’arrive jamais à la vraie paix et satisfaction, vu qu’elle n’est pas arrivée à la nudité et au vide en ses puissances, comme il est nécessaire à la simple union. » (M.C. II, ch. 5.) Condamnant ailleurs tout attachement aux visions, il dénonce avec vigueur les âmes qui en font cas : « et ces âmes mises dans ces appréhensions demeurent là, et ne sont point édifiées en foi ni vide, ni dénuées, ni détachées de ces choses pour voler à la hauteur de la foi obscure. » (M.C. III, ch. 18.) Vide en effet doit être l’autel du sacrifice : « C’est pourquoi Dieu commandait que l’autel sur lequel se trouvait l’arche du Testament fut vide au dedans, pour donner à entendre à l’âme combien Dieu la veut vide de toutes choses, afin qu’elle soit un digne autel où soit Sa Majesté. » (M.C. I, ch. 5.)
À l’âme qui abandonne l’ardeur de ses désirs, qui renonce à la satisfaction de ses penchants et au « vide plus grand qui en découle » s’offre celui du rejet volontaire de tous les objets créés : « L’âme qui aura nié et rejeté le goût de toutes choses, mortifiant son appétit en elles, nous pouvons dire qu’elle est comme en l’obscurité d’une nuit, qui n’est en elle qu’un vide de toutes choses… si elle nie et rebute ce qu’elle peut recueillir par les sens nous pouvons bien dire qu’elle demeure en obscurité et vide… De même que celui qui ferme les yeux demeure dans l’obscurité, comme l’aveugle qui n’est pas capable de voir. » (M.C. I, ch. 3.)
Ce rejet, ce vide, relève de l’attitude intérieure puisqu’il ne s’agit pas d’une privation, mais d’un détachement : « Nous ne traitons pas ici de la privation des choses — car cela ne dépouille point l’âme si elle en a l’appétit — mais de la nudité du goût et de l’appétit qu’on y prend ; c’est ce qui laisse l’âme libre et vide, quoiqu’elle les possède, parce que les choses de ce monde n’occupent point l’âme et ne lui sont d’aucun dommage, puisqu’elles ne pénètrent en elle, mais seulement la volonté et l’appétit qui demeurent en elle. » (M.C. I, ch. 3.) C’est la convoitise et non son objet qui disparaît pour l’âme promise à l’union divine : « tout ce qui vit en l’âme doit mourir, le peu et le beaucoup, le petit et le grand, elle [146] doit demeurer sans aucune convoitise de tout cela, et aussi détachée que si elle n’était pas pour cela, ni cela pour elle. » (M.C. I, ch. 11.)
Aussi la terre se vide-t-elle pour l’âme engourdie par la Grâce comme au crépuscule s’estompent les contours du paysage familier. « “J’ai regardé la terre, dit Jérémie, et elle était vide et elle n’était rien, comme aussi les cieux et il n’avait point de lumière.” En disant qu’il vit la terre vide, il donne à entendre que toutes les créatures qu’elle contient n’étaient rien ni la terre non plus ; et de dire qu’il regarda les cieux et ne vit point de lumière, cela signifie que toutes les lumières du ciel comparées à Dieu sont de pures ténèbres. » (M.C. I, ch. 4.) L’âme délivrée par la vertu d’espérance découvre le monde « — comme il est en effet — sec, flétri, mort et de nulle valeur ». (N.O. II, ch. 21.)
C’est aux trois vertus théologales, en ejfet, qu’il appartient de dégager de toutes les choses créées les trois puissances de l’âme : l’entendement, la mémoire, la volonté.
« Il est nécessaire de donner à entendre… comment les trois vertus théologales — la foi, l’espérance, la charité, — font le même vide et la même obscurité chacune en sa puissance : la foi en l’entendement, l’espérance en la mémoire, la charité dans la volonté… La foi dans l’entendement cause un vide et une obscurité d’entendre ; l’espérance en la mémoire fait un vide de toute possession et la charité dans la volonté un vide et un dénuement de toute affection et de toute jouissance de tout ce qui n’est point Dieu. » (M.C. III, ch. 6.)
Ainsi, de même qu’il n’est de branche verte où se poser, d’eau claire à boire, d’ombre où se rafraîchir pour la tourterelle qui n’a pas trouvé son compagnon, de même l’âme « doit désirer d’être privée de toute sorte de délectation — ce qui est ne s’asseoir pas sur les branches verdoyantes — et de tout honneur et gloire du monde et de toutes sortes de goût — ce qui est ne pas pas boire de l’eau claire et fraîche — et de toute sorte de rafraîchissement et de faveurs du monde — ce qui est ne pas se mettre à l’ombre — ne voulant reposer en chose aucune, gémissant dans la solitude de toutes les choses » jusqu’à ce que l’Époux lui-même chante… la fin de ses travaux et l’accomplissement de ses désirs :
La colombe toute blanche
Avec le rameau dans l’arche est retournée ;
Et la tourterelle enfin
Sur les rives verdoyantes
À trouvé le compagnon tant désiré.
(C.S. str. XXXIV.)[147]
Avant d’entendre le chant divin l’âme doit subir le feu destructeur de la purification. Il ne lui suffit pas de se détourner du monde et de ses créatures, elle doit s’anéantir par rapport à tout ce qui est du temps, de la nature et de l’esprit…, elle doit s’abandonner au divin rayon de la contemplation purificatrice « laquelle fait passivement renoncer l’âme à soi-même et à toutes choses » (N.O. I, str. I, explication). C’est lui en effet qui dépouille les puissances de l’âme et les tient vides de toutes connaissances. « Investissant l’âme avec sa lumière divine, il excède la lumière naturelle de l’âme et en cela il l’obscurcit et la prive de toutes les appréhensions et affections naturelles qu’elle appréhendait auparavant moyennant la lumière naturelle. Et ainsi il la laisse non seulement obscure, mais aussi vide selon les puissances et appétits, tant spirituels que naturels. Et la laissant ainsi vide et à l’obscurité, il la purifie et illumine avec la divine lumière spirituelle, sans que l’âme pense l’avoir, mais croyant toujours être en ténèbres… » (N.O. II. ch. 8.) Moment difficile pour l’âme : elle recule devant le vide nouveau où la projette la passivité exigée et se raidit au lieu de s’abandonner librement à « l’infusion secrète, paisible et amoureuse de Dieu » dont elle ne comprend ni ne perçoit les effets inestimables.
« Parce que, comme elle ne peut opérer que par l’usage du sens et par le discours de l’entendement, quand Dieu veut la mettre en ce vide et en cette solitude où elle ne peut se servir de ses puissances ni exercer aucun acte, comme elle voit qu’elle ne fait rien, elle tâche de faire quelque chose, et ainsi elle se distrait et se remplit de sécheresse et de dégoût, elle qui jouissait de l’oisiveté, de la paix et du silence spirituel au moyen desquels Dieu en secret l’allait embellissant. Et il arrivera que Dieu s’opiniâtre à la tenir en cette silencieuse quiétude et elle au contraire s’opiniâtrera à vouloir travailler de soi-même avec l’imagination et l’entendement — ce que faisant, elle ressemble à un enfant que sa mère veut porter sur ses bras, et lui, crie et se démène des pieds pour aller sur ses pieds, et ainsi ni lui ni sa mère ne cheminent ; ou bien comme quand un peintre veut faire un portrait et qu’un autre le va remuant : car ou bien il ne fera rien ou bien ce sera une peinture barbouillée. » (V.F. str. III, vers 3.)
« Et ainsi, bien qu’elle chemine au pas de Dieu, elle ne sent pas le pas. Et encore qu’elle n’opère rien avec ses puissances, elle fait beaucoup plus que si elle le faisait, puisque Dieu est l’ouvrier » (id.). Dieu la porte dans ses bras, et, aveugle, elle doit se laisser porter « là où elle ne saurait aller [148] ce qui est aux choses surnaturelles, et ni son entendement ni sa volonté ni sa mémoire ne peuvent connaître ce qu’elles sont ; partant, tout son principal soin doit être de prendre garde à n’apporter point d’obstacle à Celui qui la guide. » (V. F. str. III, vers 3.) Fatale peut être sa réticence.
« Les onctions et nuances du Saint Esprit sont si délicates et si élevées que, pour leur délicatesse et leur subtile pureté, ni l’âme ni celui qui la conduit ne les aperçoivent, mais Celui-là seul qui les met en l’âme pour prendre mieux en elle son bon plaisir. Avec une extrême facilité, voire par le moindre acte que l’âme veuille alors faire de soi-même, soit de la mémoire, soit de l’entendement ou de la volonté, soit appliquer le sens ou l’appétit à quelque connaissance, goût ou douceur, cela est suffisant pour détourner et empêcher les onctions du Saint Esprit en l’âme — chose qui apporte grand dommage et grande douleur… Et c’est chose digne de grande compassion que l’âme ici, faute de s’entendre, afin de manger un petit morceau de connaissance particulière ou de douceur, se prive du bonheur qu’elle aurait que Dieu la dévorât tout entière — parce que c’est ce que Dieu fait en cette solitude en laquelle il la met, l’absorbant toute en soi par le moyen de ces onctions spirituelles solitaires. » (V.F. str. III, vers 3.) C’est pourquoi elle doit se réjouir de ses ténèbres, l’âme dont l’activité est enfin réduite à néant : « Tant plus l’âme va en obscurité et vide de ses occupations naturelles, tant plus elle est assurée…
Donc, ô âme spirituelle, quand vous verrez votre appétit obscurci, vos affections sèches et resserrées, vos puissances inhabilitées à tout exercice extérieur, ne vous peinez pas de cela ; au contraire tenez-le pour un bonheur, puisque Dieu va vous délivrant de vous-même, vous ôtant des mains les facultés avec lesquelles — même en faisant de votre mieux — vous n’eussiez su opérer si entièrement, si parfaitement ni si sûrement (à cause de leur impureté et de leur pesanteur) comme à présent que Dieu, vous prenant par la main vous conduit en obscurité comme aveugle, où et par où vous ne savez, ni jamais n’eussiez trouvé le moyen de cheminer, quelque bon pied bon œil que vous eussiez. » (N.O. II, ch. 16.)
Pour connaître la délivrance désirée, l’âme traverse le vide de la sécheresse et de l’oubli, c’est par eux qu ’opère le divin ouvrier.
Au cours de l’oraison, l’âme se trouve parfois « en un grand oubli, de sorte qu’elle ne saurait dire où elle était, ni ce qui s’est fait, et il ne lui semble pas qu’aucun temps se soit passé pour elle… ».
La cause de cet oubli est la pureté et la simplicité de cette connaissance, laquelle occupant l’âme, elle la rend ainsi simple, pure et nette de toutes les appréhensions et formes du sens et de la mémoire, par où l’âme opérait [149] dans le temps : et ainsi elle la laisse en oubli et sans temps… C’est la prière courte qu’on dit pénétrer les deux : courte parce qu’elle n’est pas dans le temps ; et qui pénètre les deux, parce que l’âme est unie en intelligence céleste. Partant, cette notice laisse l’âme, quand elle se réveille, avec les effets qu’elle a opérés en elle sans qu’elle s’en aperçût — qui sont un élèvement d’esprit à l’intelligence céleste, et une aliénation et abstraction de toutes les choses et de leurs formes et figures et souvenirs. Ce que David dit lui être arrivé, retournant à soi de cet oubli : « Je me suis éveillé et je suis devenu comme un passereau solitaire au toit ». Solitaire, à savoir étranger et abstrait de toutes choses ; au toit, c’est-à-dire l’esprit élevé en haut. Et ainsi l’âme demeure comme ignorante de toutes choses, parce qu’elle ne sait que Dieu sans savoir comment. Aussi l’Épouse met parmi les effets de ce sommeil et de cet oubli, cette ignorance, quand elle dit qu’elle y descendit, disant : « Nescivi », c’est-à-dire « Je n’ai su » d’où. Mais… encore qu’il semble à l’âme ne rien faire en cette notice et qu’elle ne s’emploie à rien, à raison qu’elle n’opère rien avec les sens ni avec les puissances, qu’elle ne croie pas néanmoins perdre son temps… c’est pourquoi l’Épouse, qui était sage, se répondit à soi-même à ce doute, disant : « Quoique je dorme » — en ce que je cesse naturellement d’opérer — « mon cœur veille » — surnaturellement élevé en notice surnaturelle. (M.C. II, ch. 14.) L’Époux ne s’y trompe pas, « il fait cas de cette tranquillité et de cet endormissement ou aliénation des sens, par cette façon de conjurer, si remarquable et si efficace, qu’il fait au Cantique, quand il dit : « Je vous conjure, ô filles de Jérusalem, par les chevreaux et les biches des champs, que vous n’éveilliez et ne fassiez veiller ma bien-aimée jusqu’à ce qu’elle le veuille ». (V. F. str. III, vers 3) Le démon sait lui aussi à quoi s’en tenir, lui qui s’efforce de faire perdre à l’âme de grandes richesses “la tirant, à guise d’un poisson, avec un peu d’appât, du gouffre des eaux simples de l’esprit où elle était abîmée et noyée en Dieu, sans trouver fond ni appui. Et par ce moyen, il la tire au bord où il lui donne appui et soutien et où elle prend pied, de sorte que désormais elle aille sur ses pieds, à même la terre, avec travail, sans qu’elle nage « dans les eaux de Siloé qui coulent avec silence », étant baignée des onctions de Dieu.” (id.).
Arrachée au temps, libérée du souvenir et de l’espoir, l’âme connaît aussi l’anéantissement de l’imagination : “et comme Dieu n’a point de forme et image qui puissent être comprises par la mémoire, de là vient que quand l’âme est unie avec Dieu (comme on voit tous les jours par expérience) elle demeure sans forme et sans figure, l’imagination perdue et la mémoire plongée dans un souverain bien en grand oubli, sans se souvenir de rien. [150] Car cette union divine lui vide la fantaisie, la nettoie de toutes les formes et notices, et l’élève au surnaturel.” (M.C. III, ch. 1.)
78
Si l’âme se débat dans cet état de vide où elle est mise, c’est qu’il lui est difficile de goûter « en cet oubli et loisir » la délicatesse de la nourriture intérieure qui lui est infusée, « laquelle nourriture est pour le sens un commencement d’obscure et sèche contemplation qui est cachée et secrète à celui-là même qui l’a. » (N.O. I, ch. 9)
Et, une fois qu’elle aura commencé à goûter cette nourriture, à reconnaître les effets de l’infusion divine, elle devra l’oublier elle aussi, être sevrée de toutes consolations, de tous biens spirituels, perdre jusqu’au souvenir de son bonheur pour tomber dans le vide de la connaissance de soi.
“Aussi Job dit « l’âme va se flétrissant en soi-même et ses entrailles bouillent sans aucune espérance ». Il n’y a ici ni plus ni moins : parce que l’âme doit posséder et jouir en l’état de perfection — elle s’achemine par le moyen de cette nuit purificatrice — d’innombrables dons et vertus, tant selon la substance de l’âme que selon ses puissances ; pour ce, il est d’abord requis généralement qu’elle se voie et se sente éloignée et privée de tous ses biens, et vide et pauvre d’eux, et qu’il lui semble en être si loin qu’elle ne puisse se persuader y arriver jamais, mais que tout bien est perdu pour elle. Comme aussi Jérémie le donne à entendre dans la même autorité, quand il dit : « je me suis oubliée des biens ». (N. O. II, ch. 10.)
L’âme quittera donc ses habits de fête, prendra ses habits de travail, il lui faut découvrir l’abîme de sa misère que lui cachaient encore les premières faveurs divines. ‘Parce que par le moyen de cette nuit contemplative l’âme se dispose pour venir à la tranquillité et paix intérieure, qui est telle et si délectable que, comme dit l’écriture, « elle excède tout sens », il faut que toute la première paix de l’âme soit premièrement laissée (laquelle, pour autant qu’elle était mêlée d’imperfections, n’était pas pas paix, bien qu’elle semblât à l’âme être telle ; parce qu’elle était à son goût : paix deux fois, c’est-à-dire qu’elle croyait avoir déjà acquis la paix du sens et celle de l’esprit, se voyant pleine d’abondances spirituelles de cette paix du sens et de l’esprit ; car comme je le dis, elle est encore imparfaite) ; il faut, dis-je, que cette paix soit premièrement purifiée en elle, et, elle, retirée et détournée de cette paix ; comme Jérémie a signifié l’avoir senti, et comme il l’a déploré en l’autorité que nous avons alléguée pour expliquer les travaux de cette nuit, disant : « Mon âme a été enlevée et repoussée de la paix ». (N.O. II, ch.
9.)
‘David dit ceci : “En la terre déserte, sans eau, sèche et sans chemin, ainsi j’ai paru devant vous pour pouvoir voir votre [151] vertu et votre gloire”. Ce qui est une chose admirable, attendu que David ne nous donne point à entendre ici que les délices spirituelles et la quantité des goûts qu’il avait eus fussent une disposition et un moyen pour connaître la gloire de Dieu, mais l’aridité et le manque d’appui de la partie sensitive, qui s’entend ici par la terre sèche et déserte.’ (N.O. I, ch. 12)
Pour devenir divine, l’âme doit donc traverser un vide spirituel total ; la force divine qui I » investit pour la renouveler ‘brise et défait de telle façon la substance spirituelle, l’absorbant en une profonde et abyssale obscurité, que l’âme se sent consommer et fondre à la vue de ses misères par une cruelle mort d’esprit ; de même que si, une bête l’ayant avalée, elle se sentait digérée dans son ventre ténébreux — souffrant les mêmes angoisses que Jonas dans le ventre de cette bête marine. Car il faut qu’elle soit dans ce tombeau de mort obscure pour la résurrection spirituelle qu’elle attend… Ce que cette âme dolente ressent le plus ici, c’est qu’il lui semble clairement que Dieu l’a rejetée et, l’ayant en horreur, l’a précipitée dans les ténèbres — ce qui est pour elle un grand tourment et une peine lamentable, de croire que Dieu l’ait abandonnée. David, sentant aussi beaucoup cette peine, dit à ce propos : « Comme les blessés dormant dans les sépulcres, desquels Vous n’avez point de souvenance, sont repoussés de votre main, ils m’ont mis dans le lac le plus profond et inférieur, dans les lieux ténébreux et l’ombre de la mort ; votre fureur a été confirmée sur moi et Vous avez attiré tous vos flots sur moi »,’ (N.O. II, ch.6.)
Se sentant rejetée et châtiée, l’âme découvre son ‘intime pauvreté et misère… Parce qu’elle sent en soi un vide profond et une pauvreté de trois sortes de biens ordonnés au contentement de l’âme, qui sont : les temporels, les naturels, et les spirituels, se voyant réduite au maux contraires, c’est à savoir : aux misères d’imperfections, aux aridités et vides des appréhensions des puissances et à l’abandonnement de l’esprit en ténèbres. Car, pour autant que Dieu purifie l’âme selon la substance sensitive et spirituelle et selon les puissances intérieures et extérieures, il faut qu’elle soit mise dans le vide, dans la pauvreté et l’abandon de toutes ces parties, la laissant sèche, vide et en ténèbre. Parce que la partie sensitive se purifie en la sécheresse, et les puissances dans le vide de leurs appréhensions, et l’esprit en ténèbre obscure…
«... Elle souffre d’ordinaire une grande destruction et un tourment intérieur — outre ladite pauvreté et vide naturel et spirituel — se vérifiant ici l’autorité d’Ezéchiel disant : ‘Assemble les os que je brûlerai au feu, les chairs seront consumées et toute la composition [152] se cuira et les os se dessécheront’. En quoi est signifiée la peine qu’on endure dans le vide et la pauvreté de la substance de l’âme sensitive et spirituelle. Et aussitôt il ajoute : “Mets-la aussi vide sur la braise pour que son métal s’échauffe et se liquéfie, et que son immondice soit défaite au milieu d’elle, et que sa rouille soit consommée”.’ (N.O. II, ch. 6.)
Une épreuve d’une nouvelle nature s’offre à l’âme quand les cavernes de ses puissances vides, purifiées et nettes de toute affection aux créatures, découvrent « le grand vide de leurs profonde capacité ».
« Quand les cavernes sont vides et nettes, la faim et la soif qu’elles endurent et l’angoisse du sens spirituel sont intolérables. Parce que comme les replis de ces cavernes sont profonds, ils souffrent une peine fort profonde, parce que la nourriture dont ils déplorent l’absence est bien profonde, puisque c’est Dieu même, comme j’ai dit. Or ce si grand tourment arrive d’ordinaire vers la fin de l’illumination et de la purification de l’âme avant qu’elle arrive à l’union, où elle est enfin satisfaite. Parce que, comme l’appétit spirituel est vide et purifié de toute créature et de toute affection envers elle, l’inclination naturelle étant désormais perdue, il est proportionné à ce qui est de Dieu et son vide est désormais prêt ; et toutefois, comme on ne lui communique pas encore ce qui est divin, par le moyen de l’union à Dieu, la peine de ce vide et de cette soif arrive à plus qu’à mourir, principalement quand au travers de quelques vues ou fentes, quelque rayon de Dieu se découvre à lui, lequel néanmoins ne lui est pas communiqué. Et ce sont ceux-là qui sont travaillés d’impatience d’amour, lesquels ne peuvent demeurer longtemps sans recevoir ou mourir. » (V.F. str. III, vers 3.)
Ainsi, quand l’entendement est vide, ‘son vide est la soif de Dieu : elle est si grande que David la compare à celle du cerf (n’en trouvant point de plus grande à qui la comparer) dont on dit qu’elle est très véhémente : ‘Comme le cerf, dit-il, désire les sources d’eau, ainsi mon âme te désire, mon Dieu. » Et cette soif est la soif des eaux de la sagesse divine, qui est l’objet de l’entendement. » (id.).
Quand la volonté est vide, ‘son vide est une faim de Dieu si grande qu’elle fait défaillir l’âme, ainsi que dit David : « Mon âme défaille en désirant le tabernacle du Seigneur ». Et cette faim est la faim et le désir de la perfection d’amour à laquelle l’âme prétend.’ (id.). [153]
Quand la mémoire est vide, ‘son vide est une consomption et une liquéfaction de l’âme pour la possession de Dieu, ainsi que le remarque Jérémie disant : « je me souviendrai de lui avec ma mémoire et je m’en souviendrai beaucoup et mon âme se fondra en moi — même ; repassant ces choses en mon cœur, je vivrai en espérance de Dieu » (id.).
C’est de ces nouveaux tourments que se plaint l’Épouse dans la première strophe du cantique spirituel :
“Où t’es-Tu caché, Ami,
Toi qui me laisses dans les gémissements ?
Pareil au cerf, Tu as fui,
M’ayant navrée ; après Toi
Je sortis, criant, et Tu étais parti !”
Sa plainte est d’autant plus fondée, commente le saint, “qu’étant blessée de son amour pour lequel elle a quitté toutes choses, et soi-même encore, elle se voit néanmoins privée de la présence de son Ami…”. Elle semble donc dire : ‘mon Époux, en cette vôtre touche et blessure d’amour, Vous avez tiré mon âme non seulement de toutes choses, me rendant étrangère à elles, mais aussi Vous m’avez fait sortir de moi (car à la vérité, il semble qu’il tire même l’âme du corps) et Vous m’avez élevée à Vous, criant vers Vous, déjà dégagée de tout pour m’attacher toute à Vous.
Comme si elle disait, lorsque je voulais saisir votre présence je ne vous ai point trouvé, et je me suis vue déprise est dégagée de toutes choses pour Vous sans être attachée à Vous, travaillant et peinant dans l’air d’amour sans appui de Vous ni de moi.’ (C.S. str.I, vers 5.)
“Que ne guéris-Tu ce cœur,
Puisque c’est de Toi qu’il a reçu sa plaie ?
Et me l’ayant dérobé,
Pourquoi le laisser ainsi
Et ne pas emporter le vol que Tu fis ?”
(C. S. str. IX.)
Inépuisable se révèle le vide de l’absence de l’Époux pour l’Épouse qui languit, souffre et se meurt. Aussi se plaint-elle à nouveau dans cette neuvième strophe. ‘Elle Lui dit que puisqu’il a navré son cœur de l’amour de sa connaissance, pourquoi II ne l’a point guéri par la vue de sa présence ; et que puisqu’il le lui a aussi ravi par l’amour dont II l’a rendu épris, le tirant de son propre pouvoir, pourquoi II l’a laissé ainsi, à savoir tiré de son [154] propre pouvoir (parce que celui qui aime ne possède plus son cœur, l’ayant donné à l’amour), pourquoi, dis-je, Il l’a ainsi laissé, ne le logeant pas vraiment dans le sien en le prenant pour soi par une entière et parfaite transformation d’amour en gloire.’ (Id. expos.)
‘Le cœur ne peut être en paix ni en repos sans quelque possession ; et lorsqu’il est affectionné, il n’a déjà plus de possession de soi ni d’aucune autre chose ; d’où vient que, s’il ne possède pas vraiment ce qu’il aime, il ne manquera de tourments jusqu’à ce qu’il le possède. Parce que jusqu’alors, il est comme le vaisseau vide (c’est-à-dire le vase) qui attend qu’on le remplisse, ou comme le famélique qui attend à manger ou comme le malade qui gémit après la santé, ou comme celui qui est suspendu en l’air et qui n’a où s’appuyer : le cœur épris d’amour se sent de cette manière — ce que l’âme éprouvant et expérimentant, elle dit :
c’est-à-dire “vide, famélique, seul, navré et malade d’amour, suspendu en l’air”
C’est à savoir, pour le remplir, le rassasier, lui tenir compagnie et le guérir, l’arrêtant et le faisant reposer parfaitement en Vous ?’ (C.S. str. IX, vers 4.)
Mais ce parfait repos, dont rêve l’Épouse, reste inaccessible tant que l’âme embrasée n’a pas atteint la perfection de l’amour, ‘comme le fit comprendre Job, disant : “Comme le cerf désire l’ombre, et comme le mercenaire attend la fin de son œuvre, de même j’ai eu des mois vides, et je me suis compté des nuits pénibles et sans fin. Si je me couche pour dormir, je dirai : quand est-ce que viendra le jour pour que je me lève ? Et derechef j’attendrai le vêpre et serai rempli de douleurs jusqu’aux ténèbres de la nuit. »
… Job n’a point dit qu’il attendait la fin de sa peine, mais la fin de son œuvre’, car « l’âme qui aime n’attend pas la fin de sa peine, mais la fin de son œuvre ; parce que son œuvre c’est d’aimer, et de cette œuvre qui est d’aimer elle attend la fin et le faîte, qui est l’accomplissement et la perfection d’aimer Dieu. Et jusqu’à ce que cela arrive, l’âme est toujours en l’état que Job se dépeint…, tenant les jours et les mois vides, et les nuits pénibles et sans fin ». (C.S. str. IX, vers 5.)
Au cœur de ce vide qui est celui de l’espérance, l’âme gémit : ‘Comme elle vit toujours en espérance, elle ne peut pas se garder de sentir un vide qui fait qu’elle gémit — bien que d’un gémissement doux et agréable — [155] et ce, tout autant qu’il s’en faut qu’elle n’ait l’entière et parfaite possession de l’adoption des enfants de Dieu, moyennant laquelle, sa gloire étant consommée, son appétit sera rassasié.’ (V.F. str. I, vers 5.) C’est de cette souffrance que jaillissent les plaintes de l’âme « qui peine pour voir Dieu ».
.
« Je vis sans plus vivre en moi
Et mon espoir est de telle guise
Que je meurs pour ce que je ne meurs.
.
En moi, non, je ne vis plus,
Et sans mon Dieu, vivre je ne puis.
Car sans lui, ni sans moi demeurer,
Qu’est-ce qu’une telle vie ?
Mille morts elle vaudrait :
Je languis pour ma vie elle-même
Quand je meurs pour ce que je ne meurs.
….
Et si je suis dans la joie,
Mon Seigneur, en espérant Te voir,
À voir que je Te puis perdre encore,
S’en redouble ma détresse.
Vivant en telle terreur
Espérant d’une espérance telle
Je me meurs pour ce que je ne meurs. »
(Couplets de l’âme qui peine pour voir Dieu.)
Plainte bienheureuse de l’âme qui commence à entrevoir la gloire dont elle est encore privée. L’ardeur de l’amour qui perce à travers ses gémissements les oppose clairement à ceux qu’elle faisait entendre, quand, en proie au feu ténébreux de la purification, elle découvrait sa misère. Désormais c’est d’amour qu’elle meurt, ce sont les flèches de l’Aimé qui creusent le vide de son absence, et elle le sait :
« Mais comment peux-tu survivre,
O ma vie, en ne vivant pas où tu vis,
Quand déjà il te faudrait
Mourir sous le coup des flèches
De ce qu’en ton cœur tu conçois de l’Aimé ? »
(C.S. str. VIII.)
À la présence qu’elle perçoit, elle mesure ce qui lui est encore refusé :
‘Ce qui est conforme à ce que David sentit, disant : « Mon âme désire et défaille en les avenues du Seigneur » parce qu’alors [156] l’âme défaille avec désir de s’engouffrer en ce souverain Bien qu’elle sent présent et couvert, parce qu’encore qu’il soit couvert, elle sent très notablement le bien et la délectation qu’il y a là ; et pour ce sujet elle est attirée et emportée vers ce bien avec plus de force qu’aucune chose naturelle ne l’est vers son centre. Et avec cette avidité et appétit viscéral, l’âme, ne se pouvant plus contenir, dit :
(C.S. str.XI, vers 1.)
Son tourment mesure alors la plénitude à laquelle elle est promise, les touches d’amour se révèlent à la fois don et privation : « les apparitions de gloire et d’amour qui se devinent en ces touches, et se voient arrêtées à la porte sans entrer en l’âme, pour n’y pouvoir pas loger à cause de la petitesse de ce logis terrestre, ces apparitions sont telles que ce serait plutôt un grand défaut d’amour de ne demander pas l’entrée en cette perfection et en cet accomplissement d’amour. » (V.F. str. I, vers 6.)
De la brûlure de la privation jaillit le désir de la possession jusqu’à ce qu’il soit assez violent pour briser, dans un ultime élan, l’écran de la dernière toile. Car tel était le secret de la divine brûlure :
au cœur de la nuit « l’éveil de l’Aurore »
au sein du silence « le rossignol dans la douceur de son chant »
au fond de la solitude « le souper qui recrée et qui énamoure ».
(C.S. str. XV et XXXIX.)
C’est pourquoi, au seuil de la gloire à laquelle l’invite le Bien-Aimé, l’âme ne se plaint plus, mais chante les délices brûlantes de la Vive Flamme « qui consume et plus ne peine » :
« Ô flamme vive d’amour
Qui navres avec tendresse
De mon âme le centre le plus profond
N’ayant plus nulle rigueur,
Achève, si tu le veux,
Brise la toile de ce rencontre heureux.
O cautère délectable,
Ô caressante blessure,
O flatteuse main, ô touche délicate
Qui sens la vie éternelle
Et qui payes toute dette,
En tuant, de la mort tu as fait la vie. »
(V.F. str. I et II.)
« La réalité çivaite est d’une manière ineffable nonchalance pleine d’ardeur, ténèbre faite de lumière, vacuité identique à la plénitude. »
Samvidullāsa.
Si l’on veut survoler les diverses vacuités échelonnées au long de la vie spirituelle afin de les embrasser toutes dans une perspective unique, on en trouve dans le Çivaïsme moniste du Cachemire un panorama heureusement déjà tout tracé, le seul à ma connaissance, exception faite des vingt-cinq vacuités des bouddhistes Mahāyāna — tableau trop obscur pour mon propos.
Le Svacchandatantra 307 qui remonte aux premiers siècles de notre ère expose sept sortes de vide. Ainsi sur la trame offerte par ce livre sacré du çivaïsme cachemirien, je situerai les paliers de l’expérience' vacuitante ». Bien que précieuse, puisque basée sur une expérience séculaire, cette trame est mince. J’ai donc dû l’étoffer de maintes explications prises dans le Tantrāloka d’Abhinavagupta ainsi que dans les hymnes aux kâlî, énergies, de l’école Krama, 308 mais sans préciser mes sources afin de ne pas être entraînée à une présentation trop technique.
En vue de décrire les six vides progressifs d’une manière suivie, il faut d’abord marquer les deux instants décisifs de cette progression : le vide [214] en profondeur de l’intériorité — percée à travers les phénomènes pour atteindre le Soi — puis le vide en extension — vide de l’Immensité qui se dilate à la mesure de l’univers.
Les Çivaïtes désignent le vide de l’intériorité par le terme kha, vide du moyeu de la Roue cosmique, celle des énergies conscientes, et celui de l’immensité par vyoman, firmament infini de la Conscience sur lequel débouche le premier.
Chacun d’eux se décompose à son tour en un vide passif dénommé çūnya et en un vide dynamique, l’indicible, anākhya.
Le vide se creuse de façon inattendue et spontanée entre les pôles opposés de la dualité, et l’illumination jaillit. Kha ou khe moyeu, centre apaisé et immobile de la roue cosmique ou vide intime du cœur est atteint quand on perce à travers deux modalités du devenir. Un tel vide implique intériorité, repli et révélations des profondeurs du Soi. Dans la conscience qui se rattache à ce vide, le Soi reste le centre et l’univers y est comme résorbé. Même si le monde reste présent, il a perdu sa densité, le pôle du Soi ayant tout absorbé. C’est là l’extase sans pensée du Quatrième état, nirvikalpasamādhi, dont l’énergie se nomme khecarî, celle qui vole dans le firmament intérieur (khe) de la pure conscience du sujet vibrant. À ce propos une stance de la Cidgaganacandrikā :
“O Déesse ! Tu T’adonnes à détruire la Parole allant du Verbe suprême à la parole ordinaire. Tu atteins la demeure de Çiva libre de tout voile et Tu te révèles comme celle qui vole dans le firmament de la Conscience et lui permet de s’épanouir. O Mère ! Tu es cette kundalî qui s’envole comme l’éclair et dévore avidement l’éclat du feu, du soleil et de la lune (à savoir sujet connaissant, connaissance et objet connu). Lorsque Tu te fraies un chemin par la voie du milieu en kha jusqu’au bindu (puissance virile de l’homme libre identique à Çiva), on Te connaît sous le nom de khecarî.”309.
Vyoman représente le firmament sans limites de la Conscience, le Tout auquel donne accès le moyeu de la Roue infinie aux mille rayons. Il ne [215] comporte plus de centre puisque le Soi et l’univers ne font qu’un ; ou, si l’on préfère, le Centre est partout. Tel est le suprême anākhya — indicible. L’énergie entièrement libre et épanouie remplit le cosmos : on l’appelle donc vyomavārnesvarî, souveraine du monde qu’elle vomit (vāmā hors du Soi). Elle fulgure en sa transcendance, car, bien que contenant en son sein toutes les choses, elle ne laisse pas d’être un vide infini (vyoman), les modalités du sujet et de l’objet ne s’y dessinant plus. En elle coïncident conscience de soi, connaissance du monde en tous ses détails et liberté absolue. L’univers qu’on ne projette plus comme une donnée extérieure objective et auquel on ne s’agrippe plus s’intègre au Soi ; parfaitement assimilé, on en jouit puis on s’en détache. Les notions différenciées peuvent alors déferler sur un fond immuable et indifférencié, connaissances et activités se trouvant désormais divinisées.
Un texte ancien compare les libres randonnées du yogin dans le ciel de la Conscience au grand cygne étirant ses ailes :
« En vérité, les cygnes étendent largement les ailes et volent partout dans le ciel, ô cygne du Lac sacré, ô pensée ! ton vol prestigieux s’élève au plus lointain du ciel lorsque tu déploies tes ailes : vacuité et élan. »
Deux choses sont en effet nécessaires à l’oiseau pour voler dans la Splendeur universelle : l’espace ouvert à l’infini et sans obstacle, mais aussi l’impulsion qui le lance dans toutes les directions à la fois, en écartant les limites imaginaires. Vide et élan, tel apparaît l’Indicible que creuse la grâce, vide rendu vibrant par l’élan subtil et incessant qui l’anime310.
Pour les çivaïtes, partisans comme les bouddhistes de l’universelle instantanéité et de la discontinuité de notre vie empirique, connaissances et activités recouvrent la Réalité d’un flux incessant, mais cette succession hétérogène est, à chaque pas, coupée par des vides : une brèche dans l’expérience objective se présente donc à tout moment : période d’insensibilité totale où n’opèrent ni la pensée ni les sens. Ainsi lorsque je dis :' je sais cela « , un vide s’ouvre entre le' je' et le' sais » ; pourtant l’impulsion qui me pousse vers la construction mentale du second instant ne me permet pas d’en prendre conscience. Si la grâce agit puissamment [216] elle me précipite dans le vide où je m’enfonce en toute lucidité d’esprit ; en ce vide illuminé resplendit le Je avant que la connaissance ait pu se poser et, ce faisant, le voiler. Tel est le moment sans pensée de la Révélation du Soi. Si, par contre, la grâce n’est pas aussi intense, emporté par mon impulsion, j’enjambe ce vide et je parviens au second instant, suscitant la durée par ce saut horizontal. C’est là le moment de projection et de découpage propre au' je sais ». Mais à nouveau, entre' sais' et cela “, se creuse une faille et si j’y sombre avec un esprit éveillé, j’atteins une illumination plus ou moins durable.
Plusieurs vides jalonnent de la sorte la voie des mystiques, s’offrant au moment de transition entre expérience sensible et expérience subtile, puis entre celle-ci et l’expérience la plus élevée, en particulier aux deux phases importantes de la progression : découverte du Soi et pénétration dans la Conscience universelle lorsqu’on égalise extase et activité, Soi et univers.
Le Vijñānabhairavatantra fait allusion à la première de ces phases (que nous allons examiner) dans la strophe 89 :
“Qu’un obstacle (s’oppose à l’exercice) d’un organe quelconque ou que (de soi-même) on y fasse obstruction, si l’on s’enfonce dans le vide sans dualité, là même le Soi resplendit.”
Ainsi que nous l’avons dit ce vide a deux aspects : vide proprement dit ou samādhi passif et anākhya ou samādhi dynamique et instantané. Le premier dans lequel résident pour une durée plus ou moins longue les êtres conscients du vide (çūnyapramātri), correspond à la vacuité de la quiétude, au vide de la coagulation et à la nuit spirituelle auxquels nous avons précédemment fait allusion. Le second constitue le vide interstitiel où, grâce à la fonte des résidus, le mystique parvient soudain et instantanément à la sphère supérieure, le vide se creusant selon les cas entre deux instants successifs : entre deux mouvements respiratoires, entre deux énergies ou connaissances, entre le je purifié et la volonté portée à son summum.
Ainsi on peut noter un progrès continu dans la prise de conscience du vide interstitiel : on repousse la dualité sous toutes ses formes, à commencer par le couple des souffles jusqu’à celui de servitude et de délivrance, en se tenant ferment dans l’indifférenciation primordiale.
Le Svacchandatantra 311 énumère sept variétés de vides superposés qui vont s’élargissant à mesure que les obstacles et les limites disparaissent.
Ce vide relatif au cœur se présente au moment où l’on quitte le domaine objectif — l’ensemble des objets tel qu’un yogin le perçoit — avant qu’on atteigne le domaine de la connaissance subtile proprement mystique. Il met fin aux impressions de dualité à l’égard de sa personne limitée et de son corps. Le yogin perd conscience de son corps et du monde environnant tout en demeurant conscient du vide lui-même sur lequel se détache une connaissance purifiée. S’il n’est pas attentif et tend vers un vide passif, il évite difficilement le sommeil sans rêve ou des concentrations stériles dont il ne peut sortir sans l’aide d’un maître. S’il reste attentif, il coagulera ses doutes à l’intérieur du vide conscient, mais il devra fournir un grand effort pour faire fondre les coagulations. Quant à la dualité de l’objectivité, la fonte définitive se produit soudain lorsqu’il pénètre dans l’Indicible (anākhya), samādhi actif qui donne accès au domaine de la pure connaissance. Néanmoins ici encore, il est difficile d’éviter un samādhi passif où l’on éprouve paix et félicité, mais qui offre des dangers de stagnation.
Le vide relatif à la connaissance, plus dynamique et donc plus précieux que le précédent, se creuse au moment du passage du domaine encore différencié de la connaissance subtile au domaine indifférencié du pur sujet conscient (le Je). La pure conscience de soi demeure seule dans ce vide illuminé qui s’accompagne d’une grande félicité. En lui prennent fin la projection de l’univers objectif ainsi que la connaissance discursive qu’elle entraîne.
À nouveau deux possibilités se présentent au yogin à l’instant même où il pénètre dans ce vide : s’il manque de vigilance, il tombe dans le sommeil spirituel du yoga (yoganidrā), samādhi passif dans lequel seules surnagent de très pures notions : qu’il s’y installe et il deviendra un véritable adepte conscient du vide dont il ne pourra sortir aisément sans un bon maître. Si, par contre, il entre dans le vide en toute acuité d’esprit, il fait fondre par une simple prise de conscience les derniers vestiges de doutes, aussi subtils qu’un tissu de papier brûlé lequel conserve apparemment sa forme, mais s’évanouit à la moindre chiquenaude. [218]
D’après le Svacchanda, le vide intermédiaire se produit au moment où l’énergie vitale — souffle udāna ou kundalinī — étant parvenue à la gorge, traverse le palais, le centre des sourcils, le front et parvient au sommet du crâne. Montée verticale en flèche dès que le feu udāna a consumé les dernières traces de dualité, c’est-à-dire la peur d’y retomber.
Emporté alors par l’élan du cœur, le yogin s’enfonce dans le vide interstitiel, vide lucide et vibrant de l’illumination du Soi, samādhi actif de pure intériorité, intuition du Quatrième état (nirvikalpasamādhi).
La Conscience” Je' déployée jusqu’ici en connaissance et en objet connu se trouvait cachée par ces deux voiles et, par eux, déterminée. Lorsque ceux-ci sont résorbés, demeure seul le Je à l’état nu, apte à jouir de l’extase indéterminée.
Le vide supérieur qui apparaît au moment où le Je ainsi purifié va recouvrer la conscience du Je universel, met fin à la servitude, c’est-à-dire aux limites individuelles, et le Soi s’y révèle en tout son éclat. Mais si le yogin se libère de son esclavage, il n’est pas pour autant vraiment libre, car il n’a pas la maîtrise de l’énergie et, s’il a reconnu l’identité du Soi et de Çiva, il ne perçoit pas encore la divinité partout répandue y compris dans les obstacles.
Ce vide s’étend à tout à l’exception du suprême Sujet conscient.
Certains êtres stagnent dans ce vide, ce sont les fous de Dieu, comparables au majdoub de la mystique musulmane qui vivent constamment en extase sous l’emprise d’une puissance qu’ils ne comprennent pas. Privés de la pleine jouissance de leurs facultés intellectuelles, ils vont errant ici et là comme s’ils étaient ivres, inconscients à l’égard du monde et d’eux-mêmes, sans désirs ni intention ; ils ne peuvent en ces conditions exercer une activité prolongée dans un univers où ils n’ont pas repris pied. C’est probablement à un niveau plus élevé — au moment où le yogin passe du vide individuel au vide universel lorsqu’il cherche à égaliser le Soi réalisé durant l’extase et sa vision d’un univers non encore totalement imprégné d’extase — qu’il faut situer l’état appelé par les çivaîtes « ghūrni', sorte d’ivresse causée par un flux trop puissant de vibrations ; le yogin titube physiquement et spirituellement, saisi de vertige quand s’effondrent les derniers supports de l’individualité.
Pour qui les éprouve, ces états sont plénitude ; mais pour qui les [219] a dépassés, une telle plénitude apparaîtra incomplète et même' vide' par rapport à l’unicité divine.
Le yogin n’a encore atteint que le vide de l’intériorité, son énergie vole en kha, dans le moyeu de la Roue de la conscience, mais non eucore en vyoman, l’immensité indicible. Il doit donc traverser d’autres vacuités où il prendra conscience du Je universel doué de toute sa puissance. Il s’agit moins d’un dépassement que d’un épanouissement de l’expérience originelle d’un Soi non encore réalisé en sa cosmicité.
Ce grand Vide (mahāçūnya) relève de l’énergie omnipénétrante (vyāpinî) laquelle commence à envahir les vides précédents. S’instaure alors l’harmonie spontanée entre vie intérieure et vie extérieure (290).
Les limites corporelles étant tombées, le yogin pénètre partout dans le vide éthéré (vyomavyāpti). Le souffle de vie devenu diffus (vyāna) sort du corps pour se répandre dans le cosmos et ne faire bientôt qu’un avec la Vie universelle (prānana). La divinité ne se révèle plus seulement dans l’intimité du Soi ni même dans le Soi manifesté en tout son éclat, mais jusque dans ce que l’on considérait comme privé de Soi, ainsi les entraves, les notions, etc.
Enfin la subjectivité s’étant déversée dans l’objectivité et l’objectivité dans la subjectivité au point de s’égaliser, le yogin se trouve immergé dans le vide très subtil et indéfinissable de l’égalité, duquel va surgir l’illumination cosmique. Le temps pressuré a perdu sa vitalité en l’absence de l’alternative qui l’alimentait. Les limites spatiales et temporelles franchies, le mystique a pour séjour le fondement apaisé de la manifestation universelle. État merveilleux dans lequel Çiva seul opère, où ne règne qu’une pensée unique, sans intention, où cesse à jamais tout calcul du fait que le temps et la mort ont été surmontés.
Si, parvenu à l’étape de l’énergie impassible et égale (samanā), le yogin dirige à nouveau son regard vers le monde, il dispose souverainement [220] de pouvoirs surnaturels : s’identifiant au vide propre à l’énergie omnipénétrante, il devient grâce à elle omniprésent. S’il s’absorbe dans le vide relatif à samanā, il participe à l’omniscience de cette énergie, et de même quant aux autres vides et à leur énergie spécifique. Mais si, dans sa volonté inlassée de tout transcender pour parvenir à Paramaçiva, il se désintéresse de ces facultés supérieures, secouant alors ses dernières attaches, il s’engloutit dans le vide par-delà toute Pensée.
C’est dans ce vide que s’éveille la vibration de l’ineffable Réalité. Pourtant ici encore se présente — pour la dernière fois — la possibilité d’accéder à deux sortes de vide soit que le mystique demeure en çūnya, soit qu’il s’abîme définitivement dans l’ultime anākhya — l’Indicible.
Il repose dans le vide transcendant (çūnyātiçūnyā) s’il ne cherche pas à quitter, faute d’audace (vîrya), la bienheureuse et impassible équanimité (samatā) en vue de jouir de l’expansion et du retrait de l’univers. Il n’exerce donc pas sa libre efficience dans un monde appréhendé comme multiple et divers.
Du fait qu’il n’est pas parvenu à la Totalité ou plénitude indifférenciée, on le qualifie de “vide’ ou de çiva — sans — relation avec l’univers. Toujours en extase, grand Cygne glissant à la surface des eaux sans souiller son immaculée blancheur, il perçoit encore une distinction entre pur et impur. Face à un univers qui, tel un spectacle, se déploie sous ses yeux, il se tient immobile, en nirvāna, passif et sans désir, n’ayant aucune raison d’agir puisqu’il baigne dans une paix inénarrable et dans la félicité de la Conscience.
Dans cet état de vide absolu, le suprême Sujet conscient qui, entraîné par-delà le cercle temporel avait englouti l’objectivité, va à son tour être dévoré par la plus haute des énergies, l’unmanā s’il quitte ce samādhi passif ou si, ayant évité le vide transcendant, il accède par l’impétuosité de son élan au samādhi actif et instantané propre à l’ultime Indicible. C’est de ce dernier qu’il est dit « non-vide absolu qui élimine le vide et son opposé ».
L’énergie de ce vide à laquelle le mystique s’identifie lui livre accès à Çiva qu’il perçoit comme pénétrant presque intégralement le cosmos.
Ainsi de vides en vides toujours plus profonds et plus vastes se produit l’intégration du monde sensible en Paramaçiva : d’abord l’objet connu se résorbe dans la connaissance, puis la connaissance dans le sujet [221] connaissant, ce dernier, parvenu à l’universalité, porte à Çiva le nectar de l’univers qu’il a composé pour lui tout au long du chemin en butinant les fleurs radieuses des sensations, des sentiments et des idées.
Il faut pourtant abandonner les six vacuités précédentes au profit d’une septième, d’une extrême subtilité et qui ne présente aucun rapport avec un état quelconque, puisque la pénétration étant achevée, Çiva est partout présent. Alors, s’il n’y a plus d’état, le Sujet conscient universel (apte à en prendre conscience) n’a donc lui aussi qu’à disparaître en s’engloutissant dans l’énergie ultime identique à Çiva. Du fait que dorénavant on ne peut plus rien dire de lui, on le qualifie d’indicible. Cet ultime anākhya contient tout : l’infime en Çiva et Çiva dans l’infime. C’est le Vide parfait, l’absolu, la plénitude, la félicité cosmique, Paix suprême ou Paramaçiva non-différent de sa libre énergie. La toute-puissante Conscience établit de la sorte le monde différencié dans sa propre essence à la manière de reflets dans un miroir ; et simultanément elle se révèle comme différenciée et comme indifférenciée, soit qu’elle fasse se succéder en elle-même comme à la surface d’un miroir les phases d’apparition, de subsistance et de disparition de l’univers, soit que, tel le miroir, elle reste une et indivisible sans être affectée par les reflets multiples et changeants, exempte de tout, bien que capable de tous les mondes en un moment éternel.
Telle est également l’activité de l’être indicible qui vit en apparence comme un homme ordinaire tout en ayant recouvré conscience de soi et de l’univers, ceux-ci étant identifiés, transfigurés.
Avec une connaissance, une volonté et une activité divinisées, il se plaît à agir, audacieux et libre, en manière de jeu. On compare donc son activité spontanée à celle d’un roi puissant qui, dans l’exultation de sa force, prend plaisir à marcher comme un simple fantassin.
Lilian SILBURN.
Centrée sur Mi Fou, l’un des fondateurs de l’école des lettrés au XIe siècle, mais incluant ses prédécesseurs et ses héritiers, l’étude de Madame Vandier-Nicolas déborde largement l’époque des Song. Afin de situer l’esthétique chinoise dans ses coordonnées profondes, l’auteur, comme les artistes eux-mêmes, se met à l’écoute des sages taoïstes du passé et des maîtres de ce Bouddhisme profondément chinois, dit du Dhyâna ou Tch'an, qui confirme à sa façon propre les notions taoïstes de vide et de spontanéité. À travers ce livre, on voit clairement l’importance du vide à la source de l’inspiration, et c’est autour de ce thème que nous en présentons ici des extraits, ne dégageant ainsi qu’une seule perspective à l’intérieur d’un travail riche et nuancé qui en comporte mainte autre.
Le nom même des lettrés : wen-jen situe ceux-ci au carrefour de l’art et de la sagesse puisque wen, manifestation du Tao, « principe d’ordre et de resplendissement, apporte à la fois vérité et beauté. Pris dans son sens concret, wen désigne un dessin ; par analogie il qualifie l’homme civilisé, le Sage,' l’Homme vrai' » (p.2).
D’une culture vaste et profonde, de goûts extrêmement raffinés, souvent à la fois calligraphes, peintres et poètes (c’était le cas de Mi Fou), ces [291] lettrés étaient généralement de hauts fonctionnaires à l’allure indépendante, au langage si libre qu’il entraînait parfois leur disgrâce, au demeurant personnages fort pittoresques, voire extravagants ; ils se groupaient à l’écart non seulement de la foule, mais de l’existence conventionnelle et intéressée de la bourgeoisie pour préserver la pureté et la liberté de leur quête.
Ainsi Mi Fou avait pris pour maîtres de vie « les héros du fong-lieou », virtuoses de l’art des « purs propos » au Ive siècle, esthètes fantasques en apparence dont il avait compris que « la semi-folie était une évasion vers le vrai… Il avait appris d’eux à jouer avec son pinceau » en obéissant à ‘l’esprit du vent et des eaux courantes (fong-lieou)’ (p. 3) et son geste était devenu créateur.
‘Le fong-lieou est un esprit de spontanéité totale, c’est pourquoi il a présidé à la naissance de l’art calligraphique… Le Spontané est le mode d’activité du Tao, c’est le Tao sous son aspect dynamique. Lorsque le calligraphe travaille sous l’implusion du Pouvoir créateur, il transmet naturellement à son écriture le mouvement de la vie, et déclenche, en jouant avec son pinceau, la mutation créatrice… La mutation est divine, ou plutôt elle est la première manifestation saisissable du Pouvoir vital (chen)/1, qui est au commencement. Le calligraphe doit laisser agir ce Pouvoir à travers lui… Il devient capable, alors, d’évoquer la vie sous tous ses aspects… Son pinceau se porte alternativement de haut en bas, puis de bas en haut ; de droite à gauche, puis de gauche à droite, et ses caractères se nouent sur le papier vide, comme se noue dans les cieux le dessin des étoiles’ (p. 19-20). Ainsi le geste de l’artiste va du yin au yang et participe de la spontanéité originelle ; ceci n’est possible qu’à une condition :
« Dans l’étude de la calligraphie, selon Mi Fou, il faut considérer comme essentiel l’art de jouer avec le pinceau. Ceci signifie qu’il faut tenir son pinceau légèrement, et écrire spontanément, la main et l’esprit restant vides. L’écriture doit être rapide, fulgurante, toute naturelle et jaillir de l’idée. » La main et l’esprit de Mi Fou restant vides, « son pinceau allait perçant et coupant, comme une lame fine et forte au combat. » Son écriture, « soulevée par un souffle divin, rappelait le vol de l’oiseau qui s’élève vers le ciel ; musclée et charpentée, elle était puissante et vigoureuse. »
1 chen : l’esprit, le divin.
Entendu en ce sens, tout art, celui de la guerre, de la dialectique ou de la calligraphie, exige des qualités de force, d’audace, de totale maîtrise : « Jouer avec le pinceau signifie :' jongler avec le pinceau et l’encre de façon à renverser sens dessus dessous le oui et le non. »
292
Il faut manier le pinceau et l’encre au mépris de l’équilibre, en rompant les plans jusqu’à l’éblouissement, comme on jonglerait avec une balle ou avec une épée » (p. 112-113).
Le Spontané se communique à la main vide par le moyen du souffle, non seulement physique, mais subtil.
Le mouvement du pinceau est “régi par le souffle qui emprunte sa puissance à l’esprit (chen). Le rythme de la respiration varie d’un individu à l’autre. Chaque écriture respire à sa manière et se distingue de toutes les autres par une allure, un éclat particulier” (p. 25). On sait que l’ascète taoïste apprend à se nourrir de souffle, à le conduire dans tout son corps pour le ramener au centre de la tête, dans le palais du Ni -wan, petite case d’un pouce carré, « siège de la méditation mystique ». Ce n’est donc point par hasard qu’“une véritable œuvre d’art « se nourrit au centre du cerveau ». L’artiste voit l’image dans son cerveau, comme l’ascète voit les dieux à l’intérieur de son corps. D’après les croyances taoïstes, les dieux sont nés du Chaos originel, et formés par le souffle primordial. Ils sont du souffle coagulé. L’œuvre d’art se noue elle aussi, dans le cerveau, où elle s’éclaire soudain, née, comme les dieux, du Chaos, du Grand Vide, du Spontané” (p. 29).
Il en est de la poésie et de la peinture comme de la calligraphie. C’est grâce au vide de la pensée que le spectacle, ou le thème, s’épure et acquiert sa dimension d’éternité. D’après un essai poétique du me siècle, “le poète entre d’abord en communion avec la nature, il donne libre cours à son imagination… “il secoue les feuillages et remonte le cours des eaux'. Puis, sa méditation se fait plus profonde, son esprit se vide de toute pensée particulière. Il devient alors capable' d’emprisonner le ciel et la terre dans la cage des mots' ou' d’enclore l’infini de l’espace dans un pied carré de papier'… Une peinture, un poème, une pièce musicale sont autant de petits mondes… (qui), créés par l’esprit, sont équivalents au vaste monde, mais plus réels que lui parce que sans pesanteur, transparents à l’esprit, immortels » (p. 34-35).
La main et l’esprit vides, perdu dans un état contemplatif, l’artiste est rempli d’une énergie intense et l’œuvre jaillit de façon si impersonnelle qu’on a pu parler d’ ’art sans art ». D’après Tchang Yen-yuan, celui qui s’applique à sa tâche va au-devant de l’échec. « La réussite va à ceux qui exercent leur mental et remuent leur pinceau sans avoir conscience de peindre. Lorsque la main ne se raidit pas et que l’esprit ne se fige pas, la peinture devient ce qu’elle devient, sans qu’on sache comment elle s’est ainsi faite » (p. 57).
293
C’est ce qui arrivait à Li Tch'eng, « grand seigneur indépendant et désintéressé dont les ancêtres avaient appartenu au clan impérial des Tang », l’un de ces grands lettrés ‘à l’esprit pur et délivré. « C’est pourquoi dans ses peintures, il atteignait à un degré merveilleux l’accent du samâdhi » Il perdait conscience de sa propre existence lorsqu’il peignait. Comme oppressé par la vision qu’il portait en lui, il ne voyait plus que les montagnes et se déchargeait sur la soie de l’extraordinaire paysage qui lui gonflait le cœur. « Ceux qui, plus tard, ont cherché le secret de son art en examinant ses tableaux n’ont pas compris que ses peintures étaient faites dans l’oubli de toutes choses. Ils ont dit que son pinceau et son encre laissaient des traces et qu’on pouvait, en observant la manière dont il les disposait, découvrir sa méthode. Ce sont là des gens qui, dans leur propre cerveau, ne possèdent pas une montagne, pas une vallée… »/1. Peindre est une activité toute spirituelle. C’est à la noblesse de son âme qu’il faut juger un artiste, non point à des recettes de métier dont la spontanéité des grands peintres n’a cure…
‘Tous les aspects que Li Tch'eng évoquait, les montagnes boisées, les marais et les plaines, les lignes rompues des chemins en lacis, les ponts brisés et les torrents impétueux, l’eau et les pierres, le vent et la pluie, les vapeurs et les nuages, la neige et la brume, toutes ces formes il ‘les vomissait ». Il s’épanchait avec son pinceau, comme Mong Kiao dans ses poèmes, et Tchang Hiu dans sa cursive. Le lavis, qui projetait l’image sur la soie sans que subsistent les traces du procédé, était l’instrument parfait de « l’art sans art ». Les paysages qu’il présentait semblaient doués d’une vie magique. L’on songe, en contemplant leur corps transparent, à cet hymne du Lankâvatara sûtra : ‘Lorsque tu examines le monde avec ta sagesse et ta compassion, il est pour toi comme la fleur de l’éther dont on ne peut pas dire si elle est créée ou évanescente, car les catégories de l’être et du non-être lui sont inapplicables »'. (pp. 72-74 et note 5 p. 73.)
/1 « On remarque l’importance que l’esthétique du temps attachait à l’art de peindre sans laisser de traces » (note 4 p. 73).
Evanescentes aussi étaient telles peintures de Mi Fou, spécialement ses scènes de brume : « ses paysages semblaient menacés de disparaître, absorbés par le brouillard. Son univers, saturé de gouttelettes d’eau, travaillé par la circulation du souffle originel » faisait dire au grand critique des Ming qu’il avait pu, grâce à lui, comprendre « le samâdhi de l’encre » (p. 122-3).
294
Cet allègement n’est qu’un exemple de la tendance au vide dont la peinture chinoise offre tous les dégradés, et qui se trouve même dans la calligraphie :
‘La méthode… du « blanc qui vole » était un emprunt de la peinture à la calligraphie. L’expression désignait un tracé d’encre lacunaire : des vides subsistaient dans le corps du trait… Le papier, aperçu à travers un réseau ténu de lignes filiformes, donnait une impression de blancheur floconneuse, et l’encre, alternativement légère ou lourde, rappelait les mouvements de l’atmosphère chargée d’humidité’ (p. 220-221).
Tantôt les éléments du paysage tendent à se résorber dans le vide, tantôt ils semblent en surgir, comme dans les tableaux d’un peintre excentrique dont on ne sait pas le nom véritable et qui avait coutume de boire avant de peindre — l’ivresse était parfois utilisée. ‘Alors tout en riant et en chantant, il éclaboussait d’encre sa toile. Il travaillait avec ses pieds, avec ses mains et maniait son pinceau avec une incohérence étrange… on l’avait surnommé « Wang l’Encre ». Chez lui, la main répondait à l’idée avec une promptitude qui rappelait l’instantanéité des mutations créatrices. Il faisait surgir du vide les nuages et les brumes et brossait la pluie et le vent avec une adresse quasi divine. “Lorsqu’on regardait attentivement ses peintures, on ne voyait pas la marque des taches d’encre, fait qui paraissait extraordinaire à tous”’ (p. 68).
Il est difficile de savoir en quoi consistait exactement la technique de « l’encre éclaboussée », il faut attendre le xviie siècle pour en trouver une description, qui ne correspond sans doute pas à ce qu’elle était à ses débuts. ‘Au xviie siècle et au xviiie, les peintres qui travaillaient à « l’encre éclaboussée » construisaient d’abord leur sujet sur le papier en éclairant les montagnes et les forêts. Ils laissaient ainsi subsister des vides entre les formes qu’ils avaient suggérées, afin de permettre au souffle de circuler à travers la peinture. Ils assuraient ensuite, par quelques touches légères, la jonction entre les' vides et les pleins ‘, puis ils animaient l’ensemble en opposant les noirs faits avec de l’encre desséchée, et les tons pâles traités avec une encre saturée d’eau. Il restait, une fois la peinture sèche, à' encager' par un léger voile d’encre pâle les points sombres : le sommet des montagnes, les pics et jusqu’aux espaces laissés libres entre les nappes de brume » (p. 64).
Le vide joue donc plusieurs rôles ; il permet en particulier la circulation du souffle. Or « le souffle façonne l’œuvre d’art comme il modèle l’univers. Il réserve sa part de vie à chaque élément du corps total. Il fait ressortir le rythme propre à chacune des parties dont se compose le tout, il accorde ces parties entre elles, et il les ramène à l’unité… Dessinées par les lignes,
295
modelées par les couleurs, les figures ne respirent que par l’espace où elles baignent » (p. 22o).
Ainsi les conceptions de la sagesse chinoise sur l’importance du vide et du souffle aussi bien que sur la nature ou la place cosmique de l’homme ont leur écho dans les œuvres elles-mêmes. Les alternances naturelles, si présentes à l’esprit chinois (yin et yang), se traduisent sur la soie ou le papier par le jeu des vides et des pleins « qui se répondent », de l’eau et du roc, de la vallée et de la montagne, en des rythmes aussi spontanés que celui du souffle, et, de même que le cosmos s’organise autour du centre vide — l’Essence transcendante — d’où il a surgi, selon le symbole des pierres antiques représentant un disque perforé au milieu, le tableau se déploie de part et d’autre d’une vacuité médiane essentielle.
Le tableau doit reproduire l’ordre cosmologique et réserver la place du Ciel en haut, de la Terre en bas. Dans l’entre-deux, on situe alors l’idée et l’on établit le site… Mais pour se développer sur la feuille, l’image a dû d’abord prendre vie ‘dans le vide de la pensée. La corrélation harmonique entre le haut et le bas est établie par l’idée… La section centrale, restée vacante sur la toile entre le ciel et la terre est comme une équivalence de « l’entre-deux cosmique », comparé par le Lao-tseu à un soufflet de forge, qui ‘se vide sans s’épuiser, et se meut en produisant toujours davantage ». Le pinceau d’un véritable artiste réserve le centre de sa toile à l’élan constructeur du souffle, qui brasse les formes dans le vide spatial’ (p. 225-226).
L’accent mis sur la spontanéité ne doit pas faire croire que le travail est dédaigné. Les amoncellements de pinceaux usagés — le moine Tche-yong en remplit cinq corbeilles de dix boisseaux avant de se déclarer satisfait — témoignent d’un labeur acharné. ‘“… tumulus des pinceaux', « lac d’encre »… étaient autant d’allusions à un savoir que les calligraphes se plaisaient à tenir secret’ (p. 49-50).
Mais ce savoir dépasse immensément une simple technique, car le travail se situe à l’intérieur d’une perspective spirituelle — tout travail d’ailleurs peut le faire. ‘Comme l’escrime, comme le tir à l’arc, la calligraphie n’est pas seulement un sport, mais un art, et plus qu’un art, une voie (tao) vers la sagesse’ (p. 5o). En quoi consiste cet accomplissement ?
On en distingue deux grandes phases principales, dont la première, toute préparatoire qu’elle soit, peut néanmoins durer fort longtemps :
‘Pendant les trente années que Tche-yong passa au sommet de son pavillon, il apprit à surmonter sa maladresse en se corrigeant de ses
296
habitudes mauvaises. Il apprit, en particulier, à décontracter ses muscles et à détendre son esprit. Ainsi procèdent les grands calligraphes. Ils empruntent d’abord une voie négative, mais à peine ont-ils atteint leur but qu’ils le dépassent en l’oubliant. Alors les conditions de leur expérience se renversent du tout au tout. Leur activité devient presque inconsciente. Ils écrivent' naturellement “ ,' sans effort', sans intention ni réflexion. La calligraphie cesse d’être pour eux un exercice conscient, elle cesse même d’être un art, elle n’est plus que libération. Considérée dans sa totalité, la vie d’un artiste présente donc deux aspects opposés et contradictoires : l’un est négatif, mais correspond à un progrès ; l’autre est positif (c’est-à-dire créateur), mais correspond à un état de plein accomplissement qui ne laisse subsister aucune pensée d’acquisition » (p. 51-5).
Madame Vandier-Nicolas saisit ici un processus fondamental de double renversement qui intéresse notre propos. D’une phase à l’autre il y a en effet, pour la personne elle-même, passage du plein au vide (de la pléthore du psychisme ordinaire à l’oubli de soi), et, pour son mode d’expression, passage de l’impuissance ou de l’insuffisance qui résultait de cet encombrement intérieur, à la plénitude créatrice née de la vacuité.
Il est clair que cette fin positive : écrire ou peindre « naturellement, sans effort, sans intention ni réflexion » ne peut être cherchée. On ne poursuit pas le Spontané, ni même le vide où jaillit celui-ci, car tout vouloir-faire estompe le but. On ne peut accomplir que le vide de soi. Aussi le peintre ne cherche-t-il pas à peindre, ni l’archer à viser la cible ; ils ne travaillent qu’en vue de l’achèvement suprême, dans le désintéressement et le renoncement, et là gît le secret de leur réussite. Ainsi s’expliquent à la fois la durée de la première phase, car longue est la quête de la sagesse, et la grandeur du résultat obtenu, qui touche non seulement l’exercice de l’art auquel s’adonnait le chercheur, mais son être entier si bien que désormais son activité, quelle qu’elle soit, s’avère libre et spontanée, pertinente et créatrice. Ici la voie et le but coïncident, c’est le même Tao, et il ne saurait y avoir d’autre objectif à atteindre. On comprend alors comment' la peinture porte à sa perfection la civilisation… scrute la mutation divine et sonde le mystère' (Tchang Yen-yuan) (note 6 p. 51).
L’entraînement intérieur poursuivi au cours de la première phase, malgré la sobriété des termes employés, et avec toute la richesse, voire la fantaisie d’un cheminement à même la vie courante, constitue une ascèse (non pas un ascétisme) mystique. Le dépouillement apparaît sous ses formes principales : pauvreté ou détachement des biens ou indifférence
297
à l’égard de l’infortune, oubli de soi total, suppression de la pensée dualisante jusqu’à l’inconnaissance ou l’inconscience, vide du temps qui fait vivre ou penser ‘d’instant en instant' dans le discontinu, bref, la pratique constante du “lâcher tout appui ».
On lit que Mi Fou avait appris à méditer selon les méthodes du Dhyâna. « Impassible, rejetant la notion du bien et du mal, celle du vrai et du faux, celle de l’être et du non-être, l’ascète se tient assis, jambes croisées, dans l’état de non-attachement ». D’après un contemporain de Mi Fou, ' la pratique du Dhydna consiste en renoncements… Renoncez à toutes les opérations de votre conscience relative… Retirez-vous en votre intérieur… Si votre réflexion sur vous-même devient de plus en plus profonde, le moment viendra où, pour vous, la fleur spirituelle/1 s’épanouira soudain, illuminant l’univers entier' (p. 168). Le Kin-kang king le confirme : ‘Cet état d’anéantissement total, c’est la réalisation de soi' (p. 229).
1 Littéralement : la fleur du cœur' — il s’agit bien sûr du cœur mystique.
D’un maître du paysage, ses biographes disaient : ‘Il n’était rien qu’il ne comprît ». On l’appelait le ‘Grand Hébété' (p. 233). Dans le sens où on l’entend ici, l’hébétude va de pair avec la perspicacité et l’intuition. Lao-tseu ne dit-il pas : ‘J’ai l’esprit d’un ignorant, obscur, ignare ! ' (p. 42.) Le peintre ne sait plus rien de la technique (il l’a maîtrisée, puis oubliée) ni du paysage quand il peint. En effet, étant donné l’importance dans le Taoïsme de la notion de centre vide — le moyeu de la roue, l’espace dans le vase qui en permet l’emploi, « c’est au Centre Indéterminé que le Sage demeure. Le Centre ne compte pour rien et régit cependant la mutation créatrice. Il règne sur l’univers parce qu’il est vide » (p. 42).
Les conceptions bouddhistes font écho à celles du Taoïsme sur ce point, comme sur celui du détachement. Citant le célèbre Sûtra de l’estrade de Houei-neng, et le Concile de Lhassa traduit par P. Demiéville, Madame N. Vandier-Nicolas en expose les traits majeurs. ‘Le Bouddha est Pure Pensée… Il est “l’Esprit spontané', notre propre esprit, et sa nature est notre « nature foncière », ‘nature spontanée', parfaitement pure, vide, et si vaste cependant, qu’elle peut ‘embrasser tous les phénomènes ».’ Et le Bouddhisme, spécialement l’école subitiste, insiste sur l’instantanéité. Pour accéder à l’essence indifférenciée, il faut ‘retourner la vision vers la source de l’esprit'. « Lorsque l’ascète a vu resplendir en lui-même son propre esprit, il est tout aussitôt délivré… Sa pensée est alors parfaitement détachée de l’objet, elle va et vient en toute spontanéité, semblable à l’eau qui coule librement »… Dans ce cas, ‘l’absence de pensée ne consiste pas à ne penser à rien, ce qui serait une manière de s’attacher à ce rien, mais à penser à toutes
298
choses, d’instant en instant, avec un perpétuel détachement. Si… la pensée se fixe, on sera lié ; pour être délié (libre, délivré), il faut que les pensées glissent perpétuellement sur toutes choses sans jamais se fixer'. L’Éveil est soudain. « L’esprit se saisit lui-même, se réalise et se délivre dans l’étincellement d’une seule pensée » (p. 37).
Ainsi « la droite vue de la bodhi est un état de désappropriation parfaite et d’absolue quiétude ». ‘Dans la « vacuité absolue », dans la “vacuité de non-acquisition”, l’Éveil complet se trouve réalisé’ (p. 41). « Lorsque l’esprit ne s’appuie plus sur rien, chaque pensée devient délivrance et sapience… La vision du véritable artiste se distingue de la vision commune par son caractère immédiat, synthétique et désintéressé » (p. 186).
Dès que l’artiste, comme l’ascète, « est dépossédé de lui-même » et « ne possède plus rien », il « entre en possession du Tout » (p. 243), il accède à une vision globale (p. 189). « Unie à l’Indéterminé, l’âme vibre à l’unisson du monde » (p. 34). Elle « se trouve en consonance avec tous les êtres et toutes les choses au sein du Tout » (p. 2).
« De ce fruit de l’extase, l’esthétique des lettrés fait l’essentiel de l’art », c’est le « don par excellence », par lequel l’artiste se distingue de l’artisan (p. 4). En voici un exemple :
‘Fan K'ouan… avant de commencer à peindre… s’absorbait dans la contemplation des montagnes et des bois, des sources et des pierres. « C’est pourquoi il devint capable de saisir le mont Sumeru tout entier, dans un grain de moutarde… Les mondains, qui prétendent peindre les montagnes sans les connaître sous leur aspect véritable, empilent les pierres et entassent la terre pour se mettre eux-mêmes en valeur. »
‘Tout retour intéressé sur lui-même prive le peintre vulgaire de sa liberté spirituelle ; son regard, obscurci par la poussière, reste trouble. Il ne voit pas le corps idéal des choses’. Au contraire, pour Fan K'ouan, « la véritable nature des choses se révèle à lui dans l’impérieuse simplicité de l’idée créatrice. La virginale puissance de l’acte gratuit se communique à son pinceau » (p. 179). « Dépossédé par l’extase de ses modes individuels de pensée, le mystique est délivré de toute dépendance étrangère à la Puissance qui le meut vers l’acte » (p. 18o).
Seuls méritent le nom de wen-jen ceux qui possèdent le « don » tel qu’il vient d’être défini. On peut dire alors que :
« La peinture des lettrés est un jeu religieux, un mystère de grâce où tout est prévenance et liberté, effusion, surabondance et délivrance.
299
L’artiste qui s’y consacre, saisi par la subite conscience d’une autonomie sans réserve, peint comme l’oiseau chante, comme le vent souffle, comme jaillit l’eau vive. Sa pensée échappe au contrôle de sa volonté dans la mesure ou celle-ci est effort, et non point poussée irrésistible de la vie spirituelle. Son pinceau n’est plus dirigé par le discours, mais par l’intuition intellectuelle, connaissance absolument libre, qui coïncide avec son objet, et, en même temps, le produit » (id.).
Le jaillissement de la liberté dans le vide caractérise désormais toutes les activités de notre Sage-artiste, aussi bien sa jouissance esthétique de « connaisseur » d’art : ‘La perte du contemplatif dans l’objet contemplé est la forme parfaite de la contemplation esthétique. La faculté d’oublier sa propre individualité pour s’identifier avec ce qui est unique, inexprimable et divin (chen) dans une belle chose, est la qualité distinctive du connaisseur’ (p. 181), que sa façon d’aborder le paysage ou le sujet qu’il va peindre :
‘Yu-kö, lorsqu’il peignait des bambous, voyait des bambous, et ne voyait plus l’homme qu’il était. Est-ce assez dire qu’il n’avait plus conscience de lui-même ? Comme égaré, il délaissait son propre corps. Sa personnalité se transformait, et il se métamorphosait en un bambou, d’une pureté et d’une fraîcheur inépuisables' (éloge par Sou Che, le plus illustre de ses disciples, p. 182).
De Sou Che encore, à propos de Li Long-mien :
‘...le peintre est-il obligé de noter ce qu’il ne veut pas oublier ? Il n’en est rien ! Ceux qui peignent le soleil lui donnent habituellement une forme ronde et plate. Pour qu’il en soit autrement, il leur faut oublier le soleil… Celui que meut le ressort même de la création se souvient sans. s’imposer de contrainte. Lorsqu’il se trouvait dans la montagne, l’ermite du Long-mien ne s’attachait pas d une seule chose. C’est pourquoi son esprit se trouvait en sympathie avec les dix mille choses, et son discernement pénétrait les secrets de l’habileté manuelle sous toutes ses formes'
(I). 184-5) —
Contempler c’est ‘s’asseoir et oublier'. « Pour peindre le soleil, il faut l’oublier, en tant que phénomène distinct, pour ne retenir de lui que son idée, forme visible et spécifiée du pouvoir total de réalisation spontanée. Prétendre atteindre l’idée particularisée du soleil serait une erreur fatale. La vie est indivisible ; en cherchant à la dissocier, on la détruit… Il faut se perdre dans le Tout pour retrouver chacun des éléments de l’harmonie totale, et faire retour à l’essence du mouvement pour découvrir intuitivement le rythme propre à chaque objet » (p. 185).
Le vide permet la vue juste ; restituées au vide, les choses revêtent leur perfection. Ne retrouvons-nous pas ici un autre aspect du phénomène
300
de renversement déjà signalé ? Lorsque le relatif si rempli, si chargé, si pesant cesse d’être contraignant et déterminant pour l’homme, lorsqu’il s’efface et que tout objet devient une « figure d’ombre », l’absolu, jusqu’alors offusqué, se révèle, non point en soi, car il est « vide de tout caractère », mais à travers le monde transfiguré. Et serait-il abusif — certes Madame Vandier-Nicolas ne le fait pas — d’interpréter en ce sens l’expression bouddhiste, symbole total de la Réalité, qu’elle mentionne : ' vacuité véritable, existence merveilleuse' (p. 204) ?
Ainsi « la calligraphie et la peinture, la poésie et la littérature, comptent parmi les expressions les plus hautes d’un art de vivre qui intéresse l’homme tout entier. La peinture des lettrés est le chant d’une vie intérieure, qui s’est allégée des fardeaux périssables pour s’éterniser dans l’universelle harmonie » (p. 243) et à l’artiste devenu un sage s’appliquent les deux dernières citations du livre : « C’est comme l’eau d’automne, claire et immobile ; pure, elle est sans activité, quiète, il n’y a point en elle d’obstacle. Quand on parle d’un être comme celui-ci, on le donne pour un homme du Tao, ou encore comme un homme à qui rien ne reste à faire ». « Vide, il est pure efficience, vacant, il est merveilleux » (p. 247).
Le vide à la source de l’inspiration chez les peintres lettrés de la Chine ancienne n’est donc pas un simple vide mental, ni ce qu’on pourrait appeler un vide d’incubation, pendant lequel des matériaux s’accumuleraient et s’organiseraient dans l’inconscient, bien que ce dernier vide ne soit point exclu. Au contraire il se produit constamment lors du travail préalable, pendant la première époque de la vie de l’artiste, au cours de laquelle s’effectue, par l’apprentissage de la technique et l’expression de soi, une sorte de dragage général du conscient et du subconscient. Mais si l’artiste alors, au lieu de s’efforcer de « se mettre en valeur », s’oriente vers un but transcendant, il découvre un vide d’ordre spirituel, le grand dénuement qui accompagne toutes les quêtes vraies de sagesse et de sainteté. C’est dans ce vide-là que jaillissent et la vérité et l’inspiration la plus haute.
Est-ce à dire que tous les peintres lettrés furent de grands libérés ? Une remarque importante va répondre à cette question. Le processus de renversement, qui a lieu de l’une à l’autre des deux phases principales de la vie, joue également, en quelque sorte, à petite échelle. En fait, il est sans cesse à l’œuvre tout le long de la progression spirituelle : chaque renoncement particulier entraîne une libération sur ce point précis. Avant de parvenir au but, une profonde transformation de l’être est donc déjà en cours : chute des préjugés, suppression des craintes ou des hésitations,
301
dénouement des entraves de tout genre, déracinement d’habitudes de sentir ou de réagir. Si l’Éveil est subit, le vide de soi qui le précède et le permet, est progressif. Peu à peu, à mesure que l’artiste, comme l’ascète, se simplifie, s’allège, s’affine, son geste devient plus libre et plus adéquat, plus rapide et plus sûr. Même pour ceux qui n’ont pas atteint la pleine délivrance, par conséquent, cette recherche, à condition qu’elle soit ardente et désintéressée, contribue à libérer l’inspiration.
Mais ce n’est qu’à son terme, lorsque l’ego est effacé, que le geste créateur peut atteindre la perfection. Alors, dans le vide dynamique où se tient l’artiste libéré, face au paysage qu’il contemple, il n’y a plus ni inquiétude ni soucis ; tout en lui est souple et fluide. Dans un complet oubli de soi, dénué d’ambition, de projet et d’intention, il ne tend pas à s’emparer du paysage pour y imposer sa marque propre. Délivré du passé, de ses habitudes et de ses déterminations, ne se projetant plus dans l’avenir, car il n’a plus d’ambition, d’idéal ni de devoir, il vit dans un temps délesté, parsemé de vides qui permettent à chaque instant un nouveau départ, porte ouverte à une liberté toujours renouvelée. Toutes les notions et valeurs statiques auxquelles on s’accroche d’ordinaire étant tombées, d’un regard pur et simple, l’artiste perçoit le paysage en une vision globale et désintéressée ; alors la coulée de vie jaillit spontanément à travers lui comme à travers la nature. Les grandes lignes de forces — celles de ce jaillissement vital — vont seules se dégager puissamment et s’inscrire d’un seul geste, d’un seul souffle, sur le papier ou sur la soie, sans même qu’intervienne sa conscience normale, tant il est absorbé dans l’unité du courant de vie.
La conquête de la sagesse est la destinée naturelle de l’homme et elle peut s’accomplir à travers toutes les activités naturelles, dont les arts. Elle a pour pivot ce vide fondamental, lieu de toutes les créations : de même que le cosmos surgit spontanément du Grand vide, le chef-d’œuvre surgit de la main et de l’esprit vides, et si le spectateur concentre son regard sur le vide médian du tableau, toutes les formes semblent en surgir avec une vie, une intensité, une unité encore plus grandes.
Citons pour conclure quelques lignes d’un poème que Mi Fou composa en regardant un tableau de Sie Ki représentant deux grues ; ces oiseaux étaient célèbres depuis que le duc de Wei avait perdu une bataille et son duché pour s’être attardé à admirer leurs évolutions.
‘Elle tend le cou vers les cieux et jette un cri solitaire
qui demeure dans les oreilles pures.
Sans hâte et l’allure élégante, elle se promène sous le porche.
302
Dans son cœur vaste et vacant, elle conserve (le souvenir) de dix mille li. »/1
Dans le cœur vaste et vacant du bel oiseau demeure l’étendue de l’espace, et dans le cœur vaste et vacant de l’homme qui « garde l’Un » reposent les dix mille êtres et les dix mille choses.
MARINETTE BRUNO.
/1 li : mesure de distance. N. Vandier-Nicolas cite ce poème dans sa thèse complémentaire : Le Houa-che de Mi Fou (1051-1107) ou le Carnet d’un connaisseur à l’époque des Song du Nord. P.U.F., 1964. On trouvera d’un accès plus facile son étude générale sur Le Taoïsme, dans la collection Mythes et Religions, P. U. F., 1965.
Reconnaissant le rôle de ferment joué depuis l’origine des traditions jusqu’à nos jours, par ceux qu’il nommait « maîtres spirituels » Jacques Masui s’interrogeait en 1967 sur la fonction qu’ils pouvaient remplir dans notre monde moderne43.
Y avait-il encore une place pour eux ? Allait-on voir éclore une nouvelle race de guides qui, en marge des traditions, allierait formation scientifique et recherche spirituelle ? Les exigences d’un univers scientifique où les préoccupations sociales prenaient le pas sur le souci d’un salut personnel, l’esprit critique sur le respect et la soumission, semblaient imposer cette évolution et l’on était en droit de se demander si le « don de former des maîtres », la science infiniment difficile de la « transmission » n’allait pas être définitivement perdue. Quinze ans plus tard le débat reste toujours ouvert, loin de s’estomper avec le temps, l’intérêt de ces réflexions ne cesse de grandir.
Le besoin et la recherche obscurs, mais de plus en plus souvent exprimés d’une dimension autre que matérialiste, ont fait se multiplier en Occident sectes, maîtres ou guru dans la plus grande confusion. Ébranlés par les excès vertigineux de la technologie, par les échecs des grandes transformations sociales ou les insuffisances d’une religion socialisée, nombre de nos contemporains pensent trouver leur salut dans un nouveau bien de consommation, importés d’Orient, le maître ou le guru, et laissent s’engouffrer tous leurs espoirs dans ce mot devenu magique, nouveau
42 Article paru dans Le Maître Spirituel selon les traditions d’Orient et d’Occident, Hermès III, nouvelle série, Les Deux Océans, 1983
43 Dans son introduction au volume IV d’Hermès : Le Maître Spirituel selon les traditions d’Orient et d’Occident, 1966-1967.
87
point de fixation des dépendances ou des superstitions, dernier lieu possible de l’illusion.
À la faveur de cette nouvelle mode le terme de « maître » est en effet employé à tort et à travers et appliqué aux fonctions les plus diverses, si bien que c’est au moment où il est le plus utilisé qu’il risque de perdre son sens, et de nous faire définitivement oublier l’expérience fondamentale et universelle qu’il désigne.
C’est pourquoi le rappel net et sans doute élémentaire de quelques points de repère nous semble nécessaire pour éviter que des emplois erronés ou déviés ne fassent perdre le souvenir de cette expérience intérieure spécifique à laquelle ne saurait se substituer aucune technique moderne de communication ; ceux dont l’aspiration est profonde et authentique ne doivent pas être détournés de leur espoir par les faux — semblants qui leur en sont trop fréquemment offerts.
Il ne suffit pas d’apporter le réconfort d’une relation personnalisée^ ou de proposer une forme quelconque de vie communautaire intervention certes bénéfique dans une civilisation où l’individu séparé du monde, des autres et de lui-même est menacé d’asphyxie — pour faire vivre l’expérience de l’intériorité profonde. C’est abuser du terme que d’attribuer le titre de « maître spirituel » à ceux qui généreusement et à bon escient remplissent les fonctions de père, d’enseignant, de directeur de conscience, voire de thérapeute et d’analyste ou même de simple confident dans une société où les relations humaines doivent être réinventées. Si ces derniers nous apprennent ou nous aident le plus souvent à mieux explorer nos facultés, à cerner nos limites, à trouver aisance et équilibre dans un univers déjà construit, telle n’est pas la fonction du « maître spirituel », même si son action se répercute avec bonheur sur ce plan-là. De même nous nous fourvoyons si nous imaginons que la rencontre d’un maître résoudra à leur propre niveau nos problèmes latents sous prétexte qu’il aura le pouvoir de nous fournir un monde conforme à nos désirs, de nous déposer au cœur du paradis terrestre tel que notre rêve l’organise, en portant à la perfection la satisfaction de nos désirs, même les plus nobles.
Si nous sommes animés par l’unique désir du bien-être ici-bas ou au — delà, si nous voulons jouir à l’intérieur de nos limites de nos qualités propres ou de la perspective de notre propre salut, si nous cherchons la
88
maîtrise de nous-mêmes et du monde, il est inutile de prendre les risques d’un choix, ces entreprises ne relèvent pas de la compétence d’un maître spirituel. Mais si, au contraire, nous avons épuisé les charmes de tout ce qui circonscrit, si nous avons pressenti en profondeur que l’issue n’est plus pour nous dans un perfectionnement de nous-mêmes et du monde, si nous désirons échapper à toute forme de limites, de mesures, de fabricatiorypour accéder à ce que nous savons radicalement différent et que nous sentons en nous aussi proche qu’inaccessible, alors la rencontre du maître est imminente. C’est le propre du « maître spirituel » en effet que de nous faire franchir ce hiatus mystérieux qui sépare en nous le monde qui nous emprisonne de celui qui nous libère, de lever cet obstacle invisible contre lequel ne cesse de buter notre impuissance. Le secret de ce passage réside dans un ébranlement de notre être tel que s’éveille en nous la conscience qui échappe à toute dualité. Seul un véritable maître peut opérer cette transformation et actualiser ce qui, sans son efficience, ne restera qu’à l’état de virtualité ou ne se manifestera que fugitivement.
Mais une telle transformation ne peut être improvisée : seul un acrobate expérimenté peut faire faire sans risque ce merveilleux saut périlleux dans le vide qui, arrachant à la caverne des limites et des illusions, projette dans l’immensité sans fond d’une vie réelle.
Aussi est-ce gravement s’exposer que de ne pas s’assurer de la compétence spirituelle de celui à qui l’on se confie pour cette aventure. Si en tout homme résident les germes d’un développement intérieur, n’importe quel jardinier ne peut en assurer la croissance ; beaucoup au contraire, par ignorance ou perversion en détruisent le mécanisme vivant et, confiés à l’action obscurcissante d’un mauvais maître ignorant ou épris de pouvoir, les énergies se perdent, condamnées qu’elles sont à le suivre dans sa destinée infernale. Aussi l’expérience mérite-t-elle que l’on soit vigilant et que l’on se souvienne des signes solidement établis par toutes les traditions, vérifiés de siècle en siècle et permettant une discrimination éclairée.
Comment s’orienter en effet aujourd’hui parmi ceux qui se disent maîtres, ceux que l’on nomme tels, ceux qui ne disent rien et dont on ne peut rien dire, parmi les saints et les mystiques, compte tenu qu’ils peuvent être saints sans être mystiques, et mystiques sans être maître ?
89
Une métaphore, celle de la montagne, nous permettra de situer tous ceux qui, à des niveaux divers et selon des modalités variées, attirent notre attention sans que nous sachions toujours voir avec précision le rôle ou la fonction qu’ils peuvent remplir auprès de nous.
La montagne figure donc l’expérience mystique ou l’intériorité profonde dans sa spécificité, et l’accès à la montagne, l’ouverture du cœur mystique.
Vont jusqu’au bout de cette expérience ceux qui atteignent la cime, mais parmi eux s’instaure déjà une nette distinction. Les uns ont gravi la montagne avec ou sans maître et se tiennent au sommet dans un ravissement continuel. Ils illuminent comme des phares, mais ne peuvent ni ne veulent redescendre. Ce sont de grands mystiques, de grands saints, mais ce ne sont pas des maîtres. Les sûjî les nomment « wéli ». « Le wéli est celui qui est anéanti, et mort par rapport à son propre état, qui subsiste dans la contemplation de Dieu, qui ne peut plus rien dire de son existence individuelle et qui ne saurait être en repos sans aucun autre que Dieu » 44. Totalement perdus dans « le ventre de l’annihilation » les wéli ont fixé leur séjour dans « la région de l’ébahissement » ; « ils n’ont pas reçu la commission d’en perfectionner d’autres », mais la paix et l’amour émanent d’eux comme la lumière de la lampe, ils fascinent les foules qui se recueillent autour d’eux, éblouies par l’éclat de leurs perfections et les effluves de leur ivresse, ivresse dans laquelle ils demeurent.
Comme eux se tiennent sur quelque pic ou plateforme moins élevés des mystiques qui répandent à leur mesure paix ou amour, exerçant une attraction irrésistible sur ceux qui les perçoivent et qui recherchent leur proximité comme une protection lumineuse ; mais ne pouvant redescendre, ses saints ne peuvent prendre des disciples en charge.
44 Abd-Ar Rahman Al Jâmî, Vie des Soufis ou les haleines de la familiarité. Traduit du Persan par Sylvestre de Sacy, Ed. Orientales, Paris, 1977, p. 42.
90
Parmi ceux qui atteignent la cime, il en est d’autres, « les parfaits » selon les sufi, les sadguru de l’Inde et les bodhisattvas qui, ivres et sobres à la fois, allient ravissement et méthode ; ils redescendent des hauteurs de l’unité pour faire faire le chemin aux disciples qui les reconnaissent.
«... Gens que la bonté de l’Être suprême et la faveur éternelle, après qu’ils ont été absorbés dans la source de l’union et dans l’abîme de la confession de l’Unité, a jugés dignes de s’échapper du ventre du poisson de l’annihilation, pour les jeter sur le rivage de la division et dans l’hippodrome de l’existence (sensible) afin qu’ils servissent de guides aux hommes pour leur montrer le chemin du salut et des degrés (de la vie spirituelle). »45
De tels guides jouissent de la plus grande des efficiences, avec eux on apprend à reconnaître les signes qui caractérisent le plus compétent des maîtres.
Ce dernier a gravi la montagne jusqu’au sommet sous la conduite d’un guide émérite qui lui en a fait explorer tous les versants, tous les accidents ; aussi monte-t-il et descend-il sans cesse pour faire faire l’ascension aujourd’hui. Il offre à chacun un trajet en fonction de ce qu’il est et de ce qu’il peut, n’imposant aucune technique, aucun moyen, aucune condition ; il fait monter jusqu’à la cime, évitant toute impasse, tout atermoiement. À sa suite les timorés sont rassurés et s’égaillent dans la montagne au rythme de leur souffle, chacun étant sûr d’être conduit aussi loin qu’il est possible d’aller. Mais les plus ardents sont portés, hissés d’à pic en à pic, le maître leur jette inlassablement la corde d’amour, les accoutumant à toutes les difficultés du terrain qu’ils affrontent sans répit, mais sans effort.
Maître des courants d’amour et de félicité, vivant dans et par la grâce, ce type de guru donne l’amour au cœur éveillé, l’éveil au cœur ignorant et son efficience silencieuse détruit l’ego sans jamais en parler, donnant sans cesse au disciple l’occasion de se sacrifier. Avec lui, grâce et amour sont synonymes et dans son sillage, la perte du moi se révèle épanouissement et découverte de la liberté. Il sacrifie tout à la
45 Ibid., p. 49.
91
progression de ses disciples, peu importe sa réputation, tous les germes d’idolâtrie doivent être détruits, tous les doutes éliminés. Près de lui on touche à l’essentiel, il renvoie uniquement au réel, mais tout s’opère dans le silence du cœur à cœur sans que personne ne s’en aperçoive.
Son enseignement est une découverte intime et silencieuse faite par chacun, une lecture constante des signes que sont ses paroles, ses gestes, ses actes dont le disciple, oublieux de lui-même, déchiffre le sens au fur et à mesure que s’ouvre son cœur et s’affine sa discrimination.
Pour bénéficier de l’efficience d’un tel maître il faut et il suffit de le reconnaître, mais cette reconnaissance est purement intérieure. Il vit en effet caché, aucun signe distinctif ne le désigne au regard et il s’efforce de tenir secrets ses pouvoirs surnaturels multiples. Assumant tous les aspects de la destinée humaine, il refuse jusqu’au nom de sa fonction, il est l’ami, le disciple de son propre maître en qui il se perd et c’est l’en séparer que de vouloir le reconnaître maître à son tour. Sa discrétion et sa simplicité font que seuls s’attachent à lui ceux qui pressentent la nudité de sa vie profonde. Sont ainsi éliminés les amateurs de magie ou de faux merveilleux, ceux qu’exalte une personnalité aux apparences extraordinaires. Ses disciples ou amis ne forment ni secte ni groupe, ont les modes de vie et les personnalités les plus variés, chacun étant révélé à lui-même là où il se trouve.
Issu d’une lignée de guide, un tel maître en forme un ou plusieurs qu’il entraîne à monter et à descendre les pentes de la montagne pour qu’ils puissent faire faire à leur tour le trajet à d’autres alpinistes, formation qui exige de longues années de présence auprès de lui. Il est utile à tous et convient particulièrement à ceux qui redoutent les exercices de tous ordres, mais peuvent renoncer à tout appui et sont prêts au don total d’eux-mêmes, une fois reconnue la pureté du guide ; seuls leur importent les horizons que leur offrira la cime une fois qu’ils auront été conduits.
À côté de ces géants de l’alpinisme, de bons guides de grande renommée offrent leur solide expérience comme modèle. Le guru de ce type a gravi une partie de la montagne avec ou sans maître et chemine en
92
direction du sommet. Tournant le dos à la plaine, il s’en tient manifestement à l’écart, vivant retiré dans la solitude ou partageant au contraire la vie collective des ashrams ou des communautés religieuses qu’il dirige. Révélant à tous que l’ascension est l’unique occupation de sa vie, il arbore de nombreux signes distinctifs qui rappellent sa détermination : tonsure, nom spécial, vêtement de couleur significative, emblème, rosaire… Il organise des pèlerinages de grandes assemblées dans des lieux spéciaux.
Il précède ceux qui le choisissent pour guide, ayant découvert le reflet de la montagne dans ses yeux. Ces derniers sont ardents à suivre les conseils qu’il donne sur la manière dont il faut aborder la montagne. Son enseignement nourri d’expérience s’appuie sur la connaissance des textes. Quand il a un contact réel avec ses disciples, il répond à leurs questions et oriente leurs efforts nombreux et soutenus. Mais comme un guide montagnard qui impose un équipement, des relais, un trajet, il est contraint à utiliser toutes sortes de moyens plus ou moins extérieurs : initiations, mantras, conversion à un système ou à une religion qui sont donnés comme des conditions d’accès.
Maître des techniques, il vise essentiellement à faire taire la pensée pour que se développent vigilance et maîtrise intérieures ; à cet effet il soumet ses disciples à des exercices de toutes de tous ordres : jeûne, concentration, exercices du souffle, postures de yoga… Ces méthodes sont éprouvées, mais quelle que soit la forme imposée, il faut toujours gravir la montagne par soi-même, soumis à l’autorité du guide et entraîné aux efforts les plus acharnés, sans jamais être sûr de le rejoindre sur les versants plus ou moins élevés qu’il a escaladés ; car l’imitation, aussi appliquée soit-elle, reste souvent extérieure et les exercices exigés par les différentes pratiques peuvent toujours détourner de l’essentiel, comme détourne de la lune le doigt pointé vers elle ; toute intuition de l’ascension, tout esprit d’initiative ou de découverte est compromis ; à se plier aux gestes imposés, le disciple risque de ne jamais gravir les premiers escarpements de la montagne parce que concentré tout entier sur des moyens, il risque d’oublier le but ou encore parce que les méthodes qui ont été fructueuses pour son maître ne sont pas forcément adaptées à lui.
93
Ce type de maître convient toutefois aux disciples qu’effraie le vide d’un abandon total, à ceux qui veulent fournir un effort personnel, lutter avec leurs limites ou leur impuissance, à ceux qui ont besoin de règles, pour progresser régulièrement, à ceux qui rêvent de « faire de la montagne », de jouer avec l’équipement de l’alpiniste, mais redoutent le vertige des cimes où les avalanches de la perte du moi.
Certains ont un jour aperçu la montagne ou tout au moins l’ont cru, ils pensent même y avoir fait, sans guide, à l’improviste, une fugitive excursion, mais sans jamais avoir pu renouveler celle-ci, une fois revenus dans la plaine.
De cette échappée ils gardent une nostalgie et se font une auréole ; ils s’autorisent de ce « baptême du feu » pour faire miroiter aux autres leur supériorité. Du haut d’une colline proche de la ville, ils prêchent, ils enseignent, leur silhouette se détache, haute dans le ciel, et se confond avec la montagne à l’horizon pour le regard mal exercé. Redoutable impasse que leur enseignement : leur expérience perdue aggrave en quelque sorte leur ignorance. Ils en font l’objet de discours, en parlent de mémoire, mais avec une conscience qui n’est plus celle du moment et qui s’approprie ce qui échappe à toute saisie ; ils restent prisonniers de l’illusion qu’ils sont eux-mêmes la cause ou la source de l’aventure et que c’est eux seuls qui peuvent la renouveler : grave inconvénient de l’expérience dite sauvage, éclair fugitif qui arrache à la plaine sans jeter définitivement sur les pentes de la montagne.
Incapables de refaire ou de poursuivre leur propre ascension, comment pourraient-il guider les autres ?
Après, il convient de citer ce que nous nommerons les cartographes. De la montagne ils ne connaissent que des échos qu’ils ont perçus dans les livres ou les paroles de ceux qui l’ont gravie. Pour eux la montagne se perd dans des brumes, ils ne peuvent l’apercevoir et ils en rêvent… mais
94
ils savent qu’elle existe et ils veulent en témoigner : c’est un de leurs mérites.
Ils ne l’ont cependant jamais vue ; ils parlent par ouï-dire, leur savoir est de seconde main : par là ils sont dangereux.
Discourant sur la montagne, ils renvoient l’écho d’une vérité précieuse pour ceux qui voient leur intuition ou leur pressentiment intime justifié par des récits plus ou moins évocateurs des ascensions auxquelles ils aspirent.
Ils donnent courage et espoir à ceux qui ne veulent pas se laisser engluer dans les terres boueuses de la plaine : il y a une issue puisque la montagne peut se dessiner un jour à l’horizon, on peut regarder vers le ciel encore vide, puisque sa cime pourrait y surgir ; ils aident leur public à se dégager d’un matérialisme pesant. Leurs lettres, leurs conversations, leurs conférences exercent une influence morale, permettent de reconnaître en soi des intuitions, des vérités qui arrachent aux premiers niveaux de l’avidité et de la rivalité pour faire acquérir ce qu’il est convenu d’appeler une vie intérieure, prise de conscience d’un domaine intime dans lequel on apprend à se reconnaître et à évaluer, découverte d’un moi profond.
Cependant leur ignorance est redoutable ; enseignant les exigences de l’ascension d’une montagne qu’ils ne voient pas, ils recréent une sorte de parcours à l’horizontale dont le réseau est nourri des informations recueillies sur la véritable ascension, ils veulent faire monter sans offrir de verticale, un peu comme s’ils faisaient nager sans eau. À ce régime, ceux qui les suivent se trouvent souvent pris dans le filet stérile d’un univers imaginaire qui, pour être « spirituel », n’en est pas moins trompeur. Ils acquièrent des mérites à parcourir des étapes fictives, leur goût et leur ardeur s’épuisent à des comportements de renoncement, de silence et de solitude qui se révèlent vains parce que non justifiés par la logique naturelle et les bienfaits d’une ascension réelle. Seule l’expérience de la plénitude fonde le renoncement, le courant ascensionnel de l’amour, l’abandon. Sans eux, renoncement et abandon sont non seulement stériles, mais frelatés, font naître des sentiments de frustration, créent une tension, voire une sublimation qui engendrent quelquefois de graves désordres, comme il est possible de l’observer pour certains religieux ou adeptes
95
qu’une règle aveugle livre à la volonté de puissance de supérieurs autoritaires.
Ces avocats d’une vie dite spirituelle recueillent et soutiennent ceux qui, écœurés par les limites d’un rationalisme utilitaire, aspirent à l’élargissement d’un comportement individualiste. Ils dégagent et nourrissent de solides aspirations religieuses.
Mais ces alpinistes en chambre qui parlent d’escalade sans jamais avoir vu la montagne font courir le plus grave des dangers : ils empêchent souvent ceux qui la voient sans le savoir, de la reconnaître. Contre eux protestait en son temps Saint Jean de la Croix quand il dénonçait les ravages des directeurs de conscience sans expérience mystique : ils sont remplacés de nos jours par certains psychothérapeutes qui s’appliquent à ramener sans cesse les élans d’ouverture intérieure à des manifestations régressives et refusent de voir dans l’appel de la montagne une source d’épanouissement de la personnalité. Quand par chance la montagne surgit inopinément, elle échappe en effet à tout ce qui a pu être dit ou imaginé par les colporteurs de seconde main, quelle qu’ait été leur sincérité. Prisonniers de la plaine, ils ne peuvent imaginer les pentes verticales malgré l’application qu’ils ont mise à scruter les récits de ceux qui les connaissent. Et il ne peut y avoir de plus grand préjudice que d’être détourné par ignorance de la plus précieuse des ouvertures, celle du cœur : non reconnue au moment où elle surgit, elle risque d’être perdue à jamais.
À côté de ces chercheurs de l’esprit, on trouve à l’opposé, semble-t-il, mais sur le même plan, les pionniers du corps, cartographes à leur manière, qui proposent la libération à partir de techniques physiques ou ascétiques de tout genre. Ils contribuent, certes, à réhabiliter un exercice ? corporel souvent compromis par un intellectualisme exacerbé et une morale désincarnée. Ils s’imposent en général par la qualité et la maîtrise de leur art. Avec eux on réapprend l’usage heureux de son corps, mais quelles que soient les résistances psychologiques que ces pratiques surprennent ou font tomber, heureuse exploration de soi dans le meilleur des cas, une saine gymnastique, même intériorisée, ne saurait se substituer à l’ouverture du cœur.
Dans la mesure où ces techniques entraînent un effort conscient sur soi, elles risquent en outre de détourner d’une expérience dont la
96
caractéristique essentielle est la spontanéité. Bien des efforts sur ce plan restent stériles, car les enseignants de ces pratiques proposent souvent comme résultat décisif — et c’est ici qu’ils révèlent leur ignorance de cartographes — les symptômes ou les effets d’un processus dont ils ignorent l’origine. C’est le cas des tentatives désespérées de ceux qui par exemple s’acharnent à obtenir l’éveil et la montée de la kundalini à partir d’exercices du souffle : erreur fatale qui prend les effets pour les causes et condamne à l’échec les entraînements les plus acharnés, les plus obstinés. Le souffle se modifie assurément quand s’éveille la kundalini, mais il ne suffit pas de modifier son souffle pour la faire se dresser.
Il faut aussi compter avec ceux qui n’ont pas assimilé les enseignements traditionnels auxquels ils empruntent les exercices qu’ils proposent. Faute de maîtriser l’esprit véritable d’une méthode on en perd le sens et par là le profit.
Les techniques ont chacune une efficacité en elles-mêmes, mais pratiquées hors de la vision du but, elles mobilisent et détournent à leur seul profit immédiat l’énergie qu’elles développent, privant des cheminements plus avancés vers la fin ultime.
Elles peuvent même conduire à des dégénérescences irréparables qui rendent toute reprise du chemin impossible.
Même lorsqu’elles apportent pour d’autres des progrès visibles, celui qui les a vainement et mal tentées pour lui-même en vient à douter des promesses dont la tradition se porte garante, et abandonne toute quête.
Parlant encore d’après la carte, certains affirment que chacun est son propre maître et se tient au sommet de la montagne sans le savoir : ils éliminent ainsi et le choix du maître et l’ascension. Mais n’est-ce pas flatter sans profit ?
Érigeant en doctrine ce qui est seulement vrai à un moment du parcours, ils faussent ainsi la lecture de la carte ; ils isolent un élément qui ne prend son sens que par rapport à un ensemble et retiennent ce qui se révèle à la fin de l’ascension, mais à la condition d’avoir fait le trajet qui précède, un peu comme s’ils voulaient lancer dans l’espace un neuvième étage sans les huit qui le soutiennent. En d’autres termes ils refusent de
97
partir à l’assaut de la montagne sous prétexte qu’ils sont déjà au sommet. Certes toutes les traditions s’entendent pour reconnaître qu’il n’y a pas de « buffle », qu’il n’y a pas de chemin, que le périple intérieur n’est qu’un retour à l’origine, que tout réside déjà sous le brin d’herbe de notre jardin. Mais il faut avoir fait le voyage pour le savoir vraiment, pour en avoir une connaissance réelle. Sinon ce n’est qu’un énoncé verbal dont la répétition inlassable ne peut se substituer à l’évidence intérieure et qui remplace par une illusion fatale la plus profonde des découvertes, celle qui jaillit sur la voie véritable une fois que la Conscience a précisément été transformée par l’efficience et l’amour d’un maître.
À répéter qu’il n’y a pas de montagne à escalader, ils privent du bénéfice de l’exploration. Ils multiplient pour cela paradoxes et joutes dialectiques. Dégageant certes l’intelligence de ses automatismes les plus grossiers, ils entraînent à une gymnastique qui l’assouplit, la familiarise avec la logique d’un univers spiritualisé, mais lui fournissant des formules qui la fascinent, ils lui donnent l’illusion du pouvoir parce que, grâce à cet enseignement, les apparences les plus élémentaires semblent déjouées.
À les suivre on risque de confondre les subtilités d’une science intellectuelle avec le discernement intérieur qui surgit sous la poussée de l’énergie transformée par les courants d’amour et de grâce. Et leurs énoncés « aussi provocants soient-ils, laissent toujours le cœur à sec. Avec eux, il est vrai, on acquiert une certaine rigueur de la pensée et on est sûr d’éviter les inconvénients de la crédulité ; superstition et magie sont éliminées et l’on ne tombe pas dans la dépendance fatale d’une volonté soumise au pouvoir d’une autre. Celui qui enseigne que l’on peut se délivrer seul des angoisses de la dualité par une simple prise de conscience ne devient-il pas — peut-être malgré lui — le maître à penser de ceux qui lui prêtent foi ? La parole qui affirme qu’il ne faut suivre aucun guide devient pour eux référence, vérité. Certains fréquentent pendant des dizaines d’années des séminaires dont ils notent et citent le contenu sans comprendre la stérilité d’un discours qui ne saurait conduire à une transformation réelle.
Cet enseignement satisfait sans doute le souci d’autonomie d’une époque qui, refusant maladivement toute forme d’autorité, nie toute compétence. Il nourrit également les prérogatives de l’esprit critique
98
indispensable pour préserver certaines formes de liberté, pour se protéger en particulier des fanatiques de pouvoir et de domination.
Mais à perpétuellement se protéger, on reste prisonnier de soi, les cœurs se dessèchent, faute d’être éveillés, se désespèrent devant leur propre impuissance. Et derrière cette grande prudence qui se veut indépendance n’y a-t-il pas le refus secret ou ignoré de reconnaître une compétence supérieure à soi dans une personne vivante ? Faut-il enfin renoncer au meilleur pour être sûr d’échapper au pire, mourir de faim de peur d’une nourriture empoisonnée et nier l’efficience d’un bon maître sous prétexte que les mauvais pullulent ?
En marge de ces attitudes variées, mais honnêtes sévissent les meneurs de foule, les chefs de sectes qui vendent une montagne à laquelle ils ne croient pas et déguisent leur avidité ou leur volonté de puissance sous les dehors d’un discours intransigeant.
Charlatans, illusionnistes, ils parquent définitivement dans la plaine les auditeurs les plus crédules qui se livrent à eux, corps et biens, dans une fuite éperdue d’eux-mêmes, payant de leur liberté leur désir infantile de sécurité. Changement de nom, hiérarchie, uniforme, règle collective, chants, renoncement aux ressources propres sont autant de pratiques qui les délivrent de la charge d’eux-mêmes, leur fournissant l’illusion d’une protection et leur permettant de confondre leur refus de s’assumer avec une aspiration qui se croit inconditionnée à l’absolu : et chacun de se perdre dans l’indifférenciation d’une foule aveugle, chacun de se dissoudre dans l’exaltation d’une régression collective, pour le plus grand profit du maître de chœur.
Ce phénomène est le produit d’une société où ne cesse de croître le sentiment d’insécurité et où le comble de l’aliénation s’attribue les privilèges de la libération.
Faut-il aussi nommer ceux qui, plus néfastes encore, détournent les candidats alpinistes pour les entraîner vers des gouffres souterrains sous prétexte de cavernes aux trésors ? Ils promettent en effet des pouvoirs qu’ils sont acquis eux-mêmes, souvent à la faveur d’expériences occultes,
99
et qui dépassent assurément les prétentions d’une simple volonté de puissance individuelle.
Ils imposent aux adeptes qu’ils tiennent sous leur domination un travail constant, les soumettant à des séries d’épreuves variées. Seules des performances surhumaines peuvent les conduire au succès. Par des tensions multiples, ils poussent à leur limite les résistances physiques et psychiques sans tenir compte des risques de déséquilibre et sans assurer les possibilités de repli. Au lieu de renouveler les énergies de ceux qui les suivent, ils brisent sans retour leur vitalité, ôtant toute possibilité d’ascension à venir. Ils n’ont le secret ni de la grâce de l’amour et sont dépourvus d’humanité.
La dureté de leurs cœurs pleins de mépris pour ceux qui échouent, s’atténue sans doute pour ceux qui atteignent leur niveau ou leur puissance. Mais combien parviennent à ce résultat ? Et quel en est le profit s’il se ramène à la jouissance démoniaque ou perverse qui consiste à jouer de son emprise sur les plus faibles ?
Sans doute, est-il plus facile de développer une métaphore que de s’orienter à travers soi-même et les autres.
Mais comment se diriger à bon escient si l’on n’a pas jeté un regard d’ensemble sur les directions possibles ?
Apprendre à discriminer et à distinguer les différents plans ou niveaux de recherche et de réalisation est le seul moyen efficace que nous ayons pour nous protéger des déguisements et des faux-semblants où entraîne la confusion. S’il n’est pas possible de connaître la montagne avant de l’avoir vue, on peut cependant savoir ce qu’elle n’est pas et conserver ainsi la chance de reconnaître un jour celui pour qui les sommets neigeux ont disparus dans les brumes de l’universel amour où plaine et montagne se confondent à jamais.
[122] Parmi tous les systèmes philosophiques indiens, le Shivaïsme moniste du Cachemire apparaît comme celui qui expose de la façon la plus complète et la plus approfondie les divers modes d’influence du maître spirituel.
Dès le début du VIIe siècle et même avant, existaient au Cachemire plusieurs traditions mystiques, Trika, Kula, Krama, etc., possédant chacune sa lignée de maîtres vénérés (sampradāya). Abhinavagupta, qui vivait à la fin du Xe siècle, eut pour guru les plus grands maîtres de son temps et fut initié par eux dans ces différentes traditions ; ainsi Shambhunātha qui relevait du système Kula, lui révéla le Soi et lui enseigna les pratiques d’initiation.
Abhinavagupta commenta certains des traités et des recueils de ces systèmes. La « Somme » de leur enseignement se trouve dans son volumineux Tantrāloka (Lumière des Tantra) consacré aux voies de la libération et composé en vers sanscrits.
Les matériaux qui ont servi à l’élaboration du présent article ont été puisés dans le Tantrāloka ; ils appartiennent donc à l’enseignement d’Abhinavagupta qui fut lui-même un maître célèbre et compta de très nombreux disciples315. [123]
Le rapport de maître à disciple ne se comprend que dans la mesure où l’on garde présente à l’esprit la nature de ce rapport ; Abhinavagupta distingue l’humanité en deux espèces : ceux qui sont « flairés » par la grâce et les autres. Le problème de maître et de disciple ne se pose que pour les premiers, et donc en fonction de la grâce : « Le suprême Seigneur qui projette éternellement le monde dans son énergie, est grâce, il fait émaner et résorbe le monde, il est libre. » (Trikahridaya.)
En effet, dans ce système moniste, Shiva, par le jeu impétueux de sa liberté, voile d’abord sa propre essence en se dissimulant sous les formes toujours renouvelées de son énergie et devient, librement, un être limité et asservi ; c’est encore lui qui, aussi librement, dispense sa grâce et se révèle en sa véritable essence. Que Shiva mystifie ou qu’il accorde sa grâce, sa nature foncière n’est que grâce. Il est donc le seul maître, universelle Conscience ou Je absolu. Sa suprême énergie — la Grâce — veille perpétuellement dans tous les sujets conscients et constitue la relation réelle entre maître et disciple.
C’est une même Conscience qui interroge en tant que disciple et qui répond en tant que maître : sous le premier aspect, conscience imparfaite sans clarté, pleine de doutes et d’incertitudes (vikalpa), sous le deuxième, intense et lucide, elle met fin à tous les doutes (I, 233 et 253 sv.). Ainsi les apparences de maître et de disciple en des corps différents, parce qu’elles sont des constructions imaginaires, disparaissent lorsqu’une seule et même Connaissance libératrice illumine l’un et l’autre.
Il n’importe guère que la lignée des maîtres s’étende à l’infini dans le temps, le guru est un ; quand il libère son disciple, c’est lui-même qu’il libère (235).
Shiva, le premier des gurus, revêt la forme de maîtres multiples : divinités, sages, surhommes et hommes ; à chacun d’eux répond un disciple de la catégorie immédiatement inférieure : Shiva a pour disciple sadhāshiva, différenciation à peine esquissée de lui-même ; à l’autre bout de l’échelle, maître et disciple sont des humains. Mais, partout et toujours, la relation suprême doit se retrouver à chaque niveau : si le guru est un homme, il faut le considérer comme Shiva et soi-même comme sadhāshiva (I, 273).
La grâce apparaît comme indispensable puisque c’est elle qui, imprégnant l’être humain, le rend apte à jouer son rôle de maître et détermine les diverses modalités de la transmission. Le terme guru, qui signifie' lourd “, s’emploie en raison de la grâce dont le poids entraîne des modifications importantes et durables chez le disciple. Sans elle pas de véritable guru. Si Shiva n’accorde pas sa grâce, déclare un Tantra, le guru en dépit de tous ses efforts ne peut instruire le disciple et, s’il le pouvait, celui-ci manquerait de vigilance et ne conserverait pas ce qu’il a reçu ; le conserverait-il, qu’il en perdrait le bénéfice en s’attachant à des jouissances passagères qui arrêteraient toute progression. [124]
Shiva accorde ou refuse sa grâce sans se soucier des mérites ou des démérites des hommes ni de leur connaissance ou de leur ignorance. Si l’on objecte que certains s’efforcent de se purifier et de s’en montrer dignes, en fait, le désir de se purifier est déjà signe de grâce.
Bien que l’Essence soit une, on l’appelle grâce en tant que don gratuit, efficience, force vive qui ébranle le cœur, l’esprit et suscite des vibrations sonores, lumineuses et autres. On la désigne aussi du nom de pratibhā, illumination spontanée. C’est là un terme essentiel pour le système Trika qui met l’accent sur le rayonnement de la grâce, éveil brusque de la puissance divine qui somnole dans le cœur humain. En réalité tout être conscient est éternellement immergé dans cette énergie bénéfique, mais il la capte, l’utilisant à son profit ; ainsi il la sépare de sa source et la prive de son efficience ; il la limite et l’individualise, l’orientant vers l’extérieur, l’assujettissant aux sentiments et aux désirs particuliers. L’énergie unique se disperse en énergies multiples, le corps cosmique en corps distincts, la vibration suprême (spanda) en mouvements limités, et la vie (prāna) en souffles vitaux. Alors l’énergie en soi, infinie et indifférenciée — Je absolu — apparaît morcelée et dépendante.
Mais comme l’être humain ne se sépare pas réellement de sa propre essence faite de grâce, il peut reprendre conscience de soi et recouvrer sa liberté originelle : pour y parvenir, ses énergies dissociées vont converger vers leur centre, le Cœur. Le guru, nous le verrons, aura pour tâche de favoriser ce retour à la source en s’insinuant dans le corps du disciple par divers procédés : il unit ses souffles aux siens, pour réveiller les forces qui somnolent en lui et lui permettre de rejoindre le souffle indifférencié qui le réintégrera dans la vie totale ; ou bien il pénètre en son cœur pour y provoquer les vibrations du Cœur universel ; ou encore, mêlant conscience à conscience, il le rend apte à reconnaître le Soi. Tels sont les trois aspects du retour à l’unité : insertion dans le souffle, éveil de la force vitale (kundalinī) et illumination.
Il existe trois façons d’entrer en possession de la grâce 1. de soi-même, sans intermédiaire, lorsqu’elle s’éveille spontanément. C’est ce processus qu’indique le terme prātibhajñānin, le gnostique, maître par illumination ; 2. par l’intermédiaire des textes sacrés, lorsqu’un homme puise dans les Livres la formule qui le mène à la libération ; 3. par l’aide d’un maître.
Si la Réalité est toujours présente et si la grâce résidant en tout être se manifeste spontanément, pourquoi Shiva se révèle-t-il par l’entremise des maîtres et des Livres sacrés ? Abhinavagupta répond que tel est son bon plaisir et qu’il se révèle à la fois comme guru, comme disciple accédant à l’éveil et comme l’éveil lui-même. Le maître ne manifeste pas la Réalité, il ne fait que libérer le disciple de son ignorance, de ses fausses impressions [125] de dualité « en coupant avec l’épée de l’initiation les liens qui l’attachent au moi ; aussitôt la Réalité resplendit, comme un feu qui couvait se met à flamber lorsqu’on écarte les cendres » (XIII, 175).
Parmi les maîtres eux-mêmes, on distingue l’initié — formé par un ou plusieurs gurus — du prātibho guru qui a reçu l’illumination sans intermédiaire ; mais, par rapport au disciple, chacun peut être appelé sadguru, maître authentique.
Cette sorte de maître bénéficie de l’intensité d’une grâce qui, se répandant soudain sur lui, dilue immédiatement son ignorance. Il s’absorbe dans l’énergie divine et comprend par lui-même la nature du lien et de la libération. Il s’attache alors avec constance à l’essence suprême, s’abîme en Shiva, s’identifiant bientôt à lui. Libéré vivant, il n’a d’autre tâche ici-bas que de délivrer les autres.
Cette intuition illuminatrice qui fait office de maître intérieur surgit des profondeurs du Soi et ne dépend ni des Écritures sacrées ni d’un guru. Dès son apparition, il faut s’y tenir, repoussant toute autre connaissance, à la manière dont on éteint les lampes au lever du soleil (XIII, 179). Seule en effet elle donne la certitude absolue qui met fin aux doutes inséparables de la dualité. Qu’importe si ce jñānin n’a pas été initié dans les règles : il possède la maîtrise véritable, car il a reçu l’initiation de ses propres énergies intériorisées au moment où toutes convergent sans effort vers leur centre et plongent dans la Conscience indifférenciée (141).
Il arrive à ce maître éminent d’accepter l’aide d’un autre maître ou de recourir à l’étude des textes sacrés afin de devenir plus parfait encore et de renforcer sa propre conviction. On le dit alors vraiment accompli en raison de la plénitude de sa triple illumination : à l’illumination spontanée s’ajoutent l’illumination née de la lecture des Agama et celle de son propre maître auquel il finit par s’identifier. Il s’est d’abord exercé assidûment, au cours de samādhi approfondi, à mêler la sapience du guru à la sienne puis, parcourant à sa suite la gamme complète des expériences mystiques, il hérite des connaissances accumulées durant des siècles par une lignée de maîtres qualifiés (IV, 76-77).
Si l’illumination est instantanée, comment se fait-il qu’on puisse la développer ? En fait sa profondeur et son expansion varient ; elle ne s’établit pas toujours de la même manière : tantôt elle fulgure comme l’éclair et ne revient plus ou, d’abord vacillante, elle s’affermit par degrés, avec ou sans l’aide d’un maître ; tantôt elle apparaît d’emblée définitive, faisant de qui la possède un prātibho guru.
Les maîtres n’ont donc pas le même champ d’influence : l’illumination surgit chez les uns pour leur seule libération ; chez d’autres, elle leur permet de libérer en outre un petit nombre de disciples ; chez quelques [126] rares personnes elle les rend aptes à éclairer une foule de disciples ; quant au Maître universel, il libère l’humanité toute entière. On les compare respectivement à un ver luisant qui n’éclaire que lui-même, à un joyau, à une étoile, à la lune et au soleil (XIII, 159 et IV, 139). On reconnaît ce prātibho guru à certains signes dont le plus important est une dévotion inébranlable envers Shiva. Maître des formules et du pouvoir qu’elles recèlent, il domine aussi les éléments, connaît le succès dans toutes ses entreprises, possède le don poétique et la compréhension des Livres sacrés.
Ces divers pouvoirs surgissent au moment où la discrimination intuitive s’éveille : ses organes et sa pensée, purifiés, et donc parfaitement conscients, il peut voir et entendre à distance ; mais il ne doit employer ces pouvoirs que pour faire naître chez ses disciples foi et certitude. Ainsi provoque-t-il en eux la confiance qui l’aide à les libérer (XIII, 183).
Le maître digne de ce nom doit avoir la connaissance parfaite du Soi (ātman) et s’être identifié à Shiva. Abhinavagupta en donne une belle définition quand il le qualifie « d’ardente vigilance ».
Indifférent à l’opinion d’autrui, il fuit toute ostentation, à l’inverse de l’hypocrite qui se présente comme un maître illuminé alors que la connaissance du Soi lui fait défaut. L’énergie obscurcissante dont cet hypocrite est victime se produit, comme la grâce, indépendamment du mérite et du démérite ; Shiva, usant de sa liberté, dissimule ici totalement sa nature même et tourne en dérision son propre rôle : il ne peut aller plus loin dans le jeu ! L’être éveillé, en raison de sa libre conscience, peut se comporter en public comme un ignorant puisqu’il se moque des conventions sociales ; de façon analogue l’ignorant, sous l’influence de l’énergie divine peut agir en maître avec le plus grand sérieux, alors qu’il n’éprouve que mépris pour ce comportement, car lui non plus ne se confond pas avec son rôle ; l’absence de sympathie pour ses propres actes condamne celui qui n’a pas reçu la grâce (XIV, 6-8).
Il faut encore distinguer avec soin le véritable guru des jñānin et des yogin qui n’ont pas surmonté les tendances à la dualité et ne constituent pas des maîtres authentiques. Il existe des gnostiques pourvus de connaissance, mais privés d’expérience mystique et des techniciens du yoga doués d’expérience, mais non de connaissance. Selon les Shivaïtes du Cachemire jñānin et yogin se divisent les uns et les autres en quatre groupes qui se correspondent à peu près : au premier appartient le théologien qui ne s’attache qu’à la théorie et peut enseigner les textes révélés qu’il a étudiés et compris. Parallèlement le yogin initié au yoga s’adonne à des pratiques variées. Du second groupe relève le gnostique qui a le sentiment vécu des traités dont il pénètre le sens profond à l’aide d’une discrimination intuitive (cintā). Dès que son intuition bien exercée lui permet de reconnaître [127] le Soi, il devient un yogin zélé qui parcourt avec ardeur le chemin du yoga et lui consacre sa vie. Mais seul le gnostique du troisième groupe316, est un véritable maître, car il possède la complète expérience mystique qui, à son sommet, rejoint l’illumination permanente, la Connaissance essentielle du divin ; même s’il n’a pas lu les Traités, il les connaît d’instinct. Il est, en outre, maître en samādhi d’où son nom de siddhayogin, yogin accompli. Bien qu’il ait rejeté toute dualité, il garde assez conscience de la distinction entre guru et shichya 317 pour accomplir son œuvre libératrice. De cet ordre relève le maître efficient capable de conférer à de nombreux disciples à la fois la Connaissance de soi et les pouvoirs surnaturels du yoga. Abhinavagupta en est l’exemple par excellence.
Il existe encore un quatrième ordre de jñānin et de yogin très parfaits (susiddha) ; comme ils demeurent sans discontinuer dans le samādhi indifférencié, tout est pour eux plénitude absolue ; ils ne perçoivent ni lien ni libération et ne peuvent, en conséquence, prendre en charge de disciples (XIII, 328).
Un Texte sacré définit la tâche fondamentale du guru : « O Bien-aimée, déclare Shiva à la Déesse, celui qui, dans les Livres saints ou de la bouche du maître, apprend ce que sont l’eau et la glace, n’a plus de devoir à accomplir, cette présente naissance sera pour lui la dernière. » Le guru faisant fondre le cœur du disciple rend à leur nature fluide les glaçons durs et morcelés de ses pensées, et le disciple se laisse emporter en toute confiance par l’eau vive de la vie indifférenciée suivant les plus subtiles des incitations du guru et de Shiva. Confiance et soumission de sa part sont donc indispensables. Il ne peut participer à la connaissance mystique et au pouvoir du guru s’il ne s’absorbe totalement en lui. Cette soumission tend à l’identification avec le maître puis avec Shiva ; par le don de soi la personnalité factice s’anéantit de façon radicale. Pourtant le disciple ne devient pas esclave ; il n’obéit en fait qu’à sa nature profonde et découvre la liberté au sein du plus complet des abandons.
Les Tantra distinguent trois sortes de grâce, intense, moyenne et faible, chacune d’elles se divisant à son tour, selon son intensité, en trois espèces (Ch. XIII).
De la grâce dépend le désir : aspiration de l’être entier vers Shiva en une dévotion sans partage, désir de briser les entraves ou enfin désir de se libérer tout en continuant à jouir jusqu’à la mort des plaisirs de ce monde. [128] Selon la force de ce désir, l’adepte rencontrera un guru très efficient ou un simple yogin et, s’absorbant en lui, il parviendra au niveau spirituel correspondant à son inclination profonde.
L’immersion de la conscience du disciple dans la conscience élargie du maître étant ce qui permet à l’initié de briser ses propres limites, nous étudierons les différents modes de transmission de guru à shichya d’après la compénétration entre grâce divine, maître et disciple dont cette transmission dépend.
La Conscience ultime qui s’était obscurcie peut à nouveau s’illuminer immédiatement ou médiatement : le plus haut degré de communion 318 de maître et de disciple dans la grâce se produit d’emblée, se traduisant en pure béatitude. Trois autres sortes de communion utilisent divers intermédiaires, qui vont du simple élan de la volonté jusqu’aux pratiques assidues ; les efforts du guru et du shichya s’imposent d’autant plus que la grâce s’affaiblit et que la communion se montre moins parfaite. La première, propre à Shiva, a pour seul appui la volonté ; la seconde, dépendant de l’énergie divine, a recours à la connaissance intuitive, et la troisième met en œuvre l’activité des organes sensoriels, du corps tout entier, des souffles et de la pensée.
La compénétration entre Shiva, le maître et le disciple, éternellement accomplie, échappe à toute voie. À la vérité, Shiva transcende initiateur, initié et initiation ; comment donc parler de pénétration ? Qui d’autre que lui pourrait pénétrer en Shiva, l’unique Réalité ? Nous devons avec Abhinavagupta envisager le problème sous l’angle de la relativité, les obstacles s’évanouissant spontanément selon l’intensité de la grâce reçue :
1. Foudroyé par la plus puissante décharge de l’énergie divine, l’être élu atteint l’identité à Shiva-Bhairava, mais meurt aussitôt ou, s’il survit encore quelque temps, frappé d’inertie, il ne peut servir de guide.
2. Quand la grâce encore intense, quoique à un moindre degré, s’établit d’emblée de façon définitive et que le corps l’assimile, l’ardent adorateur de Shiva accède à l’état de maître génial 319 dont nous avons déjà parlé. Il discerne en un instant, et de lui-même, la Réalité resplendissante, libre, qui déborde de félicité, c’est-à-dire le Je dans lequel tout se reflète.
Cette grâce peut aussi lui être transmise par un maître qui, impassible au centre même de l’énergie, agit par simple rayonnement spirituel. Celui qui bénéficie d’une telle grâce doit être animé d’une grande ferveur [129] et ne s’attacher qu’à l’essentiel, Shiva. Deux conditions suffisent : il doit d’abord posséder un Soi très pur, apte à comprendre d’instinct que, pour reconnaître la Conscience en sa plénitude, rien n’est requis, ni yoga, ni concentration, ni aucune activité ; en effet, la Conscience brillant de façon spontanée, il n’existe d’autre moyen de l’appréhender que son éclat même. À cette certitude que la Conscience s’épanouira d’elle-même, une fois les modalités évanouies, doit s’ajouter la conviction que son guru baigne dans la Réalité ineffable et peut conférer la grâce de cœur à cœur sans intermédiaire (anupāya) « comme on allume une lampe à une autre lampe ». Cette conviction ou vision intuitive (darshana) importe essentiellement, puisque c’est par elle, et par elle seule, que le disciple participe à la parfaite absorption en son maître.
Ces conditions remplies, il suffit au shichya d’entendre la parole du maître — simple allusion à Shiva, identique au Soi — pour que cette connaissance se réfléchisse en lui comme dans un miroir ; mais il doit prendre intensément conscience de son identité à Shiva. Ainsi, à l’issue d’une parfaite identification avec son maître, s’absorbe-t-il dans la Conscience indifférenciée. Il repose dans la béatitude dont la saveur se révèle partout la même. Tel est le meilleur des disciples qui, selon la définition d’Abhinavagupta, « goûte sans cesse la complète félicité ».
Le maître ne prodigue ici ni conseil ni enseignement, car un disciple digne de cette transmission ineffable n’a besoin d’aucune explication ; s’il s’agit d’un disciple médiocre, ignorant des subtilités de la vie mystique, le guru sera astreint au silence ou au mensonge, toute parole étant mensongère par rapport au Réel.
3. La grâce intense encore, bien qu’adoucie, procède de la volonté divine ; elle suscite chez celui qui la reçoit un tel désir de se libérer que ce désir conduit bientôt au maître parfait (sadguru). Le disciple le rencontre tout naturellement, soit qu’il le découvre lui-même, soit que des amis le lui fassent connaître. C’est aussi cette grâce qui pousse à quitter un maître inefficient au profit du véritable guru égal à Shiva.
Ayant reconnu le Soi, le mystique se libère immédiatement ou graduellement et devient un libéré vivant : il ne renaîtra plus. Puisque la libération dépend en ce cas d’une connaissance parfaite, le maître doit être un gnostique possédant la science complète des traités et des catégories de la réalité ; un simple yogin ne servirait ici de rien. Ce jñānin peut être un maître illuminé ou un maître initié. Comme le maître de l’initiation 320 précédente, il transmet la faveur divine d’une manière ineffable ; notons pourtant une différence dans l’attitude du maître comme dans celle du disciple : le guru n’est plus tout à fait inactif, il examine avec attention [130] le disciple afin de juger si, bien purifié par la grâce, il est digne de la communion immédiate ; de son côté le disciple ignore que le maître est au centre de la Réalité libre de processus et de moyens ; sa conviction ne joue donc plus de rôle prépondérant. En outre, la transmission elle-même présente de légères différences : aux dires d’un Tantra, le maître agit sur le disciple comme un serpent qui, par son seul regard verse son venin à distance.
Au cours de ce second type de darshana, le disciple assis en face du guru qu’il contemple s’établit aisément dans la suprême Réalité, la conscience illuminée du maître passant dans celle du shichya par l’intermédiaire d’une parole, lors de l’explication d’un texte sacré, par l’intermédiaire de la formule mystique (mantra) qui est compréhension intuitive du Je, formule éminente. Le guru peut encore entrer dans le souffle du disciple, comme nous l’expliquerons en détail ; enfin, il lui confère une initiation libératrice qui au moment de la mort le sépare de ses souffles vitaux. Ainsi le maître rayonne la grâce : qu’il pense, parle, regarde, respire, ses moindres attitudes et paroles sont chargées de force spirituelle. Par une seule de ces initiations ou par toutes, il manifeste l'efficience du Je au disciple dont le dévouement et la foi lui ont donné satisfaction totale, car l'essentiel est l'amour constant qui unit guru et shichya.
Signalons encore une troisième forme de darshana sans intermédiaire, due elle aussi à une grâce intense : certains êtres privilégiés perçoivent en rêve ou durant le samadhi des hommes et femmes accomplis nommés siddha et yoginī ; ayant reçu d’eux l’ordre d’exécuter un acte remarquable, exigeant un grand courage, ils s’absorbent dans la Réalité indicible dès qu’ils ont obéi.
Si le disciple ne peut pénétrer immédiatement dans l’Essence lumineuse à l’aide de la seule présence d’un grand maître, il doit, pour s’élancer vers l’absolu, se servir comme tremplin de sa libre énergie. Repoussant alors tout ce qui n’est pas Shiva, il s’abîme en Lui. Cette « via remotionis » 321 lui donne accès au plan cosmique où le Soi resplendit dans sa majesté originelle, identique à Shiva, source de toutes les énergies.
Une communion de Shiva, du maître et du disciple aussi parfaite ne peut se produire que chez un shichya vigilant, sans désir, pur de pensée dualisante (nirvikalpa) ayant pour guru un homme doué d’illumination. Ce dernier se bornera à indiquer au disciple que l’univers, en tant qu’énergie divine, se réfléchit en Shiva, Conscience universelle, et n’a de réalité qu’en lui. Percevant ainsi le monde comme un reflet de sa propre conscience, le disciple n’est plus son esclave, mais son soutien. Le maître dévoile aussi d’autres rapports entre le Je et l’univers, soit que le je [131] l’émane par l’entremise des phonèmes, soit qu’il le résorbe au moment où toutes les formules se contractent en une seule, aham, Je absolu, identique à Bhairava universel et quiescent (Ch. III).
Les communions immédiate ou divine sont exceptionnelles. En général, même chez les très grands mystiques — dont le nombre d’après Abhinavagupta est des plus réduits — la grâce, puissante encore, s’établit avec fermeté, 322 mais elle déploie son efficience peu à peu au cours de la vie. La compénétration entre Énergie divine, maître et disciple va donc s’approfondissant et les prises de conscience doivent être répétées. C’est aussi avec l’aide de toutes ses énergies portées à leur maximum que l’initié se libérera de ses entraves, atteignant d’abord l’illumination et, plus tard, l’identification à Shiva.
Dans la voie de l’énergie où la connaissance joue un rôle essentiel, le guru est irremplaçable, car il supprime les obstacles entre le disciple et la Réalité : constructions imaginaires, doute, manque de confiance ; d’autre part il renforce sa foi et sa conviction. Subtilement, il agit sur la pensée et l’inconscient du disciple, les purifiant de leurs tendances à la dualité. Il transforme les convictions erronées — croyances à l’asservissement — en convictions diamétralement opposées, certitude de l’identité au Seigneur dont le corps est l’univers et le Soi, la Conscience. Étayée par la pratique constante de la contemplation (bhāvanā), une telle conviction élimine les doutes et les fluctuations qui empêchent l’adhésion au Réel.
Le guru développe également chez le shichya le juste discernement (sattarka), pouvoir de discrimination entre l’essentiel et le superflu ; ainsi l’initié apprend à reconnaître les caractéristiques d’un bon enseignement et celles du véritable maître doué de connaissance intuitive (pratibhā). Parallèlement, le guru lui enseigne l’inutilité des moyens indirects relevant du yoga (contrôle du souffle, postures et autres) étant donné que, dans cette voie, seul est nécessaire le Savoir lumineux issu d’une discrimination exacte.
Afin d’exorciser le fantôme du pur et de l’impur323, celui des prescriptions ou interdictions morales, sociales et religieuses, le maître éclaire d’un jour nouveau ce que doit être le comportement tout intérieur d’un yogin : chaque activité, même la plus humble, sert à la prise de conscience ininterrompue de soi, lui tenant lieu de prière. Une idée quelconque traversant son esprit : telle est sa méditation. Tituber, ivre d’un excès [132] de la grâce divine : telle est l’attitude mystique par excellence. Don de toute chose au Seigneur et à lui seul : voilà le sacrifice. L’offrande du monde différencié dans le feu de la Conscience de Bhairava, voilà l’oblation. La perception de l’égalité en toute chose : tel est son vœu le plus parfait et une réflexion intense sur sa propre Essence, le véritable yoga.
Le maître transmet en outre à l’initié des formules (mantra) efficaces et fait monter en lui son énergie (kundalinī) ; enfin à l’aide de certaines attitudes (mudrā), il lui apprend à équilibrer, pour les unir intimement, son expérience interne — celle du Soi révélé — et son expérience externe — celle de la vie quotidienne (Ch. IV).
Avec la voie de l’énergie, nous venons de le voir, la pensée discursive se purifie d’elle-même sous l’effet de l’intuition discriminatrice et le disciple atteint l’état d’énergie divinisée, dès que la Connaissance se manifeste à lui. Mais quand la grâce faiblit, l’homme ordinaire chemine lentement par une voie détournée ; la purification de la pensée dépend alors de moyens limités. Maître et disciple devront faire effort sur le plan du yoga et de la connaissance. Le guru n’est plus nécessairement un jñānin ou un sadguru, un yogin suffit à la tâche. Simple instrument de la grâce, il la transfère à l’aide de formules, d’impositions de mains, et impartit un enseignement philosophique et religieux s’adressant à la personne entière du shichya. Il emploie des procédés variés, dont le plus élevé est la méditation intellectuelle. Nous mentionnerons par ailleurs la poussée ascensionnelle du souffle qui éveille la force vitale (prānakundalinī) ainsi que de nombreuses formes d’initiation dont nous ne retiendrons que la plus importante (Ch. V).
Si les initiations externes ont pour point de départ le niveau inférieur de la voie individuelle, elles s’intériorisent bientôt et débouchent sur la voie divine de Shiva. Nous ne donnerons donc qu’un aperçu du culte préliminaire
Le guru commence par vénérer l’ensemble des divinités, la lignée des anciens maîtres, les yoginf, la Déesse de la parole et les gardiens des directions de l’espace. Il s’assure ensuite que Shiva l’autorise à célébrer le rite. Il médite alors sur le cercle sacrificiel, les objets du culte (vase, etc.), le feu et le Soi comme formant un tout. Après les offrandes d’usage versées dans le feu, il s’adresse ainsi à Shiva : « Tu m’as consacré maître, ô Seigneur, accorde Ta grâce aux disciples ici présents qu’incite l’énergie divine ; bénis-les directement Toi-même en les initiant en rêve ou par [133] l’intermédiaire du maître ». Puis le guru invite Shiva à pénétrer en lui afin de ne faire plus qu’un avec lui.
Il se purifie ensuite en récitant une formule associée à des impositions de mains qui remontent des pieds au sommet de la tête, puis il se concentre sur l’univers reposant en son corps ; il atteindra de cette manière le niveau spirituel qu’il désire. Il place alors le disciple en face de lui, examine ses dispositions et tendances afin de l’initier selon les fruits de la grâce qu’il découvre en lui (XV, 20), car les effets de la cérémonie correspondent à la commune intention de l’initiateur et de l’initié. Cette intention apparaît donc comme fondamentale : une même initiation donnée à plusieurs disciples assouvit les désirs de qui cherche le bonheur ici-bas et procure la révélation du Soi à qui aspire à se libérer (XV, 20-23).
Vient ensuite la partie la plus intéressante de cette initiation : la pénétration de la conscience illuminée du maître dans la conscience obscure du disciple ; cette pénétration se comprend si l’on se souvient que règne une Conscience unique, « ce grand océan, domaine infini de l’Illumination ».
Déjà une ancienne Upanishad, la Brihadāranyaka (I, V, r7) décrit la transmission (sampratti) du souffle d’un père mourant à son fils : « Quand il trépasse en ce monde, il pénètre avec ses souffles (ses sens et ses facultés) dans son fils. Par son fils il garde un support dans ce monde et les souffles divins, immortels, pénètrent en lui. » À cet extrait, ajoutons un autre de la Kaushitakī (II, 15) : « Quand le père est sur le point de mourir, il appelle son fils. Après avoir jonché la maison d’herbes nouvelles, avoir installé le feu… le père se couche, revêtu d’un costume neuf. Une fois arrivé, le fils se couche sur lui, touchant avec ses organes des sens les organes des sens (du père). Ou bien le père peut lui faire la transmission, (le fils) étant assis en face de lui. Il lui transmet donc : « Je veux transmettre en toi ma voix, dit le père. — Je reçois en moi ta voix, dit le fils. Je veux mettre en toi mon souffle, dit le père. — Je reçois en moi ton souffle, dit le fils… » Il en va de même pour regard, ouïe, goût, actions, plaisir et souffrance, démarche, esprit, etc. Et son fils les reçoit.
L’initiation du fils spirituel s’inspire de cette ancienne transmission puisque, par elle, l’initié hérite la personne ainsi que les biens mystiques de son maître.
Le guru ne peut éveiller la force vitale (kundalinī) de l’homme qu’il va initier sans avoir au préalable purifié son souffle. Dans ce but il fait entrer son propre souffle à un point du canal médian où expiration et inspiration s’équilibrent et s’apaisent. Puis il infuse ce souffle expiré, pur et plein d’énergie dans le souffle inspiré du disciple ; reprenant ensuite dans son propre souffle le souffle que celui-ci expire, il le purifie ; il poursuit sans interruption ce processus qui s’effectue automatiquement et souvent même à l’insu du disciple. On reconnaît un souffle purifié à ce qu’il vibre. Apte à s’insinuer dans le canal médian, il forme le souffle (134) ascendant (udāna) désigné par le terme kundalinī. Aussitôt le souffle purifié, le guru s’insinue dans le disciple en tant qu’énergie kundalinienne. Les modes de cette transmission ou pénétration nommée vedhadīkshā, que décrit brièvement Abhinavagupta (ch. XV), furent tenus secrets durant des siècles et conservés dans des Tantra comme le Shrīgahvara, l’Impénétrable.
Un savant qui posséderait la connaissance théorique des Traités n’a pas la compétence pour conférer de telles initiations ; il y aurait danger si, par une faute du guru, la kundalinī prenait un cours descendant au lieu de s’élever à travers les centres. Il est donc indispensable que le maître soit avisé, expert en yoga et de plus parfaitement exercé à plonger en lui-même puis à reprendre contact sans discontinuité avec le monde extérieur.
Ayant pleine conscience de son identité à l’univers et de l’identité de l’univers à Shiva, il fait passer son être divinisé dans un disciple qu’il aime comme un fils : souffle dans le souffle, pensée dans la pensée, cœur dans le cœur, lui permettant ainsi de s’identifier à son tour à Shiva. Tout d’abord le guru élève sa propre kundalinī du centre inférieur au centre supérieur, transperçant successivement le centre radical (au bas de la colonne vertébrale) le nombril, le cœur, la gorge, le sommet du palais, le milieu des sourcils, le front et le sommet du crâne. Puis, par des moyens qui varient selon la forme de transmission, formule, résonance, poussée ascensionnelle du souffle ou de l’énergie, félicité, il agit sur le disciple assis en face de lui en sorte que leurs souffles s’accordent naturellement ; la kundalinī du maître et celle du shichya montent par degrés en totale harmonie. Parvenues au sommet de leur ascension, elles reposent en pleine félicité ; l’homme asservi se dégage de ses liens et jouit de la Connaissance ultime ainsi que de pouvoirs surnaturels.
Dans cette initiation par le son324, le maître fait monter sa kundalinī qui spontanément se met à résonner. Cette résonance devient de plus en plus subtile à mesure que s’élève l’énergie, son apogée coïncidant avec la prise de conscience de soi. Cette résonance pénètre dans le cœur de l’initié et, de là, descend jusqu’à son centre inférieur, remontant ensuite au centre supérieur. Contrairement à ce qui se passe d’ordinaire, cette descente de l’énergie n’a rien de dangereux, car c’est le fait d’un yogin en samādhi dont la force vitale a pénétré dans le canal médian ; en outre, cette descente qui a lieu au début de la pratique est bientôt suivie d’une ascension. [135]
La résonance se produit au même instant dans la voie médiane du guru et dans celle du disciple, tous deux vibrant au même rythme, à la manière de deux vînā harmonieuses jouant de concert, mais qui seraient conscientes d’elles-mêmes et de leur accord.
Au cours d’une autre initiation nommée binduvedha, le guru arrête sa kundalinī au centre nommé bhrū, entre les sourcils et, l’ayant rendue semblable à une flamme, il illuminera l’initié, la faisant pénétrer en lui par le centre correspondant si celui-ci est purifié ou, à défaut, par le cœur. Cette pratique n’éveille que les centres situés entre les sourcils et le centre supérieur.
La pénétration par l’énergie est par contre une voie complète : tous les centres se trouvent animés par une force spirituelle intense ; ils vibrent au passage de la kundalinī et tournent comme des roues, d’où leur nom de cakra. L’initié connaîtra ainsi ses divers centres de manière intuitive et certaine, il jouira de leurs félicités spécifiques et il aura plein pouvoir sur eux. Il pourra par la suite, s’il devient à son tour un maître, les éveiller chez ses disciples.
Abhinavagupta donne de brèves explications sur cette obscure pratique : grâce à une poussée ascensionnelle du souffle chargé d’énergie (uccāra) jusqu’au centre supérieur, l’initiateur s’identifie à Shiva, maître de l’énergie cosmique, et s’empare, lui aussi, de cette énergie. Il suscite ensuite une poussée analogue dans le centre inférieur de l’initié, où l’énergie encore indifférenciée et enroulée sur elle-même se déploie. Alors la divine énergie pénètre dans l’univers entier sans effort, de façon automatique à la manière d’une abeille qui bourdonne.
Ce processus s’achève par l’initiation dite de l’énergie dressée ou du serpent. L’énergie universelle et suprême, précédemment lovée, s’épanouit en une félicité cosmique, comme un cobra dont le quintuple capuchon s’étale complètement, toutes les modalités de l’univers bien épanouies. La kundalinī part de son lieu d’origine d’où elle jaillit comme l’éclair et accède, sans interrompre son mouvement, au séjour du brahman 325 où elle se repose à jamais. Ainsi entre-t-elle dans le corps, ainsi pénètre-t-elle dans le Soi.
Tant que l’initié demeure conscient d’un processus, on peut parler de pénétration, mais, dans l’initiation suprême, cette impression s’efface, toute dualité exclue ; ainsi la voie médiane disparaît ; la force spirituelle omniprésente ne va plus d’un centre à un autre, les modalités variées, [136] organes, souffles, sujet connaissant, connaissance et connu s’évanouissent ainsi que la pensée pour faire place à la suprême et unique félicité indifférenciée. Le disciple ayant perdu le sentiment de son corps, de son moi, ne se distingue plus de cette compénétration universelle où il accède au plan cosmique. Telle est la plus haute des initiations (XXIX, 237 à 254).
Le véritable guru est en définitive celui qui donne la pleine consécration, rendant autrui capable d’initier et de dispenser la grâce. Par cette consécration le disciple sera couronné souverain en compagnie de la Reine, l’Énergie (Shakti), et possédera non seulement l’illumination qui lui permet d’échapper aux forces cosmiques, mais encore la puissance divine par laquelle il en deviendra maître.
Le guru donne l’investiture à celui-là seul qui en est digne, qui a fait vœu d’obéissance, possède une connaissance intuitive très exercée et se voue sans partage à l’adoration de Shiva. Cette initiation s’adresse à tous, femme, eunuque même, indépendamment de caste, lignée, etc., pourtant on doit la refuser à qui s’attache aux marques extérieures de la piété, à l’ascète shivaïte qui couvre son corps de cendres : elle demeure l’apanage de celui dont la sainteté reste secrète.
Le nouvel initié doit témoigner à tous les hommes amour et compassion, être généreux à leur égard, expliquer les textes sacrés et initier sans hésiter ceux qui ont reçu la grâce. Dès qu’il a formé un maître et transmis son pouvoir, et seulement alors, il peut, sans encourir de blâme, cesser d’accomplir les rites d’initiation.
L’onction étant purement intérieure, elle se passe du cérémonial d’usage : offrandes, purifications… Le sadguru l’accomplit donc sans intermédiaire (anupāya) : il lui suffit de s’identifier à Shiva puis de contempler le disciple comme identique à lui-même pour que ce dernier s’identifie effectivement à la Réalité. Il prie Shiva de bénir le disciple et de le mettre en possession, par sa grâce, de l’énergie divine ; celle-ci le consacrera maître.
Après avoir reçu l’onction, il incombe encore à l’initié d’acquérir l’efficience des formules et de s’identifier au maître dans l’efficience comme dans la Connaissance. Pendant six mois il brise ses derniers liens et cherche à s’imprégner de l’efficience de la formule (mantravīrya) qui l’identifiera à la divinité dont il souhaite acquérir la puissance. Dès qu’il y est parvenu, il retourne auprès de son maître et reçoit une dernière initiation : du cœur du guru sort une essence subtile que l’on compare à un son apaisé, à une ligne droite qui s’élève (kundalinī dressée), à un cristal, blanche ambroisie. Le maître fait monter cette essence par la voie médiane jusqu’au centre supérieur et, de là, l’énergie du souffle dans sa plénitude emplit de cette essence le cœur du disciple. Il récite alors une formule fulgurante ; celle-ci à la manière d’une flamme fait fondre la dualité, apaisant toutes les formes d’agitation. La formule ainsi embrasée, à l’apogée de sa force, pénètre directement dans le cœur du disciple ; le guru la reprend puis l’infuse à nouveau, en un constant va-et-vient de cœur à cœur. Quand la formule a exercé son action dans le cœur du disciple, ce dernier expérimente l’énergie devenue très subtile qui, à l’état suprême, repose dans le centre supérieur où elle s’unit à Shiva. À ce stade elle envahit le cosmos. Enfin le maître met en branle le processus inverse et ramène l’énergie dans son propre cœur. Les mantra que l’initié donnera à ses disciples posséderont l’efficience (Ch. XXIII).
Par cette initiation le disciple quitte son corps à l’instant même et atteint la libération. Une telle initiation s’adresse de préférence à un homme qui, s’étant consacré au service d’un guru peu avancé, a manqué sa vie. Alors, si la grâce le favorise, au moment de sa mort, sa famille ou ses amis font appel à un grand maître, car il faut un guru exceptionnel pour donner cette sorte d’initiation. Après s’être assuré que l’homme est parvenu au terme de la vieillesse ou que sa maladie est mortelle, le maître purifie graduellement toutes les portions de son corps par une imposition spéciale nommée « nuit de la destruction universelle » faite non avec la main, mais avec un poignard aiguisé. On la dit semblable au feu de la destruction finale, car elle consume le corps du disciple. Le guru, se concentrant sur le feu, doit entrer avec son souffle dans le corps du shichya par son gros orteil et non par les narines ; puis à l’aide de la seule méditation, il disjoint ses articulations et ses points vitaux. La mort du disciple doit coïncider avec le moment où s’achève l’oblation qui clôt la cérémonie (Ch. XIX).
§
Les pouvoirs extraordinaires du grand maître ne semblent pas avoir de limites : il peut, dit-on, reprendre la grâce accordée par mégarde au partisan d’un système dualiste. Son action transcende l’espace et le temps il initie à son désir un absent et même un mort si ce dernier avant de mourir a exprimé le souhait d’être initié. Le guru se sert dans ce cas de la méthode du « grand filet » et le capture en quelque lieu qu’il réside : ciel, terre ou enfer, parmi les trépassés, les divers esprits ou sous quelque forme qu’il revête après sa renaissance (homme, animal) il le libère aussitôt (XXI).
Pour convaincre un disciple libéré qu’il ne renaîtra plus, le guru accomplit certains rites : sur sa main droite il évoque une figure triangulaire (mandala) représentant un feu aux flammes resplendissantes avec, au centre, la lettre R, germe du feu, qu’attise le vent symbolisé par la lettre Y. Il prend dans sa main gauche une poignée de graines quelconques qu’il jette sur le triangle ; récitant la formule phat afin de consumer leur [138] pouvoir générateur, il entre à plusieurs reprises dans le cœur du disciple puis retourne à sa propre main pleine de graines en se concentrant sur les graines qu’il considère comme brûlées par le feu de la conscience. Posant enfin sa main sur la tête du disciple, il le déclare libéré vivant. Pour le lui prouver, il sème les graines dans une bonne terre ; guru et shichya pourront ensuite constater qu’elles ne germeront pas. Ainsi l’initié aura la certitude que les résidus de ses actes antérieurs ne porteront aucun fruit.
L’initiation de la pesée (tulādīkshā) tend à un but analogue. Le disciple entièrement purifié monte dans l’un des plateaux d’une balance et le guru met des poids correspondants dans l’autre. Puis, après l’initiation, il remplace ces poids par une guirlande de vingt-sept fleurs. Si les plateaux restent en équilibre, c’est que les actes des vies passées du « libéré » ont perdu leur poids.
Ces deux dernières pratiques sont encore en vigueur de nos jours au Cachemire.
Lilian SILBURN.
LE rayonnement spirituel des grands mystiques, leur pouvoir de transformer parfois subitement les êtres et d’agir même sur les animaux, constituent un leitmotiv de l’hagiographie chrétienne. En dépit de son universalité, cette étrange « influence » reste difficile à analyser. Et ne serait-elle pas au fond une métaphore illusoire ? Si beaucoup de témoignages rapportent des faits de ce genre, on saisit mal leur processus. Qu’elle soit sceptique ou admirative, toute interprétation préconçue risque de ne pas clarifier le problème. Seuls des documents bruts et immédiatement contemporains peuvent fournir des détails significatifs, que des monographies récentes ont souvent négligés. Sur cette sorte de contagion et d’attirance qu’ont exercée les mystiques, de nombreuses biographies et relations du XVIIe siècle français n’apportent que des indications dispersées. Par contre un prêtre à la fois homme d’action et contemplatif comme Olier mérite une attention plus spéciale, parce qu’il paraît avoir offert d’abondants phénomènes de cet ordre, et qu’il en a pris nettement conscience.
Parisien né en 1608 et mort à 49 ans, après une carrière des plus animées, Jean-Jacques Olier, qui participa tout d’abord à plusieurs missions en province, est surtout connu comme curé de Saint-Sulpice et fondateur du séminaire du même nom. En tentant de christianiser son immense paroisse, qui comptait plus de i 50 000 habitants, il suscita parfois des conflits, et, au cours d’une émeute provoquée par la coalition de quelques ecclésiastiques mécontents et de professionnelles du faubourg Saint-Germain, dont il voulait brusquement réformer les mœurs, il faillit être lynché. Il lutta contre le duel en mobilisant gentilshommes et officiers. Il fut aussi un tenace adversaire des jansénistes, qui raréfiaient la fréquentation eucharistique, et c’est d’un incident soulevé à Saint -
191
Sulpice deux ans avant sa mort que naquit la polémique des Provinciales. Il contribua à l’envoi d’une petite colonie au Canada. Les institutions qu’il créa durant sa vie acquirent par la suite un vaste développement, car les séminaires et les collèges de la Compagnie de Saint-Sulpice ont actuellement essaimé de par le monde/1.
M. Olier apparaît donc au premier abord surtout comme un apôtre dynamique, que l’on aurait tort de juger à travers la silhouette légèrement compassée des sulpiciens décrits par Renan dans ses Souvenirs d’enfance et de jeunesse, alors que l’expérience intérieure d’une excçptionnelle intensité, qui fut le ressort de son action, risque de nous être doublement masquée par la formulation dévote conventionnelle de certains de ses écrits, comme par la publication trop fragmentaire de son journal spirituel/2. Son évolution se dessine néanmoins clairement. Jusque vers 3 o ans, Jean-Jacques Olier subit des influences décisives et connut des phénomènes mystiques quelquefois violents. Vers 1635-1636, écrit-il par exemple dans son journal, « je ressentais souvent de grands assauts d’amour, qui me forçaient à me jeter à terre, ne pouvant les supporter »/3. Mais il éprouvait aussi des moments plus subtils et plus doux de présence ou de simple recueillement. Puis vint une période de dépression et de sécheresse, en 1640-1641, qui en même temps le dépouilla plus radicalement de lui-même et lui fit comprendre la valeur des phases de tourment ou d’insensibilité. Enfin, après avoir retrouvé son équilibre, il eut à nouveau des états intérieurs encore très forts, qui évoluèrent, comme cela est classique, vers une tonalité plus paisible. Dans cette dernière étape, de 34 ans à sa mort, il exerça sur autrui un large rayonnement. Si M. Olier a un jour symboliquement décrit comment un contemplatif
1 Dans Ces Messieurs de Saint-Sulpice (Fayard, 1957), J. Gautier a décrit l’œuvre et l’esprit des sulpiciens jusqu’à nos jours, en regrettant que l’un des successeurs de M. Olier : Louis Tronson, ait, en réglementant les traditions, quelque peu sclérosé l’entreprise initiale. Il est courant de continuer à appeler « Monsieur » un prêtre de Saint-Sulpice, comme au XVIIe siècle, c’est pourquoi nous parlerons de M. Olier.
2 Les références donnent à ce journal la dénomination de « mémoires ». On trouvera des extraits de ces notes jetées sur le papier au jour le jour par M. Olier de 1642 à 1646, à la demande de son directeur, Dom Hugues Bataille, et qui eurent par la suite un caractère plus doctrinal, au livre VIII de la Vie de M. Olier par Nagot (Versailles, 1818 ; ces passages, rarement datés, furent repris, sans leur présentation ou commentaire, aux colonnes o81-1184 des Œuvres complètes d’Olier éditées par Migne en 1856) ; dans la Vie de M. Olier de Faillon (4e éd., 1873, 3 vol.) ; puis dans le tome I, seul paru, de la Vie de M. Olier par F. Monier (de Gigord, 1914), dont le récit, illustré de courtes citations, s’arrête malheureusement à 1643. Cf. aussi le chap. XIX de P. Pourrat : jean-jacques Olier (Flammarion, 1932). D’inquiétantes inexactitudes dans les éditions et citations de M. Olier ont été signalées par I. Noye (Compagnie de Saint-Sulpice. Bulletin du comité des études, 1957, p. 602-614). Ce même Bulletin a publié une étude de G. Chaillot : Les Premières leçons de l’expérience mystique de M. Olier (déc. 1962, p. 501-543), basée sur le journal, jusqu’en 1642. La correspondance de M. Olier renseigne aussi, mais plus allusivement, sur sa vie intérieure.
3 Monier; p. 152.
192
retiré dans la solitude pouvait stimuler l’action dévorante des autres, son propre cas illustre au maximum ce rapport entre la vie profonde et l’activité extérieure.
L’une des plus importantes modalités de l’action de M. Olier fut sa direction spirituelle, bien connue par sa correspondance et par ses propos/1. Détachement de soi et abandon, patience, acceptation des périodes d’insensibilité ou de privation, voilà quelques-unes des attitudes qu’il recommande, comme bien d’autres directeurs ou moralistes chrétiens. Mais son enseignement frappe par son caractère concret. C’est ainsi que les minutieuses règles de vie qu’il donnait en 1647 à la princesse de Condé purent être amplifiées dans un livre de 1655, La Journée chrétienne, où tous les instants, toutes les occupations ou rencontres — lever ou repas, maladies, sacrements, promenades, vue du soleil ou du feu, des fleurs, des arbres, chant des oiseaux — deviennent autant d’occasions de prière ou de méditation, où lyrisme et symbolisme s’entremêlent. La même méthode sensible et imagée s’applique aussi bien au commentaire d’une cérémonie religieuse qu’aux vêtements ou aux fonctions des clercs/2. Parfois néanmoins la limite est dépassée et prête à sourire, comme dans cette lettre du 8 septembre 1653, à l’une de ses dirigées à qui il propose, pour fêter ensemble, de loin, la nativité de la Vierge, de fabriquer chacun un berceau devant lequel ils s’inclineraient simultanément à la sonnerie de leurs montres. Entre les conceptions ultra-raréfiées de la métaphysique et les pieuses naïvetés, la mesure n’est pas facile à maintenir, et il faut reconnaître que dans les prolongements parfois trop sensorialisés du christocentrisme de Bérulle, dont M. Olier était admirateur, ont surgi des pratiques et des « révélations » surprenantes, qui divisèrent par la suite bien des croyants. Il importe donc de situer M. Olier dans le courant de la Contre-Réforme, qui tenait à valoriser à l’extrême les dogmes ou les rites alors menacés. Henri Bremond, qui pose clairement les rapports entre mysticisme et dévotion, a marqué, à propos de M. Olier, sa préférence pour une théologie lyrique qui parle à tout l’être/1.
1 Lettres de M. Olier. Nouv. éd. augmentée par H. Levesque (de Gigord, 1935, 2 vol.). Ses Lettres spirituelles avaient d’abord été éditées en 1672 par M. Tronson, qui s’inspira de notes de M. de Bretonvilliers (qui avait passé près de 15 ans aux côtés de M. Olier) pour rédiger L’Esprit d’un directeur des âmes, ou Maximes et pratiques de M. Olier touchant la direction.
2 Le Traité des saints ordres, que retoucha Tronson, fut réédité par J. Gautier (La Colombe, 1958), avec un long exposé des principes de l’École française.
1 Histoire littéraire du sentiment religieux en France (Bloud et Gay), 1923, t. III : la Conquète mystique. I. L’École française. Cf. les chap. 4 et 5 de la 2e partie sur M. Olier.
193
Il semble bien que sa ferveur, son enthousiasme, expliquent partiellement le succès de l’orateur. Mais nous laisserons ici de côté ses prédications publiques pour recourir à des témoignages individuels qui permettent de mieux en analyser les effets. L’une des attestations les plus significatives sur ce point est celle de Mlle Barbe Le Roguée qui fut délivrée par M. Olier de ses angoisses.
« Il y avait cinq ou six mois, écrit-elle, que je souffrais des peines intérieures les plus sensibles que l’on puisse endurer : opposition à Dieu, pensées contre la foi, tentations de toute espèce. J’en étais venue au point de croire que Dieu m’avait abandonnée, et, dans mon désespoir, je pensais que tout fût perdu pour mon salut ; j’étais tombée dans un état de mélancolie, que l’on aurait peine à imaginer, et d’autant plus étrange, que, jusqu’alors, ayant été conduite par une voie fort douce et une dévotion tendre et sensible, je ne connaissais nullement ces sortes de peines. Au milieu de cette affreuse désolation, je parlais à mon confesseur, plus par mes larmes que par mes paroles ; et tout ce qu’il pouvait me dire était insuffisant pour me consoler. »
Accompagnant une amie qui désirait s’entretenir avec M. Olier, elle demanda son aide à celui-ci qui voulut la voir en particulier.
« Quelques jours après, il me fit dire d’aller lui parler à Issy, près Paris… Dès que je fus avec ce saint homme, il se mit à me parler de l’intérieur de la très -sainte Vierge et des moyens de l’honorer/2.
2 Ce thème de l’intérieur de la Vierge était cher à M. Olier et les développements qu’il y consacra librement dans son journal ont été réunis en un montage quelque peu indiscret par Faillon (Rome, 1866, 2 vol.), qui n’hésita pas à y introduire ses vues personnelles et suscita des critiques.
Les choses qu’il me disait étaient si ravissantes, que toutes mes peines s’en allaient à mesure qu’il me parlait, à peu près comme si on me les avait ôtées avec la main, et que l’on eût mis à la place la paix et la joie des bienheureux. Cette paix toute céleste m’inondait des plus ineffables consolations, au point que j’oubliai entièrement mes peines, et ne lui en dis pas un mot. Je restai même plusieurs mois sans me souvenir de ce qui m’avait si étrangement tourmentée, et depuis je n’en ai plus rien ressenti… Après être demeurée une heure et demie avec ce grand serviteur de Dieu, et lui avoir demandé sa bénédiction, je m’en revins à Paris à pied, si touchée et si occupée de ce que je venais d’entendre, que les deux demoiselles qui m’accompagnaient ne pouvaient tirer de moi une parole. Ma joie était si grande, que je ne la pouvais presque supporter ; et, revenant par la campagne, je ne me sentais pas marcher en sorte que ces personnes avaient peine à me suivre. »/1
1 Faillon, Vie de M. Olier, 4e éd., t. II, p. 288-290.
Il n’y a aucune invraisemblance à ce que l’ardeur de ces paroles ait
194
mis fin aux divisions qui tourmentaient Mlle Le Roguée en créant en elle un climat plus fervent/2. Le timbre d’une voix masculine, la chaleur de son intonation, la vue d’un visage recueilli ou inspiré, apparaîtront en outre comme autant de facteurs possibles de contagion. Il arriva aussi à M. Olier de recourir à la suggestion franchement autoritaire, par exemple avec une religieuse atteinte d’un crachement de sang, qui cessa aussitôt/3.
2 « Désoccuper d’elle-même une âme inquiète, l’amener à s’absorber dans une contemplation noble, quoi de plus apaisant et, tout ensemble, de plus stimulant ? », remarque justement ici Bremond qui, dans ses deux longs chapitres, a négligé les autres aspects possibles de la transmission que nous allons étudier.
3 Faillon, III, p. 507.
Même si l’efficacité de l’éloquence de M. Olier, qui parlait d’abondance, semble quelquefois extraordinaire et hors de proportion avec l’enthousiasme ou l’euphorie qu’il provoquait, il serait difficile de mettre en cause un autre facteur si l’on ne possédait pas des attestations et des récits où le même résultat était obtenu par une sorte de participation contagieuse. Le langage n’était nullement indispensable à M. Olier qui, d’après maint témoignage, agissait aussi par sa seule présence. On découvrirait dans la vie d’autres mystiques de semblables phénomènes d’écho ou de transmission, mais d’habitude ils ne sont pas consciemment perçus, alors qu’ils prennent ici une forme concrète, que M. Olier a plusieurs fois évoquée dans ses mémoires, comme si quelque chose sortait effectivement de lui pour envahir autrui.
« L’un des principaux magistrats du Parlement de Paris, M. Molé, premier président, dans une visite que je lui fis, me dit, dans la joie de son cœur : J’ai senti une vertu sortir de vous, qui a réjoui et conforté mon âme… Le jour de la Septuagésime, confessant un de nos Messieurs, je sentais une certaine influence, qui sortant de ma poitrine, se répandait en lui. Je demeurai longtemps sans lui parler, laissant influer ces effets dans son âme ; et lui aussi demeurait en silence durant ce temps. Le jour de l’Annonciation, M. de Bretonvilliers venant se confesser à moi, ressentit en lui, dès qu’il fut à genoux, une substance qui le remplissait, et sortait de ce serviteur misérable ; et n’étant pas accoutumé à ces expériences divines, il ne savait ce que c’était. Il demeurait près de moi, sans pouvoir se retirer, et me disait, par étonnement : Vous êtes en moi : je vous sens en mon âme. »/1.
Plus proche du sens latin au XVIIe siècle, le mot « vertu » ne désigne pas ici une qualité morale, mais une énergie ou une force. Dans l’Évangile
1 Faillon, II, p. 229-230.
195
de Luc (8, 45-48), le Christ, au moment de la guérison d’une femme qui l’avait touché à son insu, déclare qu’une « force » venait de sortir de lui. En commentant cet épisode, M. Olier remplace ce terme par « vertu », qui avait pour lui la même signification/2) et, quand il parle ailleurs d’une « influence », qu’il sent sortir de sa poitrine pour envahir ses interlocuteurs, on se rappellera la nuance du mot à l’époque : « Il s’agit alors d’un véritable écoulement matériel (latin in-fluere, “couler dans”) d’un fluide supposé qui, descendant des astres, exerçait ainsi son action sur les hommes et sur les choses. »/3
2 Faillon, II, p. 288.
3 Cayrou, Le Français classique. Lexique de la langue du XVII° siècle (Didier). Rappelons la place qu’eut au siècle suivant cette hypothétique influence astrale dans la pensée de Mesmer, qui, par ses essais empiriques de guérison, déclencha un ample de courant de recherches sur le « magnétisme animal », l’hypnose et la parapsychologie, dont toutes les incidences sont loin d’être explorées. Ce mot a pris de nos jours dans la terminologie psychiatrique un tout autre sens. Avec le « délire d’influence », où prédominent « voix », automatismes, dissociation intérieure (le Dr Lhermitte en présente plusieurs cas dans Mystiques et faux-mystiques, Bloud et Gay, 1952, p. 165 sv.), le malade se sent généralement traqué. Mais à côté de la persécution liée à des hallucinations auditives, doivent prendre place d’authentiques phénomènes de contagion, comme ceux qu’éprouvèrent spontanément plusieurs psychanalystes, par exemple Harold Kelman (dont le témoignage a été cité dans le N° 2 d’Hermès, p. 94-97), ou L. J. Bendit dans sa thèse : La Connaissance paranormale (trad., Paris, L’Arche, 1951).
Ces sortes de communications attisaient d’habitude chez ceux qui les avaient éprouvées leur désir de Dieu ou leur soif de perfection. Mais M. Olier découvrit en outre leur capacité de rendre à l’organisme sa vigueur. On l’appela un jour auprès d’une petite fille inanimée :
« Je me tenais debout auprès d’elle, immobile ayant toujours les yeux arrêtés sur cette enfant, et sans pouvoir ni me mouvoir, ni parler. Durant ce temps, je sentais une vertu qui sortait de moi, se répandait sur cette fille ; et j’entendis par trois fois ces paroles : C’est la vie… Après cela, l’enfant revint en santé ; et depuis elle se porte bien, grâces à Dieu. Cela ne s’est pas su ; mais les parents de cette fille disent : Que les prières d e ce pécheur l’ont ressuscitée. »/1
1 Faillon, II, p. 287-288.
Telle que M. Olier la conçoit, cette transmission s’inscrit dans un cadre spécifiquement religieux. La force émanant de lui ne lui appartient pas et, si la grâce divine opère à travers sa personne, c’est à la vivante présence du Christ en lui et aux effets renouvelés de l’eucharistie qu’en membre zélé de la Compagnie du Saint-Sacrement, il attribue son pouvoir de toucher autrui.
« Depuis que Notre-Seigneur, écrivait-il dans son journal, a daigné me
196
rendre participant à son état d’hostie, à vrai dire ce n’est plus moi qui vis : c’est lui-même qui vit en moi. Chaque jour après la sainte communion, je le sens répandu par tout moi-même, comme si je sentais sa présence dans tous mes membres… Il réside en moi pour produire dans les âmes des effets de communions divines, et se répandre de là en elles… C’est Jésus-Christ en moi qui produit ces effets : car en parlant à ces personnes, je sens sa vertu sortir de moi et se porter en elles, pour leur communiquer ses lumières et ses grâces… »/2
2 Faillon, II, p. 228-229. — Le directeur de conscience ne doit donc se considérer que comme un simple intermédiaire ou un « canal », Jésus demeurant la source divine et le « directeur universel ». (L’Esprit d’un directeur des âmes, 1831, p. 12-13, ou Migne, col. ii90). Sur un plan plus doctrinal, Bérulle avait justifié par l’autorité du pseudo-Denys, que connaissait également M. Olier, cette transmission hiérarchique de grâces. Cf. Jean Orcibal, Le cardinal de Bérulle, évolution d’une spiritualité (Éd. du Cerf, 1965, p. 147-148), et Paul Cochois, Bérulle, hiérarque dionysien (Revue d’ascétique et de mystique, 1961, p. 314-353, et 1962, p. 354-375), et du même : Bérulle et le pseudo-Denys (Revue de l’histoire des religions, 1961, p. 173-204).
Il paraît naturel que, pour un catholique, l’eucharistie augmente, plus que tout autre sacrement, son identification intérieure avec le Christ, mais M. Olier rattache en outre celle-ci à une expérience qui intervint lors d’un moment dramatique et lui laissa un tel souvenir qu’il en a maintes fois répété le récit dans son journal. C’est au cours de sa phase de scrupules et de déréliction (il lui semblait alors que, pour l’humilier, Dieu désertant son corps le laissait vide, épuisé, parfois titubant, incapable de manger ou d’enchaîner plus de quelques mots), que, dans la petite église de Marines, M. Olier crut voir le Christ sortir du tabernacle et pénétrer dans sa poitrine/1. Cette vision, qui l’aida à traverser sa crise, lui apporta une image plus saisissante de la présence christique en lui et il lui a directement rattaché sa capacité de transmettre.
« Cette fécondité qui s’échappe de mon cœur, émane de Jésus-Christ, depuis qu’il y vint sous la forme d’un enfant de feu, pour-y faire sa résidence ; et de temps en temps je ressens sa présence sensible, tout impur et misérable que je suis. Ces jours passés, conversant avec M. de Breton-villiers, il me dit qu’il savait que Notre-Seigneur habitait dans mon âme, comme un enfant de feu, d’après ce que lui avait dit la personne qui lit mes papiers. Je fus tout attristé de ces paroles ; et toutefois, je sentis, aussitôt après, Notre-Seigneur se dilater en tout mon cœur, dans un feu divin, qui me semblait être un brasier. »/2
Plusieurs autres textes de M. Olier confirment cette impression de brûlure qui s’irradie du cœur dans tout l’organisme et prend parfois une acuité insupportable à la poitrine, fait crier, presque défaillir/3.
1 Monier, p. 242-243 -
2 Faillon, II, p. 231.
3 Nagot, p. 359, 367-368, 370.
197
Il s’agit là d’une sensation commune à la plupart des mystiques chrétiens, hommes ou femmes, jeunes ou d’un âge avancé, mais qu’ils ne sont pas les seuls à connaître/4. L’« incendie » ou le « feu de l’amour » — ainsi que l’appelait au XIVe siècle l’ermite anglais Richard Rolle — se rapproche d’une intolérable chaleur physique que l’on cherche à calmer par la fraîcheur de l’eau ou du vent. De telles impressions cardiaques sont si inusitées qu’elles ont naïvement fait croire à diverses mystiques (comme Lutgarde, Catherine de Sienne, Marie des Vallées, Marguerite-Marie Alacoque, et une religieuse de Langeac qui joua un grand rôle dans la vie de M. Olier) que le Christ leur avait littéralement ôté le cœur de la poitrine pour y substituer le sien/5.
4 On retrouve très forte cette brûlure au cœur ou à la poitrine chez Philippe Néri, qui tenait parfois un instant embrassés contre lui ceux qu’il voulait apaiser ou guérir, tandis que M. Olier ne recourait à aucun contact. La même différence se remarque dans l’Inde entre Ramakrishna, à qui il arrivait de toucher la langue ou la poitrine de ses disciples, et Ramana Maharshi, qui agissait par sa seule présence.
5 On regrettera que dans le volume des Études carmélitaines sur le Cœur (Desclée de Brouwer, 195o), où le Dr Lhermitte analyse parfaitement les impressions d’expansion cardiaque et pectorale liées à la joie, le problème de l’incendium amoris n’ait pas été envisagé de même sous l’angle psychophysiologique. (L’élucidation de la plaie au côté par le P. Beirnaert reste d’inspiration psychanalytique.) Avec ces sensations au cœur trop littéralement interprétées, et que renforçaient des paroles ou des visions, l’on touche à l’une des sources subjectives du cule du Sacré-Cœur, dont le recueil des Études carmé-litaines retrace la naissance et les vicissitudes, depuis l’opposition des jansénistes et les réticences prolongées de Rome, jusqu’à la désaffection d’une partie de la jeunesse d’aujourd’hui pour une imagerie trop sensible.
Si la brûlure est une constante mystique, on l’a associée à des sentiments multiples que le fidèle a projetés sur Dieu lui-même, qui apparaît tantôt comme amour, tantôt comme jalousie, exigence ou colère, tantôt comme feu purificateur/1. La signification de ces sensations aiguës au cœur peut donc non seulement varier, mais s’inverser. C’est ainsi que chez
M. Olier, qui au cours de sa crise s’imaginait perdu et damné, la vision de l’enfant de feu avait été préparée par des impressions cardiaques anxieuses : il y sentait comme la blessure d’un poignard en rencontrant dans l’Évangile le nom de Judas, qui renforçait ses propres sentiments de réprobation/2. Quelques années plus tard, s’étant entretenu de cette apparition de l’enfant Jésus avec une carmélite de Beaune, il eut, en disant la messe huit jours après leur rencontre, l’impression que l’âme de cette religieuse sortait du ciboire et pénétrait de même en lui/3.
1 L’article « feu » du Dictionnaire de spiritualité montre bien la multiplicité des interprétations théologiques possibles.
2 Monier, p. 242.
3 Lettre du 21 ou 22 sept. 1647, éd. 1935, I, p. 350.
198
Il est banal que le cœur accuse la répercussion physiologique d’une émotion et l’on surprend souvent ce processus, mais intense, chez M. Olier, lorsqu’il aperçut par exemple au loin la basilique de Lorette à la fin d’un pèlerinage harassant/4, ou bien Notre-Dame, un jour qu’il venait d’échapper à un péril en bateau sur la Seine, et dans diverses circonstances de ce genre, il éprouva de même comme un coup de flèche au cœur/5. L’impression de blessure ou de feu pouvait aussi bien être réactivée par une allusion de quelqu’un (de M. de Bretonvilliers dans le passage cité plus haut), que par une conversation ou une pensée fervente, un jour qu’il choisissait par exemple des thèmes d’oraison pour ses séminaristes, ou qu’il parlait de saint Paul avec enthousiasme. Ces états surgissaient donc parfois en présence d’autrui, mais plus fréquemment dans la solitude d’une chambre ou d’un jardin, en méditation ou en prière. L’oraison intériorisée est en effet pour les directeurs la source où ils puisent les forces qui vivifient ceux qui les entourent. M. Olier répétait souvent :
4 Le renforcement de l’émotivité par l’épuisement semble avoir joué à la fin d’une trop longue marche (il y a près de 30 o km de Rome à Lorette et les Apennins à traverser), que, pour se mortifier, le pèlerin tint à faire malgré le temps trop chaud avec ses lourds vêtements d’hiver ; il arriva en ayant peine à se traîner et fiévreux. Fatigué pa.r une dure journée de prédication à Saint-Ilpize, un soir de Pentecôte, il fut de même terrassé, en priant, par la violence du sentiment qui « regorgeait » en lui, et il se jeta à terre malgré la gênante présence d’un témoin (Monier, p. 153).
5 Monier, p. 52, 149.
« Nous devons vaquer à l’oraison pour y recevoir la plénitude de la vie divine, que nous sommes obligés de communiquer au prochain. Les directeurs sont les véritables pères du peuple, mais ils en sont aussi les mères et les nourrices… C’est dans l’oraison que Dieu communique son Esprit : dans l’oraison il leur donne ce qu’ils doivent répandre dans les âmes, mais avec une telle abondance que, semblables à de vastes bassins, remplis sans cesse des eaux de la source, ils les communiquent continuellement sans s’épuiser jamais. »/1
M. Olier parlait ici d’expérience, car, après avoir limité au début son temps quotidien d’exercices spirituels, il passa par la suite de longues heures en oraison, et, fait capital, il s’y adonna plus intensément à diverses périodes de sa vie, au cours de retraites de plusieurs semaines. De telles phases d’entraînement suivi ont un effet accru, dont on ne soupçonne pas l’ampleur lorsqu’on se limite à une ou deux méditations quotidiennes/2.
1 L’Esprit d’un directeur des âmes, p. 20, ou Migne, col. 1194.
2 Il est significatif qu’un jésuite allemand, ayant déjà pratiqué le sévère entraînement ignacien (lorsqu’elle n’est pas abrégée, la retraite se prolonge un mois, à raison de cinq heures de méditation chaque jour), ait reconnu l’extraordinaire efficacité des sessions d’une semaine qu’il suivit dans un monastère japonais. Cf. Lassalle, Le zen, chemin de l’illumination, Desclée de Brouwer, 1965.
199
On songera aussi que l’oraison préconisée par M. Olier était plus dépouillée et moins discursive que les schémas sulpiciens de méditation, trop subdivisés, qui furent élaborés par la suite.
Le repliement sur soi et la mise au silence prolongés jouent un rôle essentiel dans le développement de nouveaux états intérieurs, de même que dans l’affleurement d’impressions organiques, comme la prise de conscience du cœur, ainsi qu’on l’a de nos jours constaté en pratiquant de façon expérimentale ou thérapeutique diverses techniques de concentration. On a commencé à étudier comparativement celles-ci, en les enregistrant, afin de mieux interpréter les mécanismes neuro-physiologiques mis en jeu non seulement dans le yoga ou le zen, mais au fond dans toute méthode d’absorption en soi-même/3. Si de tels processus rendent largement compte de certains des effets qui sont subjectivement éprouvés par tous les méditants, ce niveau proprement corporel ne saurait à lui seul élucider les phénomènes de transmission constatés chez M. Olier. Il serait important de découvrir pourquoi, d’après toutes les traditions religieuses, le progrès spirituel s’accompagne de manifestations singulières que les yoga-sutras ont nommées des « pouvoirs », et qui, si elles peuvent se rencontrer chez des médiums indépendamment de toute ascèse, révèlent chez les mystiques d’invisibles énergies qu’ils manient en général avec infiniment plus de maîtrise et de puissanc que quiconque.
3 Cf. les bibliographies d’Hermès, 1963-1964, N° 1, p. 117-118 et N° 2, p. 118-119.
Les formes de cette osmose intérieure sont multiples. En même temps qu’il agit sur les autres, le grand spirituel découvre leurs dispositions ou pensées les plus secrètes, parfois celles qui sont oubliées, et pareille intuition stupéfaite qui en est l’objet, donne aussi à la direction plus de sûreté. L’histoire de M. Olier offre une multitude d’exemples de ce genre, que nous ne pouvons songer à exposer ici. Si la « connaissance des cœurs » reste relativement rare au degré où l’ont poussée les mystiques, elle appartient moins à la compétence des hagiographes qu’à celle des parapsychologues, qui l’étudient au lieu de s’en émerveiller et qui y voient une faculté beaucoup plus répandue qu’on ne l’imaginait jadis/1. Non seulement tout être vivant paraît susceptible de recevoir, plus ou moins
1 Un jésuite membre de la Société anglaise de recherche psychique, le P. H. Thurston, a réexaminé comparativement plusieurs des « prodiges » de l’hagiographie, dans The Physical phenomena of mysticism (Londres, Burns Oates, 1952 ; trad. Gallimard, 1961), et Surprising mystics (Burns Oates, 1955), mais s’en tenant surtout aux manifestations physiques (stigmates, incendium amoris, lumière extérieure, jeûne, etc.), il n’a pas abordé dans ces deux ouvrages les innombrables cas d’intuition et d’interaction psychologique avec autrui que présentent les grands mystiques.
200
inconsciemment, des messages d’autrui, mais il serait aussi capable d’en transmettre à son tour, qu’il le désire ou non. Plus que d’une information à sens unique il s’agirait donc d’un échange. Avec une telle interaction on devrait théoriquement s’attendre à des chocs en retour. M. Olier remarque effectivement :
« Si l’âme de l’un s’épanche le moins que ce soit en quelque créature, l’autre souffre étrangement, sans même qu’elle le sache… Pendant que cette seconde âme qui, s’amusant à la créature, se retire de Dieu et se refroidit elle-même, perd sa joie, sa paix et le repos, elle met l’autre âme dans la langueur, dans la froideur… »/2
2 Icard, Doctrine de M. Olier, Paris, 1891, 2e éd., p. 259-260. Comme le soulignera le texte cité plus loin, Mme Guyon a beaucoup insisté sur les douloureux contrecoups qu’elle subissait en fonction des fluctuations intérieures de ses « enfants spirituels ».
Grâce à sa vie intérieure beaucoup plus ardente, un maître spirituel devrait neutraliser les imperfections de ceux qu’il dirige. C’est la fonction que M. Olier attribue spécialement au prêtre, qui, dans cette sorte de « communion des saints » au niveau des vivants, devient ainsi responsable de la tiédeur aussi bien que du progrès d’autrui, quoiqu’une telle influence doive au fond être généralisée, car le type de transmission que nous étudions dépasse le plan formel des sacrements et des rites. Pas plus que la direction ne se confond avec la confession, l’influence spirituelle immédiate qui s’exerce d’un individu sur un autre n’est liée au sacerdoce — que personne ne soupçonnera ce fondateur de séminaires de minimiser —, et agit sans distinction de sexe ou de religion. Cette influence transformatrice viendra plus authentiquement d’un solitaire assidu à l’oraison ou d’une mystique que d’un ecclésiastique superficiel, et tout l’effort de M. Olier a précisément tendu à intensifier la vie intérieure du clergé séculier. C’est au mépris des conventions de la hiérarchie que se formèrent quelquefois spontanément de petits groupes, par exemple autour de Catherine de Sienne, qui tirait sans le chercher de ses extases rayonnement et autorité. On reconstituerait aisément une sorte de légende de ce genre avec divers épisodes de la vie de M. Olier, auprès de qui deux femmes jouèrent un rôle crucial. La première fut une laïque, Marie Rousseau, qui l’apostropha un jour avec des clercs de son âge, alors qu’ils se divertissaient à la foire de Saint-Germain en 1629. Elle leur déclara qu’elle priait depuis quelque temps pour leur conversion, ce qui n’étonna pas le jeune Olier qui, se sentant intérieurement troublé, en avait déjà parlé à ses amis/1. Le tour un peu théâtral de cet incident suffirait à expliquer l’impression qu’il produisit dans son esprit, mais l’apparition que devait avoir l’abbé Olier, quelques années plus tard, d’une religieuse inconnue — qu’il prit d’abord pour la Vierge —, eut une allure encore plus saisissante. Qu’on les attribue à une prémonition
1 Monier, p. 42 sv. Cf. sur Marie Rousseau les p. 554-567.
201
ou à de la télépathie, de telles rencontres en vision ou en songe ne sont ni inexplicables, ni uniques/2. La Mère Agnès de Jésus, qui vivait au couvent des dominicaines de Langeac, s’était imposé depuis trois ans mortifications et prières pour sanctifier le jeune abbé de Pébrac, M. Olier, qu’elle n’avait jamais rencontré. Elle lui apparut à deux reprises, à la veille de son départ en mission pour l’Auvergne, où il eut la surprise, quand elle leva son voile au parloir, de reconnaître le visage qu’il avait vu alors qu’il faisait une retraite à Paris. Il passa à Langeac de longues heures d’entretien et de prières auprès de cette religieuse qui mourut peu après son départ.
2 On prétend ainsi qu’avant de se connaître, François de Sales et Jeanne de Chantai s’étaient apparu l’un à l’autre.
Il ne faudrait pas retenir exclusivement des influences féminines sur M. Olier, qui avait dans son enfance rencontré François de Sales, et que Vincent de Paul, le Père de Condren et Dom Bataille devaient diriger/1. Dans la seconde partie de son existence, c’est surtout lui qui semble avoir agi sur autrui, et les femmes comme les hommes qui éprouvèrent son rayonnement furent nombreux. Il se méfiait cependant des sympathies naturelles. Dans la mesure où le sentiment commence à jouer sur le plan humain, pensait-il, l’être s’éloigne de la source et devient de moins en moins capable de transmettre. Directeur comme dirigé doivent se garder de l’attachement qu’ils peuvent éprouver l’un pour l’autre, et au besoin rompre. Si une certaine union s’instaure entre eux, il faut que ce soit au-delà de toute sentimentalité, à un niveau qui n’est pas corporel et qui joue tout aussi bien à distance. La discrimination est ici d’autant plus délicate que, par l’amour désintéressé qui émane de sa personne, le mystique exerce une puissante attraction, qu’éprouvent parfois même les bêtes, mais toute généralisation serait abusive et il arrive aussi que se déchaînent dans son entourage des réactions négatives ou hostiles.
1 Renaudin évoque les « amitiés spirituelles » féminines de M. Olier dans Mystiques et saints de chez nous, les Éditions nouvelles, 1947, p. 92 sv.
Si l’on admet qu’une perméabilité psychique existe entre les êtres et que l’efficacité des mystiques soit dans ce domaine plus forte, il faut préciser les résultats que l’on a cru observer avec ces derniers. En dépit des variantes individuelles de leur expérience et du niveau des personnes sur lesquelles ils agissent, on trouve presque toujours auprès d’eux apaisement et joie. Lorsque commencent à opérer ces étranges dynamismes, dont les contrecoups persistent plus ou moins longtemps, le sujet est en général réduit au silence et à l’immobilité
« Presque toutes les fois qu’elle s’entretenait avec M. Olier, ou qu’elle
202
était seulement en sa présence, a observé la Mère de Saint-Gabriel, elle ressentait une impression de grâce si abondante qu’elle en était toute pénétrée et comme embaumée, non seulement dans le temps de leur entretien, mais durant des mois entiers, pendant lesquels elle eût désiré d’être séparée de toute créature, pour ne s’occuper que de Dieu seul. Quelquefois cet effet durait jusqu’à ce qu’il revînt ; alors la même grâce se renouvelait encore et avec tant d’abondance, qu’il lui est arrivé de ne pouvoir proférer dans cet état une seule parole. »/2
2 Faillon, III, p. 506.
Dans deux des cas cités plus haut, lors de la guérison d’une petite fille, ou pendant une confession de M. de Bretonvilliers, M. Olier resta lui-même longtemps silencieux, sans mouvement, et la communication semble capable de plonger également celui qui « reçoit » dans l’engourdissement ou la quiétude, mais il est rare qu’elle l’entraîne vers une expérience tranchée comme l’extase. (Celle-ci fut cependant parfois atteinte à proximité de Jean de la Croix, ou exceptionnellement de Mme Acarie.) En général le résultat est plutôt une impulsion, un éveil ou un élan, qui tendent à s’affaiblir et qu’il faut renouveler, soit en revenant auprès de celui qui en fut une première fois l’occasion ou l’origine, soit en cherchant à rétablir d’une manière ou d’une autre le contact avec lui, ne serait-ce que par le souvenir ou par le rêve. Lorsque la Mère de Saint-Gabriel n’avait pas la possibilité de s’entretenir directement avec M. Olier de ses sujets d’inquiétude, « elle songeait à lui durant son sommeil, croyant lui parler comme si elle lui eût exposé ses peines… Le matin en s’éveillant, non seulement elle en était délivrée, mais s’étonnait de se trouver dans une paix si profonde. Dès qu’elle le voyait, elle ne manquait pas de lui faire part de son rêve, et plusieurs fois M. Olier lui dit en riant que la même chose était arrivée à d’autres personnes, également guéries par ce moyen. »/1
Combien plus surprenantes sont les traditions à visée hagiographique qui assurent que de tels effets se prolongent après la mort. Les chances d’illusion s’accroissent ici en fonction de l’attente des disciples ou des admirateurs qui guettent la moindre présomption de miracle posthume (il est indispensable d’en réunir d’abondants témoignages pour former un dossier de canonisation), et en raison du désir de ceux qui espèrent leur soulagement d’une invocation au disparu, d’une visite à sa sépulture, ou du simple contact avec un fragment de ses vêtements ou de son corps, que, pour satisfaire les fidèles de différentes villes ou communautés religieuses, l’on a maintes fois mutilé et dispersé. Nous ne nous étonnons donc pas que des phénomènes de ce genre, traditionnels dans les vies édifiantes de l’époque, aient été rapportés après le décès de M. Olier,
1 Faillon, III, p. 505-506.
sur le tombeau de qui vint prier, par exemple, une femme, invalide de son bras droit depuis deux ans : rentrée du Canada, où elle avait fait une chute sur la glace, Mlle Mance éprouva dès son arrivée dans la chapelle un extraordinaire « saisissement de joie » et, au contact du coffret de plomb contenant le cœur du défunt, fut subitement guérie/2.
2 Faillon, III, p. 509 sv. (Ce livre X contient bien d’autres récits de guérison.)
Il ne fait pas de doute que des mécanismes de conditionnement et de suggestion, confirmés de nos jours par l’effet placebo (où la substitution d’un corps neutre au principe actif d’un remède n’empêche pas son efficacité), ont dû intervenir dans nombre de cas. Cependant la possibilité d’un transfert énergétique ou d’une sorte de présence résiduelle ou de rémanence, ne peut être totalement écartée, car la parapsychologie a étudié des manifestations similaires, qui n’impliquent pas nécessairement l’hypothèse de la survie. Qu’au cours de cet article ait été indifféremment employé un vocabulaire analogique évoquant tantôt une « transmission » (qui supposerait le mystique plus puissamment chargé d’une force qu’il communiquerait à son tour comme un intermédiaire ou un canal), tantôt comme une simple « induction » ou une « résonance », cela souligne notre incertitude sur le mécanisme en jeu dans ce type d’expérience, qu’un magma de superstitions à travers le monde suffirait à lui seul à faire rejeter a priori, car les croyances et les pratiques de vénération qui ont proliféré autour des saints et des reliques forment l’un des chapitres les plus fantastiques de l’histoire des religions.
Même si la cause efficiente ou la nature de l’énergie à l’œuvre actuellement nous échappe, ou si les interprétations comme les abus qui lui furent associés masquent à nos yeux le phénomène fondamental et sans doute objectif que nous venons d’examiner, du moins importe-t-il de reconnaître la place qui lui fut toujours empiriquement faite dans l’expérience religieuse. Les carmélites de Beas dirigées par Jean de la Croix aimaient, en son absence, recevoir ou relire quelques-uns de ses aphorismes. Parmi ces sentences figure celle-ci, que le cas de M. Olier aide à comprendre :
« L’âme qui a de la vertu, mais qui s’isole et vit sans maître, ressemble à un charbon incandescent hors du foyer ; au lieu de s’enflammer davantage, il se refroidira. »/1
Jean BRUNO.
1 Jean de la Croix, Œuvres spirituelles, trad. Hoornaert, Desclée de Brouwer, t. II, 1937, p. 138 (N° 7 des Sentences et avis spirituels, d’après l’autographe d’Andujar).
Mme Guyon offre, avec Jean Jacques Olier, l’un des meilleurs cas au XVIIe siècle, pour étudier les processus de participation ou de contagion interindividuelle, car elle a évoqué celle-ci à maintes reprises dans plusieurs de ses ouvrages, que publia, à Amsterdam, le pasteur Pierre Poiret, mais son autobiographie reste la source la plus abondante et la plus directe à ce sujet.
Peu après son départ clandestin de Montargis, Mme Guyon avait découvert, d’abord avec le Père La Combe, puis avec un nombre croissant de personnes, la possibilité d’une communication ou d’un échange intérieur, et ce qu’elle a nommé sa maternité spirituelle. Non seulement elle se sentait capable de guider autrui sur les chemins qu’elle avait elle-même suivis, mais il lui semblait transmettre directement la grâce : « Tous ceux qui sont mes véritables enfants ont d’abord tendance à demeurer en silence auprès de moi… Dans ce silence je découvre leurs besoins et leurs manquements, et je leur communique en Dieu même tout ce qui leur manque. Ils sentent fort bien ce qu’ils reçoivent et ce qui leur est communiqué avec plénitude » (Vie, IIe partie, chap. 13, § 8). On se rappelle les doutes et les sarcasmes de Bossuet dans sa Relation sur le quiétisme (où la phrase précédente est textuellement citée) sur cette communication immédiate, qui était très supérieure pour Mme Guyon à tout enseignement par l’écriture ou la parole et agissait aussi bien au loin qu’en sa présence. Mais en retour Mme Guyon subissait douloureusement les imperfections et les résistances de ses enfants spirituels : c’est cette souffrance qu’elle décrit dans le présent chapitre (Vie, IIIe partie, chap. 10), qui terminait son autobiographie, lorsque le manuscrit en fut remis, à l’automne 1693, pour examen, à Bossuet, et où il pouvait lire en outre au début cette petite phrase « Je porte souvent les peines des âmes pour les en délivrer/1. »
J. B.
1 P. 293 du manuscrit de la Vie conservé à la Bibliothèque Bodléienne d’Oxford (Rawlinson D. 525). Cette phrase sauta dans la version imprimée. La première édition de la Vie de Madame Guyon écrite par elle-même, publiée par Poiret, avec l’adresse fictive : Cologne, Jean de la Pierre, 1720, en 3 volumes, fut rééditée deux fois sous la Révolution, précédée d’une introduction enthousiaste, par le pasteur Jean-Philippe Dutoit, avec deux paginations différentes, en 1790 et en 1791. Aucune réimpression complète n’en a paru depuis en français, alors qu’on en fit plusieurs traductions en anglais et en allemand. Des fragments inédits du manuscrit d’Oxford sont ajoutés en notes aux extraits de la Vie publiés en 1961 dans le volume VI des Cahiers de la Tour Saint-Jacques, sur la jeunesse et les années de progression mystique de Mme Guyon, de 1648 à 1681 (volume I et chapitres 1-4 du volume II). La seconde série d’extraits, décrivant sa carrière « apostolique », ses voyages et ses persécutions jusqu’en 1709, est en préparation. Un troisième ensemble de textes, sur les dernières années à Blois, jusqu’en 1717, et sur la diffusion du guyonisme en milieux protestants, doit suivre.
205
1. Je ne saurais plus rien écrire de ce qui regarde mon état intérieur :
je ne le ferai plus… Je dirai seulement, qu’après l’état ressuscité, je me trouvais quelques années avant que d’être mise dans l’état que l’on appelle apostolique ou de mission pour aider les autres, toute propriété ayant été pour lors consumée dans le purgatoire que j’avais passé ; je me trouvais dis-je dans une félicité pareille à celle des Bienheureux, à la réserve de la vision béatifique/1. Rien de ce qui est ici-bas ne me touchait, et je ne vois non plus à présent quoi que ce soit au ciel ni en terre qui puisse me faire peine par rapport à moi. Le bonheur d’une âme de cet état ne se peut comprendre sans expérience, et ceux qui meurent sans être employés à aider au prochain, meurent dans la suprême félicité, quoique comblés de croix extérieures/2.
Mais lorsqu’il plut à Dieu de vouloir bien m’honorer de sa Mission, il me fit comprendre que le véritable père en Jésus-Christ, et le Pasteur apostolique, devait souffrir comme lui pour les hommes, porter leurs langueurs, payer leurs dettes, se vêtir de leurs faiblesses…
1 En parlant de résurrection, Mme Guyon fait allusion à la fin de la longue crise qu’elle traversa de 1674 à 1680, qu’elle compare à un purgatoire et qui, de fait, la dépouilla et accentua sa libération intérieure. Les extases qu’elle connut à Gex pendant très peu de temps augmentèrent son détachement, en lui faisant vivre une sorte de perte dans l’immensité, alors que ses premières expériences, purement intériorisées, avaient brusquement débuté une douzaine d’années plus tôt, au moment où, sur le conseil d’un fransciscain, elle avait abandonné les méditations discursives pour l’oraison du cœur. C’est au cours d’une retraite, en 1682, où elle put complètement s’abandonner à ses états, qu’elle découvrit à la fois sa capacité de connaître intuitivement et d’aider autrui, et l’inspiration (elle écrivit alors de façon automatique Les torrents spirituels). Comme cela arrive fréquemment chez les mystiques, Mme Guyon traversa donc des expériences très fortes et contrastées avant de s’engager peu à peu, vers le milieu de son existence, dans une carrière « apostolique », qui atteignit un maximum à Grenoble en 1684, puis s’exerça dans un cercle plus aristocratique, à partir de 1686, après son retour à Paris.
2 Les tribulations extérieures ne manquèrent pas dans la vie de Mme Guyon : d’abord souffrances familiales et domestiques (dont le manuscrit d’Oxford présente une image plus dramatisée), puis tracasseries ecclésiastiques de toutes sortes (à cause de son anti-jansénisme, de sa fortune, de son attachement au Père La Combe, enfin de son apostolat). Mme Guyon parle souvent de son appétit ou goût des croix, dans lequel nous serions tentés de soupçonner une pointe de masochisme, alors que ce fut l’un des rares traits que Bossuet ait appréciés en elle.
206
2. Il me fit comprendre, qu’il ne m’appelait point, comme l’on avait cru, à une propagation de l’extérieur de l’Église, qui consiste à gagner les hérétiques/1, mais à la propagation de son Esprit, qui n’est autre que l’Esprit intérieur, et que ce serait pour cet Esprit que je souffrirais. Il ne me destine pas même pour la première conversion des pécheurs, mais bien pour faire entrer ceux qui sont [déjà] touchés du désir de se convertir, dans la parfaite conversion, qui n’est autre que cet Esprit intérieur. Depuis ce temps Notre Seigneur ne m’a pas chargé d’une âme qu’il ne m’ait demandé mon consentement, et qu’après avoir accepté cette âme en moi, il ne m’ait immolée à souffrir pour elle. Il est bon d’expliquer la nature de cette souffrance, et de sa différence de celle que l’on souffre pour soi.
3. La nature de cette souffrance est quelque chose de plus intime, de plus fort, et de plus séparé. C’est un tourment excessif. On ne sait où il est, ni dans quelle partie de l’âme il réside. Il n’est jamais causé par
1 Le zèle de Mme Guyon pour l’orthodoxie s’affirma à plusieurs reprises. À Montargis d’abord, quand elle espéra persuader un vicaire janséniste, qui lui inspira dans sa période de sécheresse une passion platonique et tourmentée, ou quand elle ramena au catholicisme un horloger protestant avec toute sa famille. Puis, à la fin de sa crise, quand elle se sentit de plus en plus irrésistiblement appelée vers Genève, ce qui motiva apparemment son départ pour la Savoie, où elle séjourna d’abord dans une maison de Nouvelle Catholiques, destinée à recevoir les protestantes converties. Bien qu’elle soit demeurée personnellement très attachée aux croyances et aux dévotions catholiques, elle perdit ses préventions religieuses, car, après ses années d’incarcération à Vincennes et à la Bastille, elle termina obscurément sa vie, entourée surtout de protestants étrangers, la plupart écossais, dont certains l’aidèrent à mettre au net le manuscrit de son autobiographie. Elle correspondit alors avec son éditeur, Pierre Poiret, qui vivait en Hollande. Jugeant, comme Mme Guyon à la fin de sa carrière, l’expérience intérieure plus essentielle que les différences de confession, celui-ci publia les écrits mystiques les plus divers, de la Théologie germanique ou d’un résumé de Boehme, à Angèle de Foligno, Catherine de Gênes, J. J. Olier, ou au Frère Laurent de la Résurrection, et il fit précéder sa Bibliotheca mysticorum selecta d’une dissertation de James Garden, intitulée Theologica pacifica seu comparativa. Répandu, après sa condamnation par Rome, en divers milieux protestants, piétistes, quakers, le quiétisme y apporta une confirmation ou un ferment. On lira à ce propos Les spirituels français et espagnols chez John Wesley et ses contemporains, de Jean Orcibal (Revue de l’histoire des religions, janvier-mars 1951), ou The Later periods of Quakerism, de Rufus Jones (Macmillan, 1921, 2 vol.). Certains témoignages sur les assemblées recueillies des Quakers, cités par Henri van Etten (Georges Fox et les Quakers, Seuil, 1956), rappellent l’intercommunication décrite par Mme Guyon : « Dans le silence, nous entrons en communion non seulement avec Dieu, mais avec les autres. » Ou encore : « Il n’y a pas que l’influence de la parole : il y a l’expérience de la présence et de la lumière que chacun irradie autour de soi. Ceux qui n’ouvrent jamais ou presque jamais la bouche au culte ne sont pas moins indispensables pour créer cette ambiance de recueillement et d’adoration. Nous connaissons par expérience tout ce qu’apporte la seule présence de telle ou telle personne, homme ou femme. »
207
réflexion, et n’en peut produire aucune. Il ne cause ni trouble, ni entortillement. Il ne purifie point, c’est pourquoi l’âme ne trouve point qu’il lui donne rien. Son excès n’empêche point une jouissance sans jouissance, et une paix parfaite : il n’ôte rien de la largeur. On n’ignore point que c’est pour des âmes que l’on souffre, et très souvent on sait la personne : on se trouve dans ce temps uni à elle d’une manière douloureuse comme un scélérat est attaché à l’instrument de son supplice. On porte souvent les faiblesses que ces personnes devraient ressentir, mais pour l’ordinaire c’est une peine générale, indistincte, qui souvent a une certaine relation au cœur, qui cause d’extrêmes douleurs de cœur, mais des douleurs violentes, comme si on le pressait ou qu’on le perçât avec un glaive. Cette douleur, qui est toute spirituelle, a son siège au même lieu qui est occupé de la présence de Dieu : elle est plus forte que toutes les douleurs corporelles, et elle est cependant si insensible et si éloignée du sentiment, que la personne qui en est accablée croirait, si elle était capable de réflexion, que cela n’est pas, et qu’elle se trompe.
Depuis que Dieu voulut bien me faire part de l’état apostolique, que n’ai-je point souffert! Mais à quelque excès qu’ait été ma souffrance, et quelque faiblesse que j’aie eue dans les sens, je n’ai jamais désiré d’en être délivrée : au contraire, la charité pour ces âmes augmente à mesure que la souffrance devient plus grande, et l’amour que l’on a pour elles croît avec la douleur/1.
1 Mme Guyon décrit ailleurs ses souffrances pour le Père La Combe, dont elle disait éprouver de loin les résistances ou les retours à Dieu, ce que des lettres par la suite lui confirmaient (Vie, IIe partie, chap. 12, § 8). Elle souffrit aussi pendant trois ans pour la purification d’une servante qui vivait en sa compagnie et dont il lui arriva de ressentir l’approche ou le contact comme un feu insupportable, qui fait songer à la brûlure attestée par Ramakrishna lorsque quelqu’un d’insuffisamment purifié le toucha à l’improviste (Vie, IIe partie, chap. 16). Ce qui comptait essentiellement pour Mme Guyon était le degré de refus ou d’abandon de l’individu : elle ne se sentait capable de pleinement transmettre qu’avec l’assentiment d’autrui.
Elle a précisé dans ses Discours (1716, 2 vol.) les modalités de la transmission, selon l’insuffisance de réceptivité, l’agitation ou la passivité du disciple, la durée, la distance, et il serait significatif de comparer ses remarques à celles faites à ce sujet dans d’autres traditions. « Au commencement que l’âme se communique à un sujet rétréci en lui-même, celui-ci ne reçoit que peu à peu ; et l’âme dont Dieu se sert le sent très bien, car il ne sort pas d’elle autant que Dieu lui donne pour ces personnes, parce que, comme j’ai dit, leur cœur est étroit, ou qu’il y a trop d’activité. Il faut alors que la longueur de temps supplée au défaut de la largeur [du cœur]. Il est aisé de comprendre qu’une eau ne se communique pas abondamment dans un endroit trop étroit, et qu’elle se pousse avec impétuosité dans les lieux où il y a assez d’étendue. pour la contenir… L’âme ne peut non plus ignorer pour qui Dieu la remplit de la sorte, parce qu’il penche son cœur du côté qu’il veut qu’elle se communique comme on met un tuyau dans un jardin pour faire arroser l’endroit que l’on veut arroser, et cet endroit-là seulement demeure arrosé. Quelquefois plusieurs personnes reçoivent dans le même temps l’écoulement de ces eaux de grâce, et cela à proportion que leur capacité est plus ou moins étendue, leur activité moindre, et leur passivité plus grande » (Discours LXIV, § 6-7, t. II, p. 354-355).
« La communication se fait de loin aussi bien que de près lorsque les âmes sont assez perdues pour cela, mais cette communication [de loin] n’est [ordinairement] ni si intime ni si prompte [que celle de près]. » Après avoir rappelé le récit de l’Évangile de Marc, où une femme fut guérie par la « force » sortie du Christ, à l’instant où elle parvint à toucher furtivement son manteau, Mme Guyon ajoute : « Les communications ne sont de cette sorte que pour un temps, non par rapport à la personne de qui elles sortent, mais par rapport à celui qui les reçoit. Plus son cœur est étroit, plus il faut d’approche pour se communiquer, et la communication ne se fait que peu à peu. Mais quand le cœur est devenu étendu, et qu’il participe à l’immensité de celui qui lui communique, alors on se communique aussi bien à cent lieues que proche » (Discours LXVII, § 1-3, t. II, p. 371-372).
208
4. Il y a deux sortes de douleurs, l’une, causée par l’infidélité actuelle des âmes, l’autre, qui est pour les purifier et les faire avancer. La première serre le cœur, l’afflige, affaiblit les sentiments, cause une certaine agonie et comme un tiraillement, de même que si Dieu tirait d’un côté et l’âme de l’autre, en sorte que cela déchirât le cœur. Cette douleur est plus insupportable qu’aucune autre, quoiqu’elle ne soit pas plus profonde. La douleur de la purification pour autrui est une douleur générale, indistincte, qui tranquillise, unit à la personne pour laquelle on souffre et à Dieu. C’est une différence que l’expérience peut seule faire entendre ; toute personne d’expérience me comprendra.
Rien n’égale ce que l’on souffre pour des personnes qui l’ignorent très souvent, ou pour d’autres qui loin d’en avoir de la reconnaissance, ont du rebut pour ceux qui se consument pour elles de charité. Tout cela ne diminue point cette charité, et il n’y a point de mort ni de tourment que l’on ne souffrît avec un plaisir extrême pour les rendre comme Dieu veut.
5. La justice divine appliquée sur l’âme pour la faire souffrir en purifiant les autres, ne cesse point de faire souffrir lorsque c’est pour une infidélité actuelle, que cette infidélité ne soit cessée. Il n’en est pas de même pour la purification ; elle se fait par intervalles, et l’on a du relâche après avoir souffert. On trouve que l’on acquiert une certaine aisance avec cette âme, qui marque que ce que l’on a souffert a purifié et mis l’âme dans le moment présent comme Dieu la souhaite. Quand les âmes sont en voie et que rien ne les arrête, cela va tout uniment, mais lorsqu’elles sont arrêtées, il y a quelque chose au-dedans qui le fait connaître.
6. La justice de Dieu fait souffrir de temps en temps pour certaines âmes jusqu’à leur entière purification : sitôt qu’elles sont arrivées où Dieu les veut, on ne souffre plus rien pour elles, et l’union qui avait été souvent couverte de nuages s’éclaircit de telle sorte, qu’elle devient
209
comme un air bien pur, pénétré partout, sans distinction, de la lumière du soleil. Comme M***/1 m’a été donné d’une manière plus intime que nul autre, ce que j’ai souffert, ce que je souffre, et — ce que je souffrirai pour lui surpasse tout ce qui se peut dire : le moindre entre-deux entre lui et moi, entre lui et Dieu (car l’un est comme l’autre), c’est comme une petite ordure dans l’œil qui lui fait une extrême douleur, et qui n’incommoderait aucun autre endroit du corps où elle pourrait être mise. Ce que je souffre pour lui est très différent de ce que je souffre pour les autres, sans en pouvoir pénétrer la cause, si ce n’est que Dieu m’a unie plus intimement à lui qu’à nul autre, et que Dieu a de plus grands desseins sur lui que sur les autres.
1 II s’agit de Fénelon, déjà cité à la fin du chapitre précédent, lequel s’achevait, dans le manuscrit primitif, sur un passage quelque peu exalté. Lorsque Mme Guyon estima que Bossuet cherchait à la condamner et désirait pour cela faire lire son autobiographie aux deux autres ecclésiastiques chargés de l’examiner, elle supplia le duc de Chevreuse de retirer les cinq feuillets concernant Fénelon, afin de ne pas compromettre ce dernier, en qui, après sa désignation comme précepteur du jeune duc de Bourgogne en août 1689, elle avait sans doute mis espoir pour faire politiquement triompher la dévotion. Ce texte, dont Bossuet prit néanmoins connaissance puisqu’il le signale dans sa Relation sur le quiétisme de 1698, et qu’élimina l’édition de la Vie en 1720, fut publié par Maurice Masson en tête de la correspondance échangée par Fénelon et Mme Guyon en 1688-1689 (cf. Fénelon et Mme Guyon, Hachette, 1907). Au cours d’une lettre Mme Guyon fait état des sentiments de joie et de paix qu’aurait éprouvés Fénelon en sa compagnie. Dans ses propres lettres, Fénelon, s’il parle quelquefois de façon vague de son « union » avec elle, se plaint le plus souvent de son état sec ou languissant, ou encore de ses progrès inégaux dans l’esprit d’enfance et l’abandon. On peut supposer qu’il avait été préparé à admettre cette transmission immédiate par les allusions que firent peut-être devant lui son oncle Antoine et M. Tronson à propos de M. Olier. Toujours est-il que, parmi les citations que Mme Guyon, avec l’aide de Fénelon, réunit en une sorte de dictionnaire des grands thèmes dans le but de défendre ses propres écrits (ses justifications), figure, à la fin de l’article « fécondité spirituelle », l’une des lettres d’Olier publiées par Tronson à l’époque où le futur archevêque de Cambrai entrait au séminaire de Saint-Sulpice.
7. Lorsque je souffre pour une âme, et que j’entends seulement prononcer le nom de cette personne, je sens un renouvellement de douleur extrême. Quoique depuis bien des années je sois dans un état également nu et vide en apparence, à cause de la profondeur de la plénitude, je ne laisse pas d’être très pleine. Une eau qui remplissant un bassin se trouve dans les bornes de ce qu’il peut contenir, ne fais rien distinguer de sa plénitude, mais lorsqu’on lui verse une surabondance, il faut qu’il se décharge. Je ne sens jamais rien pour moi-même, mais lorsque l’on remue par quelque chose ce fond infiniment plein et tranquille, cela fait sentir la plénitude avec tant d’excès, qu’elle rejaillit
210
sur les sens/1. C’est ce qui fait que loin d’entendre dire ni lire certains passages, je l’évite : non qu’il me vienne quoi que ce soit par les choses extérieures, mais c’est qu’une parole entendue remue le fond. Quelque chose dite de la vérité, ou contre la vérité, le remue de même, et ferait éclater si cela durait/2.
1 Les contrecoups physiologiques de cette plénitude rejaillissant sur les sens n’ont pas moins surpris Bossuet que le refus des prières de demande ou des actes réfléchis ; il voyait là une façon non sacramentelle et anarchique de transmettre la grâce, de même qu’il était choqué par le pouvoir de « lier et délier » que Mme Guyon semblait s’attribuer. « Tout cela, écrit-il, me parut d’abord superbe, nouveau, inouï, et dès là du moins fort suspect, et mon cœur, qui se soulevait à chaque moment contre la doctrine des livres que je lisais, ne put résister à cette manière de donner les grâces. Car distinctement, ce n’était ni par ses prières, ni par ses avertissements qu’elle les donnait : il ne fallait qu’être assis auprès d’elle pour aussitôt recevoir une effusion de cette plénitude de grâces. Frappé d’une chose aussi étonnante, j’écrivis de Meaux à Paris à cette Dame, que je lui défendais, Dieu par ma bouche, d’user de cette nouvelle communication de grâces, jusqu’à ce qu’elle eût été plus examinée. » (Relation sur le quiétisme, IIe section, § 3.) Mme Guyon écrivait à Bossuet le 6 octobre 1693 qu’elle lui préciserait les noms de ceux qui avaient expérimenté avec elle cette communication, dont elle espéra un peu naïvement pouvoir faire bénéficier Bossuet lui-même. La part du subjectif ou de l’illusion demeure donc ici un problème et la seule « preuve » de tels phénomènes dans le passé réside dans les témoignages, tandis que de nos jours des enregistrements simultanés fourniraient peut-être un indice plus objectif d’un accord éventuel entre deux sujets.
2 Le débordement de la « plénitude » pouvait donc aussi bien résulter d’une allusion religieuse, qui la touchait, que d’une inexactitude ou d’une contrariété. Dans l’épisode rendu célèbre par les persiflages de Bossuet, et où Mme Guyon, séjournant à la campagne chez la duchesse de Béthune-Charost, dut être délacée, son malaise ne venait pas seulement du besoin de « se décharger » de l’excessive plénitude qu’elle ressentait, mais aussi de son incapacité à s’expliquer devant plusieurs personnes peu au courant et dont la présence la gênait (Vie, IIIe partie, chap. I, § 9, d’où a disparu de la version imprimée le détail pittoresque du corset ou du corps de jupe crevant de deux côtés, que signale la Relation). Mme Guyon a plusieurs fois décrit son besoin de parler ou d’agir spontanément, sans retenue ni arrière-pensée.
8. On croira peut-être que parce que tout le temps de la foi lorsqu’elle est savoureuse, on a peine à lire (j’entends que l’on éprouve un je ne sais quoi, qui ferme la bouche), ce sera ici la même chose : on se tromperait. On ne peut presque se servir d’expression dans les derniers états qui n’ait quelque signification pareille à celle des états antérieurs : cela vient de la disette des termes, et il n’y a que l’expérience qui puisse démêler cela, car toutes les personnes qui sont dans les états de foi nue mêlée de soutien et de quelque saveur profonde, se croient où je dis. Ceux-ci sont recueillis, ou plutôt sentent émouvoir en eux, par la lecture ou par ce qu’on leur dit, une certaine occupation de Dieu qui leur ferme la
211
bouche, et souvent les yeux, leur empêchant de poursuivre la lecture. Il n’en est pas de même ici : c’est un regorgement de plénitude, un rejaillissement d’un fond comblé et toujours plein pour toutes les âmes qui ont besoin de puiser les eaux de cette plénitude : c’est le réservoir divin, où les enfants de la Sagesse puisent incessamment ce qu’il leur faut lorsqu’ils sont bien disposés, non qu’ils sentent toujours ce qu’ils y puisent, mais je le sens bien.
Il ne faut pas prendre les choses qui sont écrites aux termes des paroles, car si on les prenait de la sorte, il n’y a presque point d’état consommé qu’une âme d’un certain degré ne crût éprouver : mais patience, elle verra elle-même dans la suite cette infinie différence. Les âmes mêmes des degrés inférieurs paraîtront souvent plus parfaites que ces âmes consommées dans l’amour et par l’amour, parce que Dieu, qui veut qu’elles vivent avec les autres hommes et leur dérober la vue d’un si grand trésor, couvre leur extérieur de faiblesses apparentes, qui comme une crasse vile, couvrent d’infinis trésors et empêche leur perte.
9… Les âmes arrivées ici se trouvent dans une perfection actuelle consommée, et elles meurent d’ordinaire en cet état lorsqu’elles ne sont pas destinées pour aider les âmes, mais lorsqu’elles le sont, Dieu divise le fond divinisé d’avec l’extérieur, et livre l’extérieur à des faiblesses enfantines, ce qui tient l’âme dans une abstraction continuelle et une ignorance totale de ce qu’elle est, à moins que ce fond, dont nous avons parlé, ne soit remué, et cela pour le bien des autres : alors on se trouve bien étrange, mais de dire ce que c’est, on ne le peut exprimer. Les faiblesses extérieures de ces âmes leur servent de couverture, et empêchent même qu’elles ne servent d’appui aux autres dans les routes de la mort où elles les conduisent. Ce sont toutes des faiblesses enfantines. Si les âmes qui sont conduites par ses personnes pouvaient pénétrer au travers de cet extérieur si faible la profondeur de leur grâce, elles les regarderaient avec trop de respect, et ne mourraient point à l’appui que leur ferait une telle conduite…
10. Ces personnes sont un paradoxe et à leurs yeux et aux yeux de tous ceux qui les voient, car on n’y voit qu’une écorce grossière, bien que pourtant il en sorte souvent une moelle divine. Et ainsi, ceux qui en veulent juger par les yeux de la raison ne savent par où s’y prendre. O divine sagesse, ô science savoureuse, vous coulez incessamment de la bouche et du cœur de ces âmes comme une source [de sève] divine qui communique la vie à une infinité de branches, quoiqu’on ne voie qu’une écorce grossière et toute moussue./1
1 De ceux qui sont intérieurement libérés Mme Guyon remarque aussi dans les Torrents : « L’extérieur de ces personnes est tout commun et l’on n’y voit rien d’extraordinaire. » Parfois cependant leur liberté scandalise les esprits étroits, et l’on entrevoit ici, des taoïstes aux fous du Christ en Russie, ou aux
212
malâmatis de l’Islam, toute la gamme des comportements tantôt effacés, tantôt risibles, tantôt choquants, à l’abri desquels la vie intérieure la plus profonde cherche à passer inaperçue. Dans la suite du chapitre, Mme Guyon observe : « Une telle âme ne se soucie ni d’honneur, ni de bien, ni de vie… Si elle n’était pas de la sorte, elle ne pourrait servir aux âmes dans toute l’étendue des desseins de Dieu. La moindre circonspection empêche l’état de la grâce » (§ 9). Elle souligne la violence des oppositions que rencontre l’action apostolique (§ 12). Il existe une progression continue, depuis le début, alors que les puissances et les facultés jouent fortement leur rôle, jusqu’au dénuement, où tout s’efface dans l’unité divine : ainsi perdue dans le « fond-Dieu », l’âme acquiert une « souplesse infinie » (§ 15). La réserve vis-à-vis de certains dirigés ne dépend plus alors que de leurs propres réticences et préjugés. Finalement il est impossible de juger correctement de l’extérieur ces âmes qui ont dépassé toute valeur raisonnable et dans lesquelles s’unissent paradoxalement « ces contraires qui s’allient si bien, quoiqu’ils paraissent inalliables, de la force divine et de la faiblesse d’un enfant » (§ 16).
LES écrits de Madame Guyon sont assez riches et assez nombreux pour qu’il nous ait paru intéressant de compléter le chapitre de son autobiographie qu’a présenté Jean Bruno par un choix de textes permettant de situer la transmission spirituelle dans l’ensemble de sa profonde expérience mystique et d’en dégager les différents aspects. Nous avons puisé ce témoignage non plus seulement dans La Vie, mais aussi et surtout dans les Discours spirituels et les Lettres326 si vivantes, adressées à ses intimes, à ses disciples.
À cette lecture, il nous est apparu qu’elle n’était pas seulement une grande mystique chrétienne, mais aussi qu’elle guidait d’autres personnes sur le chemin splendide, mais ardu qu’elle avait elle-même parcouru pendant tant d’années. Elle en avait une vision si limpide, si directe, qu’il est impossible de douter de l’authenticité de son expérience. Elle découvrit au fil de l’évolution de sa propre vie intérieure qu’il ne s’agissait pas uniquement d’expériences personnelles éprouvées en solitaire, mais que cette union divine, cette grâce reçue, cette félicité dont elle était imprégnée pouvaient se communiquer aux autres sans l’ombre d’une volonté propre dans un mouvement de flux et de reflux, une union des cœurs. Ces communications s’opéraient au cours d’oraisons silencieuses faites en commun d’abord, puis de loin comme de près.
La connaissance de ce mystère s’approfondit lorsqu’elle atteignit ce qu’elle appelle « l’état apostolique » et, dans des lettres admirables, elle décrit avec une clarté, une subtilité extrêmes, l’état de celui qui transmet cette « grâce divine » à autrui, ainsi que la perception incroyablement fine, précise qu’elle a de l’état intérieur de celui qui la reçoit.
À une époque où le « pur amour » est l’objet d’une doctrine et d’acerbes controverses, Madame Guyon en est l’incarnation vivante : le pur amour chez elle est pure expérience. Certes, lorsque débuta son « état apostolique », elle connaissait les textes, elle avait même tôt commencé à lire les grands mystiques, mais très tôt aussi elle était entrée dans une vie de « pur amour », de « foi nue » et de « charité parfaite ». Tout ce qu’elle en dit est inspiré
214
par cette expérience personnelle, qu’elle décrit souvent à la première personne. Son ton affirmatif, sa clarté, fruits d’une évidence qui l’habitait tout entière, éveillent chez le lecteur attentif et non encombré de préjugés intellectuels une résonance profonde d’authenticité.
Au terme de cette longue expérience327, c’est-à-dire une fois l’opération divine accomplie :
« … L’âme ne se sent ni possédée de Dieu, ni animée, ni pénétrée ; mais elle est écoulée dans la divine essence, sans néanmoins qu’elle sente cet écoulement. La subsistance n’est plus en elle, ni pour elle ; c’est Dieu seul qui subsiste dans le centre de son être divin. Ô qui pourrait exprimer les grandes merveilles de cet état, auquel l’âme ne prend plus de part, non plus que si elle n’avait jamais été créée ! » (Discours LXX, tome II, p. 389-390).
Ainsi l’être tout entier est maintenant investi par Dieu. Avec des accents purs, ailés, merveilleux, Madame Guyon dit :
« Tout est tellement transformé en Dieu, que tout est fait Dieu et au corps et en l’âme : tout se divinise et se rend uniforme en amour. Ô pureté incompréhensible, qui ensevelit le corps aussi bien que l’âme ! On ne peut plus distinguer le corps d’avec l’âme. Tout est un en Dieu, et tout est Dieu. L’âme n’est plus un poids au corps, ni le corps n’est plus un empêchement à l’âme. Dieu est tout en tout dans le centre de son amour. Je ne sens plus rien qui me nuise et qui me charge. Je ne sens de tendance pour aucune chose : tout se repose dans son centre, et je ne puis rien dire qui puisse exprimer cet état… » (Ibid p. 393).
Cette transmutation de l’être achevée, il ne restait plus à Madame Guyon qu’à transmettre la grâce divine dont elle était profondément imprégnée. Cela se fit peu à peu et elle nous révèle les étapes de sa découverte, autrement dit de son entrée dans ce qu’elle appellera elle-même l’état apostolique.
La communication se fait au début de près et en silence :
« … J’appris alors un langage qui m’avait été inconnu jusque là. Je m’aperçus peu à peu que lorsque l’on faisait entrer le P. La Combe ou pour me confesser, ou pour me communier, je ne pouvais plus lui parler et qu’il se faisait à son égard dans mon fond le même silence qui se faisait à l’égard de Dieu (…) Peu à peu je fus réduite à ne lui parler qu’en silence, ce fut là que nous nous
215
entendions en Dieu d’une manière ineffable et toute divine. Nos cœurs se parlaient et se communiquaient une grâce qui ne se peut dire. Ce fut un pays tout nouveau pour lui et pour moi, mais si divin, que je ne le puis exprimer. Au commencement cela se faisait d’une manière plus perceptible, c’est-à-dire que Dieu nous pénétrait d’une manière si forte de lui-même et que son divin Verbe nous faisait tellement une même chose en lui, mais d’une manière si pure et si suave, que nous passions les heures dans ce profond silence, toujours communicatif, sans pouvoir dire une parole. C’est là que nous apprîmes par notre expérience les communications et les opérations du Verbe pour réduire les âmes dans son unité, et à quelle pureté on peut parvenir en cette vie. » (La Vie, IIe partie, chap. XIII § 5).
À la lecture de l’extrait d’une lettre où elle s’adresse personnellement et intimement à son correspondant, nous découvrons le mode de communication qui s’opère dans le silence d’un cœur à cœur ineffable hors de tout moyen sensible :
« On se connait, Monsieur, sans s’être jamais vu ! Et il y a en notre cœur un juge qui juge des autres cœurs. Vous m’entendez assurément ; et un seul mot que vous m’avez dit dans votre lettre me fait comprendre que vous m’entendez, puisque vous entendez la parole du Verbe, qui non seulement se fait entendre en vous, mais même se communique d’un cœur dans un autre lorsque tout est réduit en une parfaite nudité et unité. C’est dans ce parler ineffable que je vous en dis plus que je ne saurais vous en dire : c’est par lui que l’on se communique sans qu’il soit besoin d’aucune expression sensible, puisque ce silence très profond et toujours éloquent se fait mieux entendre que toutes les paroles possibles. Mon cœur est uni au vôtre dans celui qui ne souffre ni diminution ni partage. » (Lettre CXIII, Tome III p. 505).
De même dans son autobiographie :
« Tous ceux qui sont mes véritables enfants ont d’abord tendance à demeurer en silence auprès de moi », dit Madame Guyon dans un passage déjà cité (p. 204), « et j’ai même l’instinct de leur communiquer en silence ce que Dieu me donne pour eux. » Elle ajoute plus loin :
« Quand ils ont une fois goûté cette manière de communiquer, toute autre leur devient à charge. Pour moi, lorsque je me sers de la parole et de la plume avec les âmes, je ne le fais qu’à cause de leur faiblesse, et parce que, ou ils ne sont pas assez purs pour les communications intimes, ou il faut encore user de condescendance, ou pour régler les choses du dehors. » (Vie IIe partie, chap. XIII, § 8.)
216
Elle commente elle-même la découverte extraordinaire de cette communication intérieure, cet écoulement de grâce qu’elle ressent maintenant aussi bien de loin que de près :
« … Lorsque j’eus fait assez d’expériences de cela pour comprendre ces manières de communications, ces besoins si extrêmes se passèrent, et je commençai à découvrir, surtout avec le P. La Combe lorsqu’il était absent, que la communication intérieure se faisait de loin comme de près. Quelquefois Notre Seigneur me faisait comme arrêter court au milieu de mes occupations, et j’éprouvais qu’il se faisait un écoulement de grâce pareil à celui que j’avais éprouvé étant auprès de lui, ce que j’ai aussi éprouvé avec bien d’autres, non pas toutefois en pareil degré, mais plus ou moins, sentant leurs infidélités, et connaissant leurs fautes par des impressions inconcevables, sans m’y tromper, ainsi que je le dirai dans la suite. » (La Vie, IIe partie, chap. XIII § 12)
Les Lettres et les Discours montrent combien elle était en pleine possession de la connaissance de la transmission. Seuls une expérience mystique véritable, un accomplissement intérieur et une longue pratique de la communication avec autrui amenant une fine discrimination ont pu dicter de tels textes. Laissons-les parler pour elle :
« Vous m’avez demandé comment se faisait l’union du cœur ? Je vous dirai, que l’âme étant entièrement affranchie de tout penchant, de toute inclination et de toute amitié naturelle, Dieu remue le cœur comme il lui plaît ; et saisissant l’âme par un plus fort recueillement, il fait pencher le cœur vers une personne. Si cette personne est disposée, elle doit aussi éprouver au-dedans d’elle-même une espèce de recueillement et quelque chose qui incline son cœur. On discerne alors fort bien qu’on éprouve quelque chose au-dedans de soi-même que l’on n’éprouvait pas auparavant, mais pour ce temps-là seulement ; et quoique cela soit très simple, il ne laisse pas de se faire goûter du cœur, qui éprouve en soi une correspondance pour cet autre cœur.
Mais lorsqu’il y a quelque chose qui resserre ou empêche cette communication, l’âme supérieure le sent bien. C’est comme une eau qui voulant se faire passage, et ne trouvant point d’issue, retourne sur elle-même. Cela peut venir aussi de ce que l’autre personne n’étant point accoutumée à cette manière n’y correspond pas par un certain recueillement et un certain esprit d’attente, comme pour recevoir ce que Dieu voudrait donner par là.
Cela ne dépend point de notre volonté : mais Dieu seul l’opère dans l’âme, quand et comme il lui plaît, et souvent lorsqu’on y pense le moins. Tous nos efforts ne pourraient nous donner cette
217
disposition ; au contraire, notre activité ne servirait qu’à l’empêcher. Dieu la donne donc, et l’ôte, comme il lui plaît.
Il ne faut point dire à cela : je ne veux rien : car il faut recevoir également tout ce que Dieu donne, et par le moyen qu’il lui a plu de choisir, et qui n’y a non plus de part qu’un tuyau qu’on met auprès d’une eau pour la faire couler, et qu’on ôte quand on veut. » (Discours LXVIII, tome II, p. 376-7)
« (…) Lorsque les personnes auxquelles on se communique sont d’un degré inférieur, cela est plus sensible ; c’est comme lorsqu’une rivière se décharge dans une autre beaucoup plus bas cela fait beaucoup de bruit et est bien plus marqué. Mais quand ces eaux sont à niveau, et quand il n’y a plus du tout de pente, cela est fort tranquille. C’est alors comme une mer immense, où il se fait un flux et reflux de communications… » (Discours LXVII, tome II, p. 375)
Madame Guyon décrit avec subtilité et d’une façon imagée ce qu’elle ressent pour les personnes avec lesquelles elle communique. Elle distingue avec finesse et une rare sensibilité les aspects particuliers des effets de la grâce transmise selon les besoins de chacun.
« Il me semble que mon âme est comme une eau qui se répand dans les cœurs de ceux qui me sont donnés, avec abondance, jusqu’à ce qu’elle les ait rendus égaux à soi en plénitude divine. »328
« Ne vous étonnez pas de la joie et de la paix que vous goûtâtes l’autre jour avec moi. C’est une opération de Dieu, aussi bien que les autres que vous expérimentâtes. Vous en aviez besoin. La joie dilate, et la tristesse resserre le cœur. C’est en quoi on se méprend, surtout dans cette voie, lorsque l’on veut par une composition extérieure retenir certains instincts et mouvements de joie… »329
« La grâce intérieure pour les âmes augmente toujours, de sorte qu’il est surprenant de voir les effets que cela opère sur les âmes qui sont disposées. Il semble que ce soit un aimant qui les attire pour les perdre en Dieu ; et j’ai dans cette communauté deux ou trois filles qui, surprises de ce qu’elles éprouvent, disent que Dieu ne m’a amenée que pour elles. »330
« La communication que Dieu fait par lui-même et par ses créatures est toujours conforme et entre elles et à l’état de l’âme. Si c’est une personne qui ait besoin de sensible, cela se fait avec goût
218
et sensibilité ; si elle n’a besoin que de souplesse dans la main de Dieu, son âme par là est rendue plus souple ; si elle est en état de mort, cela lui cause la mort ; si elle a besoin de courage, cela lui en communique un imperceptible. Ainsi donc, il ne faut pas juger de l’utilité que nous recevons des communications par ce que nous ressentons ou goûtons sensiblement, mais par la suite ; et parce que l’on nous donne toujours ce qui nous est propre dans la volonté de Dieu, et selon son dessein éternel sur nous. »331
Le flux et le reflux, c’est-à-dire un certain échange au sein de la communication n’a lieu qu’avec des âmes déjà avancées.
« … pour le Père, j’éprouvais qu’il se faisait un flux et un reflux de communication de grâces qu’il recevait de moi et que je recevais de lui ; qu’il me rendait et que je lui rendais la même grâce dans une extrême pureté. » Ordinairement, pour « d’autres bonnes âmes… je ne faisais que leur communiquer la grâce dont elles se remplissaient auprès de moi dans ce silence sacré, qui leur communiquait une force et une grâce extraordinaire, mais je ne recevais rien d’elles. » (Vie, IIe partie, chap. XIII § 5.)
« (…) Il me semble que lorsque je suis avec vous, les choses ne sont que comme une simple transpiration imperceptible. Vous n’en connaissez pas les effets : il ne laisse pas d’y en avoir beaucoup : mais comme vos sens sont dissipés, et que vous êtes souvent occupé à parler ailleurs, cela me cause un tiraillement furieux : mais si nous étions ensemble quelque temps considérable sans distraction, vous apercevriez plus de largeur et d’aisance, et moins d’opposition pour moi. Dieu veut qu’il y ait entre vous et moi une communication parfaite de pensées sans exception, de cœurs et d’âmes sans réserve. Il m’a fait comprendre qu’il fallait qu’il y eut de vous à moi comme un flux et reflux, et que ce serait la communication éternelle que nous aurions ensemble lorsque nos âmes seraient de niveau. Mon âme fait à présent à votre égard comme la mer qui entre dans le fleuve pour l’entraîner et comme l’inviter à se perdre avec elle. (Lettre CXXIX, tome III, p. 560.)
Les lettres à Fénelon, son enfant spirituel le plus cher -- « il n’y a personne sur terre pour qui je sente une union plus intime et plus continuelle » -- sont empreintes de noblesse et d’enthousiasme tout ensemble, elles révèlent une très fine discrimination quant aux mouvements de la grâce en elle à son intention et aux effets de celle-ci en lui.
“Dieu me tient si fort occupée pour vous en lui, que cela aug ‑
219
mente chaque jour, loin de diminuer. Votre âme m’est continuellement présente, et il fait toujours jour chez elle pour moi. Il m’est montré comme elle me fut donnée dès que je vous vis en songe il y a huit ans : mais je ne vous connaissais pas, et vous ne me fûtes proprement manifesté qu’à N. Il semble que notre Seigneur ne me fasse vivre et rien souffrir que pour votre âme ; et c’est ce qui me paraît essentiel, tout le reste me paraît comme des accidents. Je m’explique : c’est comme un ruisseau que l’on conduit pour arroser un parterre ; il arrose bien en passant les endroits par où il est conduit, mais ce n’est que comme en passant, sa principale destination étant d’arroser ce parterre.
Sitôt que je suis devant Dieu, ce qui est fréquent (je veux dire d’une manière aperçue ; car il me semble que Dieu me fait la miséricorde de ne jamais sortir de lui-même) il me paraît que je suis comme un bassin qui reçoit avec abondance, mais qui ne reçoit que pour s’écouler en vous : et cela se fait continuellement. Votre âme me paraît d’une extrême pureté pour son degré, quoiqu’elle se couvre quelquefois à mon égard de petits brouillards qui la dérobent pour des moments à ma vue, sans la dérober à mon expérience, comme une personne que l’on sait être auprès de nous, mais dont les ténèbres nous dérobent la vue, et qui sans changer de situation, reparaît sitôt que les ténèbres se dissipent : c’est de cette sorte que votre âme m’est présente : elle me l’est continuellement et inséparablement comme je la suis de moi-même ; mais elle est quelquefois couverte de petits brouillards. Cette vue ou manifestation n’est point une vue objective ou distincte, mais une possession en soi, qui fait que l’on goûte cette âme, qu’on la possède en Dieu plus réellement (quelque éloigné que l’on soit de la personne) que l’on ne possède un ami présent lorsqu’on le tient embrassé ; car cette dernière possession est très grossière, imparfaite, momentanée, et hors de nous ; et la première est toute intime, spirituelle, pure, dégagée, continuelle, indépendante des moyens.” (Lettre, CCXXI, tome I, p. 625-627.)
« Il y a des moments qu’il me semble que mon âme vous attire à elle et vous change en elle en sorte que j’éprouve une unité ineffable de Dieu, de vous, et de moi, qui rend indivisibles des choses qui paraissent si distinctes. Lorsque je suis auprès de vous, il semble que l’on verse mon âme dans la vôtre d’une manière impétueuse : mais j’éprouve que mon âme n’est versée dans la vôtre que pour l’attirer à soi et l’abîmer en elle. Ce que je vous dis est plus réel que je ne puis dire : et je ne crois pas qu’il y ait encore une pareille union sur terre ; non de sentiment, mais en vérité et pureté. Votre âme est goûtée par la mienne, et je la trouve d’une pureté extrême. Ce qui fait la pureté de l’âme ne consiste pas dans les sentiments purs ou impurs, mais dans la séparation de
220
soi, sans retourner jamais pour un moment sur la demeure qu’on a quittée. Cela fait que l’âme demeure fixement attachée à Dieu, et ne s’en détourne jamais ; parce qu’elle ne peut s’en détourner que par retourner sur elle-même. » (Lettre CCXIX, tome I, p. 618-619.)
Écoutons à présent le témoignage de Fénelon lui-même :
“Je pense très souvent à vous, et je me trouve uni à vous de plus en plus, mais c’est une union générale et de pure foi. Je me trouve avec vous en celui qui est tout, et il me semble que nous y demeurerons toujours unis ; je suis persuadé comme vous que Dieu se sert de vous pour me préparer ses dons. La pensée que j’ai de vous m’est toujours utile, car je ne vous vois jamais qu’en Dieu, et Dieu à travers de vous, sans m’arrêter à vous…
« Notre union est fixe et elle va toujours croissant dans ce temps même. Vous avez raison de dire que rien n’est si doux que ces unions, quoiqu’elles ne paraissent donner aucun sentiment distinct. Je ne saurais dire aucune pensée particulière que j’ai eue en pensant si souvent à vous. C’est une vue confuse et comme morte, qui a néanmoins le germe de tout, avec un goût de paix et un rassasiement en Dieu. La confiance est pleine par la persuasion de votre droiture, de votre simplicité, de votre expérience et de vos lumières sur les choses intérieures, enfin du dessein de Dieu sur moi par vous.
“Je ne sais pas ce que vous ferez aux autres, mais je sais que vous me faites beaucoup de bien. Je suis ravi de me taire avec vous…” (Masson, op. cit. p. 114-115.)
À cette lettre Madame Guyon répond :
“Vous avez expliqué en peu de mots la nature de l’union simple, générale, qui ne forme nulle espèce, parce qu’elle subsiste en Dieu. Je vous trouve en Dieu et Dieu en vous. Plus je suis unie à Dieu, plus je vous trouve en lui. Ce qui me paraît plus marqué est que quelquefois il se fait en moi un réveil, comme si mon âme se répandait plus abondamment dans la vôtre, et comme si elle tirait la vôtre à une parfaite unité ; et cela d’une manière aussi pure que nue. » (Lettres, CCXXVI, tome I, p. 639-640.)332
Dans la lettre citée plus haut, Fénelon ayant fait une brève allusion à « certains petits moments de doute », mais seulement « passagers et dans l’imagination » au sujet de Madame Guyon qu’il ne connaissait alors que depuis quelque mois, celle-ci, dans la présente lettre, répond avec finesse, justesse et modestie :
221
« Comment n’auriez-vous point de doutes sur moi, qui en aurais infiniment moi-même si je pouvais réfléchir ? Lorsqu’il m’en est venu, ils se sont évanouis quelquefois par une lumière qui me faisait comprendre que Dieu prenait plaisir à se glorifier dans les sujets les plus faibles et les plus défectueux, afin que la force n’en fût pas attribuée à l’homme, mais à lui seul ; mais le plus souvent tout se perd dans une entière indifférence de tout ce qui me regarde. »
En effet, si Madame Guyon affirme la filiation spirituelle établie entre elle et ceux à qui elle transmet l’amour divin, si elle les guide dans le chemin ardu de leur progression mystique et les porte, tel un maître ses disciples, jamais elle ne se donne comme un maître ; elle parle de sa mission merveilleuse avec la plus grande humilité.
‘Je ne me regarde pas comme un conducteur, et il me semble qu’il y a de la différence de moi aux autres Directeurs (comme) d’un paysan à un Gouverneur. Le Gouverneur conduit un enfant avec autorité et par raison ; et comme il le mène dans un chemin, il vient à lui un pauvre paysan qui lui dit, Monsieur, je sais un chemin bien plus beau et bien plus court que celui que vous suivez, j’y passe tous les jours, suivez-moi, je vous y mènerai. On suit ce pauvre paysan à cause de son expérience, et non par nulle autorité qui soit en lui.’ (Lettre CXXXIV, tome III, p. 577.)
« La voie est bonne et droite, sainte, pure et sans tache ; mais combien de méchants marchent-ils par la voie des Saints ? Je n’ai jamais voulu vous tromper ; mais je ne vous ai jamais donné de certitude sur moi ; je vous en ai donné sur vous et sur la voie plût à Dieu que par tout mon sang je vous la puisse faire suivre jusqu’à la mort. Mais pour moi, laissez-moi, laissez-moi ; ne vous liez qu’à Dieu seul. Les moyens sont bons tant qu’ils sont dans l’ordre de Dieu ; ils nous nuiraient si nous les retenions un moment contre sa volonté. J’espère que quand vous serez arrivé en lui, vous trouverez cette misérable gouttelette d’eau dans cet Océan divin. » (Lettre CXXXVIII, tome III, p. 586.)
Mais en d’autres circonstances elle dira :
« Peut-on douter de la grâce d’une personne qui communique l’onction de la grâce, le goût de Dieu et le recueillement ; qui donne à chacun, sans se méprendre, selon son besoin, et qui pacifie les âmes troublées quand elles approchent d’elle ? » (Masson, p. 316.)
Un jour, elle eut l’idée de mettre à l’épreuve son aptitude à communiquer :
‘Hier… j’eus la pensée que, si c’était l’esprit de Dieu qui pro-
222
duisait cela en moi, une personne qui est bien à Dieu et qui était présente en ressentît les effets, sans rien marquer de ce que je pensais. Aussitôt cette personne entra dans une profonde paix, et me dit, sans savoir ce que j’avais pensé, qu’elle goûtait auprès de moi quelque chose de divin. » (Réponse de Madame Guyon à Fénelon citée plus haut.)
Madame Guyon apprécie à sa juste valeur ce don exceptionnel :
“Le don d’aider aux âmes sans paroles et en pure communication intime est des plus rares et des plus purs, et où la créature a moins de part ; et Dieu ne le donne que pour des âmes qu’il destine à un don singulier de nudité de foi, et à ne point agir par l’entremise des sens et des organes.” (Lettre CXXIII, tome III, p. 542 et Masson, op. cit. p. 237.)
“J’ai lu votre lettre, mon cher F. avec consolation, voyant la continuation des miséricordes de Dieu sur vous. Pour ce qui est de la filiation spirituelle, c’est une chose très véritable et très réelle, qui a même été éprouvée de quantité de personnes d’une raison opposée à ces sortes de choses qui demandent beaucoup de petitesse. Ceux que Dieu unit à sa paternité divine, ont un don de se communiquer intérieurement à leurs enfants de grâce, et Dieu s’en sert comme d’un canal de communication. Ils ont encore une autre qualité, qui leur coûte cher, et qui est de souffrir pour leurs enfants, de porter leurs faiblesses et leurs langueurs ; et les enfants éprouvent de leur côté qu’ils ont auprès de leur père ou mère de grâce une onction toute particulière ; c’est pourquoi ils éprouvent qu’il leur est communiqué quelque chose par le fond qu’ils ne reçoivent de nulle autre part.
S’ils se désunissaient volontairement de ces parents de grâce, ils se trouveraient aussitôt désunis de Dieu et dans le trouble ; et n’auraient la paix qu’en se remettant dans leur place, c’est-à-dire, demeurant unis de cœur et de volonté à ces personnes. L’union n’est point interrompue par la distance de lieux ; elle ne l’est que par l’infidélité. Les parents de grâce goûtent de loin d’une manière très simple et très pure la disposition de ceux qui leur sont unis de la sorte.” (Lettre CXXX, tome III, p. 565-6.)
Dans une autre lettre, elle justifie cette nécessité qu’elle avait de a communiquer’ à autrui la grâce divine dont elle était investie :
(…) “Or je dis que Dieu, comme être communicatif, communiquant à tous les êtres épurés ses qualités, il les rend lui-même des êtres communicatifs quand ils sont assez purs pour ne communiquer que lui-même : et alors c’est en eux aussi bien qu’en Dieu, (de la nature duquel ils sont rendus participants) une nécessité de se communiquer, sans choix et sans élection. Il leur est rendu
223
nécessaire de se communiquer à proportion que les âmes leur sont plus proches et plus unies en charité. Et comme tous ces petits moyens de communication (que j’appelle petits à l’égard du Tout qui se communique) sont disposés de telle sorte qu’il n’y a pour eux nul choix ni nulle inclination, le Maître les gouverne comme un excellent jardinier qui arrange des canaux ; il les dispose l’un d’une façon, et les autres d’une autre : en sorte que quoique ces canaux ne reçoivent de la même source que pour répandre, il faut qu’ils ne répandent nécessairement qu’aux endroits où ils sont situés, et ils se déchargent sans choix sur ceux qui leur sont les plus proches. L’eau qui se répand dans d’autres canaux différents, est la même, il est vrai, et en source elle ne fait qu’une même et seule eau, comme elle n’en fera éternellement qu’une même y étant retournée : mais cette eau n’a pas pour cela aucune pente marquée vers aucun côté : il faut que nécessairement elle suive celle qui lui est donnée sans choix et sans élection. De cette sorte le moyen ne sert jamais d’empêchement et d’entre-deux.
Saint Jean était le seul des Apôtres disposé à recevoir la communication du Verbe en cette manière : aussi quoiqu’il fut le plus jeune des Apôtres, il ne laissait pas d’être l’Apôtre de la dilection. Et pourquoi était-il le bien-aimé ? C’est qu’il était celui qui pouvait recevoir cette communication immédiate comme nous l’avons dit. Et comme la communication du Verbe est une communication d’amour, il aime nécessairement ceux dans lesquels il se communique de cette sorte. Saint Jean nous a appris qu’il recevait cette communication sans moyen ; puisqu’en reposant sur le cœur de Jésus-Christ, il recevait et approfondissait des secrets infinis dans un silence ineffable dont sûrement il n’était pas apprenti. O divin Maître, qu’il y avait longtemps que vous vous communiquiez de cette sorte à votre disciple, et que vous vous écouliez en lui ! Il s’était fait une transfusion si admirable de Jésus-Christ en Saint Jean, et le Maître s’était tellement écoulé dans le disciple en manière ineffable, que Jésus-Christ ne fit aucune difficulté d’assurer à la croix que Jean n’était plus Jean, mais qu’il était lui-même : car à mesure que Dieu s’écoule en nous, il nous perd en lui. C’est le même mouvement que celui des vagues de la mer : la même vague qui pousse, ce semble, dehors, perd et abîme en soi ce qu’elle avait poussé.” (Lettre, CXVI, tome III, p. 519-522.)
Dans la lettre (à Fénelon) d’où nous avons extrait le passage sur la rareté du don de communication en silence, Madame Guyon définit d’une façon aussi géniale que condensée l’essentiel de ce qu’elle nomme l’état apostolique -- l’état paradoxal de celui qui transmet. Peut-on exprimer avec plus de simplicité et de netteté la coexistence subtile de l’anéantissement et de la cha ‑
224
rité, dans une autre tradition on dirait du vide et de la compassion333, l’un étant la condition de l’autre ?
« II y a en moi deux états, qui n’en composent cependant qu’un. L’Essentiel, qui est toujours une foi nue, pure, ou plutôt un anéantissement total, qui exclut toute distinction, tout ce qui est et subsiste, en quelque chose que ce soit, tout aperçu, tout ce qui se peut dire et nommer, l’âme subsistant en Dieu en pure perte, ou plusieurs en total anéantissement. Il y a aussi un état accidentel, qui est ce que j’éprouve pour les autres, qui me fait goûter et connaître leur état et tout ce qui les concerne, ce qui donne des distinctions, songes, connaissances, etc., mais cela est séparé du fond immobile et n’a nul rapport avec lui ; de sorte que ces connaissances ne sont point des lumières et illustrations qui donnent une disposition particulière à l’âme, comme celles qui sont reçues dans les états inférieurs, qui, faisant une constitution à l’âme, l’altèrent et l’arrêtent, parce que cela la tire de sa générale nudité. » (Lettre CXXIII, Tome III, p. 541-542.)
Pour conclure, voici des extraits d’un très beau Discours334 qui prouve bien, encore une fois, que la mission apostolique de Madame Guyon repose sur une expérience mystique personnelle achevée. Il donne de l’état paradoxal décrit dans la lettre ci-dessus la trame profonde, la justification théologique.
Madame Guyon explique l’activité de l’âme à la lumière de la Trinité. Elle distingue en effet l’Essence divine immuable et la Trinité opérante des personnes. Les personnes de la Trinité sont « unies dans l’essence », mais elles parlent et agissent au dehors « en distinction » quoique « en unité parfaite ». C’est par elles que Dieu meut l’âme en état apostolique.
Tandis que le chemin mystique conduit l’âme à travers Jésus-Christ et les personnes de la Trinité jusqu’au plus profond de l’intériorité, jusqu’au point central ultime de « l’Unité essentielle » l’état apostolique consiste en une « sortie » à partir de ce point et à travers ces mêmes personnes, mais dorénavant Dieu seul opère sans que la créature agisse en quoi que ce soit. Ainsi se répondent le périple dans l’intériorité au-delà du monde des apparences et la mission apostolique de sortie en ce monde, mais d’une sortie toute divine :
« Or je dis qu’il faut que l’âme passe par Jésus-Christ et par la Trinité en distinction avant qu’elle arrive en Dieu seul, qui est la Trinité essentielle et indivisible, tout se trouvant réuni dans l’essence unique en unité parfaite (…) dans le point de l’Unité essentielle, où toute distinction personnelle se perd, et où nous demeurons cachés en Dieu avec Jésus-Christ. (…)
« Mais l’âme étant réunie dans ce point essentiel de Dieu seul, elle sort au-dehors par les effets comme les divines personnes par
225
leurs opérations, et ainsi elle se multiplie dans ses actions, quoiqu’elle soit une et très simple et indivisible en elle-même : de sorte qu’elle est une et multipliée sans que la multiplicité empêche l’unité, ni que l’unité interrompe la multiplicité. (…)
“Cet état néanmoins n’est point une sortie de la créature au-dehors pour parler, agir et produire les effets de la vie apostolique. L’âme n’y a point de part : elle est morte et très anéantie à toute opération ; mais Dieu, qui est en elle essentiellement en unité très parfaite où toute la Trinité en distinction personnelle se trouve réunie, sort lui-même335 au-dehors par ses opérations, sans cesser d’être tout au-dedans ; et sans quitter l’unité du centre il se répand sur les puissances (…) durant que cette âme, vide de toute propriété et distinction, non seulement des personnes, mais d’elle — même, demeure essentiellement unie à Dieu dans le fond, qui est Dieu même, où tout est dans le repos parfait de l’unité/essentielle de Dieu, pendant néanmoins que le même Dieu agit par elle en distinction de personnes.” La créature alors “est entièrement incapable de faire ce discernement et ne connaît ses paroles et ses actions que lorsqu’elles paraissent (…).
“L’âme arrivée à ce degré est immuable quant au fond, Dieu lui faisant part de son immutabilité. Elle est si pure, si nette, et si dégagée de toute sorte d’espèces qu’il ne lui vient pas quelquefois en tout un jour une seule pensée. Son esprit est comme une glace pure, qui ne reçoit aucune impression que celle qu’il plaît à Dieu de lui donner. (…)
“Dans cet état, l’on connaît ce qui est de l’intérieur des personnes pour lesquelles Dieu applique, et cela dans la même lumière. C’est là que l’on sait tout sans faire rien (…).
“C’est là que les merveilles du temps et de l’éternité sont découvertes sans nulle manifestation particulière : le moment qui fait parler ou écrire en fait tout le discernement. (…)
“C’est donc là ce que j’appelle ‘la vie apostolique’, savoir, l’état où l’âme étant morte à tout et parfaitement anéantie, ne retenant plus rien de propre, Dieu seul demeure avec elle et en elle, et elle est abîmée et perdue en lui, ne vivant dans son fond que de sa vie essentielle, mais sortant sans sortir au-dehors par sa vie personnelle en distinction d’effet, et non de connaissance ; ce qui nous est marqué dans les Apôtres, qui ne furent confirmés dans l’état permanent de la vie et des emplois apostoliques
226
qu’après la réception du Saint-Esprit avec plénitude, qui causa en eux un vide entier d’eux-mêmes, et une si grande souplesse à tout ce que Dieu voulait opérer par eux, qu’il est dit, que ce n’était pas eux qui parlaient, mais l’Esprit de leur Père céleste qui parlait par leur bouche ; que c’était Jésus-Christ qui parlait en lui. Toute personne qui aura lumière, ou qui sera parvenue à ce degré m’entendra.
Je dis de plus, que peu de personnes arrivent à cet état, et que de très saintes âmes meurent dans la consommation en Dieu seul, sans que Dieu soit sorti personnellement et par les effets en elles336. Il faut une vocation particulière pour que cela soit : et quand cela arriverait, il ne tire en rien l’âme de son unité parfaite en Dieu seul. (…)
Les âmes Apostoliques en qui cela s’opère, n’ont ni mouvement ni tendance, pour petite qu’elle soit, à aider et parler au prochain ; mais Dieu leur fournit tout par providence, et leur met en bouche des paroles, comme il lui plaît et quand il lui plaît. Ceci supposé, il est aisé de voir que très souvent il en est qui font de semblables fautes que celle qui a été remarquée, lorsque se trouvant dans la passivité de lumière et d’amour, ils prennent souvent comme de Dieu ce qui ne vient que de leur ferveur : et il y a souvent de la tromperie. Mais dans l’état dont je parle ici, il n’y en a point, et il n’y en peut avoir, à moins de sortir de l’état. Ces autres personnes disent souvent comme Coré, nous sommes aussi propres que les autres à aider le prochain, puisque tout ce qui est en nous est saint : mais la suite et l’expérience feront bien voir que s’ils sont saints en eux et pour eux, ils ne le sont pas encore pour faire l’office de Prêtre et de Pasteur en faveur des autres, cela étant réservé à ceux que Dieu a choisis pour cet emploi.
On peut aussi connaître par cela même, pourquoi tant d’ouvriers qui travaillent beaucoup dans l’Église de Dieu font très peu de fruit : c’est parce qu’ils s’ingèrent d’eux-mêmes sans être appelés, ou parce qu’ils ne sont pas assez établis en Jésus-Christ, ni unis à lui, pour rapporter par lui-même un grand fruit.”
Nous nous proposons d’aborder le problème de l’identité ou de la non-identité des relations analyste-analysant et maître-disciple. C’est à dessein que nous n’étudierons pas d’autres aspects de la comparaison entre l’analyse et la mystique. Nous mettrons plus particulièrement en valeur dans ces deux types de relation le sentiment d’amour qui prête souvent à confusion.
Nous nous sommes référés pour la situation analytique à un cadre que nous pensons commun à toutes les écoles, le plus épuré possible, c’est-à-dire à un cadre qui ne se soutient que par les sujets en présence. Excepté les contraintes de lieu et de temps dont nous parlerons plus loin, il n’existe en effet pas d’autre condition requise que la rencontre de deux personnes : analysant et analyste. C’est même l’absence de toute autre condition qui fait que tout repose sur les personnes de l’analysant et de l’analyste et de ce qui se noue entre eux. De ce point de vue, nous pensons que l’expérience analytique acquiert sa spécificité par elle-même et dépasse les divergences d’écoles. À ce titre, nous entendons par analysant la personne, le patient qui est dans un travail analytique. Le terme d’analyste se réfère plus à une fonction qu’à l’individu lui-même ; cette fonction, comme nous le verrons plus loin, tient de la position où l’analysant place la personne de l’analyste.
De même nous prenons la relation maître-disciple dans ce qu’elle a de plus central par-delà les traditions et indépendamment des particularités des différents systèmes. Toute notre étude repose sur ce qui se transmet et se vit entre le maître et son disciple, afin de mieux cerner la spécificité de cette relation par rapport à celle que nous étudions dans le cadre de l’analyse et afin de mettre en évidence plus clairement leur différence de nature. Nous désignons par “maître” la personne capable de transmettre ce que les mystiques appellent la grâce337. Le terme de “disciple” désigne le
228
sujet qui s’abandonne à l’action de la grâce transmise par le maître.
Ceci défini, il nous reste à lever une double ambiguïté : la première concerne l’amalgame devenu fréquent de nos jours entre thérapeute et maître, comme en témoigne le succès actuel de thérapies mystico-analytiques » ; la deuxième concerne l’usage d’un double discours : les mots ne désignent pas les mêmes réalités selon qu’ils sont employés dans le cadre de l’analyse ou dans celui de la mystique. Pour ne citer qu’un exemple, le terme « amour » est utilisé dans des sens très différents que nous nous efforcerons de préciser. Seule l’expérience permet de distinguer ce qui appartient à l’un ou à l’autre cadre.
Dans un premier temps, nous procéderons à la mise en place de notre recherche en précisant les axes principaux et en donnant quelques définitions indispensables à la compréhension de l’ensemble de l’article.
Dans un deuxième temps, nous aborderons la matière même de la relation propre à chacune des deux situations ; il y sera envisagé les différentes formes d’amour qui peuvent naître entre les deux protagonistes dans chacun des cas.
Dans un troisième temps, nous envisagerons l’aspect dynamique des deux relations. Le lecteur pourra observer dans cette partie une certaine symétrie dans le processus qui amène les différentes transformations : au début, les personnes sont à la recherche de quelqu’un qui sera susceptible de les accompagner, de les guider dans leur parcours. Il ne sera possible de parler d’analysant et de disciple qu’une fois cette quête achevée. Dans le premier cas s’opère un aménagement du transfert, dans le deuxième, le disciple va se saisir du lien ; l’un entre par le biais du transfert dans son histoire, tourne son regard sur lui-même et n’est plus en représentation, sa recherche est avant tout personnelle, l’autre par le « lien d’amour » accède à la nature même de l’expérience mystique qui l’introduit à l’instantanéité et à la plénitude. Ensuite nous analyserons le processus transférentiel et le cheminement vers l’union au maître à travers les formes de l’amour.
229
Nous parlons d’« analyste » et d’« analysant » à partir du moment où il existe un transfert entre deux personnes.
Être analysant correspond d’abord à une démarche de l’individu à la recherche de lui-même. Ceci va à l’encontre de la conception courante réduisant l’analyse à une thérapie : le projet de la cure analytique ne saurait se juxtaposer à la restauration de la santé, car cela supposerait qu’il existe obligatoirement une maladie à soigner. Il n’est plus possible aujourd’hui de considérer que le normal et le pathologique appartiennent à des catégories bien définies. Opposer l’un à l’autre ne saurait servir à notre sens un abord psychanalytique.
Être analysant suppose la capacité d’être en relation avec son inconscient (ce terme étant pris dans le sens où l’entend la psychanalyse) ainsi qu’une capacité au transfert. Ces deux points sont liés et en étroite dépendance.
Il en résulte qu’une analyse ne commence pas à n’importe quel moment, mais seulement quand la personne peut tourner son regard sur elle-même, sur son mode de relation aux autres et à son histoire, moment où peut également se développer une certaine créativité psychique. Dès lors un déplacement, voire un report d’affects, de sentiments portés sur les parents pourra s’effectuer sur la personne d’un analyste. C’est en ce sens que l’on peut parler de transfert. Celui-ci est limité par la règle d’abstinence : la relation n’est pas consommée, il n’existe pas de passage à l’acte, la majeure partie du vécu est exprimée en mots.
Le terme d’analyste fait référence à la place où il est mis par l’analysant qui l’a choisi comme tel et dont il a ici la charge. En ce sens il n’existe pas de fonction d’analyste en soi : cette fonction découle de la position occupée dans la psyché de l’analysant, position de celui qui est « supposé savoir » témoignant de la confiance que l’analysant porte à l’analyste, lequel à son tour ne peut s’autoriser que de lui-même. Le travail analytique qu’il a déjà entrepris sur sa propre personne reste le garant permettant de mener à bien la cure.
Le transfert demeure d’abord une relation d’amour, elle-même
230
report de relations plus précoces, en général infantiles. Il se joue dans la possibilité pour l’analyste de porter les images chargées d’affects ou de sentiments que projette sur lui l’analysant. En d’autres termes la demande ou la plainte d’amour, voire la séduction du patient concerne en dernier ressort l’analyste. L’analyse débute alors, le déplacement d’objet d’amour est possible (amour d’objet).
À ceci s’ajoute la fonction de miroir humain où le vécu de l’analysant est renvoyé de ce point de l’espace occupé par un autre que lui.
Ces trois termes désignent l’aspect tangible et limité de la relation. Ils définissent le cadre ou ce que les Anglais appellent le « setting ». L’aménagement de l’espace (lieu chaleureux propre à la détente et à la mise en confiance), les horaires, la mise à disposition de l’analyste pour le patient, sa tolérance et sa capacité à maintenir un cadre peuvent contribuer à une relation plus ou moins proche de la symbiose, mais déjà ouverte ou du moins orientée vers une séparation dans les limitations objectives données d’emblée que sont la régularité des horaires, des séances et la permanence du lieu.
Le contenu de la relation s’exprimera d’abord en mots. L’interprétation peut avoir une forme allégorique, mais elle utilise le canal du langage. Les mots peuvent être vécus comme substituts d’aliment (relation nourricière), mais ils portent en eux la séparation dès le départ.
Ce chemin de l’analyse, découverte de soi, est sous-tendu par l’éveil d’une instance de la personnalité appelée le moi. Ce terme appartient au langage philosophique, il est aussi utilisé dans bien des écrits mystiques. Si la psychanalyse s’en est emparée, c’est pour lui donner un sens qui lui est propre. Vu l’importance que revêt cette notion dans la théorie, il nous est apparu nécessaire de donner quelques éléments de définition pour replacer ce terme par rapport à d’autres qui peuvent sembler synonymes tels que : « je » ou « ego ». Suivant les écoles, il recouvre des sens différents. Lorsqu’il désigne la personne, il s’agit généralement d’une opposition entre l’intérieur (le moi) et l’extérieur. Par suite, le moi devient donc une limite, un organe de perception de la réalité (moi-réalité). Il peut désigner également une instance de la personnalité
231
dans la mesure où il est le siège, le centre de conflits. Ailleurs, Freud le considère comme un réservoir d’énergie.
Cette polysémie donne à comprendre le moi à la fois comme élément d’une dynamique de la personnalité, comme organe de perception de ce qui lui appartient ou non, comme un lieu pulsionnel (réservoir d’énergie), un centre, ou un pôle organisateur de décision donnant une direction, reposant sur un éveil de la conscience ; il désigne alors la position de celui qui voit (confrontation).
Le centre de la personne est édifié et renforcé dans la première relation avec la mère et peut l’être également dans la cure (acquisition d’un moi fort). Durant l’analyse le moi est éveillé en tant que capacité à se comprendre. Le patient trouve là un outil et aiguise un pouvoir de perception de lui-même et un pouvoir ordonnateur : ainsi la personne totale, le soi, peut-elle retrouver plus de cohésion.
Le transfert préside à cette transformation. Il fait bien souvent la spécificité de la cure propre à chaque école analytique.
L’ego, lui, se conçoit essentiellement comme une part de l’être. Il se manifeste souvent par le déni et l’agressivité. Lacan l’exprime sans détour :
« Nous avons appris à être sûr que lorsque quelqu’un dit : “ce n’est pas ainsi”, c’est parce que c’est ainsi ; et quand il dit : “ce n’est pas cela que je veux dire” il dit vraiment » (Lacan 1951).338.
Si le danger est tel que s’érigent des défenses manifestes propres à la survie, c’est que précisément le centre de la personne est menacé. L’ego, en effet, trouve ses premières bases dans un moment d’unification que Lacan rapproche du stade du miroir (vers 8 mois). Ce stade peut également être mis en rapport avec la « phase dépressive » (6-12 mois) décrite par Mélanie Klein, « la peur de l’étranger » décrite par R.A. Spitz et le stade du « Je suis » par D.W. Winnicott339.
Lors de cette expérience devant le miroir, l’enfant manifeste une jubilation intense du fait de l’illusion d’unité donnée par la découverte de son image qui le rassemble (les animaux lorsqu’ils s’aperçoivent de l’illusion se désintéressent complètement du
232
miroir). Cette jubilation répond « en miroir » à la peur de glisser à nouveau dans le chaos antérieur et à l’angoisse d’annihilation et d’effondrement qui se rattache à ce type d’expérience.
Cette mise en jeu de l’intégrité du sujet fait résistance au processus analytique :
« Nous le connaissons (l’Ego) comme la résistance au processus dialectique de l’analyse. Le patient est prisonnier de son Ego ; au degré exact qui cause sa détresse, et révèle sa fonction absurde. C’est très exactement ce fait qui nous conduit à élaborer une technique qui substitue les étranges détours de l’association libre à la séquence du dialogue » (Lacan 1951)340.
Le petit homme naît immature. Le développement s’exprime donc en termes de maturation. En effet, durant cette première relation, le centre de la personne, le moi, est encore fragile. Cette fragilité crée pour une bonne part la dépendance des débuts. L’élévation du seuil de réponse aux stimuli sensoriels et l’environnement jouent le rôle d’écran protecteur. L’image de lui-même que le nourrisson acquiert par le biais de ses proches lui devient nécessaire pour son autonomie, sa capacité à être seul et à se placer en face d’un objet, d’un autre vraiment autre. Ce centre est ce que les Anglo-Saxons appellent le « vrai self » par opposition au faux self (représenté par le self résultat de l’éducation, personnage social…) qui l’entoure, le protège, mais aussi tend à l’atrophier. Ce « soi caché » (Kahn) peut émerger du chaos en tant que conscience du monde grâce aux soins prodigués et à l’efficacité de la barrière protectrice vis-à-vis des empiètements de la réalité extérieure. La frustration au bon moment ainsi que la présentation du monde par la mère contribuent à l’éveil de ce self en tant que conscience.
L’analyse s’intéresse au vrai self pour en affermir les bases et développer un pouvoir de différenciation. Ces deux processus procurent une latence plus grande vis-à-vis des défenses archaïques et permettent ainsi à l’individu de mieux se trouver.
Dans l’inertie opposée au processus analytique, la notion d’ego répond donc à un point de vue structural. Elle fait référence au sujet d’un discours dont le véritable énoncé est souvent l’inverse de celui qui est dit, comme l’image au miroir. C’est précisément l’écoute de ce sujet-là qui va permettre de suivre les dédales du refoulé.
Les notions de self et de je indiquent un noyau profond de la personnalité. Ce noyau se constitue lors des tous premiers stades du développement, ses bases dépendent en particulier de la qualité
233
de la première relation (surtout avec la mère). Le self s’affermit et se renouvelle lors du processus analytique.
Le maître a une fonction toute différente de celle de l’analyste. Dans les traditions mystiques un maître est considéré comme tel lorsqu’un disciple reconnaît sa Réalité, l’Énergie d’Amour dont il est la source, et sa fonction faite d’efficience. Il ne sera question ici que du maître apte à transmettre directement en silence un courant d’amour qui éveillera le cœur mystique du disciple et le conduira à l’amour divin.
Être un disciple, reconnaître la Réalité d’un maître suppose une capacité à l’éveil mystique : cette potentialité est inégalement répartie suivant les individus, et plus ou moins prête à s’éveiller selon les moments de la vie et l’aptitude à oser s’abandonner sans réserve, sans remise en question ni doute sur le courant perçu et sur celui qui le transmet. Ainsi être disciple ne résulte pas d’un désir provoqué par une simple curiosité ou par une compensation aux frustrations de la vie.
Il s’établit une relation d’amour entre le disciple et le maître, que nous nommons « amour-abandon » pour désigner l’amour du disciple et « amour pur » pour désigner celui du maître. Il ne s’agit pas d’un transfert comme nous le montrerons plus loin, mais d’un lien, d’un courant d’énergie d’amour, d’un échange dynamique dans lequel le disciple reçoit « l’amour pur » que le maître irradie et est éveillé à « l’amour -abandon ».
Le « lien d’amour » cher aux Soufis s’établit :
Ce que l’on appelle le « Lien d’amour » est l’affection qui unit le Chercheur à son Maître. Si cet état ne se produit pas, le chercheur ne retirera aucun bénéfice de son guide, mais il y a plus que cela à découvrir… Dans le miroir du Prophète, la Création est visible. Les manifestations sont les manifestations de la Réalité, son Essence est l’Essence de la Réalité. Or celui qui aime un vrai guide aime le Prophète lui-même. Pourquoi ? Parce
234
qu’un tel guide n’a pas d’existence propre, son existence s ’est fondue dans celle du Prophète de Dieu. »341.
Il s’agit là d’un mouvement du cœur du disciple qui, envahi par l’amour qu’il porte à son maître, perd tout intérêt pour lui-même. Ce mouvement oriente vers une identification progressive non aux apparences de la personne du maître, ce qui relèverait de la projection, mais à sa Réalité profonde. C’est grâce à cette qualité d’amour ressentie pour son maître que le disciple pourra supporter de ne plus avoir d’existence propre.
À la différence de la relation analytique, celle du maître et du disciple existe sans qu’un lieu défini en soit le cadre, ni un horaire précis, le temps. Le maître agit en effet dans la spontanéité de l’instant, son efficience se manifeste en sa présence ou non, hors de tout lieu défini. Le courant d’amour capté par le disciple dans sa vie quotidienne peut être perçu à l’improviste dans n’importe quelle situation, dans l’activité du travail ou le repos. Le maître ne tient pas secrète sa vie personnelle ; sa vie privée, sa vie sociale sont une avec sa vie mystique : il n’y a pas de séparation.
Le lieu du maître est l’infini, le temps l’éternité.
Le « moi », « l’ego », termes plus ou moins employés par les mystiques de différentes traditions, sont le plus souvent associés à l’idée de perte, de mort. D’où l’interrogation qui surgit couramment : qu’est-ce qui est perdu, qu’est-ce qui meurt ?
Nous ne nous attarderons pas à préciser quelle part de l’être est concernée, car il s’agit plutôt pour les mystiques d’une désignation globale. L’approche de la vie mystique s’inscrit dans une démarche inverse de celle de l’analyse, car aucune introspection du moi et de l’ego n’est en jeu. Il se produit un éloignement plus ou moins progressif de ce vécu humain décrit par la psychanalyse, par la découverte d’une « troisième dimension » où les deux autres existent (celles de la dualité de la vie ordinaire). Il ne s’agit pas d’une régression psychique à des niveaux fusionnels et informes (« sentiment océanique »). La psychanalyse et la cure analytique, même dans leurs investigations les plus poussées, restent dans un monde à deux dimensions, celles du sujet et de l’objet, le « mystique » tend à découvrir la Vie d’une « troisième dimension » : l’Un des Soufis, l’Âtman des Hindous, le Royaume de Dieu des
235
Chrétiens, monde de l’Unité où celui de la dualité existe, mais n’est plus directement l’objet de l’expérience, -- dimension de l’être où il est impropre d’utiliser le langage psychanalytique.
Il est aussi difficile, sinon plus, pour la personne qui n’a aucune expérience de la vie mystique de comprendre ce que les mots, les métaphores, les symboles employés par les mystiques pour décrire leurs états signifient pour eux, qu’il est difficile pour le lecteur non averti et non expérimenté de comprendre le langage de la psychanalyse sans en avoir fait l’expérience. L’homme non mystique n’a de vécu que par rapport à lui-même, qu’il s’agisse de son vécu intérieur ou de son vécu avec le monde. L’homme mystique accède à un autre vécu : son expérience lui permet de prendre conscience de l’existence paradoxale d’un centre au plus profond de son être, centre qui est à la fois le plus intime de lui-même et le plus impersonnel qui soit, -- centre ressenti à la fois comme une fine pointe et un sans-limite. Les paradoxes abondent dans les écrits mystiques pour essayer de donner l’intuition de cette expérience à qui ne l’a pas connue.
L’éveil du cœur mystique (ce centre d’où jaillit toute Vie) anime peu à peu toute la vie psychique et les différentes instances de l’être. Ce mouvement vers une plénitude que suscite l’expérience répétée de cette autre dimension, entraîne un détachement de soi et du vécu ordinaire, détachement alors perçu comme une perte progressive du moi ou de l’ego. La plénitude ressentie grâce à ce nouveau vécu masque puis estompe toute perception du moi à son profit. Perte de vue du moi et de l’ego ne signifie pas déstructuration, retour à un non-différencié originel, mais plutôt une « plongée » dans une « troisième dimension », « extra-ordinaire » qui inclut les deux autres.
Le transfert est l’outil essentiel du travail analytique. Aussi, en limitant notre propos à ce lien particulier, pensons-nous être plus à même de lever les ambiguïtés, voire même les confusions et amalgames devenus fréquents.
L’amour (qui contient également la haine), nature même du transfert, continue aujourd’hui d’être une question très pertinente
236
de la psychanalyse. Notre propos s’attache ici à préciser son contenu dans la relation analysant-analyste.
La situation analytique malgré l’artifice du cadre a pour projet d’être une autre scène de la vie quotidienne. Nous y retrouvons donc différentes formes de sentiments. Nous choisissons de façon un peu arbitraire d’en décrire deux formes : « l’amour fou » et « l’amour d’objet ».
« L’amour fou » que nous appelons également « amour-dépendance » recouvre la première relation du très jeune enfant à ses parents et surtout à sa mère. D’un côté comme de l’autre, il est possible de parler d’attache. Le corps y joue une part importante dans les soins indispensables portés au bébé. Le nourrisson a besoin d’amour comme de lait. Du point de vue du vécu du bébé, l’autre n’est pas différencié de soi, car il n’y a pas d’extériorité de l’objet. La distance nécessaire à un pouvoir séparateur n’existe pas. Cette première relation imprègne la vie entière de l’individu. L’état amoureux en est fortement teinté : l’intensité, le besoin irrésistible et les forces mises en jeu en témoignent.
Ce type d’amour se caractérise par la méconnaissance de l’objet. Il peut, tant les individus sont parties prenantes, déboucher sur la tyrannie.
D’un autre point de vue, la première période, où la mère est dévouée à son nourrisson, établit les bases saines d’une personnalité, fait qu’un moi sera fort ou déclinant.
L’analyste, par sa capacité d’accueil, sa tolérance, et le cadre qu’il offre répond à cette dimension que peuvent occuper les sentiments de l’analysant. Le patient ainsi « tenu » peut opérer une certaine régression, affermir et cicatriser la part fragile d’un self mettant celui-ci sur le chemin d’un renouvellement.
À l’opposé, « l’amour d’objet » s’apparente à une distance entre le sujet et l’objet. Il demeure la partie du transfert accessible à l’interprétation. Il est l’expression et le résultat du travail analytique qui mobilise les pulsions vers des objets différenciés. L’analysant prend conscience de ses projections par le biais du miroir de l’analyste. L’altérité d’autrui devient de plus en plus effective. Le paiement de la dette limité par le prix de la séance contribue à la survenue de ce type d’amour.
Le transfert se constitue de ces deux formes d’amour : l’une se tisse dans l’obscurité, car elle est peu traduite en mots, l’autre s’opère de plus en plus dans le conscient grâce à l’interprétation qui utilise essentiellement le canal du langage verbal.
237
C’est par et grâce au « lien d’amour » qui unit le disciple au maître que s’opère la communication fructueuse entre ces deux personnes. Nous choisissons ce terme afin de différencier plus aisément ce que recouvre dans l’expérience mystique le mot « amour ». Nous y distinguons deux sortes d’amour : « l’amour-abandon » et « l’amour pur ».
L’abandon est la base, le tremplin à partir duquel le disciple peut quitter peu à peu son vécu ordinaire et vivre à son tour dans cette dimension de « l’amour pur » dont son maître est la source et à laquelle il aspire. Cet abandon est fait d’une confiance fondamentale liée essentiellement à la perception (qui peut être inconsciente au début) de l’infini de « l’amour pur » que le maître irradie. Le disciple est pris alors dans un élan irrésistible telle la phalène attirée par la flamme, il éprouve un sentiment jamais ressenti auparavant qui se traduit par une confiance absolue dans le maître, il en pressent la Réalité profonde.
De cette confiance totale du disciple découle « l’amour-abandon » qui engloutit peu à peu tous les obstacles à « l’amour pur » :
« Le pur amour est nu, dégagé de tout, il n ’attend rien, ne désire rien, il n’a aucun retour sur soi. »342.
Ici l’amour est dégagé de tout sentiment ordinaire en rapport avec un objet : il s’agit de l’amour pris à sa source même, toute dualité abolie et fondue dans l’unité :
« Cet amour est aussi différent de l’autre que l’infini l’est du fini, le créé de l’incréé. »343
Distinction essentielle entre le sentiment humain ordinaire qui n’existe que dans la dimension de la dualité et du fini et l’Amour divin dont le domaine est l’Unité, l’Infini.
Tout se joue dans le « lien » qui amène peu à peu le disciple à vivre cet « amour pur » à l’instar de son maître. Ce lien tissé dans l’intime et le silence d’un cœur à cœur de plus en plus profond permet l’identification du disciple au maître. Identification et non symbiose car il s’agit là d’une transmutation de la nature même de l’amour du disciple. Cet amour deviendra, grâce à l’alchimie du vide-plénitude et de l’instantanéité, « amour pur » sans objet comme un combustible se transforme en feu et en prend la nature.
238
Le travail de l’analyse peut se percevoir au travers des différentes formulations de la demande de l’analysant.
La personne qui vient en analyse a une demande manifeste qui est la résolution de sa souffrance. Il apparaît plus ou moins rapidement une autre demande sous-jacente à la première qui ne pouvait se dire d’entrée de jeu et que le travail de l’analyse va permettre de formuler le plus souvent en mots. La spécificité du travail analytique demeure en effet un travail dont le langage est le principal objet.
Durant ce processus, s’opère une transformation des désirs de l’analysant, dont il devient de plus en plus le sujet par un dire que lui seul peut formuler. Encore enfant, le patient était dans le désir de ses parents (par exemple l’enfant dont les parents se plaignent de la lenteur tend paradoxalement à être cet enfant lent) : en effet, le jugement des parents, leur dire, leur parole installent l’enfant dans son identité, car ce jugement bon ou mauvais confère un sentiment d’existence nécessaire à l’édification de la personnalité. Dans le processus analytique, l’analysant reconnaît les désirs de ses proches comme n’étant pas les siens. Il n’en dépend plus. L’énergie libidinale attachée à ses anciens désirs peut être à nouveau disponible pour d’autres investissements. D’enfant il devient adulte.
Par le biais de l’association libre, l’analysant prend connaissance de lui-même, pour percevoir à chaque étape sa vraie demande. L’analyste, par son aptitude à porter les projections de l’analysant et par sa capacité d’accueil, permet ce renversement. Par sa présence vivante il devient peu à peu « un autre » pour le patient, place bien différente de celle qui lui était donnée au départ et que certains appellent celle du « grand Autre » (place qu’occupe par exemple la mère dans la première relation lorsqu’elle est tout pour son enfant). Ainsi l’existence d’une demande et la possibilité d’un travail sur celle-ci donne une position d’analysant au patient, car c’est très exactement l’acceptation de la mise en face de son man — que qui permettra le travail analytique.
Il convient maintenant de développer et de préciser pour l’analysant cette accession à son propre désir, qui s’opère essentiellement par deux processus : la reprise de son histoire et l’introduction au manque.
239
L’ego de par sa fragilité amène des clivages multiples dont nous retrouvons classiquement les effets dans l’isolation de l’histoire infantile dans la psyché de l’analysant. Lors d’une psychanalyse peut s’opérer l’intégration de différentes séquences de l’histoire d’un sujet. Le travail sur les rêves et l’association libre sont les agents qui permettent de contourner les résistances et ainsi mettent l’analysant en contact plus effectif avec son inconscient.
L’analyste durant ce parcours peut renvoyer le matériel à l’analysant comme le sien propre, tel un témoin fidèle qui atteste et peut rendre compte, ce qui ne cesse de le replacer dans sa fonction de miroir humain. Tout ceci s’opère bien sûr par le biais du transfert représenté ici par la confiance portée par l’analysant à l’analyste et par le travail qui lui est propre permettant la mise à jour et la coexistence de sentiments très différents.
D’une certaine façon le patient retrouve une mémoire. La reprise de son histoire pour l’analysant donne une place réelle à son passé dans sa vie. Les limitations qui découlent de cette opération marquent les vrais repères de l’existence. L’enfant fils ou fille d’un tel ou d’une telle devient adulte sans pour autant nier ses origines et son histoire. Il devient auteur de lui-même, sujet de son désir.
Il est possible d’opposer deux tendances dans l’individu qui sont l’entrée en possession de soi-même et la répétition. La première s’exprime dans la créativité psychique et d’une certaine façon dans la capacité au transfert (c’est-à-dire dans les variations de sentiments que l’analysant est capable de soutenir au cours de l’analyse.)
La deuxième tendance peut être perçue par exemple au travers des relations amoureuses d’un même individu, ces relations se présentant suivant la même reproduction fidèle alors qu’il s’agit de personnes différentes. De là nous pouvons poser la question comment le sujet passe-t-il de l’une à l’autre, de la répétition à l’entrée en possession de lui-même ?
Lorsqu’une personne entreprend une analyse, elle tourne son regard vers elle-même. D’évidence elle ne se lance pas dans cette aventure pour d’autres qu’elle-même. Le sujet n’est plus alors en représentation ou prisonnier du regard des autres ; il n’est plus calqué (en positif ou en négatif) sur le désir de son entourage. Du fait de l’ouverture de cette autre dimension qui est lui-même, il ne « colle » plus à ce qu’il entreprend. Il se crée entre le sujet et
240
l’objet une distance nécessaire à un pouvoir séparateur ; un vide nouveau s’est ouvert, celui d’un manque à être.
Ce manque à être se découvre dans le renvoi du matériel à l’analysant. L’individu s’aperçoit de ce qu’il est ou de ce qu’il n’est pas, ou encore de ce qu’il ne peut être pour autrui. Si l’on se réfère au modèle de la première relation, le parent n’est plus tout pour le sujet, et l’analysant ne se met plus à une place où il serait tout pour lui.
Un manque à être s’est donc creusé et mobilise les énergies du sujet vers la découverte de lui-même. Dans l’expérience du transfert où l’analysant projette ses sentiments sur l’analyste, nous retrouvons ce manque à être, car il n’est pas répondu à l’amour ou à la haine, mais seulement proposé de comprendre comment l’un et l’autre se lient et se tissent ensemble pour le sujet. La technique, le cadre et la tolérance de l’analyste vont contribuer tous trois à l’avènement de cet autre vécu. Ce sont donc ces trois aspects que nous allons maintenant envisager ensemble.
a) La réparation
Dans toute psychanalyse il demeure que le cadre spatio-temporel (stabilité des horaires, ambiance chaleureuse…) et la capacité de l’analyste à maintenir ce cadre, c’est-à-dire d’une certaine façon l’aptitude à permettre la survie du cadre mis en place et de l’efficacité technique malgré le niveau émotionnel et les attaques éventuelles du patient vont jouer le rôle d’écran protecteur et ainsi proposer au moi un renouveau. Certains analystes parlent là de « cicatrisation ». Durant cette partie de l’analyse qui peut être individualisée ou non dans le temps, l’autre n’est pas perçu dans son altérité. Il s’agit là d’un niveau peu accessible à l’interprétation qui a pour support essentiel le langage des mots ; la poésie, l’art peuvent aussi en être les représentants.
C’est à cette symbiose, cette plénitude qu’il faut s’arracher en affrontant des sentiments archaïques tels que l’envie, la haine, la jalousie pour approcher la perception de l’objet dans son rapport d’altérité. Ce développement de « la capacité à être seul 344» ne se réduit pas à un sevrage. Nous voulons parler d’un véritable éveil de la conscience. C’est à cet endroit que l’interprétation et le transfert dans ses variations jouent à plein.
b) Interprétation et transfert
Si interprétation et transfert sont ici pris ensemble, c’est qu’ils
241
ont partie liée. D’un point de vue formel, une interprétation sans transfert est une interprétation « sauvage », c’est-à-dire une interprétation inefficace renforçant tout au plus les résistances (même si elle est juste). Ainsi l’une ne va pas sans l’autre. Cette alliance représente une grande part de la technique.
L’analyste est dépositaire de la parole du patient. Cette confiance qui lui est donnée est la condition minimale pour que commence le travail de la cure. Le lieu de la séance devient en quelque sorte une autre scène de la vie quotidienne, grâce à la présence active de l’analyste. Là, dans le « hic et nunc » (ici et maintenant), sera pris en compte ce qui ne pouvait se dire qu’il s’agisse des rêves et du vécu quotidien.
L’interprétation n’est que l’image d’un discours renvoyé au patient, discours énoncé par l’analysant et entendu par un autre que lui. Il s’ensuit un travail de prises de conscience successives et d’intégration de lui-même. Cette détente, cette mise à disposition de lui-même ouvre la voie à la création par l’association libre.
c) Introduction au limité et à la séparation
Ce travail est garanti par le maniement du transfert qui consiste de part et d’autre dans l’engagement et l’acceptation d’une relation. Le cadre et la technique en donneront les limites et les repères. Les horaires, le lieu, l’espace physique dans leur permanence et leur régularité proposent les séquences du travail. Le morcellement du temps scande la présence et l’absence, la vie et la mort, et ouvre ainsi la voie au principe de réalité.
L’expression du vécu en mots et le paiement des séances instaurent un rapport social entre l’analyste et l’analysant. Le langage oral oblige tant dans son émission que dans sa réception à des limitations. Le prix peut certes être ajusté, mais une fois fixé il précise la dette de l’analysant. En ce sens, il est plus juste de parler de commerce que de don. D’un autre point de vue, l’analysant n’a pas accès à la vie personnelle de l’analyste. Il le rencontre dans l’espace-temps de la séance. Il est renvoyé à la dualité, à la différence.
Pour s’établir, ces limitations demandent auparavant la création d’un lien où d’une certaine façon le patient vient réhabiter le giron maternel dans le sens où l’analyste prend soin de lui, le comprend et le contient.
De cette relation fusionnelle, il lui faudra sortir pour accéder à la différence et à l’altérité. Il y est aidé d’un côté par les limitations, d’un autre par un pouvoir de perception de lui-même qu’il acquiert et développe peu à peu. Ce pouvoir de discrimination provient de la distance que peut prendre l’analysant vis-à-vis de ses projections qui peuvent lui être renvoyées grâce à la présence vivante de l’analyste. Ceci s’exprime également dans la distance
242
issue du maniement du transfert. L’analyste ne répond pas à la demande d’amour de l’analysant. Il lui renvoie par là son altérité, la possibilité d’une distance permettant que dans ce vide ou ce manque entre sujet et objet se développe une créativité par le travail de l’analyse, ouverte sur la connaissance de soi et pouvant organiser nouvellement les énergies du sujet.
Ainsi les limitations instaurées dans le cadre et la technique ouvrent la sortie de l’omnipotence, de la fusion-confusion vers une connaissance de soi (insight), de « l’amour fou » vers « l’amour d’objet » (il sait ce qu’il aime et qui il aime). Après la cicatrisation du moi, l’analyse débouche sur la position du sujet qui voit, le développement d’un outil de connaissance de soi dont le moi est le principal agent.
Le transfert restituait au sujet son désir alors que ce désir était aliéné au désir de l’autre. D’enfant le sujet devient quelqu’un, c’est-à-dire sujet de lui-même, fils ou fille d’un tel ou d’une telle, sujet historique, c’est-à-dire adulte acceptant ses manques sans qu’il lui soit irrésistible de les combler. La souffrance et les frustrations sont alors mieux acceptées.
Nous voyons là combien il demeure important de marquer les limites énoncées plus haut afin que l’analysant puisse fonder son vécu sur ce manque qui le sépare de l’objet et fonde son désir et sa créativité.
Une aspiration profonde à l’Absolu ne peut être comblée par la vie ordinaire du fait de ses limites. Cette insatisfaction amène à la recherche d’un maître. La personne a l’intuition, souvent même a eu une expérience particulière de cet « autre monde » dont elle a gardé un émerveillement, une nostalgie. Sa reconnaissance du maître la plonge dans l’évidence d’avoir enfin trouvé le havre de paix qui la fera accéder à cette dimension pressentie et parfois déjà touchée dans le passé, mais perdue.
En mystique, il n’y a pas de travail sur le langage comme dans la cure analytique. Si des paroles sont échangées, il s’agit la plupart du temps d’une conversation amicale traitant de sujets variés ne privilégiant pas les préoccupations du quotidien ou les sentiments du disciple. Ce dialogue est échangé sur un mode gai et souvent même humoristique où le maître incite plutôt la personne
243
à prendre une distance avec elle-même et ses problèmes psychologiques, voire à se taire pour laisser le champ libre à la communication mystique qui s’établit en silence.
Avant d’accéder totalement et uniquement à cette transmission silencieuse, bien des aspirants-disciples ont besoin d’interroger le maître sur le chemin intérieur qu’ils désirent suivre, de discourir savamment sur des sujets mystiques ou d’analyser parfois avec pertinence des textes sacrés. Certains restent uniquement à ce niveau de communication et n’expérimentent jamais le sujet même qui semble les intéresser : ils ne deviendront pas de véritables disciples.
D’autres, par contre, passent par des alternances de silence où l’abandon les plonge, et d’activité mentale exprimée en paroles ou non. Leur demande se fait de moins en moins sous forme d’interrogation et se transforme en une attitude intérieure d’attente, de réceptivité au courant mystique : le disciple alors, la tête vide, n’a plus de question à poser, la présence du maître est une réponse en soi.
Ainsi la nature même de la recherche fait que le chercheur deviendra ou non un disciple, et pourra faire l’expérience de la dimension mystique, celle de l’unité.
Comment le disciple passe-t-il du plan de la dualité à l’Unité ? Ce passage d’un monde ordinaire à un monde mystique s’opère par une plongée dans un vide où la dualité disparaît. Le maître précipite le disciple dans ce vide, « vide dynamique » conduisant à la Plénitude. Ce Vide est d’une nature totalement différente du « manque à être » décrit précédemment. C’est le Vide de l’abandon au maître où toute volonté est abolie
« A l’inverse de la vacuité d’ordre mental où l’on s’efforce de lâcher prise en vue de faire le vide, ici c’est le vide qui permet de lâcher prise les plon — gées dans le vide, semblables à des morts répétées, dégagent de l’emprise du moi et des choses tandis que les liens tombent d’eux-mérnes. Par la voie d’indifférenciation, ce vide dynamique va anéantissant et consumant tout ce qui n’est pas l’essentiel ; il supprime la dualité moi et non-moi et livre accès à l’immensité et à la liberté. »345
Ainsi par l’expérience répétée de ce vide provoquant un lâcher-prise, le maître introduit le disciple dans la Plénitude dont il est la source
244
« Vidée de tout le relatif grâce à l’absorption, la conscience a un contact réel avec l’apaisement profond du domaine indifférencié. À la place du vide qu’elle imaginait, elle trouve une vaste ouverture à une vie tout à fait nouvelle qui va sans cesse s’élargissant vers l’infini, car dans l’expérience mystique vide et plénitude alternent et se confondent : »346
Le disciple, par ces plongées successives dans le vide, est amené à l’oubli de lui-même. La Réalité du maître fait disparaître à ses yeux tout ce qui le concerne et ce qui constitue sa personnalité, son histoire propre perd tout intérêt.
Il fait alors l’expérience de l’instantanéité : il vit à même le moment présent, dans l’oubli du passé, sans projet d’avenir. Ses actes ne dépendent plus de ses désirs, ils deviennent spontanés :
« Là où s’évanouit l’organe des sens et où vole en éclats le sentiment du moi, ami, voici le corps du Spontané. Demande-le clairement au vénérable Maître ! »347
Par ces expériences répétées et approfondies, un cheminement s’instaure dont nous allons étudier maintenant les modalités pour les différencier de celles du travail analytique qui vise à un but différent.
a) Désir d’union du disciple au maître
Nous prenons le disciple tout au début de sa découverte du Maître, toute quête achevée. Un poète mystique dit :
« La douceur de voguer sur l’Océan de l’immortelle vie m’a délivré de toutes vaines questions.
Comme l’arbre est dans la graine, ainsi tous les maux sont dans les vaines questions. »348
Toutes « vaines questions » ont cessé, le maître a lancé le « lien d’amour » que le disciple a saisi. Au début, ce lien est bien souvent fragile et le disciple est encore sous l’emprise de peurs et de retenues inconscientes qui lui font perdre de vue cette merveille entr’aperçue, la Réalité mystique qui l’attire comme un aimant attire la limaille de fer.
245
La personne est maintenant poussée par son désir ardent de s’unir au Divin reconnu chez le maître, mais est retenue dans son élan par les désirs de la vie quotidienne qui la sollicitent sous la forme de plaisirs, d’ambitions et d’affections pour ses proches. Ce sont là des obstacles à une ardeur plus intense, ils proviennent d’un attachement à l’ego, au self dont nous avons parlé auparavant, au vécu du monde de la dualité seul connu jusqu’alors. La dispersion des désirs fait obstacle à l’aspiration au Divin pourtant déjà goûté grâce à la présence du maître. Si l’appel mystique est plus fort que les obstacles, le disciple perd peu à peu tous ses désirs propres. Les énergies mobilisées dans les activités multiples de la vie s’unissent pour ne plus former qu’une seule composante, un élan unique, l’ardeur mystique ; cette ardeur est telle que, si elle devenait absolue, unique, elle suffirait pour consumer en un instant et définitivement le sujet qui ne vivrait plus alors que dans une éternelle félicité d’amour.
b) Les obstacles à l’union au maître
Au début, l’abandon comme l’ardeur du disciple est limité par des peurs face au « sans-limite » du maître qu’il pressent et où son moi tend à disparaître comme une goutte d’eau dans la mer.
Tous les mystiques s’accordent à dire que seul l’oubli de soi permet au Divin de vivre en nous. Un maître soufi écrit :
“... Un autre me dit : Comment guérir l’âme ? » Je lui répondis : « Oublie-la et n’y pense guère ; car ne se souvient pas de Dieu qui n’oublie pas son âme (ou : qui ne s’oublie pas lui-même). » Vous ne pouvez donc pas concevoir que c’est l’existence du monde qui nous fait oublier notre Seigneur ; ce qui nous Le fait oublier, c’est l’existence de nous-mêmes, de notre ego. Rien d’autre nous le voile que le fait de nous occuper, non de l’existence comme telle, mais de nos désirs. Si nous pouvions oublier notre propre existence, nous trouverions Celui qui est l’origine de toute existence, et nous verrions en même temps que nous n’existons pas du tout. Comment pouvez-vous concevoir que l’homme puisse perdre la conscience du inonde sans perdre celle de son ego ? Cela ne se produira jamais. »349.
Mais cet oubli de soi ne peut s’opérer que lorsqu’on a goûté à la dimension divine, à l’Absolu auprès duquel rien ne peut exister.
L’attachement à l’ego ou au moi dont parlent les mystiques est différent des problèmes psychologiques dûs aux traumatismes de l’enfance qui freinent l’évolution vers la maturité. Au début, le disciple souffre conjointement de ses difficultés psychologiques et
246
de ses attachements à ses désirs multiples. Certains par leur immaturité ou leur personnalité profondément narcissique sont prédisposés à faire un transfert sur le maître. Ce transfert entraîne un désarroi : ils démêlent mal leur désir de fusion de leur aspiration à un amour pur véritablement mystique. Le maître peut alors difficilement leur témoigner une attention affectueuse ou un intérêt personnel sans déclencher en eux ce sentiment d’amour fusionnel qui les plonge dans la confusion. Le détachement mystique et plus tard l’union ne peuvent s’opérer sans la séparation préalable où la personne du maître doit être reconnue comme autre. Aucune discrimination n’est possible entre « l’amour fou » et « l’amour -abandon » dans le cas où l’aspiration du cœur mystique du disciple se trouve inextricablement mêlée avec la demande de fusion. Seule l’action efficiente du maître permet au disciple de s’abandonner jusqu’au plus profond de lui-même, « l’amour-abandon » supplantant progressivement « l’amour fou ».
Mais même si le disciple a une personnalité bien intégrée, a reconnu ses limites et accepté le manque qui le sépare de l’objet, il n’en est pas pour autant prêt à l’Union avec le maître. L’obstacle primordial, l’amour de soi, l’attachement à l’ego, demeure. La reconnaissance de « l’amour pur » dont le maître est la source et l’expérience qu’il lui en fait faire, permettront que le détachement mystique s’opère, anéantissant peu à peu tous les obstacles.
Ces obstacles sont multiples. Ce sont certes les attachements aux plaisirs, aux affections, aux intérêts les plus variés qu’offre la vie, mais ils peuvent se résumer en un seul : l’attachement à soi-même. « Le lien d’amour » au maître réalise le détachement de l’amour de soi, d’une forme de vécu dont notre ego et notre moi sont le centre. La présence vigilante du maître, le courant d’amour qu’il irradie, permettent à ce détachement de devenir radical, tout en s’intégrant dans la vie quotidienne sans risque de dissociation avec celle-ci. Les difficultés qui paralysaient les forces vitales disparaissent. La nature profonde se dégage et une liberté nouvelle émerge ; les énergies libérées se rassemblent tel un faisceau et intensifient l’ardeur mystique. L’instrument de cette transformation est le maître, « grâce incarnée », dont l’action efficiente attise et comble l’ardeur du disciple, le baignant dans son amour sans cesse renouvelé, et le raffermissant dans son ardeur par sa fermeté et sa grandeur à la fois cachée et éclatante. Nous préférons parler d’une transmutation plutôt que d’une transformation : le maître en est la pierre philosophale.
Cette transmutation ne s’opère pas immédiatement, de nombreuses étapes y conduisent, étapes franchies grâce à l’attention toujours vigilante du maître et au lien d’amour qui se tisse entre lui et le disciple.
247
c) Le lien du disciple et l’amour pur du maître comme moyens d’action
Cet amour divin où le disciple plonge grâce au « lien d’amour » qu’il a saisi, est souvent comparé par les mystiques à un feu qui brûle les obstacles pour les faire disparaître
« Ô amour pur ! Ô feu sacré ! C’est toi qui fonds et dissous le cœur, et qui le fais écouler dans sa source originale, où ne comprenant plus rien, il sera compris du tout. Ô nudité ! Ô flexibilité ! Ô fluidité ! Vous seule pouvez vous écouler totalement… »350.
Cette action du maître faite d’énergie d’amour dont il est la source permettra le détachement du disciple de lui-même. C’est l’alchimie du « lien d’amour » :
Nous voyons un feu presque éteint se rallumer tout d’un coup à l’approche d’un autre feu ; la flamme semble se détacher d’elle-même et sauter sur la mèche demi-éteinte ; la mèche demi-éteinte n’a aucune action propre qu’un reste de chaleur qui attire la flamme ; la flamme semble tout faire… C’est la figure de l’amour sacré, qui se précipite dans le cœur de l’homme pour l’attirer à soi… »351.
Par cette alchimie le disciple prend conscience de son détachement qui se manifeste par un désintérêt pour les objets de ses désirs habituels ; les états d’amour pur dont il fait l’expérience de plus en plus souvent apaisent les sentiments et les émotions qui l’agitaient et l’angoissaient auparavant. Sa vie se centre uniquement sur le maître, sa discrimination mystique s’affine et lui permet d’explorer avec émerveillement la dimension dans laquelle il est introduit. Conjointement il prend plus de distance par rapport à lui-même et cerne mieux ses limites.
L’abandon s’approfondit, l’amour que le disciple ressent maintenant pour son maître, envahissant tout son être, lui permet paradoxalement d’aimer les autres d’un cœur libre, désintéressé, dégagé d’égoïsme, car l’abandon crée un vide d’où surgit la plénitude de l’amour pur. Dans la compagnie du maître, l’identité profonde qui s’établit affine la sensibilité du disciple, leurs cœurs vibrent à l’unisson, celui du disciple s’accordant peu à peu à celui du maître comme un instrument de musique s’accorde à un autre pour jouer la même mélodie. L’amour divin le pénètre à tous les niveaux de lui-même. Laissons parler Sultan Vâlad :
248
« L’amour est arrivé, il est devenu le sang qui coule dans mes veines et sous ma peau.
L’amour m’a vidé de moi-même et empli de l’Ami.
Toutes les parcelles de mon existence sont envahies par 1’Ami, de moi il ne reste plus rien sinon le nom. »352.
Le lien au maître se resserre, abolissant progressivement les limites du disciple pour l’introduire dans le « sans-limite » du maître.
Si dans l’analyse le transfert est le moteur qui fait sortir de « l’amour fou » porté au début à l’analyste, la relation maître-disciple est au contraire faite d’un lien d’amour qui va se resserrant jusqu’à l’Union (et non la fusion). Cet état d’Union accompli, seule la Réalité du maître existe désormais pour le disciple, tout intérêt pour lui-même disparaît.
Les poètes mystiques ont su trouver les accents qui évoquent avec le plus de force et d’intensité cette perte de soi :
Je peux offrir mon âme au pillage :
car j’ai trouvé maintenant l’Âme des âmes ;
je peux offrir ma boutique au pillage
que m’importe, à présent, le gain ou la perte ?
…
Je peux offrir mon univers au pillage.
car c’est seulement lorsque mon être me quitte
que l’Ami vient près de moi
et que mon cœur s emplit de lumière.
Je peux offrir mon jardin au pillage :
car je suis las des rêves interminables,
las des hivers et des étés
et j’ai trouvé le plus merveilleux des jardins.
Yunus, quelles douces paroles tu dis là,
tes mots sont comme sucre et miel.
Je peux offrir toute ma ruche au pillage,
car j ’ai trouvé le miel des miels.”353.
A la lumière de la différence fondamentale qui existe entre les deux types de relation et qui donne à chacune sa spécificité, se trouve levée la confusion entre la fonction de maître et celle d’analyste.
Cette confusion est renforcée dans la réalité chaque fois que l’analyste quitte sa place de « supposé-savoir » pour venir à la place de « celui qui réellement sait » : à ce moment-là il se met très précisément dans la position du maître. L’analysant peut certes demander à l’analyste d’être celui qui sait, mais celui-ci ne doit pas répondre à cette demande s’il veut être au plus près de sa fonction d’analyste, qui permet à l’analysant, du seul fait qu’il parle, de s’entendre. A ce prix seulement l’analysant sera mis en face d’un « manque à être » qui lui donnera la mesure de ce qui le sépare de l’objet.
La fonction du maître est fondée sur une connaissance dont les maîtres qui l’ont précédé dans sa tradition lui ont donné l’expérience. C’est cette expérience qu’il transmettra à son tour dans le silence d’un cœur à cœur354. Le maître ne se situe donc nullement dans un lieu de transfert, du moins au sens où nous l’avons défini plus haut, car cette transmission demeure essentiellement un acte efficient répondant à la demande et à l’ardeur du disciple. L’analyste, à l’inverse, n’exerce pas sa fonction par un acte, acte qui consisterait ici à répondre à la demande de l’analysant et oblitérerait véritablement le projet de la cure analytique.
Notre exposé fait ressortir, nous l’espérons, la différence fondamentale entre « l’amour fou » et « l’amour pur » si souvent considérés comme identiques. Tous deux sont en effet l’expression d’un sentiment qui n’a pas d’objet.
Dans le premier cas, l’objet d’amour n’existe pas encore comme tel pour le sujet. La personne est dans une totalité qui s’ouvrira par l’introduction au « manque à être » sur la séparation entre sujet et objet et sur la dualité qui fonde le rapport de l’homme à son désir.
Dans le second cas, l’objet disparaît : l’abandon au maître et l’identité profonde à celui-ci qui se réalise progressivement effacent pour le disciple toute conscience de soi fondée sur la connaissance de ses désirs propres. En effet, celui-ci n’existe plus que dans la conscience qu’il a de la Réalité du maître, Réalité se situant au cœur, à la source même de l’Amour, domaine où ne
250
règne plus que l’Absolu. Grâce à cette identification le disciple échappe à la dépendance de « l’amour d’objet » et découvre la liberté dans l’Unité. L’amour mystique n’est pas une régression (si sublimée soit-elle), un retour à un stade anobjectal où le nourrisson sent véritablement que sa mère fait partie de lui, ce qui serait un retour profondément narcissique dans une totalité qui revient à la « méconnaissance de l’objet ».
Ceci nous amène à considérer une autre confusion, celle de l’identité du travail analytique et de la « transmission » mystique où le disciple et l’analysant ont tous deux affaire à ce que nous avons appelé l’ego, à savoir la résistance fondamentale de l’être, « la peur dépressive de désintégration »355, soit une conscience de soi primaire et primordiale, un rempart ultime, image totale en face d’une peur innommable ne pouvant être représentée et dépassée véritablement.
Le travail de l’analyse par le biais de l’association libre contourne cette résistance fondamentale afin de permettre une exploitation réelle du vrai self, base de toute création humaine. L’ego, protection ultime face à la peur de désintégration est assoupli dans certains cas, dans d’autres consolidé et même édifié. L’analysant pourra ainsi éprouver cette angoisse de désintégration sans avoir besoin de déployer des défenses archaïques.
Si, dans « l’alchimie mystique », il est question de la perte de l’ego, celui-ci n’y est pas considéré vraiment en tant que résistance fondamentale. Il s’agit plutôt de l’ego pris comme support d’une conscience de soi, du sentiment de notre propre existence. Par l’efficience du courant d’énergie d’amour irradié par le maître, le mystique perd ce support. Il sera précipité dans des vides successifs où toute représentation, même la plus abstraite, disparaît, mais en ces vides prend place la conscience d’un nouveau vécu plus subtil, plus large :
« Une énergie spécifique flue spontanément sans faire retour sur elle-même, ni se diviser en un sujet et un objet. Plus de durée vécue, tout se passe à un autre niveau. »356
Le support de l’ego, les repères du moi disparaissent, inutiles, engloutis et plus tard anéantis dans cette Vie mystique qui seule importe désormais. Sans l’apparition de cette nouvelle dimension, la disparition de l’ego projetterait la personne dans une désintégration de l’être. Seule la présence d’un maître apte à transmettre la « Grâce divine », attentif à l’évolution du disciple, l’en protège.
En résumé, nous dirons que l’analyse libère l’individu de l’aliénation « au regard de l’autre » par la séparation où l’introduit le
251
travail du transfert. La mystique délivre la personne de la conscience du moi et lui permet de ne dépendre d’aucune relation. Le disciple n’est plus dans la séparation, il vit en union avec toute chose, dans une parfaite liberté.
Si l’analyse requiert un analyste capable de ne pas outrepasser une position de « supposé-savoir » pour introduire l’analysant au « manque à être », la mystique elle, demande la rencontre, ô combien rare ! d’un maître apte à transmettre le courant de la grâce qui pourra le délivrer de son ego :
« Nombreux sont ceux qui honorent et servent des maîtres resplendissant de connaissance et de discernement. Mais, ô Déesse ! comme il est difficile à trouver ce Maître qui, lui-même délivré de l’ego, peut réduire à néant l’ego d’autrui. »357
Il n’est pas nécessaire, comme certains le pensent, de faire un travail analytique préalable pour accéder à la vie mystique. Le disciple parviendra spontanément à une maturité psychologique grâce à l’efficience du maître. L’expérience mystique peut survenir à n’importe quel moment de la vie d’un individu et indépendamment de son évolution psychoaffective, car seule la gratuité de la grâce introduit dans cette nouvelle dimension qui échappe à toute analyse.
Ainsi l’expérience mystique et l’expérience analytique se trouvent-elles radicalement distinctes.
« D’authentiques guru sont plus rares que l’or,
les charlatans plus nombreux qu’un nid de fourmis ;
des disciples dignes (aussi rares) que des lièvres à cornes,
mais des élèves beaux parleurs (autant que) troupeau de porcs. »
Brug-pa Kun-legs359.
Dans toutes les traditions, mystiques accomplis et maîtres véritables ont dénoncé avec force, voire avec violence, les gens qui s’imposent comme des maîtres ou qui se mêlent de guider les autres au niveau d’une expérience intime et spécifique, sans en avoir la connaissance et la maîtrise. Il nous a paru utile de leur laisser la parole. Ils témoignent de ce qu’ils ont vu autour d’eux et s’efforcent de mettre en garde les disciples éventuels contre l’erreur terrible et parfois fatale d’un mauvais choix, ou tentent de faire prendre conscience aux guides médiocres des risques qu’ils courent, à la fois pour ceux qu’ils dirigent mal et pour eux-mêmes.
Les plus redoutables sont des êtres impurs, ayant des pouvoirs et qui manipulent des forces maléfiques. Évidemment dépourvus d’amour, ils utilisent des techniques et peuvent jouer de leurs pouvoirs avec perversion, ou avec orgueil ou tout simplement avec sottise. Ils profitent de la crédulité de disciples qu’ils méprisent, qu’ils tiennent sous leur joug et menacent de malédiction s’ils les quittent. Le Shivaïsme du Cachemire considère qu’ils agissent sous l’influence de l’énergie déviante et obscurcissante qui préside aux limitations du devenir, et de l’emprise de laquelle justement le vrai guru délivre. Il faut voir en eux non des maîtres, mais des esclaves soumis aux puissances néfastes. Il n’est pas rare que certains de leurs disciples soient conduits à la folie ou au suicide. Nous n’en dirons rien de plus.
Les textes ici choisis illustrent des types de guides moins pervers et plus difficiles à démasquer, depuis les faux maîtres hypocrites et mondains jusqu’aux directeurs de conscience honnêtes et sincères, mais incompétents ou jusqu’aux vrais spirituels enthousiastes, mais non encore aptes à transmettre. Les extraits présentés en décrivent généralement plusieurs types, de sorte que [253] notre classement ne pourra guère que regrouper les auteurs à l’intérieur de chaque tradition.
Citons, en premier lieu, un passage d’Abhinavagupta, car le trait que ce grand philosophe cachemirien y discrimine apparaît comme un véritable critère d’après lui, le mauvais guide, manquant d’amour divin (bhakti) et n’adhérant pas à la Réalité, est victime du doute, tel un feu qui le consume intérieurement. Or, il est clair qu’un homme déchiré entre des alternatives, tourmenté par le doute, est encore enfermé dans la dualité ; il ne saurait donc aider quelqu’un à en sortir.
Abhinavagupta cite à l’appui une stance de Vidyādhipati :
« O Seigneur, si des initiés procédant sur la voie de Ta doctrine, demeurent la proie de conflits intimes, c’est qu’ils ne sont nullement pénétrés des rayons de Ton soleil. Comment donc les lotus se fermeraient-ils aux rayons du soleil ? »
Parallèlement à ces victimes du doute, des hommes savants, initiés eux aussi, mais qui fondent des systèmes philosophiques dualistes ont quitté la voie juste et leur prétendu éveil n’est que la projection de leurs illusions. D’un tel éveil, Abhinavagupta dit qu’il « est aussi erroné que la vision de serpents dans une pièce éclairée par une lampe alimentée à l’huile de serpent. » 360.
« De même que le cuivre affecté par le mercure ne reprendra jamais sa condition originelle, ainsi il n’est point d’être sur la terre qui, ayant bu le nectar d’immortalité, reste tourmenté par la faim, la soif et la douleur. »361.
Écoutons à présent Kabîr 362 :
« Kabîr, ils n’ont pas trouvé le Satguru et sont restés à moitié instruits, ils endossent un déguisement de sannyāsî, et vont mendiant de porte en porte ! »
« Kabîr, ils portent un vêtement d’ascète, mais leur conduite est mauvaise.
Extérieurement, ils se comportent comme des saints, mais à l’intérieur, ils sont grandement corrompus.
Bien qu’ils paraissent tout blancs et brillants, ne vous y fiez pas, ils font la méditation des grues 363 : [254]
Assises au bord de l’eau, elles sautent sur leur proie — ainsi ils vous feront perdre la sagesse. »
« Si le Guru est aveugle, le disciple aussi sera aveuglé364.
Si l’aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans le puits ?
Le Guru n’a pas été trouvé, et l’instruction n’a pas été donnée, par convoitise, ils ont risqué leur vie365.
Tous deux ont sombré dans le courant, ils sont montés dans un bateau de pierre ! »
« Si l’on trouve le Guru, c’est tant mieux, sinon on va à sa perte ; Comme la phalène attirée par la vue de la lampe, elle tombe, ayant prévu sa perte366.
La Māyā est la lampe, l’homme est la phalène, égaré, il tombe ainsi :
Dit Kabîr, grâce à la sagesse du Guru, quelques-uns à peine se sont sauvés. »
Les faux maîtres hypocrites ou dupes d’eux-mêmes, vains, mondains et ignorants prêchent des mots et accomplissent des gestes plus ou moins vides de sens qu’ils imposent à autrui, tâchant souvent d’en tirer profit. Ce sont par exemple les ascètes poudrés de cendres, que décrit Saraha, mais nous en verrons plus loin d’autres exemples, ainsi « les scribes et pharisiens hypocrites » admonestés par Jésus-Christ.
Saraha, de l’école bouddhique Sahajīya, ou du Spontané, met en garde.
« Avec un bâton, avec trois bâtons, déguisés en bhagavan, ils se croient sages tel le cygne.
Le monde se laisse bien à tort abuser par leur égarement…
Ces maîtres se poudrent de cendre et au sommet du crâne ils portent le chignon tressé.
Assis dans leur maison ils allument la lampe ; assis dans un coin ils sonnent la clochette.
Les yeux fermés, ils prennent la posture [du lotus] et chuchotent à l’oreille des gens, ils les leurrent.
Ils instruisent les veuves, les nonnes rasées qui jeûnent, d’autres [255] encore, et leur donnent l’initiation moyennant une somme d’argent. »367.
Et tout ce que les maîtres ordinaires préconisent d’habitude tombe sous son sarcasme — tous les gestes, toutes les attitudes systématiques y compris la méditation, tous les efforts et les ascétismes, tous les enseignements :
« … Sera-t-on délivré par la méditation ? À quoi servent les lampes ? À quoi bon les offrandes ? Qu’accomplit-on à l’aide des formules ?... Peut-on atteindre la délivrance en se plongeant dans l’eau ? »
À quoi bon, en effet, toutes ces directives ? Elles contrarient la simplicité de l’efficience du guru :
« Il n’y a rien d’autre que la parfaite connaissance de “Ceci”. Quand la Conscience s’éveille, tout est Ceci…
Point d’écoles philosophiques qui ne le visent, mais on ne le voit qu’aux pieds du guru !
Que la parole du maître pénètre le cœur et le [disciple] voit le trésor comme dans sa propre main. »368.
Lorsqu’on a découvert cette efficience, la vanité de tout le reste apparaît.
Les maîtres de Tch'an chinois ou du Zen ne sont pas les derniers, on s’en doute, à invectiver les imposteurs ou à secouer les endormis. Ma-Tsou oppose ce que l’auditeur (śravaka), selon l’enseignement du Petit Véhicule, considère comme son éveil, à l’éveil véritable :
« L’auditeur… cultive la cause pour réaliser le fruit et demeure pendant vingt mille, quatre-vingt mille kalpa dans le samādhi de la Vacuité. Bien qu’il soit déjà éveillé, cet éveil est un égarement… L’auditeur, ayant sombré dans la Vacuité et stagnant dans l’extinction (nirvāna), ne voit pas la nature de Buddha.
« Si un être de racine supérieure rencontre un ami de bien (kalyānamitra) capable de le diriger, il comprendra par ses paroles qu’il n’y a pas d’étapes ni de stades et sera subitement éveillé à sa nature originelle. »
Puis Ma-tsou efface les termes employés : « Ainsi on parle d’éveil par rapport à l’égarement, mais puisqu’il n’y a originellement pas d’égarement, il n’y pas non plus d’éveil. » Et plus loin il s’élève contre tout enseignement [256] :
« Que chacun d’entre vous parvienne à son propre Cœur, ne vous attachez pas à mes paroles. »369.
Lin-Tsi tonne :
« … C’est parce qu’ils ne comprennent rien à rien que de petits maîtres puînés font confiance à ces renards sauvages, à ces larves malignes, et leur permettent de parler d’affaires bonnes à entortiller autrui — de la nécessité d’accorder la théorie et la pratique, de veiller sur ses triples actes pour pouvoir devenir Buddha, et autres discours de ce genre comme crachin au printemps… Et c’est en ce sens qu’il est dit :
“Qui cultive la Voie ne la pratique point”… »370.
Mais tout le monde ne se laisse pas prendre aux balivernes des moines tonsurés :
« Ils s’y connaissent en traquenards de circonstances ! Les apprentis, qui n’y comprennent rien, en ont l’esprit tout affolé… Les bons apprentis font gorge chaude de ces aveugles de vieux coquins chauves qui mettent le trouble dans le monde entier. »
« Spéculations », « discussions », « commentaires phrase par phrase » que certains tirent de l’Enseignement ne sont, pour résumer le texte en termes adoucis, qu’ordures qu’ils se repassent entre eux, mais « lorsque d’autres » (Lin-tsi lui-même sans doute) « leur posent des questions sur la Loi du Buddha, ils restent bouche close, sans un mot, les yeux béants comme trous de cheminée noircis par la fumée, la bouche pareille à une palanche plate qui s’abaisse des deux côtés. Cette engeance-là… se verra… expédiée en enfer pour y subir des tourments ! ».
Que faire alors, parmi toutes ces erreurs partout répandues ?
« Adeptes, si des moinillons sortis de la vie de famille veulent apprendre la Voie, ils n’ont qu’à faire comme moi, le moine de montagne. Naguère je m’étais intéressé au Vinaya et “j’avais fait aussi des recherches sur les Textes et sur les Traités”. Puis je m’aperçus que ce n’étaient là que drogues bonnes à soigner le monde, et discours de surface ; et d’un seul coup, je rejetai tout cela. Je me mis alors à m’informer de la Voie en consultant des maîtres de Tch'an, et je rencontrai enfin un grand ami de bien ; c’est alors seulement que mon œil de Voie commença à voir clair. Je reconnus en lui un de ces vieux maîtres dignes d’être révérés [257] par le monde entier, et je sus que la connaissance de ce qui est pervers et de ce qui est droit ne s’acquiert pas en naissant de sa maman. Il faut encore sonder les choses en personne, s’épurer (comme un minerai), se polir (comme un miroir de bronze) ; puis un beau matin on s’éveille. »
Le maître japonais Hakuin déplore ce qu’est devenu l’enseignement bouddhique « en ce siècle dégénéré » (XVIIIe). Dans les pages ici retenues, il distingue plusieurs sortes de mauvais guides, en fonction de leurs tares particulières
— ceux qui sont figés en une pratique desséchée (dans laquelle on peut déceler un manque de cœur).
— ceux qui se targuent de savoir et méprisent le véritable enseignement (c’est un manque d’intelligence profonde et beaucoup d’orgueil).
— enfin ceux qui prétendent rester à l’intérieur du Zen, mais s’adonnent en secret aux pratiques rituelles propres à la secte de la Terre Pure et trompent ainsi tout le monde.
« Des moines et des instructeurs tout à fait vertueux, entourés d’une foule de disciples et de personnalités éminentes, s’emparent sottement de l’enseignement mort de l’absence de pensée, de l’absence d’esprit371, où l’esprit est comme cendres éteintes, sa sagesse effacée, et ils font de cela la doctrine essentielle du Zen. Ils pratiquent la posture assise silencieuse, morte, comme s’ils étaient des brûle-parfum dans quelque vieux mausolée et ils croient que c’est là le trésor de la vraie pratique des Patriarches. Ils font d’une vacance rigide, de l’indifférence et de la pire stupidité la quintessence de ce qui permet l’accomplissement de la Grande Affaire. Si l’on examine ces gens-là, on découvre des tonsurés vulgaires, illettrés, puants, aveugles, absolument inaptes à veiller sur la forteresse du Dharma, des gens nullement préparés à établir la base de l’enseignement.
« Et puis il y a ces idiots fieffés, possédant une connaissance générale des affaires du monde et quelque jugement, qui s’enorgueillissent de leurs opinions creuses et qui, se fondant sur leurs connaissances superficielles, disent : “Les Buddhas et les Patriarches sont hors d’atteinte et sans forme. Les vieux koans sont tous des mots vides et l’on ne peut rien en tirer.” Ils engloutissent ainsi Buddhas et Patriarches, et invectivent contre tout et partout. Ils sont exactement comme des chiens enragés qui hurlent aussi fort qu’ils peuvent, et ils ne valent même pas la peine qu’on les retienne… » [258]
Enfin voici que pullulent des instructeurs d’un nouveau genre qui veulent mêler la Terre Pure au Zen, mettre de l’eau dans le lait :
« Ils s’assoient sur des chaises ou sur l’estrade, un chapeau de soie cramoisi sur la tête et un surplis rehaussé d’or leur tombant du cou. Le chasse-mouches blanc décrit une danse gracieuse en dispersant la fumée (de l’encens…) Avec leur air sévère et leur dignité massive, ils ressemblent au Buddha doué des dix pouvoirs ou à un saint ayant obtenu les quatre récompenses. Ceux qui les voient s’inclinent tout naturellement, joignent les mains, se prosternent à terre et versent des larmes d’admiration… Après tout… ils ont les pouvoirs miraculeux d’un Maudgalyāyana quand il s’agit d’amasser des richesses et des biens ; ils sont aussi éloquents que Pūrna quand il s’agit de tromper les laïcs. Mais si on les examine bien, ils n’ont pas la moindre aptitude à voir dans leur nature propre, ni un atome de la vitalité et de la trempe qu’il faut pour atteindre l’éveil.
« Aussi, quoiqu’ils pressent le pas, ne peuvent-ils atteindre la joie du Nirvāna et, comme ils perdent du terrain, ils en viennent à redouter le cycle de la naissance et de la mort…
« En ce monde, ces gens-là… trompent les hommes qui sont sur terre aujourd’hui. Ils s’attirent une suite de laïcs, reçoivent des hommages et des présents, mais dans la vie future ils tomberont sans aucun doute dans l’enfer le plus bas… »
Finalement, déplore Hakuin, ils « apportent la confusion dans ce qui fait l’essence de notre école. Quelle conduite est-ce là ?... Pourquoi ne rejoignent-ils pas ouvertement l’école de la Terre Pure et ne deviennent-ils pas des saints de la Terre Pure, invoquant le nom du Buddha nuit et jour à voix haute. Pourquoi sont-ils si lâches ? N’est-ce pas revêtir une peau de lion et glapir comme un renard sauvage ? Ces gens-là sont comme des chauves-souris ; on ne peut pas dire que ce soient des oiseaux, mais on ne peut pas dire non plus que ce soient des rats. » 372.
Jésus dénonça les faux prophètes et s’éleva contre les scribes et les pharisiens qui pratiquement jouaient un rôle de maître.
« Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des [259] épines ? ou des figues sur des chardons ? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l’arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » (Évangile de saint Matthieu, VII, 15. 373.)
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez mers et continents pour gagner un prosélyte, et, quand vous l’avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous ! »
« Malheur à vous, guides aveugles… Insensés et aveugles… » (XXIII, 15-16).
« Laissez-les : ce sont des aveugles qui guident des aveugles ! Or si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » (XV, 13.)
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis : au dehors ils ont belle apparence, mais au dedans ils sont pleins d’ossements de morts et de toute pourriture ; vous de même, au dehors vous offrez aux yeux des hommes l’apparence de justes, mais au dedans vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité. » (XXIII, 27.)
Bien des mystiques chrétiens — mais nul mieux que saint Jean de la Croix — ont condamné les directeurs de conscience (prêtres, théologiens, thérapeutes) souvent sincères et honnêtes, mais incompétents, sans expérience mystique et qui prétendent diriger des personnes ayant pénétré spontanément, avec la seule aide de la grâce, dans la vie contemplative. La plupart des directeurs en effet ne possèdent de cette dernière qu’une connaissance indirecte, tirée des livres saints, mais ils n’y ont point accédé. Leurs directives contrarient l’action de la grâce, paralysant ou mutilant les âmes. Leur condamnation par saint Jean de la Croix repose sur une analyse très fine des états intérieurs qu’il nous faut ici abréger.
« … Et ce dommage étant tel qu’il ne se peut assez peser et déplorer, il est néanmoins si commun qu’à peine trouvera-t-on un maître spirituel qui ne le fasse en les âmes que Dieu commence à recueillir et attirer de cette sorte à la contemplation. » Car chaque fois que Dieu tient l’âme sans qu’elle puisse « goûter ni méditer chose aucune, ni de celles d’en-haut ni de celles d’ici-bas… il viendra quelqu’un qui ne sait que frapper sur l’enclume, comme un forgeron ; et d’autant qu’il ne sait point d’autre leçon que cela, il tiendra tel langage : allez, tirez-vous de là, car c’est perdre le temps et demeurer oisif, mais prenez cet autre exercice, méditez et faites [260] des actes, parce qu’il est besoin que vous fassiez des diligences de votre part, car ces autres choses sont des abus, des tromperies et des amusements de personnes grossières et sans esprit. Et ainsi, n’entendant pas les degrés d’oraison ni les voies de l’esprit, ils ne voient pas que ces actes qu’ils désirent de l’âme et que cette voie du discours, cela est déjà fait... » (VIII)374.
« … ce que ne pouvant faire, ni s’exercer en cela comme auparavant, à raison que ce temps-là est déjà passé et que ce n’est plus là leur chemin, elles s’inquiètent doublement, pensant être perdues, et eux-mêmes leur aident encore à le croire… Telles gens ignorent ce que c’est qu’esprit : ils commettent une grande irrévérence et font une injure signalée à la Majesté de Dieu, mettant leur main grossière où il opère ; car il ne lui a pas peu coûté d’amener ces âmes jusque là et il prise beaucoup de les avoir conduites en cette solitude et vidé(es) de leurs puissances et opérations, afin de leur pouvoir parler au cœur, qui est-ce qu’il désire toujours… Ce n’est pas une chose de peu d’importance ni une faute légère de faire perdre à une âme des biens inestimables par un conseil égaré, et la laisser en terre. Et partant, celui qui pèche témérairement.., ne sera pas exempt de châtiment, conformément au dommage qu’il aura fait, parce qu’il faut manier les affaires de Dieu à œil ouvert et avec grande discrétion et considération, principalement en chose si relevée et si délicate, où le gain et la perte sont presque infinis par la bonne ou par la mauvaise conduite. » (XI.)
« Mais quoique vous vouliez dire qu’ils ont néanmoins quelque excuse, bien que je ne la voie point, au moins vous ne me la sauriez alléguer pour celui qui, conduisant une âme, ne la laisse jamais sortir de son pouvoir et direction pour les vains respects et intentions qu’il sait, lesquels ne demeureront pas impunis, car il est certain que cette âme devant profiter en la voie spirituelle où Dieu lui aide toujours, doit changer de style et de manière d’Oraison, et a besoin d’une autre doctrine plus haute que la sienne et d’un autre esprit, parce que tous n’ont pas une science suffisante pour tout ce qui arrive au chemin spirituel.. , comme tous ceux qui savent polir du bois n’en savent pas faire une Image, ni tous ceux qui la peuvent tailler ne la savent aussi polir, ni celui qui la sait polir n’y saura asseoir les peintures, ni celui qui la saura peindre n’y pourra mettre aussi la dernière main en perfection. [261]
« Parce que chacun de ceux-là ne peut faire sur l’Image que ce qu’il sait, et, s’il en voulait entreprendre davantage, il la gâterait. Or, voyons si vous, ô Maître spirituel qui ne savez seulement qu’ébaucher, vous voulez mettre l’âme dans le mépris du monde et la mortification de ses appétits, ou (œuvrer) comme son sculpteur — l’exercer en les saintes méditations — et ne savez rien autre, comment guiderez-vous l’âme jusqu’à la dernière perfection d’une délicate peinture, qui ne consiste plus à ébaucher, ni à tailler, ni pour filer, mais en l’œuvre que Dieu doit faire en elle successivement. Partant, il est certain que, si vous la tenez toujours attachée à votre doctrine qui est toujours d’une même façon, elle retournera en arrière ou au moins qu’elle n’avancera point. Car dites-moi, je vous prie, où aboutira l’Image si vous n’y faites jamais autre chose que de la cogner et d’ébaucher, ce qui est dans l’âme l’exercice des puissances ? Quand est-ce que l’Image sera achevée ? Quand, ou comment la doit-on laisser afin que Dieu la peigne et la perfectionne ? Est-il possible que vous sachiez tous ces métiers ? et que vous vous estimiez si capable et si accompli que cette âme ne doive jamais avoir besoin d’autre que de vous ? et, supposé que vous soyez suffisant pour quelque âme, laquelle peut-être n’a pas de talent pour passer plus outre, il est comme impossible que vous ayez de la capacité pour toutes celles que vous ne laissez sortir de vos mains, parce que Dieu les mène toutes par divers chemins… Ces hommes donc doivent donner liberté à ces âmes, et sont obligés de les laisser aller à d’autres et leur montrer bon visage, vu qu’ils ne savent pas où Dieu les veut avancer, principalement quand elles n’ont plus de goût en leur doctrine, (ce) qui est signe que Dieu les tire plus avant par un autre chemin et qu’elles ont besoin d’un autre maître. Et eux-mêmes le leur doivent conseiller, et faire autrement procède d’une folle superbe et d’une présomption. (XII)
« Mais laissons cette manière de procéder pour parler d’une autre, pestilentieuse, que ceux-là ou d’autres pires qu’eux pratiquent. Il arrivera que Dieu oindra quelques âmes de saints désirs et motifs de quitter le monde… et eux, avec quelques raisons humaines ou des respects contraires à la doctrine de Jésus-Christ, à sa mortification et au mépris de toutes choses, appuyés sur leur goût ou intérêt, ou pour craindre où il n’y avait rien à craindre, les font temporiser et y apportent des difficultés ou, qui pis est, tâchent de les divertir de cette pensée, car, ayant un mauvais esprit, peu dévot et fort coiffé du monde, et peu adouci ou amolli en Jésus-Christ, comme ils n’entrent point, ils ne laissent point entrer les autres, comme dit Notre Seigneur : “Malheur à vous, savants de la Loi, qui avez pris la clef de la science, vous n’êtes pas entrés [262] et vous avez empêché ceux qui entraient”, —, car telles gens sont à la vérité comme des pierres d’achoppement à l’entrée du Ciel, ne prenant pas garde que Dieu les tient là pour contraindre d’entrer ceux qu’il appelle, comme il a commandé en son Évangile ; et eux, au contraire, les empêchent d’entrer par la porte étroite qui conduit à la vie. En cette manière, le maître spirituel est un aveugle qui peut empêcher la conduite du Saint-Esprit en l’âme, ce qui arrive en diverses manières comme nous avons dit, les uns le sachant et les autres l’ignorant, encore que les uns ni les autres n’en demeureront impunis, car, puisque c’est leur office, ils sont obligés de savoir et de regarder ce qu’ils font. » (XIII)
Madame Guyon, qui proteste elle aussi à maintes reprises contre les mauvais directeurs, étend ici sa sévérité à ceux qui possèdent déjà quelque expérience mystique, mais qui sont bien loin encore du but et qui, par conséquent, n’ont pas reçu la grâce très particulière de « l’état apostolique », mission d’un très petit nombre.
« Ordinairement les personnes peu avancées veulent se mêler de conduire les autres avant que Dieu les appelle à cet emploi ; elles croient même le pouvoir mieux faire que celles que Dieu appelle à cela par vocation singulière. C’est un abus dans la vie spirituelle, et qui s’y glisse même dès son commencement, que de vouloir travailler pour les autres à contretemps ; et ce n’est que par une fausse ferveur que l’on entreprend de les aider par soi-même avant d’en avoir reçu la mission. Plusieurs se croient capables de conduire dans la voie des Saints qui n’y sont pas encore bien entrés eux-mêmes ; et voulant faire part aux autres des grâces qui ne leur sont données que pour eux, ils en perdent eux-mêmes le fruit et ne peuvent en aider les autres. Il ne se faut point porter à aider le prochain tant qu’on le désire et que l’on n’a pas l’expérience des choses divines et la vocation : il faut être établi auparavant dans la vie intérieure.
« Jésus-Christ, notre parfait modèle, a passé trente ans dans la vie cachée, s’appliquant à une oraison continuelle, et demeurant anéanti devant son Père pendant un si long temps avant que de s’employer visiblement au salut des hommes ; pour nous apprendre par son exemple à laisser mourir tout empressement d’aider au prochain, et à demeurer dans le silence et dans le repos, jusqu’à ce que le temps et les moments soient venus, auxquels Dieu nous donnera sa parole et son ordre, pour travailler au salut des âmes, s’il a dessein de se servir de nous pour cela. J’ose assurer que la vie Apostolique par état permanent ne peut être donnée que lorsque l’âme est arrivée en Dieu, et en degré éminent ; ce qui n’empêche pas que l’obéissance n’y engage plus tôt. Mais lorsque c’est par obéissance, ou par le devoir indispensable, Dieu supplée à ce qui manque à l’état.
« Quelques personnes, même fort spirituelles, m’entendant parler de la vie Apostolique par état prendraient cela pour une certaine ardeur que les âmes nouvellement entrées dans la voie passive ont d’aider aux autres. Elles jouissent au-dedans d’elles d’un si grand bien qu’elles voudraient le communiquer à toute la terre. Mais ces personnes sont infiniment loin de l’état dont je parle, qui ne peut jamais arriver que l’âme ne soit morte et ressuscitée en Dieu, et fort avancée en lui seul, où tout se trouve en unité divine. Alors elle entre dans la vie Apostolique par état, par infusion substantielle, et par union essentielle, où c’est Dieu qui agit et parle en elle sans qu’elle prévienne Dieu, ni qu’elle lui résiste, ni qu’elle participe à ce qui se dit ou se fait par elle en rien qui lui soit propre, imitant en cela la façon de parler et d’agir de Jésus-Christ. »375.
Le meilleur des disciples est celui que le guru va chercher et qui ne cherche pas, car, sachant ce que serait le vrai maître, il n’a aucun espoir de le découvrir.
Excellents aussi sont les disciples lorsque, dès leur première rencontre avec le maître, quelles qu’en soient les circonstances, tout est accompli. Désormais leur champ d’intérêt se transforme, cesse de se confondre avec eux-mêmes, se déploie autour du guru, car aussitôt découvert, le guru les émerveille.
D’autres bons disciples sont amenés au maître par un ami, ou ils entendent parler de lui, ou ils lisent à son sujet ; tous cherchent et trouvent sans hésiter. Une transformation a lieu pour eux aussi : oubliant leurs préoccupations personnelles, ils se centrent sur le guru par amour et admiration.
Il est encore des disciples qui ont d’abord fait des essais infructueux. Ils n’ont pas eu tout de suite le parfait discernement, mais lorsqu’enfin ils rencontrent le sadguru, ils le reconnaissent comme tel et lui sont fidèles.
Le don du guru est sans condition, d’une absolue gratuité, car il aime qui il veut. Mais il ne suffit pas que le don soit offert, il faut [264] aussi qu’il soit reçu. Dans un sol stérile, nulle graine ne peut germer. L’impureté du disciple gêne la réception ou fait perdre ce qui a été reçu.
Néanmoins, le guru ne reprend pas ce qu’il a donné, même si le disciple lui est infidèle.
La foi défaillante, le doute sont, d’après Kabîr, les principaux obstacles alors que le secret de la réussite réside justement dans l’ouverture à la parole du guru :
« À quoi bon trouver le Parfait Guru, si l’erreur reste dans l’âme ?
Si le métier gâte le tissu, que peut faire le malheureux vêtement ?
Le Satguru que peut-il faire, le pauvre, si la faute est au disciple ?
Il peut toujours essayer de l’éveiller, comme on souffle dans une flûte de roseau !
Le Doute a dévoré tous les âges, mais nul n’a dévoré le Doute, Ceux qui ont été transpercés par les paroles du Guru, ceux-là seuls ont picoré et dévoré le Doute ! »376.
Et Madame Guyon observe qu’on ne peut transmettre la grâce à des personnes inaptes à la recevoir : elles n’en profitent pas. Il faut une « correspondance » entre directeur et dirigé :
« Ce n’est donc pas toujours, lorsqu’on ne réussit pas dans la conduite des âmes, le défaut de lumière et d’une grâce éminente, c’est la faute des personnes dirigées ; et je crois que, de même que le Directeur doit se déporter par humilité des âmes dont la grâce est supérieure à la sienne, il se doit aussi déporter de celles qui, n’ayant ni foi, ni confiance, ni ouverture de cœur, ne peuvent profiter de sa conduite (à moins qu’il n’ait quelque secrète espérance qu’elles profiteront un jour) ; car ces personnes ayant plus d’estime et de confiance en d’autres, profiteraient davantage sous leur conduite pourvu qu’elles prissent des personnes conformes à leur grâce, et non opposées. » Dans ce cas toutefois, explique ensuite Madame Guyon, ces âmes ne pourront pas progresser autant que si elles avaient pu suivre le premier et meilleur directeur377.
Certains disciples ont à l’égard du maître une relation défectueuse. Au lieu de le suivre dans son absorption intérieure, ils imitent ses gestes ou ses paroles de l’extérieur. Ainsi, tandis que [265] la mudrā véritable est un geste spontané qui jaillit chez le guru d’un état mystique profond, elle n’est plus que singerie chez un disciple qui l’observe du dehors et s’efforce de la reproduire volontairement.
D’autres défauts découlent de celui-ci. Lorsque le lien entre maître et disciple ne s’établit pas au niveau de la pure « intériorité », au sens précis où nous employons ce terme378, peuvent alors s’instaurer, ou tendre à s’instaurer, une relation d’objet, une projection, ou bien d’autres situations 379 qui n’ont rien à voir avec la transmission mystique véritable. Si le disciple fusionne avec le maître et de cette façon retrouve son « moi », il va chérir ce dernier plus encore qu’auparavant et l’on obtient exactement l’inverse du but recherché.
Tous les défauts du disciple ont au fond une même origine : il n’a pas su reconnaître « le guru divin » (gurudev). Il regarde du dehors une personne dont il apprécie les qualités en fonction de ses désirs et de ses opinions, restant ainsi centré sur son « moi ».
Au contraire, le bon disciple fixe toute son attention et se centre sur le Cœur du guru — un Cœur irradiant.
Le disciple ne peut mentir au maître. Il ne saurait non plus tenter de lui imposer sa volonté ni de lui donner un ordre. En fait le bon disciple ne demande rien, car il a une confiance absolue ; il sait que le maître fait et dit ce qu’il faut au bon moment. Et dès qu’il jouit de l’Éveil, il reconnaît la grandeur de celui qui l’a guidé jusque-là.
Quiconque a découvert le véritable maître, formé et capable de former des disciples grâce à un système vivant, une méthode à l’épreuve des siècles, ne doit pas appartenir à un autre maître, ni aller de maître en maître, car, même s’il fait le tour du monde, personne ne pourra plus rien lui donner. C’est pourquoi les maîtres refusent de se charger d’un infidèle ou de lui fournir quelque enseignement.
« Le disciple ne doit pas désirer rencontrer quelqu’un d’autre que son maître ni vouloir changer de maître.., un tel désir ronge la volonté dans le germe », dit un soufi marocain380. Avec le manque de foi et de fidélité, le lien entre maître et disciple est brisé. L’Amour véritable est pour un seul.
D’après Abhinavagupta, celui qui mêle plusieurs disciplines — Śivaïsme et Vichnouïsme — devient victime du doute et échoue dans les deux, dont il viole également les règles. Et nous avons vu [266] Hakuin dénoncer l’introduction dans le Zen de pratiques appartenant à l’école de la Terre Pure.
Mais les règles qui valent pour un guru éminent ne s’appliquent pas à un maître médiocre qu’il importe de quitter. Il y a là une discrimination importante à faire.
Abhinavagupta établit une hiérarchie entre les écoles Śivaïtes, allant du système inférieur dualiste jusqu’à la non-dualité du Trika. Le maître relevant de l’une de ces écoles a autorité sur le système qui lui est inférieur, mais il n’est nullement qualifié à l’égard de la voie qui lui est supérieure. Ainsi le maître Trika possède une totale liberté et doit sa suprématie au fait qu’il a réalisé de façon immédiate le Soi et que sa connaissance, parfaite, est sans limite, tandis qu’un être déterminé par d’innombrables contingences ignore ce qui est illimité. Le maître qui appartient à une école supérieure peut tout faire et il jouit d’une pleine autorité vis-à-vis des autres systèmes. Il est donc le meilleur d’entre tous les maîtres.
« Si un disciple qui appartenait à un système inférieur honore un tel maître et que la grâce l’enflamme, il sera bientôt conduit au sommet. Comme un torrent de montagne peut submerger lacs, champs et terrains situés plus bas, non point les terrains plus élevés, ainsi en est-il du maître formé dans une école inférieure : il n’est pas qualifié à l’égard des connaissances mystiques (vijñāna) des écoles supérieures. »
Abhinavagupta recommande à qui aspire à cheminer toujours plus haut de quitter un maître de tradition inférieure pour un maître supérieur, et il cite une stance : « L’abeille à la poursuite du parfum va de fleur en fleur ; ainsi un disciple qui poursuit la connaissance va de maître en maître. »
Mais cela est strictement défendu, objecte-t-on aussitôt. Et Abhinavagupta de répondre : « Si l’on a un maître dépourvu d’efficience, comment atteindrait-on la libération ? D’un arbre aux racines détruites, d’où viendraient fleurs et fruits ? »
« Quant à celui qui a la bonne fortune de découvrir un maître éminent, capable de le conduire de plus en plus haut, et qui, le sachant, reste attaché à un maître d’un niveau inférieur, il mérite d’être consumé par le feu de la destinée.
« Bienheureux, par contre, celui qui, flairé par une grâce intense, aspire à la connaissance et obtient le maître doué d’une parfaite Connaissance. »
Et même si l’on possède un tel guru, il est permis de se rendre auprès d’autres maîtres. « Mais, s’exclame-t-on, les livres sacrés ne soutiennent-ils pas qu’il faut briser toute relation avec l’insensé qui se plaît à aller de maître en maître et qui s’attache à plusieurs traditions ? » [267]
Voici la réponse : si une fidélité absolue est en effet exigé à l’égard du maître doué de Connaissance mystique et apte à la transmettre, on peut néanmoins fréquenter des maîtres versés en logique, en védisme, et des bouddhistes, des jaïna, etc., mais par pure curiosité intellectuelle touchant à des doctrines contenues dans des traités inférieurs.
Abhinavagupta le dit poétiquement :
« Pourquoi ne ferait-on pas déborder avec ses propres gouttelettes l’océan de la Connaissance que remplissent les courants mélangés, issus de maîtres et de traités variés ainsi que de sa propre intuition mystique ? »381.
LILIAN SILBURN et MARINETTE BRUNO
La transmission directe, aussi rare que mystérieuse, tient à la présence d’une personne vivante dont l’efficience se confond avec celle de la grâce ; présence médiatrice à travers laquelle la grâce rend perceptible au cœur de l’ignorant les courants divins d’amour et de félicité.
C’est le miracle et la vocation des grandes lignées mystiques que de conserver, de siècle en siècle, l’accès à ces courants et leur maîtrise. Miracle insondable que cette succession de disciples qui s’effacent les uns après les autres, se perdent les uns dans les autres, s’évanouissant dans les puissants courants dont ils assurent la permanence et conservent la pureté, les tenant inlassablement à la portée de ceux qui les reconnaissent à travers eux.
Saura-t-on jamais dire leur puissance et leur amour ? Puissance à la mesure des courants divins qui les traversent, amour à la mesure des vides purificateurs qui ont anéanti en eux tout attachement à soi et à la vie pour en faire des « morts avant de mourir » :
« Ils sont morts à eux-mêmes, et vivant éternellement dans l’Ami.
Il est étrange qu’ils existent encore tout en existant plus. »47
Comment décrire le dénuement total de leur vie, la vacuité vibrante de leur cœur d’où émane le plus pur des amours, la plus inlassable des patiences ? Saura-t-on mesurer le renoncement perpétuellement renouvelé qu’exige d’eux cette intime alliance de l’amour divin et de la compassion ? Échappe à toute mesure ce renoncement à la plénitude divine toujours présente, mais à laquelle ils sont arrachés par ceux auxquels
46 Article paru dans Le Maître Spirituel selon les traditions d’Orient et d’Occident, Hermès III, nouvelle série, Les Deux Océans, 1983.
47 Sultan Valad. Maître et disciple, p. 51.
101
ils la révèlent ; renoncement à un monde désormais transfiguré, par compassion pour ceux qui vivent encore dans la dualité ; renoncement, en un mot, de celui qui ayant accès au sans-mesure et au sans-limite, demeure au fil des jours, sans jamais le montrer, au cœur des limites de tous, attentif à l’éclosion de chacun. Totalement anéanti dans le divin il offre cependant la chaleur et l’éclat d’une présence intensément vivante. Tel le cheval tombé dans une mine de sel, qui y serait resté pendant des années afin de devenir de sel, la forme demeure, celle du cheval, mais le cheval n’existe plus et l’on retrouve le sel dans chacune de ses parties. 48
Ainsi le Maître qui se rattache à une grande lignée ayant « écarté le voile de sa propre existence » ne garde de la forme humaine qu’un nom et qu’une image, tandis que la plénitude divine imprègne le moindre de ses actes, éveillant les cœurs obscurs, mais habités de nostalgie qui s’abandonnent spontanément à l’efficience de son action.
Si la poignée de sel démontre l’existence de la mine de sel, l’homme de Dieu montre Dieu, dit-on ; car à travers la transparence de son cœur « sans images ni besoin » la grâce agit librement dans le silence de la vacuité et le secret de l’amour.
C’est en se tenant à la source de ce double silence, en effet, que le mystique transmet de cœur à cœur sans que jamais n’intervienne une trace d’intérêt pour son expérience ou sa volonté propre ; ainsi toutes les formes de son action portent-t-elles le sceau de ce silence. Comme le disait Maître Eckhart : « plus un maître est sage et puissant, plus son œuvre se réalise immédiatement et plus elle est simple. »49
Un tel maître accueille le disciple dans le silence du cœur ; il le connaît dans l’instant, l’accepte et l’aime tel qu’il est, sans jugement ni reproche. Il respecte profondément sa liberté et n’intervient pas dans l’organisation de sa vie ; il ne lui donne aucun ordre pour lui éviter de désobéir.
48 Op. cit. p. 40-41.
49 Œuvres de Maître Eckhart. Traduction P. Petit ; Paris, Gallimard, 1942, p. 39.
102
Son enseignement est sans parole. Sa seule présence fait fondre, comme neige au soleil, les questions inutiles. Mais surtout il laisse le disciple déchiffrer la voie au fur et à mesure qu’elle se révèle intérieurement, confirmant ses découvertes, attentif à son niveau d’expérience que dévoilent ses rêves, ses états, ses paroles, ses actes, suggérant seulement ce qui lui fera atteindre l’étape suivante. Son aide suit ainsi le rythme d’une évolution intime sans effrayer par des paroles qui ne peuvent être encore comprises ou acceptées.
Sans mot dire il accepte la lente maturation du disciple qu’affermit sa patience aussi inaltérable que rigoureuse. Il lui offre en effet une fermeté sans prise, restant insensible à ses peines ou à ses protestations quand, sous l’effet de la grâce, se dégage des exigences souvent imprévisibles de sa destinée intérieure. Pur canal de l’amour divin, il nourrit d’un amour qui échappe à toutes les faiblesses et reste sourd à toutes les revendications du moi jusqu’à leur extinction.
Il garde secrète la puissance qu’il a de transformer les cœurs. Source de la grâce, il supporte la force des courants divins d’amour et de félicité. Ce sont eux qui brûlent les impuretés, illuminent les cœurs, anéantissent le moi, sans laisser de trace, tels de mystérieux courants électriques ; mais il atténue leur intensité qu’il adapte à la mesure de chacun subissant, dans son corps, les contrecoups des résistances intérieures de ceux à qui il les transmet. Ce rôle essentiel de « transformateur » des énergies divines, pourrait-on dire, fait de sa présence vivante une condition essentielle de la transmission. Toutes les formes silencieuses de cette action émanent en vérité du silence, unique et sans fond, de celui qui est plongé dans l’essence et offre une inaltérable disponibilité aux courants divins.
Ainsi le flux divin devient le flux du guru, intermédiaire indispensable à la transformation du disciple ;
« De même, Dieu se manifeste aux croyants et aux saints selon leur degré spirituel. La lumière de Dieu descend sur eux de manière qu’ils puissent le supporter. Quand l’homme désire s’unir avec le feu, il chauffe le hammam ; par un tel intermédiaire, il s’unit au feu. Car s’il entrait à même le feu, il serait brûlé. Les hommes parfaits, pareils à la salamandre, se trouvent dans le feu même comme le poisson dans l’eau. Le reste des
103
croyants et des chercheurs de Dieu n’ont pas la force qui leur permette d’être dans le feu… Recherchez cet homme parfait afin que, par son truchement, vous ayez la même vision que lui. » î0
Quand se produit cette bienheureuse rencontre, le silence plein de feu du maître gagne peu à peu le cœur du disciple. Celui-ci apprivoisé par cette approche graduelle, se tait émerveillé, et son silence ne cesse de s’intensifier jusqu’à ce que, salamandre à son tour, il soit lui aussi dans le feu comme « le poisson dans l’eau ».
Tel est le secret de la plus prodigieuse des transformations auprès de laquelle pâlissent les plus éclatantes magies.
De cette transformation, le bénéficiaire n’est ni juge ni témoin et encore moins acteur. Et pourtant dans l’intime du silence partagé, dès la première rencontre se déploie pour lui la plus audacieuse des aventures, à condition, il est vrai, qu’il accepte de disparaître, de se perdre dans une absorption silencieuse.
De ce silence, la rencontre vivante sur laquelle repose la transmission de cœur à cœur, multiplie et renouvelle naturellement les occasions.
La première naît de l’émerveillement ; ébloui par la puissance et la grandeur de ce qui lui est révélé intimement, le disciple se tait, avide, tel le bon musicien qui se reconnaît à la qualité de son écoute ; pour mieux saisir les prestiges d’une interprétation nouvelle, inattendue, ce dernier oublie sur-le-champ tout ce qu’il a pu jouer lui-même auparavant ; ainsi, le nouveau disciple, dès la première rencontre, oublie tout ce qu’il a connu, son oreille ne veut plus entendre que la mélodie silencieuse du maître, pour pouvoir l’écouter et en découvrir toutes les subtilités, il établit en lui un silence profond et se détourne naturellement de ce qui n’est pas elle :
« Le Tchélébî (que Dieu soit satisfait de lui !) raconta à ses amis fortunés ce détail : “Quand je me trouvais en face du Maître, dit-il, je m’assis en complète tranquillité ; il n’y eut aucun mot, aucune parole 50
50 Sultan Valad, op.cit. p.31.
104
échangés entre nous ; moi, j’entendis sensiblement, avec l’oreille de l’intelligence, que l’oiseau de mon âme, de l’intérieur de la cage de ma poitrine, répondait comme une colombe aux roucoulements de l’âme du Maître ; il poussait des baqrîquoû ; la douceur de la voix de l’âme du Maître arrivait à l’oreille de la mienne, et m’enlevait l’esprit sans que j’eusse la possibilité de parler ; c’est ainsi qu’il a dit lui-même dans le livre du Methnéwî :
“La mélodie de la voix de ce corps pur parvient à chaque instant à l’oreille de sa sensation,
« Par une voie que le genre humain ne connaît pas, parce qu’elle n’appartient pas au cœur sensible et ayant forme.
‘Ses compagnons ne l’entendent pas ; lui l’entend ; heureuse l’âme que la certitude entoure !”51
Désireux d’une approche de plus en plus intime, le disciple ne peut que laisser infuser en lui à l’insu de toute pensée et de tout jugement, l’enseignement sans parole du maître ; au fur et à mesure que son silence grandit, il sent naître la paix, jaillir l’Amour et se révéler la Connaissance.
Auparavant s’impose à lui une autre raison de se taire. En envahissant son cœur, le silence du maître engourdit toutes ses facultés. Avant d’être dégagées de leurs limites et rendues à leur pleine liberté, ces dernières sont, en effet, comme paralysées. Profonde et effective, la transformation opère sur la meilleure des énergies, sur le cœur du cœur, source de l’être, et gagne peu à peu toutes les couches, les plus inconscientes comme les plus extérieures, car la totalité de la personne est touchée. Mais durant les phases de la métamorphose il n’est point de témoin pour parler ou juger de ce qui est en train de se passer. Qui pourrait s’exprimer en effet ? La chenille qui va disparaître ou le papillon qui n’a pas encore pris son vol ?
Transition sans doute difficile où l’ensemble de l’être est comme tenu en suspens entre deux mondes : l’ancien dont il se détourne, dont les contours et les fondements s’estompent sous l’action du courant purificateur, et le nouveau, totalement inconnu, qui échappe à sa
51 Aflâkî, Les Saints des Derviches tourneurs, Éditions Orientales, Paris, 1978, Tome II, p.243.
105
compréhension et à son habileté, incapable qu’il est de deviner ou d’imaginer ce qu’il faut faire pour y demeurer. Seule une soumission silencieuse à l’action du Maître peut en surprendre les secrets. Ne fait-on pas table rase de toutes les langues connues pour en parler une nouvelle ? Il faut du temps pour acquérir l’intelligence de la vie nouvelle qui apparaît, et pour jouir de la libération qu’elle apporte : un temps de silence, temps d’un apprentissage exceptionnel, celui de l’amour et de la nudité divine.
Très rapidement le disciple se tait par goût, car il apprend à ses dépens que toute interruption de son silence, c’est-à-dire toute intervention de sa volonté, de son jugement ou de son initiative propre, fait obstacle au courant d’amour qui l’emplit et le transforme sans qu’il fasse rien. Il vit comme une séparation douloureuse, un exil de plus en plus insupportable, la rupture de l’échange profond et nourricier qui s’instaure au contraire dans le silence partagé de l’absorption. Là, en effet, il découvre que l’amour commence dès qu’on s’écoule selon la direction du guru qui lui même flue comme dirigé selon la grâce, mais si la foi a le moindre défaut, le lien est brisé :
« Un contact étroit avec le cheik est indispensable, car le secours apporté par le maître est comparable à l’eau qui s’écoule dans les godets d’une roue ou dans un canal d’irrigation : plus on prolonge la durée de l’écoulement, plus la quantité d’eau qui jaillit est abondante ; mais que l’on se détourne du maître par insouciance et l’on verra son eau se raréfier et finir par tarir. »52
Il est donc aisé de découvrir à l’expérience que plus on s’abandonne au silence et à l’amour du maître plus on bénéficie de son efficience. Cette soumission n’est autre que l’apprentissage de l’abandon aux courants divins et se révèle la source de la plus grande des libertés puisque, vécue dans la foi et la fidélité, elle efface et anéanti le moi au profit de l’amour de Dieu et des autres.
Un tel apprentissage n’a qu’une condition, il est vrai, une confiance sans réticence ni partage, seule preuve de l’engagement total sans lequel le miracle de la transformation du disciple ne peut être opéré. Mais si, radicale et vivante, s’instaure cette confiance dès la reconnaissance de la
52 J. — L. Michon, L’autobiographie (Fahrasa) du Sufi marocain Ahmad Ibn ‘Agiba 1747-1809. Archè, Milan, 1982. p. 98.
106
rencontre, tout est déjà fait : le cœur mort ressuscite, un flot d’amour universel s’écoule du cœur du maître au cœur du disciple, ce dernier est alors apte à le suivre dans ses états, à saisir au vol ses plus fines suggestions pour finir par s’identifier à lui, tout ce que réalise le maître passant alors spontanément dans le disciple.
Fruit du plus rigoureux des dénuements, cette identification lui révélera le silence fondamental du message secret où « l’âme sent bien que c’est, mais ne sait pas comment c’est et ce que c’est ». Elle le conduira à ‘l’accès secret que l’âme a dans la nature divine. Car, quand l’âme n’a rien d’autre sur quoi elle repose, alors elle est préparée à entrer dans la ressemblance divine. Ceci s’appelle « aller en tant que rien vers rien », vers le rien de la nature divine où personne ne peut arriver à moins qu’il ne soit dépouillé de toute matière spirituelle’ 53.
Ainsi l’efficience silencieuse du maître est à la mesure du silence de cœur du disciple, en vérité l’un ne peut être dissocié de l’autre, ils existent l’un par l’autre, ils sont la double manifestation d’une rencontre unique où la question de l’un a intimement coïncidé avec la réponse de l’autre, ne fut-ce qu’un instant et où chacun l’a su.
Cette double reconnaissance naît du partage spontané et sans intermédiaire du silence divin. Car ce silence de la transmission directe est une expérience commune et immédiate ; il ne saurait être le produit d’une décision ou d’un exercice à sens unique ; il se dérobe à toute fabrication ou simulacre, mais il s’impose de lui-même au disciple à mesure que s’intensifie l’expérience intime de la rencontre. Échappant à toute pensée discursive, il n’exclut pas la discrimination, mais reste avant tout le fruit d’une contagion ; seule l’efficience du maître fonde et nourrit le silence de plus en plus réel du disciple.
Il est difficile d’exprimer clairement le caractère exceptionnel d’une telle expérience. Aussi simple que rigoureuse, elle se soustrait par nature à toute falsification ; elle porte en elle la garantie de sa pureté ; le courant puissant auquel elle donne accès dissout, purifie et ouvre à la plénitude, mais se dérobe à toute saisie et s’interrompt instantanément si l’on veut s’en emparer.
53 Eckhart, op. cit. 103.
107
De même, la fermeté adamantine du maître, fermeté d’un amour qui dissout toutes les formes, se dérobe aux servitudes d’une relation possessive, comme aux tentatives de l’idolâtrie. Quel désir projeter et sur qui, quand il n’y a personne, quand s’ouvre la liberté d’une vie qui jaillit de l’évanouissement de tout support ?
Pour conclure, nous aimerions dire qu’en cette expérience culmine la plus humaine des aventures. En nous jetant au plus osé de nos élans, elle nous enracine au plus profond de notre être.
Mon Dieu ! Qu’est-ce donc là que Tu as fait pour Tes Amis ?
Quiconque les cherche Te trouve,
Et tant qu’il ne T’a pas vu, il ne les connaît point.
Khwādja Abdullah Ansārī383.
Si la transmission immédiate n’existe plus au Cachemire, la lignée des maîtres si florissante au temps d’Abhinavagupta 384 ayant été interrompue au cours des siècles, elle demeure pourtant toujours vivante pour qui sait la découvrir. Dans une autre région de l’Inde et dans une autre tradition remontant, elle aussi, à un lointain et non moins célèbre passé, j’ai rencontré des maîtres capables d’opérer le transfert de cœur à cœur, d’esprit à esprit, de souffle à souffle, d’âme à âme, et d’assurer ainsi une progression aussi rapide et aisée que possible.
S’attachant exclusivement au plus intime, au plus fondamental, leur école écarte toute manifestation extérieure : culte, pratique rituelle (kirtān, danses, etc.), elle n’a pas recours à des techniques particulières telles que postures, exercices de souffle ou de concentration. Elle n’impose aucune limitation au mode de vie — célibat, impératif moral — aucune limitation doctrinale ou référence exclusive à un texte sacré.
Voie du silence par delà pensée discursive et ses normes (nirvikalpa), tendant à l’indifférencié, elle ne comporte aucun enseignement qui ajouterait illusion à illusion : tout doit être compris par le cœur et faire l’objet d’une expérience intérieure et ineffable. Voie du dépouillement, elle se refuse à substituer aux routines naturelles celles de la dévotion et de l’ascèse, et elle élimine tout effort personnel dont on pourrait tirer orgueil ou satisfaction.
Facile par sa simplicité, elle est ardue dans la mesure où elle ne propose aucune dérivation : culte, étude de texte, discussion, exercices personnels… mais exige du [276] disciple le maximum : don de soi sans condition et, de la part du maître, un renoncement absolu et une puissance exceptionnelle. Rares sont donc ceux qui s’y aventurent, plus rares encore ceux qui la suivent jusqu’au bout.
Sans équivalent dans l’Inde moderne, cette « quête » par son caractère universel et son rejet de toute forme d’idolâtrie peut être comparée à la sādhanā purement mystique de certains sants médiévaux et spécialement de Kabîr. Ces grands maîtres se tiennent comme lui au croisement de plusieurs traditions dont ils ne gardent que l’essentiel : élan vers l’Un de sūfī libres et audacieux, largeur d’esprit de certains mahātma. Ne compte pour eux que la Réalité ineffable et inconditionnée à laquelle nulle voie385, à strictement parler, ne donne accès :
“Sans semence, la pousse, sans arbre, le feuillage,
sans fleurs, l’arbre a fructifié !
….
« Sans mémoire, la Sagesse parfaite, sans sagesse, le Sage,
dit Kabîr : voilà le vrai Dévot ! »386.
Ces saints restent cachés afin que seul les découvre le chercheur ardent et tenace qui reconnaît leur puissance aux états intérieurs que leur proximité suscite et nullement à leur savoir, à leurs extases ou à leur célébrité.
J’aurais aimé évoquer la personne de l’éminent sūfī Maulana Abdul Ghani Khan Saheb qui mourut en 1952 ; mais que dire de celui qui n’a plus d’ego ? « Le saint comme le fou échappe à qui veut le saisir ». Si la pensée se fixe sur lui, il s’efface avec la pensée. C’est là sa grandeur.
Ce mystique doué de génie se consacra à former un petit nombre de disciples qui devinrent des maîtres exceptionnels, en particulier le Mahātma Radhamohan Lal Adhauliya, sadguru qui, pendant une trentaine d’années, guida de nombreux disciples dont certains venus d’Occident ; deux d’entre eux ont consenti à nous confier leurs souvenirs et leurs réflexions. Son propre père, le Mahātma Raghubar Dayal, également disciple du même maître, attirait des gens de toute l’Inde du nord ; c’est à lui surtout que se réfère le premier récit, obtenu d’un Indien.
L. Silburn.
Depuis des années j’étais à la recherche d’un maître capable, par sa propre puissance spirituelle de me faire réaliser la Félicité. J’avais déjà rencontré des personnes fort éclairées appartenant à diverses sectes et écouté beaucoup de savants discours, mais ni les unes ni les autres ne pouvaient me donner la connaissance et l’expérience que je désirais.
Au cours de l’été 1937, un de mes vieux amis me présenta au Mahātma Raghubar qui allait devenir mon guru. Dès les premières visites que je lui rendis, je vis beaucoup de gens assis auprès de lui dans un état semi-conscient et je lui adressai quelques questions à ce sujet. Il me demanda quelles étaient mes conceptions et mes pratiques, et me donna un marakba 387 six jours après ma première visite, ce qui était assez rare.
Pendant ce marakba, j’eus plusieurs expériences nouvelles — lumières colorées, vibrations sonores, vagues de paix et de félicité — qui durèrent une heure environ. Ceci suffit à me convaincre de l’efficacité du système, et m’attacha à lui pour toujours. C’est en vérité une école merveilleuse, unique, de transmission et de discipline spirituelles, car je crois que l’exemple vaut mieux que l’enseignement, et l’expérience mieux encore que tous les deux.
Mon guru était un homme parfait. Exempt de sensualité, de colère, d’attachement, de vanité et de jalousie, toujours gai, plein d’amour et de compassion pour tous, offrant aide pécuniaire aux étudiants pauvres de haute ou de basse classe et nourriture aux gens qui, de près et de loin, affluaient chez lui, il menait une vie admirable, bel exemple d’abnégation librement consentie. À tous, il nous enseigna à vivre et à mourir. Des vagues de paix et de félicité irradiaient de lui sur les personnes assises alentour et celles-ci les absorbaient selon leur capacité propre et le stade atteint dans leur quête. Cela durait vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les deux seules heures du milieu de la nuit pendant lesquelles on pouvait dire que Guruji dormait. Même alors, certains s’étendaient près de son lit pour ressentir cette félicité. [278]
Nous avions journellement la preuve qu’il pouvait connaître les pensées et les sentiments intimes de ses disciples, mais il ne les dévoilait jamais en public. Chaque fois que je venais le voir, préoccupé par tel ou tel problème, il le devinait et donnait sa réponse sans que la question eût été formulée. Il avait le pouvoir miraculeux d’enlever à ses disciples leurs difficultés et leurs souffrances. Jamais bénédiction venant de lui ne manqua de se réaliser.
Il pouvait communiquer son propre pouvoir de transmettre à autrui. Je sais que personnellement j’ai pu mettre des personnes en samādhi sans aucun effort de ma part, grâce au seul pouvoir qu’il m’avait ainsi transféré.
J’ai eu le privilège de connaître un autre homme doué d’une grande puissance spirituelle : le maître de mon guru. Puis, après la mort de ce dernier, j’ai eu comme guide son fils, disciple du même maître, qui a bien voulu m’accorder de temps à autre son tavajjuh 388 et m’aider à progresser. C’est grâce à leur rayonnement que, débarrassé de beaucoup de mes erreurs et de mes imperfections, je jouis à présent de la paix de l’esprit et de la Félicité.
Le trait distinctif de cette école consiste en ceci : le pouvoir spirituel est transmis au disciple par la grâce du maître. C’est là un don merveilleux, car il permet, sans autre moyen que la grâce divine et la bénédiction du guru, non seulement de jouir soi-même de la félicité, mais de la transmettre aux autres sans effort. De nombreuses personnes en ont fait l’expérience.
Nous arrivons le matin vers neuf heures, parfois avant que le guru ne soit là. Nous nous asseyons dehors, devant la grande maison toute simple — longue façade ocre avec peu d’ouvertures — sur des fauteuils cannés, disposés là pour les disciples (on ne voit de confort que pour eux ici !). Il fait un temps radieux. L’atmosphère est d’une pureté que je n’ai vue qu’en Inde : de la luminosité à plein ciel, l’air est léger, incroyablement léger… Bientôt voici le guru, vêtu de blanc éblouissant et d’écru ou de beige, ou encore d’une longue robe gris clair. Nous le saluons d’un geste. Il parle aimablement à tous et s’assied.
Il vit ici, non comme un yogin entouré d’ascètes, mais plutôt comme un patriarche, chef d’une nombreuse famille. Il paraît grand et fort malgré son âge ; en fait, je m’apercevrai plus tard qu’il est de taille moyenne ; sa grandeur intérieure, perçue sans qu’on sache trop comment, crée cette illusion. Beau visage allongé, aux traits purs et réguliers. [279]
Cheveux courts grisonnants, ample barbe presque blanche. Expression mobile. Parfaitement naturels sont les gestes, la voix, et pourtant on devine comme une retenue, une modestie, qui adoucit la noblesse de l’allure. Il est affable, de manières très simples, avec un sourire très bon. On sent en lui à la fois l’immobilité de la paix souveraine et un naturel actif et dynamique, que j’aurai l’occasion de constater à plusieurs reprises, ainsi ce jour où, pour mon plus grand effroi, je le vis sauter du cyclo-pousse avant l’arrêt. À vrai dire, on ne saurait l’enfermer dans une caractéristique particulière, je serais tentée de dire qu’au contraire rien ne le définit.
Deux ou trois disciples viennent régulièrement tous les jours, dont un swāmi en robe orange, fort loquace, qui arrive en chantant et jette manteau et bâton sur le goyave avant de prendre place ; d’autres n’apparaissent que de temps en temps. Tous s’inclinent, causent, puis invariablement tombent dans le silence et l’immobilité et… partent assez souvent sans avoir retrouvé la parole ! Parfois au contraire, la conversation est très animée ; j’ai entendu un jour, du fond de mon dhyana, le guru rire à gorge déployée avec ses disciples… mais l’histoire était en hindi ! Puis surgit l’un de ses petits-fils ou sa femme en sari de couleurs vives. On le tire de l’indifférencié (de l’extérieur il n’y paraît guère, mais le disciple qu’il vient de plonger dans un état profond sait bien) pour lui demander son avis en vue de quelque minime achat. Telle est cette voie : au sein de la vie courante.
Pourtant beaucoup de gens viennent ici ; ils apportent leurs soucis et leurs problèmes ; ils emportent un silence allègre, transparent, dont certains savent, d’autres pas encore, qu’il a deux faces : le renoncement et la félicité.
Au cours des deux premiers jours, lorsque le guru parle (tout à fait à mon intention, car l’une de mes difficultés majeures était la formulation théiste, autour de laquelle de graves complexes avaient cristallisé) du Tout-puissant, il m’apparaît — le mot que je vais employer ne peut avoir de sens que pour ceux, très rares sans doute, qui ont vu la chose — véritablement transfiguré. Je ne saurais décrire sa physionomie en ces instants, mais je sais que ce que j’ai vu alors, ce n’est pas quelque chose d’humain ; ce qui, du dedans, anime son visage, c’est un rayonnement d’une infinie douceur, un amour sans forme ni limite, une beauté vivante jamais vue qui, à elle seule, porte témoignage d’un au-delà de l’humain. « Je vous l’ai d’abord mis dans les yeux », me dira-t-il un peu plus tard, d’où je déduis que cette métamorphose était consciente et voulue. Et il en sera ainsi jusqu’au bout. Chaque geste, chaque parole de sa part s’inscrit dans un ensemble extraordinaire où pas une minute n’est perdue, mais dont je suis sûre qu’il ne le calcule pas d’avance, qui, bien au contraire, lui est chaque fois inspiré dans l’instant même, du fait de sa coïncidence constante avec la source de toute connaissance, de [280] toute justesse d’action, de toute harmonie, coïncidence que seul permet un dépouillement complet de l’ego.
Deux jours pour les yeux suffisaient. Le guru ne tarde pas à s’adresser à des niveaux plus profonds. Dès le troisième jour, je suis dans la paix, au sein d’une pleine réconciliation avec la voie et, en toute confiance, je me laisse aller à la joie de l’absorption silencieuse. Dès lors, le dhyāna s’approfondit et s’élargit de jour en jour, n’étant plus limité aux heures de présence chez le guru. Vers le milieu de cette première semaine, je commence à avoir avec lui de longues conversations, non point sur des problèmes d’ordre général (je n’attends pas un exposé de la vérité, je cherche l’expérience vécue qui donne accès à une manière plus fondamentale de voir et de sentir le monde), mais à propos de mes difficultés personnelles ; le guru montre une très grande attention, beaucoup de tact, une franchise parfaite, mais en même temps il touche précisément au point sensible, n’hésite pas à provoquer des réactions vives. Il se sert, pour situer le problème du moment, de quantités de rêves symboliques que je fais la nuit et que je lui raconte lorsque nous sommes seuls. Ce qu’il me faut à tout prix atteindre, et le plus vite possible pour sortir de la souffrance, c’est l’unification de mon être dans cette orientation spirituelle telle qu’elle s’est précisée les mois précédents — nouvelle étape imprévue, refusée… C’est un seuil à franchir. Alors que dans la vie normale, l’homme est tendu vers l’extérieur, qu’il pense, veut, aime en fonction de ses penchants et de tout son conditionnement, exerçant ce qu’il appelle sa liberté (qui n’est autre que l’extériorisation de ses contraintes intérieures), il faut ici le sacrifice complet du moi. Ce sacrifice est une entreprise surhumaine que très peu de gens sont capables d’accomplir sans un guide puissant et éclairé, car, au niveau du subconscient, on se heurte à des titans. En effet, les complexes acquis dans. l’enfance, les défauts héréditaires, toutes les traces de notre passé personnel et racial d’une part, et d’autre part l’empreinte de l’éducation moderne, véritable dressage à la négation, à la révolte et à l’irresponsabilité ont fait de nous des mécaniques rigides et enfermées dans leur individualisme. Hélas, même quand on a compris ce processus et la nécessité de le rompre, on ne trouve pas la force de transcender ses propres limites, de briser ses chaînes.
Dans ces circonstances, le travail du guru me paraît revêtir un double aspect. D’abord, au plus profond de nous, il infuse une force souveraine, seule capable d’enrayer la dynamique centrifuge qui nous meut : c’est la transmission directe en silence, don sans prix et sans égal, qui éveille le « cœur » mystique, et suscite de grandes expériences spirituelles dont je dirai quelques mots un peu plus loin. Et secondairement il fait un travail plus extérieur, mais pourtant remarquable, dont je vais esquisser le schéma, bien qu’il soit difficile de s’en souvenir, car on avance en abandonnant tout derrière soi, et une fois l’obstacle franchi on l’oublie aussitôt. [281]
Ainsi le guru raconte, sans raison apparente, une petite histoire anodine, mais qui provoque en moi une réaction ou une réflexion. À partir de là se produit un enchaînement serré dont j’ai l’habitude (pour avoir fait une auto-analyse il y a quelques années, en m’aidant de livres), c’est-à-dire qu’au contraire du déroulement ordinaire de la pensée, dans lequel on se « défend » toujours, ici on remonte sans indulgence jusqu’au vrai mobile, jusqu’à la source cachée et peu flatteuse, on remue le fond, on fait sortir les larves. Cela peut durer une heure ou s’étendre sur plusieurs jours avec très peu de répit. Certains aspects sont liquidés par des paroles du guru jetées à la cantonade sur un propos quelconque, mais pour moi percutantes (les assistants ne peuvent rien soupçonner). Puis, au moment où il ne reste plus que l’irréductible, ce qui définit l’être humain ou qui semble me constituer, contre quoi je suis impuissante, juste là, inexplicablement, sans un mot, sans un regard, en une seconde, le guru me souffle tout ; il ne reste plus rien. Alors que j’étais aux prises avec le problème depuis des jours (ou des mois ou des années pour certains), que je le talonnais, m’acharnais sur les nœuds, m’y cassais les ongles, tout d’un coup plus rien ! On est au large, on flotte sur un océan de paix ! Entre le rire et les larmes, je dis au guru : « Qu’avez-vous fait ? » Il sourit mais, bien sûr, ne répond pas. À présent, deux ans plus tard, il me semble que je sais ce qu’il faisait alors, c’est si simple !
De nombreuses années sont nécessaires pour mener à bien la purification. Au début on enlève de son jardin d’énormes rochers, qu’on prenait d’ailleurs pour des montagnes, puis on s’attaque aux grosses pierres, aux pierres moyennes… plus tard il faudra éliminer jusqu’au plus petit caillou. Notre conscience ordinaire, opaque, bornée, fantasque, doit acquérir une transparence de cristal ; alors il ne restera plus rien d’elle puisqu’elle aura perdu ses caractéristiques : « À la fin il ne reste plus que Lui ou son Nom », selon les termes du guru.
Je voudrais maintenant dire la miraculeuse efficience de la transmission silencieuse. L’unification totale de l’être dans le seul but de la réalisation spirituelle équivaut à une nouvelle naissance et, en vérité, elle est précédée de l’agonie et de la mort du moi ; peut-être d’ailleurs cela doit-il se produire plusieurs fois sur le chemin, car le moi revit ensuite, seulement allégé et assoupli. Depuis quelques nuits j’avais des rêves de char funèbre, de poupée morte (sic), de cadavres dont on n’arrivait pas à se débarrasser ; enfin, une certaine nuit, on voit encore le cadavre, mais assurément pour la dernière fois. Je raconte ce rêve au guru et lui dis combien je voudrais en finir et jeter pour de bon la dépouille de mon ancien moi, que je traîne depuis plus d’un semestre. Il me demande de rester absorbée toute la nuit suivante. J’essaie donc, mais au réveil je crains de n’avoir pas été centrée au bon niveau ; dans un de mes rêves, il y avait bien ce petit feu que j’avais réussi à allumer avec un peu de papier et quelques brindilles sur le sable mouillé au ras du fleuve, mais [282] où, parmi tant d’eau, trouverais-je de quoi continuer à l’alimenter ? Pourtant, ce matin-là, j’allais avoir un samādhi de deux heures, le premier. Je n’étais pas assise dans le fauteuil auprès du guru depuis cinq minutes que je fermais le livre emporté et sentais venir un état profond. Cette fois mon être entier était définitivement envahi. Mais comment pourrais-je le décrire ? Non que ce qu’on éprouve soit énorme ou fantastique. Pas du tout. Au contraire, c’est éminemment simple et subtil. L’être au lieu de se sentir dans sa complexité habituelle se sent dans sa simplicité la plus grande et son unité fondamentale, qui n’est plus seulement la sienne, mais celle du monde. On ne sait pas ce qu’est le « vide » avant cela ; ici l’on vit dans l’intime de soi la raréfaction suprême, dont on pourrait aussi bien dire qu’elle est plénitude d’une douceur infinie, mais à peine sentie. Hélas, tout ce que je dis est inexact, car rien n’est à proprement parler « senti » ! Une perfection en soi. On voudrait pouvoir passer sa vie ainsi ; on n’a plus envie de rien d’autre.
Quelques jours après, lors d’une visite au très beau musée de Sarnath, je fais une surprenante découverte. Jusqu’à maintenant l’expression concentrée et le léger, mystérieux sourire des Bouddhas me fascinaient ; ils symbolisaient le monde secret, attirant, prometteur d’infini dont j’étais en quête. Aujourd’hui je vois ce sourire.., du dedans ! Il ne peut plus m’attirer, me promettre ; la réalisation dont il témoigne a été mienne, elle est en moi, je puis m’y plonger encore ; les formes, les traits du visage, l’immobile dynamique du sourire ne m’apparaissent plus qu’à travers elle.
Plus tard, je connais un état extraordinaire, le plus merveilleux de tous, ce doit être « l’amour », mais ce mot ne peut que suggérer une idée fausse chez ceux qui ne l’ont pas connu. Il ne s’agit pas d’un sentiment ; il s’agit plutôt d’une modalité d’être ou de conscience, je ne sais trop comment dire, très subtile, enivrante, animée de légères vagues — non, d’une presque insensible pulsation — non, d’une extrêmement fine et pourtant puissante vibration, perçue comme efficiente. Je conçois qu’on puisse l’appeler amour, adoration, dévotion même (les mots ne comptent plus guère), car elle relie : telle une résonance, quelque chose d’infiniment subtil en moi, enfin éveillé, répond à l’infiniment subtil qui lui parvient ; plus, lui adhère ; mais encore une fois, ce lien ne se situe pas sur le plan sensible, les facultés habituelles (ce que les chrétiens appellent les « puissances ») n’y ont aucune part. Malheureusement ma lourdeur fait obstacle à tant de délicatesse ; cet amour dont je garderai la nostalgie ne me sera pas redonné avant longtemps.
Ainsi telle est l’œuvre du maître : une réalisation vivante, et qui atteint plus profond que ce que nous croyons être notre fond même. À l’inverse du professeur, il n’enseigne pas ; au lieu de faire répéter et apprendre, il éveille les facultés cachées de son disciple grâce auxquelles celui-ci va découvrir et comprendre par lui-même. L’élève du professeur [283] possède un savoir de seconde main (combien de guides spirituels sont seulement des professeurs !), mais le disciple du maître fait vraiment l’expérience : en mystique il n’y a pas de connaissance par procuration. Si le maître donne au disciple ce que, pour la commodité du langage, j’appelle des « états », qui sont en fait d’ineffables pénétrations au sein de l’ultime réalité, le disciple, à mesure qu’il avance, acquiert la maîtrise des stades antérieurs.
Et telle est la technique : le maître donne et le disciple reçoit. Le guru transmet une force aussi subtile que puissante — la « grâce divine » — dans laquelle il baigne et qu’il dose prudemment afin de ne pas dépasser les capacités d’assimilation du disciple. Celui-ci reçoit, souvent éperdu d’admiration, une influence qui se manifeste à lui comme paix, douceur, félicité, amour, vide — il est impossible d’énumérer les effets de cette transmission puisqu’il faudrait décrire la vie mystique toute entière. Certitude et reconnaissance grandissent en lui, l’incitant à s’abandonner davantage afin de recevoir la totalité du don, car seules nos résistances gênent ou empêchent la réussite. L’abandon du disciple apparaît ici comme l’accueil fait à la grâce.
On se tromperait lourdement si l’on considérait son « abandon » comme simple passivité, au sens habituel du mot. Aux yeux du mystique, c’est l’homme ordinaire qui est passif ; l’un des premiers grands pas sur notre chemin consiste à démasquer nos tyrans intérieurs qui, à notre insu puisque nous nous identifions à eux, nous dictent notre conduite, nos goûts, nos idées, nos prétendues volontés : je les ai déjà dénoncés plus haut. Lorsqu’on apprend à connaître le guru, on s’aperçoit que celui-ci n’obéit à aucun de ces mobiles ; on ne trouve en lui ni orgueil, ni volonté de puissance, ni désirs personnels, ni conformisme, ni aucune sorte de peur. Dénué de tout égoïsme, il est animé dans ses gestes et ses paroles d’un souffle libre : perpétuellement traversé par la grâce, la spontanéité pure renaît en lui à chaque instant.
Dans ces conditions, l’abandon du disciple à son égard n’est en rien soumission d’un homme à un autre. Ce n’est pas non plus, comme beaucoup le croient, que le disciple, spécialement sur certaines voies, soit tenu de considérer le maître comme Dieu ou représentant de Dieu. Ces formulations simplistes trahissent la délicate vérité, mais comment pourrais-je éclairer ce point, pour moi encore si mystérieux ? Il me semble que le choix du disciple par le maître, et la reconnaissance de celui-ci par celui-là scellent une destinée selon les lois les plus fondamentales et les plus secrètes du monde, sans que la personnalité de l’un et de l’autre soit une cause déterminante. Le disciple entrevoit l’infini dans le fond sans fond du maître ; alors l’attrait est trop grand : nul ne peut se dérober à l’appel de sa vraie nature, et il faut, lui répondre là où il s’est fait entendre.
Réponses variées : tantôt élan fougueux, tantôt écoute attentive, [284] tantôt doute ou réticences ; on croit que… on imagine que… et l’on refuse — ceci bien sûr en son for intérieur. Alors la voix du guru rompt le silence : « Là où il y a esclavage, il n’y a pas abandon. » Ou encore : « Où vous situez-vous ? »
Loin de se confondre avec passivité ou démission, l’abandon se présente comme un acte héroïque constamment renouvelé ; il constitue le geste mystique par excellence, mouvement psychologique dans lequel on trouverait, plutôt que dans l’expression de l’inexprimable But, le dénominateur commun à toutes les voies de libération, théistes ou non. Point critique où la solution vire, où la direction s’inverse, il varie pourtant selon les voies, et, sur une même voie, selon les stades ; en lui la souffrance cède à l’allégresse, l’ignorance à l’éblouissement. Nous le cherchons perpétuellement, ce n’est qu’un point !
Au début, il se situe dans l’instant où nos pensées et nos soucis tombent de nous, nous laissant disponibles pour le silence. Puis on le trouve dans le rude sacrifice, faille où jaillit la liberté — c’est de cette étape que je parlais plus haut. Maintenant le voici dans le simple oubli de soi, douce pente où fleurit l’amour. Plus tard, je crois, hors du doute terrassé, il fulgurera en efficience. À la fin, lorsque la transcendance elle-même est pleinement atteinte, il s’épanouit dans la gerbe d’instants qu’est devenue la vie infiniment souple, infiniment libre de celui qui demeure à la fois immergé dans l’Un et présent au monde.
Le lien entre guru et disciple une fois bien établi au niveau du « cœur » mystique, rien par la suite — ni la distance ni la mort corporelle du maître — ne peut le rompre.
Peu avant de quitter le guru, je l’avais un jour entendu dire à mon sujet : « C’était une vraie matérialiste ! » et je crois bien que j’avais répondu : « Naturellement ! » En effet, quoi de plus naturel pour des Occidentaux ? Les incroyants sont matérialistes par attachement à la matière considérée sous son aspect physique, mais les croyants, par leur attachement à des détails de rites ou de dogmes, ne le sont guère moins. Dans de pareilles dispositions, on peut recevoir le don de la grâce pendant des années et même commencer à se transformer sans comprendre la nature et la portée de l’événement. Certes, la seule « transmission », parfois si intensément vécue, prouve l’existence d’une force mystérieuse, et le jour où s’épanouit le « souffle », on a la révélation d’une réalité intérieure, autre que celles jusque-là connues. Pourtant je crois qu’en un sens, j’ai été matérialiste jusqu’à mon premier samādhi. À partir de là, non seulement rien ne peut plus jamais être comme avant, non seulement on a la connaissance vécue du dedans, mais encore tout a basculé, tout s’est inversé. Ce vide pèse plus lourd que l’univers visible entier. La vérité quitte les apparences et devient la qualité propre du fond caché. La matière n’est plus qu’un signe, un ensemble de signes, de symboles que l’on va peu à peu déchiffrer. L’homme n’est plus un mur, une limite, mais un seuil. Des perspectives insoupçonnées s’ouvrent ; le monde et les êtres sont vus dans leur dimension d’éternité. Une nouvelle vie commence avec cette naissance mystique. [285]
Comment décrire cette atmosphère typiquement indienne qui rappelle pourtant par sa douceur rayonnante un tableau de Rembrandt !
En hiver, maître et disciples sont assis à terre, enveloppés dans des couvertures de laine sombres ou colorées, dans une salle spacieuse, haute de plafond et éclairée le soir par une faible lumière. Un ancien éventail qu’actionnait la main, à présent inutilisé, suspendu à travers la pièce au-dessus de nos têtes, ne sert plus qu’aux oiseaux pour y faire leurs nids.
De même qu’il ne fixe aucune restriction quant à la nourriture ou à la vie sexuelle, le guru ne fixe pas d’heures de méditation ; la liberté est donc complète ; les uns rentrent, les autres sortent ; certains sont profondément absorbés en dhyāna ou en samādhi, mais un nouveau venu, fatigué de sa journée de travail, ronfle. Quelques-uns écrivent ou parlent entre eux ; les enfants et neveux du guru vont et viennent, jouant et riant follement. Un disciple se met soudain à scander de beaux versets hindi ou sanscrits. Si certains, respectueux et silencieux n’osent guère bouger, d’autres sont hilares, comme ivres d’une gaieté débordante, amusant le reste des disciples et le guru lui-même.
Au matin, les oiseaux gazouillent dans la pièce ou se querellent, frôlant les têtes.
Jamais personne ne le dérange. Le guru accueille avec courtoisie l’importun bavard qui interrompt brutalement une méditation silencieuse ou les hautains brahmin et sādhu qui, imbus de leur propre science, se plaisent à étaler leur savoir selon les éternels clichés qui traînent d’ashram en ashram à travers l’Inde : ils discourent sur un samādhi qu’ils ignorent à des gens qui, étant eux-mêmes en samādhi, ne les entendent pas. Seul le guru les écoute avec une remarquable patience, leur posant des questions comme s’il ne savait rien, avec beaucoup d’humour. Mais c’est avec une patience plus grande encore que, pareil à un bon maître d’école répétant sans cesse la même leçon à un écolier stupide, il infuse en silence dans ses disciples paix et félicité afin de les en imprégner.
Le comportement du guru est varié selon les personnes à qui il s’adresse : koan (pour emprunter la terminologie zen) vivants qu’il adapte aux circonstances, chant mystique ou poème en hindi ancien, en urdhu, [286] en persan ou en arabe, mêlant Tulsî-Dās, Kabîr, « Omar Khayyām, Jalāl-ad-din Rūmî, Mansūr al-Hallāj… et les disciples entrent en dhyāna. Les disciples qui ignorent la langue et ne comprennent pas le sens, suivent pourtant le sentiment (bhāva) qui les dicte et baignent à la source même — paix, amour — dont jaillit le chant.
Afin de déverser simultanément sur de nombreux disciples un flot de félicité, le maître n’a nul besoin de se concentrer puisqu’il est toujours en plein Centre ; il le fait sans cesser d’écrire, de parler, en buvant son thé ou durant des promenades. Jamais il ne dit : méditons, pourtant tous au même instant se recueillent spontanément.
De leur côté les disciples ne sont pas astreints au silence ou à l’immobilité. Mais si un même flot de grâce émane du guru, chacun y puise à des profondeurs variées selon ses capacités ou ses besoins : vibrations, apaisement, purification, renoncement, oubli de soi, connaissance, amour… comme dans un même fleuve on peut se désaltérer, se laver, se baigner ou nager librement.
Le guru irradie aussi par petits groupes en succession et quand tous ont reçu leur part, il s’occupe d’un disciple en particulier dont il éveille les centres, pendant qu’il distrait les autres en leur contant des histoires. Ces histoires tirées de la Bible, des livres des sūfī, des traités hindous, ou anecdotes concernant ses maîtres, contées avec brio, zèle, force gestes et rire sont émouvantes et ont une grande portée pour ceux à qui elles s’adressent : elles répondent souvent à une question qu’un disciple ou un visiteur n’ose pas formuler en public.
Le guru ne parle pas d’expériences spirituelles ; il ne donne guère d’explications ou seulement aux personnes qui manquent de finesse et d’intelligence mystiques. Aux autres, qui doivent tout découvrir par eux-mêmes, il ne fait que des suggestions afin que se développe en eux une manière subtile de comprendre et de sentir.
À l’issue d’un chant ou d’une question posée par un visiteur ou un disciple (il n’y a pas de différence sensible entre l’un et l’autre tant l’accueil est le même), le guru demande à chacun son opinion et de longues discussions s’ensuivent dans lesquelles cultures sūfī, brahmanique et occidentale sont brassées de façon vivante et gaie. Certains spéculent sur la nature de la transmission spirituelle ou sur celle des vibrations qu’ils reçoivent, avançant des théories saugrenues ou hautement philosophiques et même scientifiques et le maître abonde en leur sens jusqu’à ce que l’absurdité de leur hypothèse saute aux yeux ; tous rient alors de bon cœur. Le guru met tout le monde d’accord, car il domine les problèmes de façon géniale ; ses remarques sont si profondes qu’elles semblent aller de soi.
Un ami avait comparé cette atmosphère à la fois intense et simple où se mêlent poésie, humour et gaieté à celle du Banquet de Platon. Comme il arrivait à Socrate, si le guru discute d’un problème, l’interlocuteur [287] est incapable de répondre, sa pensée quasi-dissoute et comme paralysée, tant est grande la paix qui se dégage du maître.
Au début, la présence constante auprès du guru est recommandée et si les occupations du disciple l’en empêchent, il vient avant et après son travail, ne fût-ce que quelques instants. Ceux qui habitent dans une ville éloignée passent la nuit auprès de lui, ne craignant pas de le déranger dans son sommeil. L’agent de police musulman accourt entre deux rondes et le grand avocat hindou après avoir plaidé. Par contre, dès que le disciple s’absorbe de façon habituelle en son guru, une présence constante n’est plus indispensable : quelques minutes suffisent et la distance ne constitue plus un obstacle.
Une fois par an les disciples, venant de tous les coins de l’Inde, se réunissent par centaines. Bhandara « réservoir d’énergie divine » désigne les deux jours consacrés à la mémoire des maîtres disparus. Le guru, puisant à volonté dans ce réservoir, distribue généreusement la grâce qui inonde jusqu’à son corps et qui le transfigure. Chacun prend en lui assez pour subsister spirituellement une ou plusieurs années. Paysans avec leurs gros bâtons, commerçants, magistrats, banquiers, intellectuels, professeurs, riches, pauvres, hors-castes, passent ces jours côte à côte en grande harmonie.
Au cours de ce bhandara, à plusieurs reprises, le guru réussit à maîtriser en un instant la pensée instable de centaines d’hommes et de femmes déjà préparés par lui : comme un vent qui souffle soudain, tous au même moment éprouvent une paix qui les tient immobiles une heure durant, en un silence impressionnant — sans que leurs enfants qui crient et les bousculent ne les dérangent.
En quoi consiste le don indicible du maître, cette chose subtile qu’il infuse dans le cœur du disciple ? Les diverses mystiques la nomment barakah, anugraha, grâce, don divin issu d’un réservoir sans fond et sans limites ; sur le plan humain elle devient félicité (ānanda). Si elle touche le cœur, elle prend l’aspect de l’amour et si elle éveille l’esprit, celui de Connaissance illuminatrice. Comme elle anéantit tous les désirs, elle engendre une paix imperturbable.
Le guru est constamment parcouru par des flots d’amour ; il suffit donc au disciple de s’absorber en lui de façon continue pour capter ces flots. Pas une seconde, ni dans le sommeil ni au cours de ses multiples activités, il ne doit en perdre conscience. Telle est la seule chose exigée de lui. Il éprouve cette divine infusion comme un amour émerveillé ou une douce félicité. Mais à l’ordinaire, il n’en est pas conscient tant elle est simple, délicate, intime ; elle pénètre à des profondeurs où n’accèdent ni la pensée ni le sentiment. Seuls ses effets, plus ou moins lointains affleurent à la conscience.
« La félicité est la nourriture de l’âme : une goutte suffit pour toute [288] une vie. Protégée par la grâce, elle devient un océan », avait coutume de dire notre guru.
Celui qui dès sa naissance présente des aptitudes à la sainteté, a l’expérience mystique immédiatement, au premier regard échangé avec son maître : il le reconnaît comme son guru et, d’un seul élan d’amour, il s’immerge en lui. Le cœur du guru devient alors le miroir très pur dans lequel le disciple se reflète. Il suffit, en effet, d’un instant de total abandon pour que le moi s’évanouisse et, le moi disparu, le disciple s’identifie au maître. Tout lui est spontanément transmis. Dès qu’il y a amour, aucun intermédiaire n’est requis.
Pour la majorité des disciples dont la confiance est moindre et qui ont besoin de preuve, les débuts sont plus lents, l’amour se développe en eux peu à peu à mesure que la purification progresse.
Dans la purification comme dans tout le reste, le guru part de l’essentiel, allant à contre-courant des voies habituelles : En général, en Inde, un yogin se purifie par le souffle qu’il fait entrer dans le canal médian, puis il l’élève jusqu’au milieu des sourcils ; là, à l’aide d’un grand effort de concentration, il le force à monter au sommet du crâne. Le corps sera purifié et certains centres également, mais le « cœur » n’est pas touché, la pratique reste donc incomplète. Avec le présent système, tout vient du cœur et de son éveil ; un cœur étant par définition pur et plein d’amour. Sans amour, pas d’éveil. Seul un saint à l’esprit très clair et reposant dans le Cœur universel peut éveiller le cœur d’un disciple.
Ainsi, afin de transformer simultanément les divers aspects de la personne et de toucher ses centres variés, le guru commence par agir sur l’intime du cœur ; alors le souffle s’apaisera, puis la pensée se calmera sans effort et, à leur tour, les tendances inconscientes se trouveront purifiées.
Il en va de même à l’égard des kosha, gaines emboîtées qui forment selon le Vedānta, les cinq niveaux de l’être humain : à l’ordinaire on part du plan grossier puis on passe au souffle, à la pensée (manas), à l’intelligence mystique (vijñāna) et enfin à la félicité jusqu’à ce que le Soi (ātman) seul subsiste après s’être dépouillé de ses gaines. Mais dans ce système, le guru agit uniquement sur la gaine de félicité (ānandamayakosha) et celle-ci, inondant les autres niveaux, permettra de les rejoindre et de les intégrer.
Pour que passe le flot d’amour du Cœur universel — celui du guru — au cœur du disciple, il faut, dit-on, que celui-ci meure à lui-même ; ici le courant d’amour est précisément ce qui fait mourir à soi-même.
Le maître plein d’amour au cœur bien éveillé baigne perpétuellement, nous l’avons vu, dans la source originelle (bhandara) où sa conscience demeure immuable. Cœur, esprit, corps, tout en lui absorbe la Grâce. Il arrive à supporter une grâce intense qui flue sans cesse de lui comme un torrent. Mais ce pouvoir qui passe à travers lui est trop excessif pour [289] que le disciple puisse en tirer bénéfice. Le guru doit donc descendre à son niveau, ou presque, et le lui verser goutte à goutte. Si le disciple s’abandonne avec confiance à lui et s’immerge en lui, il finira par baigner sans discontinuer dans le même fleuve que son maître : alors ce que celui-ci expérimente se répandra automatiquement en lui.
Les maîtres de l’Inde transmettent la faveur divine de plusieurs façons : les uns par le toucher, ainsi Ramakrishna posant le pied sur la poitrine de Vivekānanda ; les autres par un coup d’œil, par la voix, par l’union sexuelle, par une étreinte ou encore en s’insinuant dans le souffle du disciple afin d’éveiller ses forces assoupies. Pour que le résultat soit durable et pour que le disciple acquière la maîtrise sur ses états, il est indispensable qu’une pure spontanéité préside à la transmission : le guru ne faisant aucun effort dans le désir de communiquer ses dons ni n’en exigeant de son disciple.
Un très grand maître transmet la grâce de cœur à cœur. Ici encore on peut noter une gradation : Un premier guru n’a plus de désir et demeure dans une paix et une félicité que rien ne trouble. Habile à capter les incitations divines, il attend l’ordre de Dieu pour agir et dès que le flot de grâce descend en lui, il pousse avec force son disciple. Ce dernier se sent comme précipité dans un océan et assimile avec difficulté ce qu’il reçoit. Un second maître, supérieur au premier, obéit aussi à l’ordre divin. Traversé sans interruption par de puissants courants spirituels, il agit sur son disciple sans effort ni intention quand l’occasion se présente. Un troisième guru se distingue par sa liberté souveraine : il ne dépend plus de courants spirituels ; en union profonde avec la grâce, il réside toujours en elle et la grâce en lui. Complètement englouti dans la divinité, tout ce qu’il fait est divin. À sa guise il transfert ce qu’il veut et à qui il veut. Ces deux derniers maîtres ne poussent pas le disciple, ils le transportent comme un père prend son enfant dans ses bras.
Le maître ne meurt pas sans avoir formé un maître capable d’assurer la transmission intégrale. S’il n’a pas de successeur, on ne peut le qualifier de maître complet. Donner le suprême adhikāra 391 signifie donc pour lui demeurer ici-bas puisque son pouvoir ne disparaît pas. Il suffit qu’un disciple ait renoncé à tout pour que le maître ait le devoir de lui transférer ce qu’il a reçu lui-même de son propre maître.
Le maître forme aussi des délégués (khalifa) aptes à transmettre paix et félicité à un très grand nombre de personnes et en diverses régions. Ainsi, selon la mission de chacun, il existe divers adhikāra, les uns partiels bien que suffisants, les autres complets, la grâce parfaite étant donnée à la fin à l’héritier du système. Ce dernier ne se donne jamais pour tel et [290] effectue sa tâche en silence. Celui qui se proclame successeur du maître n’est certainement pas le véritable héritier de la lignée.
L’adhikāra n’est pas une initiation, moins encore une cérémonie ; il se fait sans une parole, en une transfusion de cœur à cœur : le maître s’identifie à la suprême énergie résidant dans l’intime du cœur et source de toutes les vibrations. Ayant plein pouvoir sur ces vibrations extrêmement subtiles, il les emmagasine dans la personne du disciple et dans ses centres spéciaux, connus du système. Par ces vibrations le disciple sera purifié et pourra agir sur autrui.
Même sans recevoir l’adhikāra, un disciple bien absorbé en son maître, ou encore parce que celui-ci lui en a donné l’ordre, peut, lui aussi, servir d’intermédiaire. Il est également autorisé à donner un marakba 392 comme son guide, à la différence que le guru n’a pas besoin de s’immerger en son propre maître pour irradier la grâce puisqu’il réside toujours en elle, tandis que le disciple doit se perdre dans son guru comme une goutte dans l’océan. Bien que la goutte d’eau n’atteigne pas la profondeur de l’océan, elle ne peut pourtant plus en être extraite. Ainsi le disciple qui à ce moment devient semblable à son maître participe à sa puissance.
Il faut avoir longtemps vécu auprès de véritables maîtres et avoir fréquenté aussi des mystiques de tous ordres, d’occident et d’orient, pour savoir discerner des grands saints et jñānin, le sadguru doué de la science de la transmission ainsi que d’audace et de libre efficience.
Les saints constamment absorbés en une extase d’amour et de félicité, vivent en marge du monde et de ses soucis quotidiens : ils répandent la paix autour d’eux comme une fleur son parfum, et attirent la foule. Toujours immergés en eux-mêmes, ils ne sont pas revenus à l’état ordinaire afin de s’occuper activement de leurs innombrables disciples. Ils ont réalisé pour eux-mêmes, non pour autrui.
N’ayant pas eu de guru pour la plupart, ils se défendent d’être des maîtres. On les considère donc comme de vivants exemples plutôt que comme des sadguru.
Il existe aussi de très grands mystiques qui ne peuvent servir de guides, car les imiter serait se fourvoyer. Ainsi certain sūfī connu pour sa débauche et qui pourtant puisait à pleines mains dans le réservoir divin. Il possédait un pouvoir sans limite ; sa générosité et sa grandeur étaient telles qu’il échappait à tout interdit.
Le maître parfait (sadguru) diffère de ces sortes de mystiques : plein d’amour et de félicité comme le saint et non moins absorbé que lui, il est en outre très actif et jouit d’une liberté totale. Il a atteint, lui aussi, le faîte de l’illumination, mais a su revenir au plan inférieur après avoir (291) exploré à la suite de son maître toutes les étapes du chemin. Il peut communiquer la Connaissance parce qu’il en a la maîtrise. Ainsi formé durant des années par son maître dont il a reçu la barakah, il possède la science de la transmission et se consacre uniquement à un petit nombre de disciples choisis afin d’en faire des maîtres. À leur égard il se montre dur et exigeant en dépit de son immense bonté, ou plutôt à cause d’elle, et les force à brûler les étapes de l’austère chemin.
Il vit à même la Vie, en une libre et constante spontanéité 393 par-delà l’extase (samādhi). Une telle spontanéité s’exprime dans son être entier sa manière de donner, si aisée, avec un sourire indéfinissable ; le don lui-même, l’Amour. On la retrouve dans son comportement : il participe à toute chose avec chaleur et enthousiasme, mais sans s’y complaire marié, ayant des enfants, exerçant une profession modeste, il ne se distingue ni par le vêtement, ni par le nom, des gens du commun ; il se fait appeler familièrement oncle, frère, formant ainsi avec amis et disciples une grande famille.
Le disciple n’aura qu’à s’absorber spontanément en lui pour vivre en pleine Simplicité, au cœur de sa nature, se laissant désormais porter par elle. Le factice tombera alors de lui-même et — toute personnalité volatilisée — il découvrira la source intarissable d’amour et de félicité.
Lilian SILBURN. — Il est toujours difficile de faire comprendre les effets heureux de la vacuité. Je me demande si le processus photographique n’offre pas des analogies qui en éclaireraient bien des aspects. Par exemple, à la première entrevue, un vrai maître sait tout du disciple : c’est qu’au premier regard l’opacité du dis — ciple s’imprime directement sur sa conscience totalement vide comme sur une plaque photographique vierge.
Edouart BOUBAT. — Si j’osais, je dirais qu’au moment du déclic de mon appareil, je suis à ma façon aussi vide que la pellicule : le sujet que je photographie s’est emparé de moi sans préparation, et sans que se mêle aucun souvenir, aucun vouloir, sans la moindre projection de ma part. Cela se fait tout seul dans l’instant, en pleine spontanéité, quelque long qu’ait été l’apprentissage.
L. SILBURN. — Le vide est aussi précieux pour le disciple. S’il reçoit tout du maître à son premier regard, il lui faudra du temps pour devenir à son tour vide comme la plaque photographique, mais plus il est vide d’images, mieux il reçoit ce qui lui est transmis. Attention, il s’agit d’une vacuité vibrante, non d’un vide inerte.
E. BOUBAT. — Oui, une telle vacuité permet la percée de l’instant fugitif où tout baigne dans une seule et même lumière. C’est pourquoi le véritable artiste, peintre ou photographe, se reconnaît à ses fonds : chez lui, point de fond neutre, terne, indifférent. Le fond vibre avec le reste, car le premier regard est global, l’anecdote ne se détache pas du fond, tout est saisi dans la lumière vivante de l’ensemble.
Mais on peut encore développer la comparaison, ainsi rien de plus mystérieux que l’image latente. Après l’exposition le film reste le même apparemment. Bien qu’invisible, l’image existe avant d’être développée ; il faut donc exposer la feuille de papier sensible et la plonger dans le bain du révélateur pour que l’image apparaisse lentement comme par magie. De plus, si nous laissons cette feuille dans une boîte sans y toucher, elle peut être révélée des jours et même des années plus tard.
N’en est-il pas de même pour nous ? Ne portons-nous pas,
306
cachée en nous-mêmes notre image latente ? S’il est vrai que le premier regard du maître nous illumine, nous « expose », le disciple aura besoin de mois ou d’années pour développer cette lumière intérieure.
L. SILBURN. — Pourquoi pas ? Cela me fait penser en effet à un beau passage du Traité de Soufisme qui fait allusion au pacte intemporel1 :
« Abû Muhammad Ruwaym a dit ceci : “les soufis ont entendu leur première remémoration (dhikr) quand Dieu s’est adressé à eux en leur disant : « Ne suis-je point votre Seigneur ? ». Cela est resté caché au fond de leur être, de même qu’il a été engendré dans leur esprit. Et quand ils entendent invoquer Dieu, ce qui était latent au fond de leur être se manifeste et les secoue, de la même façon que ce qui était latent dans leur esprit s’est manifesté quand l’Être divin les en a informés… et qu’alors ils ont cru. »
Jeremy GENTILLI. — Plus j’y pense, plus il me paraît possible et intéressant de développer l’analogie dans le détail, en suivant les étapes techniques du processus photographique.
Robert BOGROFF. — Mais alors, faites-nous un exposé précis, autrement c’est sans intérêt.
J. GENTILLI. — L’obturateur de l’appareil s’ouvre un cinquième de seconde et laisse une quantité de lumière très précise pénétrer à l’intérieur du boîtier obscur où est cachée la pellicule sensible.
À cet instant, une image a été projetée sur la surface du film. La lumière a fait virer au noir ou au gris l’émulsion qui le recouvre, selon la quantité de lumière qui, pendant ce laps de temps, est entrée. S’il y en a trop, le film sera noir ; s’il n’y en a pas assez, l’image sera grise et imprécise.
La lumière est la clé de chacune des étapes du processus photographique ; c’est elle qui suscite, développe, et en fin de compte révèle l’image. Toute la suite des actes doit s’effectuer dans l’obscurité, une obscurité illuminée par un éclair de lumière.
La plaque sensible, mordue par la lumière, doit être développée et fixée. Une fois la lumière imprimée en négatif sur le film, celui-ci pourra faire apparaître le noir et le blanc sur l’image finale. Pour cela, la pellicule a besoin, à nouveau, de l’effet catalyseur de la lumière. A l’intérieur d’une chambre noire, un éclair de lumière est projeté à travers la pellicule sur une feuille de
Kalâbâdhi. Traduit de l’arabe et présenté par Roger Deladrière. Éditions Sindbad, Paris, 1981, p. 184.
307
papier sensible placée en dessous. Ce papier réagit en fonction de la quantité de lumière qui traverse la pellicule ; les endroits plus sombres filtrent davantage la lumière que les parties plus claires. De ce fait, l’image qui apparaîtra sur le papier présentera des rapports de tons inversement proportionnels à ceux qui se trouvent sur la pellicule : ce qui est sombre sera clair ; toutes les valeurs seront inversées ; de sorte que, l’image finalement développée sera la reproduction exacte, positive, de la lumière qui a pénétré dans l’appareil à l’ouverture de l’obturateur.
Le papier, cependant, reste blanc jusqu’à ce qu’il soit plongé dans la cuve de développement où il réagit lentement à une solution chimique, révélant magiquement en noir et en blanc l’effet de la lumière.
Quand les noirs et les gris sont à leur optimum de richesse, la photo, alors pleinement développée est retirée de la cuve et plongée dans un bain fixateur. Ceci, afin d’arrêter le processus chimique qui se poursuivrait à la lumière et brûlerait complètement l’image.
La lumière est la clé et la source du processus de reproduction photographique ; c’est la raison pour laquelle on peut voir une analogie avec le développement mystique en puissance dans tout être humain.
Le film sensible est dans l’appareil photographique comme un embryon. Ne pourrait-on pas dire que tout être humain porte, en négatif, la trace secrète de cette lumière divine, profondément enfouie en lui ?
Mais tous les négatifs ne donnent pas des photos. Le photographe choisit ceux dont il pourra tirer une bonne photo. De lui dépend la qualité du résultat : un mauvais photographe peut rater un bon négatif, un bon photographe tire le maximum d’un mauvais négatif.
Nous sommes simultanément un « négatif » touché par une « première lumière de Grâce », et une feuille blanche de papier sensible ; tous deux sont gardés dans la « chambre noire » de notre être. Les hasards de la vie, le tempérament, les données psychologiques font naître le désir de voir cette pellicule développée. La « seconde Grâce », c’est de rencontrer un maître capable de faire passer son amour unifiant à travers notre « négatif » jusqu’à la feuille sensible de nos virtualités. Ceci ne peut se réaliser que parce que son amour unifiant est identique à la lumière originelle dont nous portons la marque. Ensuite, comme le photographe, le maître nous plonge dans des états variés, afin de développer l’image latente imprimée sur la surface blanche de notre être. Alors, de même que la photo apparaît dans la cuve de déve ‑
308
loppement, miraculeusement, l’image vraie, positive, de la « première lumière » qui nous a touchés, se révèle.
Cette « première lumière », profondément cachée, repose dans chaque être humain. Cette « touche de Grâce », qu’elle soit Lumière, Parole, ou Esprit, est la vibration de la Source unique de tout amour. C’est le Covenant du Seigneur, la promesse de réalisation divine. C’est la « petite voix silencieuse de Dieu » ; comme la lumière qui a touché la surface sensible du film, elle touche notre cœur et le marque de façon indélébile.
Le désir conscient et inconscient suscité par cette promesse est comme le souvenir d’une chose perdue, et qui échappe toujours à notre compréhension. Ce souvenir obscur est plus fort chez cer — tains que chez d’autres. C’est l’aspiration à le retrouver et à le réaliser qui nous pousse finalement dans l’orbite de la quête mystique.
Tel l’aimant qui attire tout ce qui contient du fer, ainsi le maître spirituel, exemple de la réalisation vibrante de cette promesse, attire tous ceux qui comptent également que le Seigneur tienne sa parole.
Bien qu’elle soit cachée dans les épaisses ténèbres de notre cœur, la parole appelle la parole, le semblable son semblable, et dès le moment de notre naissance riche de cet héritage divin (our birthright), jusqu’à l’accomplissement lumineux, il n’y a qu’une ligne droite ; et cette ligne c’est la « Grâce de Dieu ».
La présence du maître fixe le souvenir de la parole enfouie. Comme la lumière pour le photographe, son amour unifiant tra — verse le négatif de notre souvenir de la parole de Dieu, et le déve — loppe ; il dissout l’opacité du disciple qui change peu à peu. Mais, celui-ci doit être dans les ténèbres pendant l’opération.
Quand la photo est complètement développée et fixée, la pro- messe a été tenue. Il n’y a plus de souvenir à retrouver. Alors, la photo témoigne à la vue de tous de l’accomplissement de la révélation.
R. BOGROFF. — Le jeu de l’analogie entre le processus photographique et l’évolution mystique peut même aboutir à un télescopage étonnant… Ainsi en est-il d’un grand maître sûfî dont l’objectif ne pouvait jamais saisir l’image. Il y avait toujours un blanc à sa place sur la photographie où l’on pouvait voir cependant tout son entourage. Rien en lui ne faisait écran à la lumière et la pellicule ne pouvait pas être impressionnée. Il se confondait totalement avec la lumière divine et quand on voulait saisir son image, il se révélait « invisible » : la chaise restait vide.
BIEN des observateurs avertis ont insisté sur la rupture opérée par le Tch'an avec le bouddhisme indien, relevant maintes formules, maintes notions taoïstes ou même confucianistes et soulignant le caractère nouveau et de plus en plus sinisé des méthodes employées par les maîtres. Que le Tch'an soit éminemment chinois (et le Zen, japonais) paraît à l’évidence et le présent volume en témoigne. Mais est-il pour autant une sorte de taoïsme démarqué ? Répondre par l’affirmative à cette question, n’est-ce pas méconnaître des aspects profonds du bouddhisme indien et méconnaître l’assimilation du bouddhisme par les Chinois dans son originalité ? Ne serait-il pas plus fécond de se demander pourquoi des Chinois qui étaient parfois des lettrés confucéens ou plus souvent des taoïstes avaient opté pour le bouddhisme ? Qu’est-ce donc, dans la religion venue de l’Ouest, qui les séduisait tant, et comment le génie chinois a-t-il pu si bien adopter la voie bouddhique qu’il l’a, à son tour, recréée sous la forme du Tch'an ?
Nous n’avons certes pas l’ambition d’apporter ici à ces questions une réponse en bonne et due forme, mais nous pouvons au moins fournir une base de réponse sûre en dégageant par des textes ces aspects profonds du bouddhisme indien ou au moins ceux qui se retrouvent dans le Tch'an ; ce sera l’objet du premier chapitre. Nous pourrons voir alors apparaître les traits fondamentaux d’une expérience commune et les particularités de sa mise en œuvre par l’école chinoise. Mais dès maintenant il convient de définir quelques notions essentielles et de situer les problèmes.
Le trait principal du Tch'an est son choix radical de l’expérience ultime et de la méthode la plus rapide pour y parvenir. Ce choix implique le rejet de tout le reste, en particulier des développements doctrinaux de toutes sortes et des pratiques élaborées dans lesquels se complaisaient d’autres écoles bouddhiques, en Chine aussi bien qu’en Inde. |14]
Mais ce choix, le Buddha l’avait fait le premier. Il avait rejeté tous les systèmes métaphysiques, toutes les Écritures qui prévalaient de son temps ainsi que tous rituels formalistes. Il avait trouvé la délivrance par son expérience personnelle et découvert les causes de l’esclavage douloureux auquel celle-ci met fin. Son enseignement ne concerna que le réel, l’expérience, l’efficience ; il montra le chemin de l’Éveil et rien que lui395.
Au cours des siècles, cet enseignement subit des interprétations systématiques et perdit sa sève.
Le renouveau du bouddhisme dans ce qui a été appelé le Grand Véhicule au début de notre ère et surtout à partir du IIIe siècle, est dû à des hommes qui surent retrouver l’attitude du Buddha, briser les cadres rigides, vivre pleinement l’expérience de l’illumination, réadapter la formulation et renouveler les méthodes. Tels furent les grands mystiques philosophes fondateurs des deux « ailes » du Mahâyâna, le Madhyamaka ou École de la Voie du milieu et le Vijfiânavâda ou Yogâcâra qui fait une subtile étude de la conscience et souligne l’importance de la pratique396.
Et tels furent aussi les maîtres du Tch'an, à cette différence près qu’au lieu de fonder de vastes systèmes, ils s’en tinrent à une expression abrupte, à dessein paradoxale et désarçonnante, leur génie étant plutôt orienté, à la chinoise, vers les méthodes pratiques.
Les maîtres tch'an sont des maîtres du dhyâna puisque tch'an-na est la prononciation chinoise du mot sanscrit. Ici aussi, la parenté avec l’Inde a été récusée et l’école chinoise présentée comme allant à l’encontre du dhyâna « à l’indienne ».
Le problème est d’importance, car il s’agit de la méthode même de l’école. Mais en quoi consiste donc le dhyâna ? Une recherche du sens vrai de ce terme amène à faire d’abord justice de quelques confusions. En effet, il a été défini comme une méditation ou une concentration [15] méthodique et par ailleurs on lui a reproché d’aboutir à une immobilité paralysante et au quiétisme. Or le dhyâna véritable n’est ni une « méditation » ni une simple concentration de la pensée, il relève du spontané bien plus que de la méthode et sa quiétude est la toile de fond de toute lucidité et de toute activité juste.
Peut-être la source de l’erreur réside-t-elle dans l’emploi du mot « méditation », malheureusement devenu courant aussi bien en anglais qu’en français, aussi bien dans un monastère Zen que dans les laboratoires américains où l’on enregistre des « méditants » et qui finit par s’appliquer à l’état intérieur éprouvé par quelqu’un qui s’assied en essayant de ne penser à rien ou de penser à une seule chose, ou en se regardant penser, ce qui n’est nullement du dhyâna et pas non plus de la méditation.
À strictement parler, la « méditation » est une réflexion profonde sur un sujet. Le mot était employé par les directeurs de conscience chrétiens qui proposaient à leurs dirigés des sujets religieux, et les mystiques chrétiens ont eu toutes les peines du monde à faire entendre qu’à partir d’un certain degré, on ne peut plus « méditer », qu’on doit alors quitter idées et représentations pour s’abandonner à l’état profond qui tend à s’instaurer spontanément et qu’il ne faut pas contrarier397.
.
C’est ici, au-delà de la méditation proprement dite, que l’on peut situer le début du dhyâna, état de conscience jusqu’alors inconnu qui fait accéder au domaine subtil d’une « intériorité » spécifique. Inutile d’essayer de le juger du dehors, on ne le connaît que par expérience, Le dhyâna n’est pas un exercice, il constitue un premier et très précieux accomplissement. Fruit du détachement, il se révèle imprégné de détente et de bonheur, vide de la pensée et des sentiments habituels, lucide sans trace de cogitation, libre sans trace d’effort : on le découvre comme un monde nouveau. Il est susceptible d’un approfondissement et le Buddha en distingue quatre degrés, décrits dans le récit de la nuit de l’Éveil398 [16]
Puisqu’il s’agit de quitter le plan de la pensée ordinaire et d’accéder à une nouvelle modalité de conscience, on comprend que le mot « concentration », dans la mesure où il suggère un effort et connote un projet, ne convient pas. Il serait plus juste de parler d’absorption et plusieurs auteurs emploieront ce mot tout en regrettant qu’il reste vague alors qu’il faudrait un terme technique ne prêtant pas à confusion. Finalement, le mieux est encore de garder le vocable sanscrit,399 mais, chaque traducteur étant libre de son choix, le lecteur pourra rencontrer ici même le mot « méditation », surtout dans les textes appartenant à l’ancien recueil.
Le domaine de l’intériorité comporte d’autres états, tels les samâdhi, et la même remarque vaut pour les termes qui les désignent.
.
Le dhyâna du Buddha sera analysé dans le premier chapitre de ce volume et l’on verra qu’il est étroitement associé au vide et à la sapience. Dans cette nouvelle modalité de conscience s’effacent les attachements multiples ainsi que les appuis habituels de la pensée, se dissolvent les structures rigides qui font obstacle à l’intuition. Par là s’instaure un vide qui va grandissant à mesure que s’approfondit l’absorption pour s’achever dans le nirvâna.
.
Mais le mot « vide » ou « vacuité » est une source d’erreurs plus graves encore que les précédentes ; elles déferlent de temps à autre et sont bien difficiles à dissiper. En effet, la pensée ordinaire ne peut que faire du vide un objet, un vide en soi, sans savoir jamais se dégager d’une interprétation négative aux antipodes de la vacuité vivante que précisément révèle l’expérience profonde. C’est ainsi que le système de Nâgârjuna, pour avoir mis l’accent sur sûnyatâ, la vacuité, est traité de nihilisme par ceux à qui échappe son aspect éminemment positif ; ils ignorent le détachement, l’élargissement de la conscience qui se met « au diapason de l’infini »400 et l’afflux de paix, de félicité, d’efficience sans lesquels le vide serait en effet stérile. Ils ne peuvent évidemment concevoir que, le devenir phénoménal cause de la douleur étant tari, ce qui apparaît est non pas un vide objectif, mais les choses « telles qu’elles sont ». [17]
Ceux qui cherchent une fixation ou un vide de la pensée dans une méditation immobile commettent une erreur analogue et tombent dans une vacuité sans issue.
.
Dès le bouddhisme ancien, il est clair que, loin de se réduire à une « méditation assise », le dhyâna influe peu à peu sur l’ensemble de la vie courante, remplaçant une pensée bornée et agitée par une conscience claire et pure, à la fois vigile et inaccessible aux remous de l’extérieur. Et c’est justement parce qu’il devient un fond durable que le dhyâna est si précieux.
Dans le Grand Véhicule, tous ces caractères se retrouvent et leur expression est plus développée. Le Bodhisattva porte le dhyâna à sa « perfection » (pâramitâ) :
« Qu’il marche, qu’il soit debout, assis, ou repose, qu’il parle ou fasse silence, il demeure constamment recueilli. Son état de recueillement ne le quitte plus… Avec ses amis ou ses ennemis, avec ce qui est agréable et ce qui ne l’est pas, avec les êtres nobles comme avec ceux qui ne le sont pas… il reste le même, il ne se montre ni condescendant ni frustré. Et pourquoi ? Parce que, pour lui, les choses sont comme vides de caractère propre, dépourvues de réalité, incréées, non-produites… »401
Le dhyâna conduit donc le Bodhisattva là où les choses sont non-nées et non-détruites selon le très subtil enseignement de l’anutpâdadharma dans l’École de la Voie du milieu qui tend à suggérer non une théorie, mais une très haute expérience. Les dharma (les choses) sont « tranquilles dès l’origine, non-produits, quiescents de par leur nature même ».
« Ils sont apaisés parce qu’ils sont du domaine de la Connaissance apaisée. » Mais rares sont les hommes capables de cette Connaissance : « Ceux qui savent que les dharma n’ont pas de nature propre sont des héros qui résident en ce monde en extinction complète, car ils vivent sans s’attacher aux attributs du désir ; ayant repoussé l’attachement, ils convertissent les êtres. »402
Dans ce vide peut donc jouer la Connaissance ou Sapience. Alors, les choses ou données sont perçues « telles qu’elles sont » (yathâbhûta), « c’est-à-dire non reliées entre elles et donc libérées des différenciations et des particularités qu’on leur impute erronément. Étant vides de nature propre, elles sont isolées, en soi, ab-solues (vivikta), pures, [18] insaisissables ; en ceci même consiste l’inconcevable profondeur de la perfection de sapience »403.
D’une description nécessairement ici trop rapide il faut au moins conclure que c’est en ne dissociant pas dhyâna, vide et sapience que l’on peut s’approcher au plus près du sens profond de chacun d’eux.
Les Chinois, surtout les Taoïstes, connaissaient déjà bien la vacuité et la tenaient en haute estime, car, selon le Lao-tseu,
« Le Tao est comme un bol vide
Qu’aucun usage ne saurait remplir
Insondable, il semble l’origine des dix mille êtres. »404
Sous un aspect qui leur était donc familier, le vide bouddhique proposait aux habitants de l’Empire du Milieu une véritable école de subtilité, de vision intuitive, d’accomplissement intérieur. Les maîtres du Tch'an accueillirent la leçon et surent la mettre en œuvre de façon originale et puissante.
Au dhyâna des hérétiques qui présente « trois sortes de défauts : l’attachement à la délectation, la vue fausse et l’orgueil »405, le Bodhisattva remédie en se consacrant tout entier au bien des êtres. Imprégné de paix, de félicité, de recueillement, d’équanimité, il peut accomplir toutes les œuvres, quelles qu’elles soient, nécessaires au bien des êtres : son acte fuse naturellement avec une justesse, une précision et une efficacité extraordinaire en chaque circonstance, car, loin de naître des conditionnements liés au karma, elle s’alimente à ce fonds infini.
Totale abnégation, compassion sans limite, conduite sans peur, connaissance sans défaut, activité inlassable, maîtrise profonde, mais en même temps spontanéité sont pour le Bodhisattva les fruits de la perfection du dhyâna. [19]
À travers les textes que nous avons choisis, il est aisé de mettre en évidence un aspect plutôt négligé et pourtant plein de sens pour la genèse du Tch'an. Bodhidharma, Tao-sin et Houei-neng décrivent en premier lieu ce qu’on pourrait appeler une voie brève ou un moyen direct et complet d’approche du but à l’intention de ceux qui peuvent se dégager des détails et des quêtes limitées pour ne s’adonner qu’à l’essentiel.
Le même propos, plus développé et en quelque sorte exemplaire, se lit dans le Sûtra de l’Éveil parfait406, l’un de ces beaux textes apocryphes qui apparurent en Chine vers les VIIe-VIIIe siècles, époque où justement se formait l’école du Tch'an. Dès le début du sûtra, le Tathâgata déclare qu’il possède une porte de la délivrance, l’Éveil parfait, d’où s’écoulent toutes les réalisations et toutes les perfections ; les bodhisattva l’atteignent en prenant appui sur sa « marque », c’est-à-dire ce que le non-éveillé peut en concevoir. C’est seulement sur l’insistance de ses interlocuteurs et comme à regret que le Tathâgata finira par exposer des méthodes moins élevées destinées aux moins ardents.
De façon parallèle, Bodhidharma, Tao-sin et Houei-neng décrivent d’abord un chemin direct : « la pénétration intuitive du Principe suprême » pour le premier, pour le second « l’absorption unifiante » grâce à laquelle « penser au Buddha » (nien fo) devient pour le disciple plein de foi une actualisation de sa nature de Buddha sans aucun recours à des pratiques accessoires. Pour Houei-neng il s’agit de la pratique de la « Grande perfection de Sapience » dans laquelle l’appui est sur la conscience (sin) et dont il reconnaît qu’elle s’adresse aux hommes « de racine supérieure ». Mais tandis que les deux patriarches anciens ne révèlent qu’avec une extrême discrétion la grande voie intuitive et ne dédaignent pas de proposer aux moins doués des moyens prenant des appuis plus proches, plus discernables tels que la conduite ou le corps et les organes sensoriels (sur lesquels il faut jeter un regard intuitif qui en discerne la vacuité), Houei-neng s’en tient là, il n’a pas de demi-mesures pour des demi-ardents, elles ne seraient pas efficaces.
Environ à l’époque où Tao-sin préconisait cette absorption profonde dite aussi samâdhi de l’unité, des maîtres de dhyâna d’autres écoles [20] proposaient des méthodes très élaborées comportant de multiples pratiques de détail dont chacune visait à obtenir une réalisation particulière selon une gradation savamment calculée407.
Les maîtres de la nouvelle école virent bien le côté négatif d’une telle systématisation, destructrice de la spontanéité indispensable à l’Éveil et à tout progrès réel. Ils comprirent l’obstacle supplémentaire que l’on crée en s’appuyant sur des notions limitées et des réalisations ponctuelles, en s’enfermant dans de nouvelles routines.
.
La tradition d’une voie directe, libre de tout accessoire, était donc là depuis bien longtemps, mais c’est à partir de Houei-neng que le Tch'an prit la tournure subitiste et radicale qui devait à juste raison faire sa fortune.
En effet, s’il existe un court chemin, c’est bien celui qu’il faut prendre. S’il existe un appui efficace, la « marque » ou le « signe » dont la pensée affecte en le nommant cela même qui échappe aux noms — l’Éveil, le Principe suprême, le Buddha — il faut s’y tenir et négliger les visées limitées. En réalité, le seul appui efficace est celui qui engloutit l’appui dans le sans-appui.
Si ce que l’on veut obtenir relève de l’instantané, de l’ineffable et de l’insaisissable, à quoi bon prétendre avancer au niveau du continu, de l’explicite, du mesurable ? Et comment chercher l’Éveil ? — l’Éveil, ce renversement total, ce bouleversement de la façon même d’être au monde qui pourtant n’efface rien, ne crée rien, ne change rien à la réalité qui n’a jamais cessé d’être « telle ». Alors que faire ? Rendre sensible l’ignorance, briser les attaches, essayer d’induire directement l’attitude de l’Éveillé. Ne pas craindre de brusquer les choses puisqu’il doit se produire une suppression de la conscience ordinaire, un retournement de la vision vers sa source.
Le Buddha guidait ses disciples pas à pas. Les maîtres tch'an en vinrent à pousser les leurs vivement jusqu’au bord de la falaise dans l’espoir qu’ils feraient le saut, lâchant d’un coup tous les obstacles en même temps que leur « moi ». [21]
sin et wou sin, nien et wou nien
tao
Que l’on soit ou non sinologue, si l’on veut approcher le Tch'an, il faut se familiariser avec quelques termes aussi essentiels pour l’expérience que pour la doctrine et que la traduction ne peut que trahir.
Sin est assurément l’un de ces mots-là, vraie pierre d’achoppement des traductions en langues occidentales, surtout en français. Il désigne le cœur, à la fois comme organe et comme siège de la pensée ainsi que des sentiments. Or, en français, si nous disons « cœur » nous excluons la « pensée » et inversement. Le mot « conscience » lorsqu’il s’applique à l’ensemble de nos facultés psychiques a une plus ample acception, il est le plus juste, mais d’un emploi parfois difficile. Ajoutons à cela que sin, comme nous allons le voir, peut avoir une dimension d’infini. La plupart des traducteurs retiennent « esprit », celui de Houei-neng a choisi « cœur ». Il faut se résigner à conclure qu’aucune traduction n’est satisfaisante et à prier le lecteur de garder en mémoire toutes les implications du terme.
.
Or il s’agit d’un terme-clé du Tch'an puisque ce cœur de l’être, fondement de toute la personne avec ses particularités, son conditionnement et ses limites est pourtant celui des Buddha, infini et immaculé, lorsque l’ignorance a disparu.
Ici s’articule tout le Tch'an. Ici tout est dit d’un seul mot :
Il faut obtenir won sin, la non-existence de cette conscience d’ignorant, de l’esprit ordinaire, de la pensée dualisante, du cœur lourd d’attachements, toutes ces expressions ne faisant que traduire sin. Wou sin obtenu, que reste-t-il ? Justement sin, cette fois dans son sens d’infini.
.
Le retournement au niveau du langage répond à un retournement dans l’expérience vécue, au niveau de la conscience profonde, que l’école indienne du Vijñânavâda décrit comme un « renversement du support » ouvrant sur l’Éveil. Désormais règne acitta (mot sanscrit morphologiquement analogue à wou sin), conscience libérée de la conscience ordinaire, empirique et dualisante408. [22]
Lorsque Houei-neng, ayant évoqué la Grande Sapience qu’il demande à ses disciples d’intérioriser dans leur cœur, lance le mot sanscrit « mahâ », « grand » et l’applique au cœur, c’est ce retournement, cette métamorphose qu’il espère les voir obtenir.
.
Suivant l’expérience au plus près, les maîtres tch'an emploient également et même plus souvent wou nien. Le caractère chinois comporte deux graphèmes : celui de sin et un autre qui suggère l’actuel, le présent ; l’ensemble désigne donc ce qui se passe dans la conscience à l’instant même, la pensée ou l’émotion du moment, généralement liée à l’apparition des événements. Lorsque le cœur et l’esprit ne sont plus troublés par le monde objectif, wou nien, disons en désespoir de cause « la non-pensée », est présente, la délivrance obtenue.
Comme il en est pour wou sin et sin, la non-pensée n’exclut que la pensée de l’ignorant ; la pensée fonctionne, mais autrement : elle ne papillonne plus et elle ne s’agrippe plus, elle ne fait plus mal, elle ne pèse plus, elle se révèle doucement au fond de ce cœur non-cœur puis s’envole aussitôt.
Et il en va de même pour l’action : wou wei, non-agir, est en fait l’activité libre, spontanée et parfaite.
.
Quant au mot Tao, le lecteur occidental ayant tendance à l’interpréter comme témoignant d’une influence taoïste, les traducteurs s’efforcent de lui trouver un équivalent français et disent tantôt la Voie, tantôt l’Absolu, tantôt la Réalité ultime, etc. Ici aussi, la traduction réduit la richesse de suggestion d’un terme que confucianistes, taoïstes et bouddhistes emploient tous et qui revêt des sens nombreux, profonds, qu’il ne saurait être question d’envisager ici. Quelques remarques peuvent suffire.
Le sens élevé que le Taoïsme a donné au mot explique son emploi par les bouddhistes. P. Demiéville, après avoir observé que « la Chine ne prit à l’Inde que ce qui lui convenait, ce qu’elle sentait pouvoir assimiler utilement » poursuit un peu plus loin en ces termes :
[Selon le Grand Véhicule] « l’absolu échappe à toute causalité comme à toute logique, et donc à toute expression discursive : il relève du silence et n’est accessible qu’à la seule expérience mystique. Or, ce genre d’absolu conçu comme une réalité indéfinissable, inexpressible, soustraite aux modalités relatives et aux oppositions logiques de la pensée profane, c’était lui aussi que la philosophie taoïste, bien avant l’arrivée [23] en Chine du Bouddhisme, avait appris à révérer sous le nom de Tao. Ce que la Chine retint du message bouddhique, ce fut donc essentiellement la doctrine du Grand Véhicule, cette dialectique de l’absolu qui éveillait des harmoniques dans la pensée chinoise »409.
L’ineffabilité du Tao, proclamée dès les premières lignes du Tao-tö-king peut être rapprochée du refus de nommer dont font preuve les bouddhistes en disant seulement « Ainsi-té » (tatha-tâ), formule également trahie par les traductions.
Concluons à une affinité, non à une influence, sans prétendre clore le dossier !
simple aperçu
Il est bien commode, mais presque abusif de parler « du Tch'an » à propos des débuts de l’école. Que l’on n’imagine pas une école fondée à une certaine date et qui aurait continué, inchangée, à travers les siècles. Il en va tout autrement. Sous la filiation traditionnelle de patriarches que le Tch'an s’est donnée et que les historiens contestent se cache, pendant plus d’un siècle, une réalité complexe et mal connue. C’est seulement sous les T’ang (618 à 907), mais alors très rapidement, que l’école s’affirma et se développa, gagnant bientôt le Tibet, la Corée, le japon. L’appellation unique de Tch'an, tard apparue, ne doit pas faire oublier qu’il s’agit de toute une floraison d’écoles dont certaines avaient un caractère fort modéré. Tsong-mi (780-841) en a dénombré une dizaine et il a analysé leurs doctrines. Les branches du Nord, dites « gradualistes », d’abord prospères, s’éteignirent et l’école du Sud, subitiste, se divisa bientôt en cinq « maisons » auxquelles deux autres s’ajoutèrent par la suite. Mais l’âge d’or était passé. De nouvelles orientations se dessinaient. Certaines « maisons » fusionnèrent et d’autres disparurent. Finalement, il reste de nos jours au Japon une école qui se réclame de Lin-tsi (Rinzai) et une autre, appelée en Chine Ts'ao-tong (Soto), issue de deux maîtres du ixe siècle.
.
Jan Yun-houa, présentant l’étude de Tsong-mi observe que « l’aspect radical du bouddhisme tch'an est souvent trop souligné » dans les [24] publications modernes « en raison de l’idéologie du Tch'an tardif »410. Le présent volume au contraire insiste par son apport nouveau sur les racines traditionnelles de l’école et sur ses débuts modérés, mais il faut mentionner en effet une évolution constante et rapide dans le sens de ce « radicalisme ».
.
La leçon venait de loin et cette évolution s’inscrit, au moins au départ, dans la ligne du Mahâyana. Le Buddha avait prêché de désagencer la production conditionnée qui enchaîne l’homme dans les lois du karma afin de parvenir au nirvâna, l’extinction du devenir. Le Grand Véhicule se situe d’emblée dans le but accompli : alors, l’ignorance éliminée, le devenir est nirvâna et il n’y a rien hors de l’Éveil. Le génie chinois pour qui le Tao est à la fois source et voie, ineffable transcendant et « mère des dix mille êtres » devait accueillir avec enthousiasme cette conception et lui donner un grand éclat, sensible dans les sûtra apocryphes et culminant dans le Tch'an.
.
Si tout est accompli, il n’est que d’ouvrir les yeux et tel est bien l’enseignement du Tch'an : le disciple doit VOIR son esprit foncier ou obtenir la vision de sa nature propre, « vision » étant entendu dans un sens que D. T. Suzuki précise ainsi : « La vision est un acte, un acte révolutionnaire de la part de l’entendement humain… (elle) est beaucoup plus qu’un regard passif, une simple connaissance obtenue en contemplant la pureté de la nature propre ; la vision, avec Houei-neng, est la nature propre elle-même, se manifestant dans toute sa nudité et jouant sans restriction. »411
Cet « acte révolutionnaire », nous le connaissons. C’est le retournement qui porte sur sin. L’esprit foncier ainsi « vu » est immédiatement présent.
.
À la faveur du double sens de ce terme plus haut mis en lumière, méthode et expression vont devenir de plus en plus radicales.
Les premiers maîtres préconisaient de calmer et de purifier l’esprit, ce qui impliquait un cheminement graduel. Voici qu’une méthode plus radicale est trouvée : il suffit d’éliminer d’un coup l’esprit (wou sin). [25]
Le maître emploie une dialectique paradoxale visant à enlever au disciple ses appuis de toutes sortes afin que se révèle l’esprit foncier. Ainsi fait Nieou-t’eou par exemple.
Tao-sin avait enseigné : « l’esprit qui considère le Buddha est le Buddha ». Bientôt les maîtres, à l’affût de tout ce qui peut servir de tremplin, proclament : « l’esprit est le Buddha », par où l’on peut entendre que tel est l’esprit de celui qui s’éveille. Mais répéter la même leçon ne produit pas un effet de choc, or il faut provoquer un choc puisqu’il y a quelque chose à briser et quelque chose à faire naître. Alors Ma-tsou : « l’esprit ordinaire est la Voie ». Tout l’art du maître réside, ce disant, dans une conviction d’Éveil ou une présence d’Éveil telle qu’il peut la communiquer.
Mais sur le plan de la doctrine, on ne peut rien dire désormais de plus radical. Par suite on verra Lin-tsi, toujours dans le but de déclencher la grande prise de conscience, avoir recours à la parole provocante ou brutale, au cri, au geste, aux coups. Et il inventera une autre manière de présenter la doctrine.
.
Si pourtant tout ceci ne suffit pas, que faire ? Il va falloir trouver d’autres moyens. De sorte que le Tch'an, qui avait d’abord éliminé les préalables et les pratiques, va avoir à en trouver lui-même. Alors naissent ou se développent des techniques : le koan, le houa-tou, le jeu des rapports entre l’hôte et l’invité, etc. Ici, le Tch'an s’éloigne vraiment du bouddhisme de l’Inde et se rapproche au contraire des antiques conceptions chinoises. Dans ces jeux de dépassement des opposés par exemple, « la terminologie symbolique était chinoise, et l’allure scolastique des commentaires trahissait l’influence des spéculations néo-confucéennes » (N. Vandier-Nicolas).
Par ailleurs, l’école ayant acquis sa propre ancienneté cite moins les sûtra et davantage les recueils de dits et d’entretiens de ses propres maîtres. Le travail porte à présent sur ces paroles des maîtres tch'an et sur les commentaires de ces paroles, etc.412 Finalement le Tch'an n’échappe pas plus aux textes qu’aux méthodes, mais ce ne sont pas les mêmes. [26]
Quoi qu’il en soit, il faut bien reconnaître que les maîtres du Tch'an ont excellé dans les techniques d’élimination et d’éclatement. Ils ont su découvrir la valeur du geste et de la parole inattendus, inventés sur-le-champ et inspirés par un discernement aigu. Ils ont fait preuve d’une ardeur, d’une vitalité et d’une ingéniosité extrêmes. Surtout ils n’ont jamais perdu de vue que l’essentiel est l’Éveil. En parler ne sert à rien, à moins que tel mot, dans telle circonstance, bousculant la pensée et jetant bas ses structures, n’ouvre une issue. Ces mots-là, le Tch'an les cherche et les apprécie.
.
Le Tch'an s’est si bien intégré dans la civilisation chinoise, et le Zen dans la civilisation japonaise, qu’ils ont influé, de façon parfois spectaculaire, sur tous les aspects de la vie et de la culture, poésie, calligraphie, peinture, arts martiaux, art de vivre enfin, mais pour en traiter il faudrait un autre volume et peut-être risquerions-nous de perdre un peu de vue la source.
.
Pour terminer, c’est à cette source qu’il convient de faire retour, car la légende de l’origine du Tch'an est peut-être sa plus grande vérité. Elle remonte au « Grand Silencieux ». Elle est bien connue, mais nous la rappellerons brièvement. À une foule assemblée sur le Pic des vautours, le Buddha aurait montré une fleur et personne ne comprit sauf Mahâkayapa qui simplement sourit. Alors le Bienheureux lui transmit directement — en dehors des Écritures — l’Œil du vrai Dharma et la Porte d’accès subtile.
Un maître japonais moderne, Isshû Miura, a écrit ceci :
« L’expérience du kensho [voir sa propre nature] a été transmise directement à partir du Buddha Sàkyamuni tout au long des générations successives de patriarches jusqu’aux hommes d’aujourd’hui au moyen de la “transmission de l’Esprit par l’esprit”. Aussi longtemps que l’expérience du kensho continuera à être ainsi transmise de génération en génération, le Zen ne disparaîtra pas, qu’il existe ou non de grands temples et de grands monastères. »413
INTRODUCTION 27
La transmission directe en silence, dans l’instant, jaillie du Cœur de l’Eveillé, est bien la grande, la vraie méthode, celle qui éclipse les autres et que l’on appellerait plus justement non-méthode.
.
Méthodes pratiques on non-méthode, textes témoignant des deux, car ils décrivent surtout la vie des maîtres (leur Éveil, leur présence, leurs gestes et leurs dits, leurs silences), voilà ce qui caractérise le Tch'an, hors de toute spéculation. Mais s’ils ont besoin d’une justification doctrinale, les maîtres ont volontiers recours aux sutra anciens et s’ils n’en retiennent que ce qui leur convient, ce qui leur convient est le cœur même du bouddhisme : l’efficience ou la sapience qui fuse dans l’instant, « la conscience non établie » ou la non-pensée, la saisie simultanée de l’extinction (nirvâna) et du devenir (samsâra) quand les signes qui ordinairement distinguent, définissent, opposent les choses (laksarta) « surgissent sans inconvénient sur le fond indifférencié ». Et ce cœur du bouddhisme coïncide avec le Réel ultime, hors de toute définition et de tout nom, que l’on parle (si l’on tient à parler) de Dharma en sanscrit ou de Tao en chinois.
Marinette BRUNO
De l’expérience fondamentale à laquelle tous les maîtres semblent se référer il ne sera donné ici à dessein que quelques points de repère simples et clairs en liaison avec la conscience ordinaire.
Au départ le triple aspect de la vie instable et douloureuse des hommes :
– la conscience empirique, à double pôle (ou dualisante), citta englobant sentiments, impressions, idées et que marque l’intentionnalité,
– la connaissance conceptuelle discursive qui porte uniquement sur les signes distinctifs (laksana, nimitta) en ce sens qu’on ne définit (cerne) une chose que par ce qu’elle n’est pas, par ce qui la distingue des autres choses sans qu’on puisse la saisir en elle-même, en son être réel, ici présent,
– le flux perpétuel ou « devenir » — le samsāra — écoulement phénoménal auquel on ne peut échapper.
.
Qu’est-ce qui arrache à cette condition ?
— le dhyāna, en apaisant la turbulence de la conscience empirique, puis en y mettant un terme ; ainsi s’obtient acitta, absence de pensée intentionnelle dualisante,
— la prajñā, connaissance dont le jaillissement élimine les signes distinctifs et qui par une percée intuitive pénètre jusqu’à l’essence. Toutes les caractéristiques une fois disparues, se révèle l’animitta,
– le nirvāna, l’extinction, arrêt définitif de l’écoulement phénoménal (samsāra), de la conscience empirique et des caractères distinctifs dont elle est inséparable.
.
La disparition soudaine de la conscience empirique et conceptuelle entraînant tout le devenir est un événement majeur que le Grand [71] Véhicule décrira plus tard comme un « effondrement du support » (āsrayaparāvrtti).
Tout est accompli pour l’arhat, le saint qui a su éviter les pièges que sont la méditation stérile (celle qui sera inlassablement condamnée par le Tch'an) ainsi que toute spéculation aussi subtile soit-elle, sans tomber dans un vide inconscient.
.
Cette expérience, éminemment positive pour le saint du Petit Véhicule, est considérée plus tard par le Bodhisattva du Grand Véhicule comme incomplète par rapport à la Réalité totale, la dharmatā (la « nature foncière » pour les maîtres chinois) qui embrasse tout sans rien rejeter. L’adepte du Mahāyāna cherche donc et obtient un retournement du support qui identifie nirvāna et samsāra. C’est le Grand Éveil.
Si déjà le nirvāna est inconcevable, que dire de ce paradoxe : la Réalité ou nature originelle se révélant en tout son éclat sans faire obstacle au fonctionnement des organes intellectuels et sensoriels !
.
Mais que se passe-t-il alors par rapport aux trois aspects qui ont été distingués plus haut ?
– Les phénomènes conscients propres à citta ne sont plus incompatibles avec acitta, d’où le thème citta-acitta et le célèbre wou nien du Tch'an, ce vide de pensées qui n’est autre que la plénitude de la nature foncière.
– Les signes distinctifs (laksana, nimitta) apparaissent et disparaissent sans laisser de traces, engloutis dans « le Tao [qui] coule librement »415.
Ces signes surgissent sans inconvénient sur le fond indifférencié (nimitta-animitta) tandis que la sapience (prajñā) douée d’efficience fulgure à travers toutes les distinctions, toutes les expressions verbales. Houei-neng a un raccourci saisissant à propos de cette réalité :
« Nature réelle et signes distinctifs sont l’Ainsité. »416.
– Quant au nirvāna : il n’y a plus arrêt définitif dans une extinction totale, mais non-demeure, aniketa. « Le Tathāgata ne voit pas le samsāra et ne voit pas le nirvāna. »
En ceci consiste l’agir dans le non-agir, l’activité efficiente, spontanée et libre jaillissant d’une Réalité foncière paisible, impassible, sans allées ni venues, mais dans une extraordinaire simultanéité. [72]
I citta nimitta, laksana samsāra
II dhyāna et acitta prajñā et animitta nirvāna
Dharmatā, dharmadhātu ou nature foncière se révèle
III citta sur fond nimitta sur fond apratisthāna
d’acitta d’animitta ou aniketa la non-demeure,
le sans-appui.
Le « Nuage d’inconnaissance » est d’un auteur anonyme, moine probablement qui vivait en Angleterre vers le milieu du 14e siècle.
Ce court traité est l’un des plus profonds de la mystique chrétienne et pourtant il est à peine connu en France et n’a pas la place qu’il mériterait dans la littérature religieuse.
II s’apparente étroitement par l’esprit et la méthode aux chefs-d’œuvre de saint Jean de la Croix qui lui sont postérieurs. Comme eux aussi il s’adresse aux contemplatifs qui cherchent à atteindre les sommets de la vie spirituelle, c’est-à-dire l’union mystique par la voie étroite du dénuement et de l’amour.
Ces contemplatifs ne sont nullement des savants ni des théologiens adonnés à la science et qui aspirent à la claire vision de Dieu puisqu’on ne peut jouir de cette vision en cette vie. Le nuage d’inconnaissance n’est qu’à l’intention des âmes humbles qui aspirent uniquement à suivre la voie de l’amour, cet élan direct du cœur vers Dieu et vers Dieu seul.
Ce nuage d’inconnaissance est un symbole particulièrement bien choisi pour exprimer l’expérience mystique dans tout son dénuement. Ce nuage qui s’interpose entre l’âme et Dieu et obscurcit la connaissance que l’âme pourrait avoir de Dieu rappelle la « divine obscurité » et la connaissance obscure par agnosie d’un saint Denys l’Areopagite et offre encore des points remarquables de similitude avec « la nuit obscure » de Saint-Jean de la Croix.
Ce nuage est l’oubli de notre activité cognitive et le renoncement aux lumières surnaturelles ; car la vie spécifiquement mystique ne consiste pas pour l’auteur de ce petit livre en une claire considération de quelque objet qui se situerait au-dessous de Dieu quelque savant et favorable qu’il soit, comme la méditation sur les perfections divines, les dons de Dieu, les saints ou les béatitudes ; elle ne consiste pas non plus en un mouvement aigu de l’intelligence ni en curiosité d’esprit ou en imagination parce que « tout ce à quoi tu penses cela est au-dessus de toi pendant ce temps et entre toi et ton Dieu » (p.32). Par contre plus valable en soi et plus plaisant à Dieu est cet aveugle élan d’amour vers Dieu en lui-même et « un tel et secret empressement en ce nuage d’inconnaissance ». La raison en est que « l’amour peut en cette vie atteindre Dieu, mais la science point ».
Il est donc possible selon l’auteur sans vue, ni lumière, ni connaissance, en un élan d’amour que sans cesse Dieu suscite dans notre volonté.
C’est en ceci précisément que consiste l’œuvre dont l’auteur donne une description extraordinaire, car c’est la seule fois à ma connaissance qu’un mystique insiste autant sur la. brièveté et l’instantanéité de l’œuvre c’est-à-dire de ce très court élan qui mène vers Dieu. Ce n’est pas une prière qui dure et s’alanguit, mais un élan dont l’intensité s’accroît sans cesse parce qu’il reprend et se renouvelle. Comme le dit si bien l’auteur du nuage d’inconnaissance : « ce n’est pas un long temps que réclame cette œuvre pour son réel achèvement. C’est en effet l’opération la plus brève de toutes celles que puisse imaginer l’homme. Jamais elle ne dure plus ni moins qu’un atome lequel atome… est la plus petite partie du temps » et cet atome est la juste mesure de la volonté. Ce mouvement de la volonté est précisément ce que l’auteur appelle le « pieux et humble aveugle élan d’amour ». À l’aide de la grâce, tous les mouvements d’une âme qui serait parfaitement pure convergeraient vers le souverainement désirable et aucun n’irait se perdre vers les créatures.
En ces conditions il nous paraît que les conseils que donne ce moine ne sont pas seulement utiles aux âmes qui ont effectivement renoncé au monde et vivent dans un cloître, mais qu’ils sont aussi à la portée de tous ceux qui se sentent portés vers la vie contemplative, car s’il est indubitable que les longues oraisons sont incompatibles avec les multiples occupations de la vie journalière, ce bref élan du cœur et de la volonté qui est apte à se renouveler parce qu’il est amour peut très bien par contre accompagner une vie active dans le siècle. En effet pour que cette œuvre s’accomplisse nous dit l’auteur « un rien de temps suffit ». « Ce n’est qu’un brusque mouvement et comme inattendu qui s’élance vivement vers Dieu, de même qu’une étincelle de charbon. Et merveilleux est-il de compter les mouvements en une heure se faire dans une âme qui a été disposée à ce travail. Et pourtant il suffit d’un seul mouvement entre tous ceux-là pour qu’elle ait soudain et complètement oublié toute choses créées. Mais sitôt après chaque mouvement, par suite de la corruption de la chair, c’est la chute dans quelque pensée ou action exécutée ou non. Mais qu’importe ? Puisqu’aussitôt après il s’élance de nouveau aussi soudainement qu’il l’avait fait avant. d’elle ; (p. 29-30).
Cet élan suffit pour unir à Dieu. Mais à certains il convient de « l’avoir comme plié et empaqueté dans un mot » afin de mieux s’y tenir et ce mot doit être bref, « Dieu », « amour » par exemple ; c’est avec ce mot qu’il nous est conseillé de frapper à coups redoublés sur le nuage d’inconnaissance et de rabattre toute manière de pensée « sous le nuage d’oubli », car à côté de ce nuage obscur qui se trouve entre l’âme et Dieu, l’auteur distingue un autre nuage « qui serait cette fois-ci non plus au-dessus de l’âme, mais au-dessous d’elle ; nous avons là le nuage d’oubli qui s’interpose entre elle et les créatures.
Ainsi le nuage d’inconnaissance est le symbole original dans lequel s’exprime l’expérience vécue du moine en sa double nudité : nudité intérieure totale à l’égard de la connaissance de Dieu, ce « Dieu immense et profond » de saint Jean de la Croix qu’aucune vision ou révélation ne peut traduire et dénuement intégral de toute chose, oubli parfait et de soi-même et des autres.
Le travail et l’effort qui reviennent à l’âme sont en effet de fouler aux pieds le souvenir de tout ce qui n’est pas Dieu et de perdre « toute idée et tout sentiment de son être propre ». (p.137).
Bien avant St Jean de la Croix, ce moine anonyme du XIV° siècle décrit encore un autre aspect de l’obscurité qui rappelle la nuit obscure du Saint. Il la nomme « l’affliction parfaite qui sert à purifier l’âme ». « Tu dois prendre en dégoût tout ce qui se fait en ton intelligence et en ta volonté, à moins qu’il n’y soit que Dieu seul. Parce que tout ce qui est autre, assurément quoi que ce soit, cela est entre toi et ton Dieu, rien d’étonnant que tu le détestes et haïsses de penser à toi-même quand il te faut toujours avoir sentiment du péché, cet horrible et puant bloc massif de tu ne sais pas quoi, lequel est entre toi et ton Dieu/cette masse pesante qui n’est point autre chose que toi-même ». (p.138).
Cette œuvre qui paraît si ardue au début deviendra facile parce que par la suite c’est Dieu qui voudra travailler seul, mais alors qu’on laisse cette œuvre agir en nous-mêmes et nous conduire où elle voudra sans nous y mêler par crainte de tout embrouiller. Qu’on devienne aveugle durant ce temps en rejetant tout désir de connaissance qui serait plus un obstacle qu’une aide « qu’il te suffise pour toi de te sentir mû et poussé par cette chose que tu ne sais pas quoi et dont tu ne sais rien sinon que dans ce tien mouvement tu n’as aucune pensée particulière pour aucune chose au-dessous de Dieu et que cet élan nu est directement dirigé vers Dieu. » (p.114)
Comme saint Jean de la Croix l’auteur du « Nuage d’inconnaissance » dit nettement que l’œuvre de Dieu en nous est passive et surnaturelle et que l’initiative de l’âme active et naturelle amènerait à éteindre l’esprit. Mais nous n’en saurons pas plus sur cette œuvre divine ni sur l’illumination qui perce parfois le nuage d’Inconnaissance ni sur l’embrasement d’amour qui en résulte, l’auteur ne pouvant ni ne voulant en parler, car sa tâche se limite à décrire l’œuvre propre de l’homme qui est attiré et aidé par la grâce.
La façon toute savoureuse, vivante et ingénue dont l’auteur fait part de ses conseils et de ses expériences est admirable par sa simplicité et sa nudité ; le lecteur n’y verra exposées et discutées que des choses essentielles, indispensables et suffisantes qui témoignent précisément de sa grande expérience spirituelle. C’est ce qui fait la valeur de ce court traité et en rend la lecture si attrayante.
Jean-Pierre Bacot
« Si l’on se livre à une recherche sur la toile pour trouver des références sur une revue dénommée Hermès, on tombera d’abord sur une publication du Centre national de la recherche scientifique(CNRS), née en 1988, qui s’occupe d’étudier de manière interdisciplinaire, avec cependant une dominante sociologique, l’univers de la communication.
« Mais ce qui nous intéresse ici est bien plus difficile à dénicher sur la toile, comme chez les bouquinistes. La première occurrence de ce titre date de 1933. Jusqu’à 1939, en trois séries, nous dit le catalogue de la Bibliothèque nationale de France (BNF), onze numéros de la revue Hermès ont été publiés avec une périodicité trimestrielle, sous la rédaction en chef d’Henri Michaux. D’orientation « méta surréaliste », la revue était dirigée par René Baert et Marc Eemans. On trouvait également dans la rédaction : Camille Goemans, Joseph Capuano, Mayrisch Saint Hubert, André Rolland de Renéville, Bernard Groethuysen, Étienne Vauthier. Parmi les rédacteurs, figuraient notamment Jean Wahl, Marcel Decorte, Henri Corbin. La revue s’intéressait principalement aux mystiques de tous bords.
« Le titre reparut en 1947, pour une quatrième série, sous la direction d’André Rolland de Renéville, puis pour une cinquième, de 1963 à 1970, sous la houlette de Jacques Masui, chez Fata Morgana. La revue était sous-titrée, pour cette dernière occurrence qui nous intéresse particulièrement ici, « Recherches sur l’expérience spirituelle ». Cette mouture d’Hermès, aujourd’hui bien oubliée et très rarement citée, fut conçue à Lausanne et diffusée en France par Véga, puis Minard. Sous réserve de trouvaille ultérieure, il semble que l’annonce d’une parution semestrielle se soit traduite en réalité par une publication annuelle.
Le premier numéro, sorti au printemps 1963, comportait notamment un article d’Henri Corbin. Dès le deuxième, les stars de ce milieu protéiforme étaient au rendez-vous, avec Marin Buber, Teilhard de Chardin, René Daumal, Hermann Broch, William Haas, Henri Michaux. Le cinquième numéro (1967-1968) fut consacré à « La Voie de René Daumal du Grand Jeu au Mont Analogue ». René Daumal (1908-1944), mi-universitaire, mi-autodidacte, fut dans sa brève existence un passionné de philosophie indienne. Proche de Georges Gurdjieff, il fut aussi un lecteur de René Guénon, ce qui le conduisit à apprendre le sanskrit. Le septième et dernier numéro, paru en 1970, fut consacré à des textes chinois et japonais. Aussi prestigieuses qu’aient été les collaborateurs et les conseillers (parmi lesquels figuraient Jean Grenier, Henri Michaux, Jean Paulhan et Mircea Eliade), la revue s’éteindra après ce numéro, ce qui montre que le public de cette sensibilité spiritualiste érudite n’était pas aussi important qu’on pouvait le croire, en tout cas à ce niveau d’exigence. On se souviendra que Planète de Louis Pauwels et Jacques Bergier (1961-1972), pourtant davantage vulgarisateur, n’a également pas pu s’installer durablement dans le paysage éditorial, malgré un succès qui ne fut en fait qu’une mode passagère.
“Le premier paragraphe du manifeste reproduit au dos des numéros est particulièrement éclairant du projet éditorial de Jacques Masui et de ses amis : « Un des faits marquants de notre époque est, indubitablement, la réévaluation de la réalité spirituelle. Cette ré estimation n’est pas seulement intellectuelle ; elle touche aux fibres les plus intimes de l’être. Elle entraine avec elle un besoin croissant de reprendre contact avec une réalité intérieure que beaucoup avaient oubliée, tandis que se développait la pensée discursive. Nous entrons dans un temps où l’expérimentation spirituelle s’impose avec une exigence accrue ».
“Jacques Masui fut également le fondateur d’une collection, “Documents spirituels”, publiée à partir dès 1953 aux Cahiers du Sud, puis chez Fayard.Marcel Lobet nous indique qu’Henri Michaux a dit de lui, son ami, qu’il était un “frère à la recherche des grands frères de par le monde et de leurs secrets qu’il importe de divulguer, en faveur de ceux qui attendent”.
“Après le décès brutal de Jacques Masui en 1975, Mme Merck, collaboratrice et héritière, et Roger Munier, tentèrent de reprendre le flambeau, mais il fallut semble-t-il attendre 1993 pour voir paraître chez Fata Morgana une collection d’ouvrages consacrés aux recherches sur l’expérience spirituelle. Une vingtaine d’opus sont, depuis lors, sortis de presse dans cette série entre 1993 et 2001, sous la signature de Gabriel Bounoure, Olivier Clément, Henri Corbin, Alain Daniélou, François Daumas, Benjamin Fondane, Jean Granier, Marcel Griaule, Louis Massignon, Jacques Masui, Jules Monchanin, Roger Munier, Andrès Padoux, Salah Stétié.
“D’autre part, les numéros 1 (“Les voies de la mystique ou l’accès au sans-accès”) de la revue Hermès de Jacques Masui (1963-1970) ; 3 (“Le maître spirituel selon les traditions d’Occident et d’Orient”) ; 6 (“Le vide, expérience spirituelle en occident et en orient” de Lilian Silburn) et 7 (“Tch’an Zen racines et floraisons” de Lilian Silburn) ont été repris en version augmentée aux éditions des Deux Océans entre 1989 et 2010.
“Cette publication n’est donc pas tout à fait oubliée pour qui voudrait bénéficier d’un large panorama de ce qui tenta, dans le mode foisonnant des revues, de réenchanter le monde au moment où la croyance et les pratiques religieuses, ainsi que les clergés, s’écroulaient, créant un véritable appel d’air pour celles et ceux qui ne se résolvaient pas à vivre le désenchantement du monde.
“(Je remercie vivement Rainer Mason d’avoir attiré mon attention sur cette publication).”
[1933-1939] PREMIÈRE SERIE419
“Pour
celles et ceux que cela intéresse, trouvé sur le site
de Marc Eemans de l’université catholique de
Louvain :
« https://marceemans.wordpress.com/bibliografie/hermes/Hermès,
“Le
sommaire de trois séries de cette revue Hermès.
L’enquête continue…
[Série 1.1]
n° 1,
juin 1933 [70 p.]
[Camille Goemans], Note des Éditeurs,
Marc
Eemans, Présentation de Sœur Hadewych,
Sœur
Hadewych, Première Vision,
Friedrich Gundolf, Stefan
George et notre temps,
Jean Wahl, Kierkegaard et le
Mysticisme,
Georges Méautis, Les mystères
d’Eleusia et la science moderne,
Jacques Masui, Note sur
le Yoga et la mystique,…
Note(s) : Achevé d’impr.
le 6 juin 1933.
n° 2, décembre
1933 [70 p.]/« Ruusbroec »
Willem
[Lodewijk] de Vreese Le Rayonnement de Ruusbroec,
Pomerius,
Pages de la vie de Ruusbroec,
G. De Deken, Rencontre de
Ruusbroec,
O. Dewette, Comment lire Ruusbroec,
Marcel
Lallemand, L’orthodoxie de Ruusbroec,
Bossuet, Les Erreurs
de Ruusbroec,
Marcel Decorte, La tonalité dit mysticisme
de Plotin,
Ibn Al Faridh, Poème mystique,
Marcel
Lallemand, Notes sur l’histoire occulte du Moyen Age.
Trad. :
Emile Dermenghem et Abdelmalek Fara (Ibn Al Faridh).
Ill. :
Emile Van Balberghe (ex-libris d’après Félicien
Rops),…
n° 3, mai 1934 [88 p.]
[Camille
Goemans], Note des Éditeurs,
J.C.G. [C.G.], Notes sur la
Poésie et l’Expérience,
André Rolland
de Renéville, L’Expérience Poétique et
l’Expérience mystique,
Marcel Decorte, Relations
entre la Poésie et la Mystique,
Jacques Masui, La Poésie
et l’inituition du Réel,
Jean Wahl, Poèmes
commentés,
John Middleton Murry, Pour racheter les
contraires,
William Blake, Poème,
Étienne
Vauthier, Note sur Coleridge,
A.E. [George Russell], Le Pays
Diapré,
Karel Van de Woestijne, Poème,
Urbain
Van de Voorde, Karel van de Woestijne et le Tourment de Dieu,
René
Baert, Hölderin ou la Mission du Poète,
Marcel
Lecomte, Esquisse du sentiment de la poésie chez Hugo
von Hofmannstahl (p. 71-78),
Notes critiques et
comptes rendus.
n° 4, mars 1935 [80 p.]
Marcel
Decorte, Du symbolisme en Métaphysique,
Marc Eemans,
Figure symbolique,
Étienne Vauthier, Destinée du
Symbole-Image,
Jacques Masui, Illustration et mesure du
Symbole,
Jean Wahl, L’Idée de Symbole,
René
Baert, Le sentiment de l’angoisse dans l’œuvre de
Maeterlinck,
Denis de Rougemont, Mystère de la
Vision,
André Rolland de Renéville, Sur la
Doctrine d’Edgar Poë,
Emile Dermenghem, Du Symbolisme
Bachique dans la Mystique Musulmane,
Franz Hellens, Introduction
à quelques poèmes inédits de Charles Van
Lerberghe,
Charles Van Lerberghe, Petits poèmes
inédits,
Jean de Bosschère, Lettre sur Max
Elskamp,
J.C.G. [C. G.], Notes sur la poésie et
l’expérience,
Notes critiques et
bibliographiques/Comptes rendus.
Note(s) :
– André
Rolland de Renéville, Swedenborg et les lettres françaises
[repris in A. Rolland de Renéville, Sciences maudites &
poètes maudits, Le Bois d’Orion, 1997,
p. 131-157
[Série 1.2]
n° 1,
janvier 1936 [114 p.]
Étienne Vauthier, Poètes
métaphysiciens et métaphysiciens poètes,
Thomas
Traherne, Poèmes,
Emile Dermenghem, Quelques thèmes
de poésie métaphysique dans les littératures
musulmanes,
André Rolland de Renéville,
Considérations sur Mallarmé,
Marcel Decorte,
Poésie et métaphysique,
Marc Eemans, La poésie
du feu,
René de Prat, Un poète de la tradition
sacrée, O. V. de L. Milosz,
René Baert,
Aspects du désespoir chez Leopardi et chez Rilke,
Clovis
Hesteau de Nuysement, Poème hermétique (introduction et
commentaire par Albert-Marie Schmidt),
Denis De Rougemont, Forme
et transformation, ou l’acte selon Kierkegaard,
A.D.
Gurewitsch, Fragments (introduction par Bernard Groethuysen),
John
Middleton Murry, Métaphysique de la poésie,
Marcel
Lecomte, De l’émotion optique dans un poème de
Paul Van Ostayen (p. 103-105),
Notes
bibliographiques/Memento.
Trad. : Jean Wahl (T. Traherne),
Mme S. G. (A.D. Gurewitsch), Mme V. V. (J.
Middleton Murry).
Note(s) :
– Thomas Traherne
(1636/1637-1674)
– Paul André van Ostaijen
(1896-1928), poète et essayiste flamand, a fondé la
revue Avontuur (1928).
n° 2, juin 1936 [120
p.]
Hermann de Keyserling, Du Verbe créateur,
Jean
Wahl, Magie et Romantisme,
Emile Dermenghem, Mortelle
poésie,
André Rolland de Renéville, La
Métaphore, arcane magique,
Albert-Marie Schmidt, Ronsard
et la Magie,
René Baert et Marc. Eemans, Histoire
merveilleuse du magicien Virgile,
G. Le Floch, Les grandes
traditions magiques de la paysannerie française,
Paracelse,
De l’Imagination, de son paroxysme et des voies qui y
conduisent,
Marcel Decorte, Connexions et oppositions de la
Poésie et de la Magie,
M. Salberg, La Magie du
spectacle,
Victor-Emile Michelet, Vertu magique de la
Poésie,
René Galland, Poèmes inédits
de H. Vaughan,
Marguerite La Fuente, Yoga Tibétain
et la Doctrine Secrète,
Pierre Leyris, Tchouang
Tseu,
Notes Bibliographiques.
Note(s) :
n° 3,
mars 1937 [88 p.]
André Rolland de Renéville,
Accession à l’Éternel,
Marc Eemans, La
Vision de Tondalus et la littérature visionnaire au moyen
âge,
Dr. René Allendy, Paracelse et
l’Inconscient,
Félix Wagener, Études sur
l’ancienne poésie du Nord,
Léopold Ziegler,
La crucifixion cosmique,
Marcel Decorte, De quelques influences
de la poésie sur l’orientation de la philosphie,
Francis
Warrain, La Loi de Création d’après Hoëné
Wronski,
Jacques de Hemricourt, Ballade par Manière
de Confession,
Dr. Walter Yeeling Ewans-Wentz, Le Yoga tibétain
et les Doctrines secrètes,
Notes
Bibliographiques.
Trad. : A. Préau (L. Ziegler), M.
La Fuente (Dr. W.Y. Ewans-Wentz).
Note(s) :
– Francis
Warrain (1867-1940)
– Walter Yeeling Evans-Wentz
(1878-1965)
– Josef Hoëné-Wronski
(1778-1853)
n° 4, juillet 1937 [112
p.]
Bernard Groethuysen, Avant-propos,
Maître
Eckehart, Sermons traduits du moyen-allemand par Mayrisch St.
Hubert,
Maître Eckehart, Deux Légendes traduites du
moyen-allemand par Mayrisch St. Hubert,
Maître Eckehart,
Sermons traduits du latin par Alexis Curvers,
Mayrisch St.
Hubert, Maître Eckehart,
Marc. Eemans, Maître
Eckehart et la mystique néerlandaise,
[Documents]
Critique et condamnation de Maître Eckehart. Traductions :
Camille Goemans, René Baert, Marc. Eemans et Alexis
Curvers
Bibliographie des principaux manuscrits
moyen-néerlandais.
[Comptes rendus] Marcel Lecomte, Les
Fleurs de Tarbes, par Jean Paulhan (p. 107-108),…
Notes
bibliographiques.
[Série 1.3]
n° 1,
janvier 1938 [126 p.]
Léon Chestov, De la probité
philosophique,
Martin Heidegger, Phénoménologie de
la mort,
Karl Jaspers, La norme de jour et la passion pour la
nuit,
H. Meyer, La précieuse guirlande de La Loi des
oiseaux (introduction par Jacques Bacot),
Albert-Marie Schmidt,
Calvinisme et poésie cosmique,
André Rolland de
Renéville, Poésie et Connaissance,
Marcel Decorte,
Les fondements métaphysiques de la Poésie,
[Notes
bibliographiques] Jean Wahl André Rolland de Renéville,
René Baert, M. Eemans, Étienne Vauthier.
Trad. :
Boris de Schloezer (L. Chestov), Henry Corbin (M. Heidegger,
K. Jaspers), Jacques Bacot (H. Meyer [trad. intégrale
du tibétain]).
n° 2, octobre 1938 [172
p.]
Béatrice de Nazareth, Hadewych, Jan van
Ruusbroec, G. Groote, Thomas a Kempis, G. Peters, Harphius,
Denys le Chartreux, F. Vervoort, La Perle évangélique,
M. de St Augustin, Marie de Ste Thérèse,
Bonifacius Maes,…
n° 3, novembre 1939
[128 p.]
Henry Corbin, Préface,
Suhrawardi
d’Alep, Deux épîtres mystiques,
Shlomo Pines,
Notes sur l’Ismailiyya,
Omar Ibn Al Faridh, Poème
mystique (introduction par Emile Dermenghem et Abdelmalek
Faraj),
Djelad-Od-Din Roumi, Poèmes lyriques
(introduction par Henri Massé),
Abraham Heschel, La
prophétie (introduction par Henry
Corbin),
S. Cyrille,…
Trad. : Henry
Corbin (S. d’Alep, A. Heschel), Emile Dermenghem et
Abdelmalek Faraj (O. Ibn Al Faridh), Henri Massé
(Djelad-Od-Din Roumi),
Note(s) : Numéro consacré
à la mystique musulmane, sous la direction de Henry
Corbin.
– Suhrawardi d’Alep, Deux épîtres
mystiques [comprend « Épître de la modulation
du Simorgh » et « Épître de la
langue des fourmis ».
[1961-1970] DEUXIÈME SERIE420
Directeur-Gérant : Jacques Masui.
Lilian Silburn fut active dans cette série (n° 4 et suivants)
[Annonce, verso de la page de titre :]
Recueils de textes et d’études paraissant deux fois l’an,
publiés par les soins de l’Association : « Les Amis d’Hermès »
Directeur :
JACQUES MASUI
Rédaction :
COMITÉ :
JEAN BRUNO, GABRIEL GERMAIN,
JACQUES MASUI, LILIAN SILBURN
CONSEILLERS :
HENRI MICHAUX, JEAN PAULHAN, de l’Académie francaise,
HENRY CORBIN, Professeur à l’École des Hautes-Études (Sorbonne), Directeur du département d’Iranologie à l’Institut Franco-Iranien (Téhéran), JEAN GRENIER, Professeur à la Sorbonne (Paris),
MIRCEA ÉLIADE, Professeur d’Histoire des Religions (Chicago),
ERNST BENZ, Professeur à la Faculté de Théologie (Marburg),
GIUSEPPE TUCCI, Président de l’Institut pour le Moyen et l’Extrême-Orient (Rome),
EDWARD CONZE, Professeur au Far Eastern Institute, University of Washington (Seattle, U.S.A.).
LU KUAN YU, (Hong-Kong).
*
DIRECTION
48, rue Cortambert — Paris, 16e
Les manuscrits non retenus restent à la disposition de leurs auteurs
pendant un an.
*
DISTRIBUTEUR GÉNÉRAL :
M. J. Minard
73, rue du Cardinal-Lemoine, Paris-5e
n° 1
HENRY CORBIN, Introduction à un traité de Sohrawardi
SOHRAWARDI, L’Archange empourpré
HAKUIN ZENJI, Entretien dans une barque au crépuscule
ALAN WATTS, C’est CELA
MICKIEWICZ, Vision
R. H. BLYTH, Introduction à un traité Zen
CHENG TSAN, La Foi en l’Esprit (Hsin-Hsin-ming)
MARINETTE BRUNO, Vide et Plénitude dans un Tantra du Cachemire
NOTES
BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 1960-1961
n° 2
MARTIN BUBER, La Voie de l’Homme selon le Hassidisme
P. TEILHARD DE CHARDIN, Fragments autobiographiques et le Milieu mystique
RENÉ DAUMAL, L’Hymne de l’Homme
H. VON HOFMANNSTHAL, La Lettre de Lord Chandos
HERMANN BROCH, Glose sur « La Lettre de Lord Chandos »
WILLIAM HAAS, La Concentration
HENRI MICHAUX, Le Dépouillement par l’Espace
NOTES
Enquête sur les techniques de concentration
BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 1961-1963
n° 3
A. E., Ce Héros qui est en l’Homme
DIARMUID RUSSEL, Mon Père
SIMONE TÉRY, Souvenirs d’A. E.
A. E., Fragments
ALEXIS KLIMOV, Introduction à la Mystique de Jacob Boehme
JACOB BOEHME, Theoscopia ou de la Contemplation Divine
ENQUÊTE : Fragments autobiographiques de M. Marius Favre
ANDRÉ PRÉAU, L’Homme et la Préhistoire
NOTES
BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 1962-1963
n° 4
[1967] Hermès/Recherches sur l’expérience spirituelle//Le Maître spirituel dans les grandes Traditions d’Occident et d’Orient, 4 421
Imprimé pour « Les Amis d’Hermès », Lausanne, 1967. Directeur-Gérant : Jacques Masui.
INTRODUCTION
FRANÇOIS DAUMAS
Maîtres spirituels dans l’Égypte ancienne
GABRIEL GERMAIN Les maîtres spirituels dans l’Antiquité classique
ISAAC NEWMAN Talmudic discipleship
ROGER LÉVITTEMaîtres et disciples dans le Hassidisme
JEAN BRUNO La direction spirituelle dans le Christianisme
Mgr ANDRÉ SCRIMA La tradition du Père spirituel dans l’Église d’Orient
JEAN BRUNO La transmission spirituelle chez un mystique du XVIIe siècle : J. J. Olier
JEAN BRUNO Madame Guyon et la communication intérieure en silence
SEYYED HOSSEIN NASR Le maître spirituel d’après la littérature soufre persane
TITUS BURCKHARDT La chaîne d’or
PATRICK LEBAIL Les visages du maître dans le Védânta
LILIAN SILBURN Techniques de la transmission mystique dans le Shivaisrne du Cachemire
A.-M. ESNOUL Un maître vishnouite : Çaitanya et l’Amour divin
*** Le maître spirituel selon Sri Ramana Maharshi
NI RODBARAN Sri Aurobindo comme Gourou
*** Autour d’un sadguru de l’Inde contemporaine
MAX KALTENMARK
Le maître spirituel dans la Chine ancienne
HERBERT V. GUENTHER The spiritual teacher in Tibet
RUTH FULLER SASAKI The master in Rinzai ( Lin-Chi) Zen
DAISETZ TEITARO SUZUKI Early memories : a recollection of my first teachers
K. VON DORCKHEIM L’art merveilleux d’un chat
Dr HENRI CHAMBRON Du psychothérapeute au Maître ultime
FRITHJOF SCHUON Nature et fonction du Maître spirituel
WHITALL N. PERRY Orthodoxy and the master
n° 5
[1968] Hermès/Recherches sur l’expérience spirituelle//La voie de René Daumal, du Grand Jeu au Mont Analogue, 5
n° 6
[1966/7] Hermès//Le Vide/Expérience spirituelle/En Occident et en Orient/6
In Memoriam : JEAN PAULHAN
Introduction
L’EXPÉRIENCE DU VIDE
LILIAN SILBURN : Le Vide, le Rien, l’Abîme
KARLFRIED VON DORCKHEIM : Horror Vacui — Benedictio Vacui
VIDE ET MÉTAPHYSIQUE
LUC BENOIST : L’Appel du Vide
ANDRÉ PRÉAU : Le Vide et le Néant
GEORGES VALLIN : Les deux Vides
EXPÉRIENCES, EN OCCIDENT ET EN ORIENT
FRÉDÉRIC NEF : Expérience du Vide et Ontologie chez les Mystiques rhénans
JOHANNES TAULER : Cantique de la Nudité
LÉOPOLD ZIEGLER : Nicolas de Cuse et la Théologie négative.
ALEXIS KLIMOV : L’Ungrund de Boehme
JACOB BOEHME : Le Rien et le Tout
JACQUELINE CHAMBRON : Le Vide chez St Jean de la Croix.
R. P. ANDRÉ SCRIMA : L’Apophase et ses Connotations selon la Tradition
spirituelle de l’Orient chrétien
D. T. SUZUKI et THOMAS MERTON : Sagesse et Vacuité
(dans christianisme et bouddhisme Zen)
JOHN BLOFELD : Shûnyatâ
EDWARD GONZE : La Vacuité dans la Prâjña-paramita
ALEXANDRA DAVID-NEEL : Le Vide suivant le Bouddhisme tibétain
LILIAN SILBURN : Les sept Vacuités d’après le Çivaisme du Cachemire
VIDE ET LITTÉRATURE
HENRI MICHAUX : Ineffable Vide (L’Aventure de la Perte de l’Avoir)
JACQUES BUGE : Milosz et la « Notion sainte du Rien »
GABRIEL GERMAIN : Un Poète à l’approche du Vide
JACQUES MASUI : Poésie et Négation chez René Daumal
JEAN GRENIER : Le Vide
E. M. CIORAN : L’Indélivré
***
GENEVIÈVE LANFRANCHI : Vivre en Vacuité.
L’ART ET LE VIDE
MARINETTE BRUNO : Le Vide à la Source de l’Inspiration chez les Peintres
lettrés de la Chine ancienne
TADAO TAKEMOTO : Une expérience Zen et le Vide.
TITUS BURCKHARDT : Le Vide dans l’Art islamique.
LE VIDE ET LA SCIENCE
ROGER OTAHI : Le Rapport du Vide et de la Découverte
E. T. BECKETT : À partir du Rien (Vide et Physique contemporaine)
***
MARTIN HEIDEGGER : L’Être comme Vide et comme Richesse
n° 7
[1970] Tch’an (Zen)/ Textes chinois fondamentaux/ Témoignages japonais/ Expériences vécues contemporaines//Hermès/ 7
AVANT-PROPOS
Avertissement
Notes sur les auteurs et collaborateurs et Tableau généalogique
D. T. SUZUKI : Le Bouddha et le Tch'an
CHINE
JOHN C. H. WOU : L’enseignement de Houei-Meng
HOUEI-NENG : Le Soiitra de l’Estrade (extraits), Trad. par P. Yampolski
CHEN-HOUEI : Entretiens (extraits), Trad. par J. Gernet
HOUANG-PO : De la Transmission de l’Esprit (extraits) Trad. par L. Wang
HOUAI-HAI : L’Illumination subite (extraits), Trad. par L. Wang
CHENG-SHAN : Inscription sur l’Esprit de Foi (Sing-Sing-Ming)
PI-YEN LOU : Traduction de trois « cas », Trad. par M. Belloni
R. FULLER-SAZAKI : L’usage du Koan en Chine
PAUL DEMIÉVILLE : Le Tch'an et la poésie chinoise
HSU-YUN : Essentiel de l’Entraînement tch'an dans la Chine moderne
JAPON
D. T. SUZUKI : Bankei et le « Non-né »
HAKUIN-ZENJI Orate Gama » (extraits d’une lettre de direction)
YASUTANI-ROSHI : Commentaires contemporains sur le koan « Mou »
Une expérience contemporaine (extraits du journal de M. P. K.)
Lettres de Taeko Iwasaki et commentaires de Harada-roshi
SHINICHI HISAMATSU : Le Zen : sa Signification pour le Monde actuel
APPENDICES
THOMAS MERTON : Un Chrétien devant le Zen
JACQUES MASUI : L’Orient et le Zen dans notre destin
[1981 — ] « NOUVELLE » [TROISIÈME] SERIE
sour la direction de Lilian Silburn
n° 1
[1981, réédité 2008]
Hermès/ Recherches sur l’expérience spirituelle//Les Voies de la Mystique/ ou l’accès au Sans-accès/ d’après le Sivaïsme du Cachemire, des auteurs chrétiens, soufis et un maître du Tch’an/ Avec un hommage à Jacques Masui/ I / Nouvelle série
SOMMAIRE
Hommage à Jacques Masui
Aperçus sur Jacques Masui, par Marguerite Yourcenar
Jacques Masui le rassembleur, par Gabriel Germain
Les choix d’un éditeur, par Jean Bruno
NOUVELLE ORIENTATION D’HERMÈS
LES VOIES DE LA MYSTIQUE
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION : ACCÈS AU SANS-ACCÈS,
par Lilian Silburn
L’Essence
L’Essence unique et incomparable
L’indicible Essence
L’Essence vivante
Le Tout
Les voiles
Intensité omnipénétrante de la lumière
Opacité des voiles ou des attributs divins
La taie sur l’œil ou le voile de la dualité
Le théâtre d’ombres
Les voies
La saisie par le cœur
La grâce
L’eau et la glace
Les trois voies
LES VOIES MYSTIQUES SELON MADAME J. GUYON
(Présentation : Marinette Bruno)
Les Torrents (extraits)
Différentes voies du retour de l’âme à Dieu
Première voie, d’activité et de méditation, ou les petites rivières
Deuxième voie, passive, mais de lumière, ou les grandes rivières et les fleuves
Troisième voie, passive et de foi nue, ou les torrents
Vie ressuscitée en Dieu
De trois voies imperceptibles (extrait des Discours spirituels)
– LES TROIS AVÈNEMENTS DU CHRIST DANS L’ÂME SELON RUYSBROECK L’ADMIRABLE
(Présentation : Jacqueline Chambron)
Les Noces spirituelles (extraits)
Du triple avènement du Christ (Livre II), traduction J. — A. Bizet
A. Le premier avènement, lequel se fait dans le
cœur
B. Le second avènement, dans les puissances supérieures : l’image de la source et des trois ruisseaux.
C. Troisième avènement. La touche ressentie dans l’unité de l’esprit
La vie dans la contemplation de Dieu (Livre III),
traduction L. Silburn
LES TROIS VOIES ET LA NON-VOIE DANS LE SIVAÏSME NON DUALISTE DU CACHEMIRE
par Lilian Silburn
Manifestation et retour à la source : le jeu divin
Les voies libératrices
La grâce et la triple absorption
Voie de l’individu
Opérations purificatrices
Les yogânga ou membres du Yoga
Recueillement ou méditation (buddhidhyâna)
Le sacrifice du monde objectif
Voie de l’énergie cognitive
Voie divine ou de la volonté
L’absence de toute voie (anupdya)
Le Tantrasàra d’ABHINAVAGUPTA
(Traduction inédite des cinq premiers chapitres)
Absorption dans la non-voie
Absorption divine de la voie de Siva
Absorption propre à l’énergie
Absorption propre à la voie de l’individu
LES DÉVOILEMENTS DIVINS SELON « ABD AI-KARÎM AL-JîLî
(Présentation : M. Bruno)
De l’homme universel (extraits). Traduction T. Burckhardt
Du dévoilement des Activités divines
Du dévoilement des Noms divins
Du dévoilement des Qualités divines
Du dévoilement de l’Essence
Le dévoilement unique : celui de Dieu à Lui-même.
LES DIX ÉTAPES DANS L’ART DE GARDER LA VACHE par K'uo An
Avant-propos de Paul Petit
Traduction
Analyse de Lilian Silburn : Le domptage du buffle.
CONCLUSION : LES TROIS VOIES ET LA NON-VOIE À LA LUMIÈRE DE MAÎTRE ECKHART
par Jacqueline Chambron
Voie de l’activité
Transformation de l’activité
Vanité des œuvres extérieures
Le recueillement ou la douceur d’aimer
Voie de la connaissance
La raison intuitive
Voie de la volonté ou voie divine
L’élan
L’instant
L’accès secret
Les mers de l’Unité
La vie divine
La non-voie
Effacement de la « grande idolâtrie »
Pure conscience
Béatitude
« L’ombre se perdit dans le soleil… »
Œuvres et abréviations
n° 2
[reprise 1989 de l’éd. 1966/7]
Hermès/ Recherches sur l’expérience spirituelle//Le Vide/ Expérience spirituelle/ En Occident et en Orient/ 2/ Nouvelle série
SOMMAIRE
on se reportera à la série précédente n° 6//Le Vide… n° 6
n° 3
[2010]
Hermès Recherches sur l’expérience spirituelle//Le Maître Spirituel/selon les grandes Traditions et d’après des témoignages contemporains/3/Nouvelle série
TABLE DES MATIÈRES422
INTRODUCTION, Aujourd’hui : quel maître pour quel disciple ?,
Jacqueline Chambron
Antiquité et Hassidisme
Le maître spirituel dans la Chine ancienne*, Max Kaltenmark
Maîtres spirituels dans l’Égypte ancienne *, François Daumas
Les Maîtres spirituels dans l’Antiquité classique*, Gabriel Germain
Le disciple selon la tradition talmudique*, Isaac Newman
Maîtres et disciples dans le hassidisme*, Roger Lévitte
Islam
Le Maître spirituel d’après la littérature soufie persane*, Seyyed Hossein Nasr
La chaîne d’or*, Titus Burckhardt
Orient
Les visages du Maître dans le Vedanta*, Patrick Lebail
Le Maître spirituel selon Sri Ramana Maharshi * (anonyme)
Techniques de la transmission mystique dans le shivaïsme du Cachemire*,
Lilian Siburn
Un Maître vishnouïte Çaitanya et l’amour divin*, A.-M. Esnoul
À la louange du guru divin, Kabir
Le bodhisattva, Zoran Zec
Le Maître dans l’école rinzaï du Zen*, Ruth Fuller-Sasaki
L’art merveilleux d’un chat *, Récit rapporté du Japon par K. von Dürckheim
Christianisme
Du Maître dans le Nouveau Testament, Guy Alapetite
La Tradition du Père spirituel dans l’Église d’Orient * 2423 , Mgr André Scrima
La transmission spirituelle chez un mystique du XVIIe siècle : J. J. Olier*, Jean Bruno
Madame Guyon et la communication intérieure en silence*,
un chapitre de sa Vie, présenté pari Bruno
Madame Guyon : L’expérience de la transmission et l’état apostolique,
Jacqueline Sebeo
Discrimination
Analyste et transfert. Maître et transmission,
Marc Porté et Jaqueline Sebeo
De l’imposture à l’incompétence,
Bons et mauvais disciples,
Lilian Silburn et Marinette Bruno
La transmission directe. Témoignages contemporains
La transmission directe, Jacqueline Chambron
Autour d’un Sadguru de l’Inde contemporaine*, Lilian Silburn
Auprès du vrai Maître, M B
Une rencontre décisive, A Z
À propos de la photographie : À bâtons rompus, Lilian Silburn,
Édouard Boubat, Jeremy Gentilli, Robert Bogroff
n° 4
[rééd. de l’éd. 1985 ; diffère de [1970] Tch’an (Zen)…, seconde série]
Hermès Recherches sur l’expérience spirituelle//Tch’an/Zen/racines et floraisons/4/Nouvelle série
SOMMAIRE
Avant-propos
Introduction par M. Bruno
Chapitre I : RACINES DANS LE BOUDDHISME INDIEN
Chantal Duhuy Le Dharma du Buddha. Un enseignement né d’une
expérience
Zoran Zec Aux sources de la non-demeure
L. S. Un fil d’Ariane…
Chapitre II : ÉCLOSION DE L’ÉCOLE CHINOISE
BODHIDHARMA
Introduction par M. B.
Les deux accès à la Réalité ultime (traduit par Guilaine Mala)
TAO-SIN
Introduction par M. B.
Le repos de l’esprit qui accède à l’Absolu (traduit par Patrick Carré)
NIEOU-T’EOU
Catherine Despeux L’école tch'an de Nieou-t’eou
Nieou-t’eou Fa-Jong (tiré de la Transmission de la lampe) (traduit
par C. Despeux)
Extinction de la contemplation (Kiue-kouan Touen) (traduit par
C. Despeux)
L’inscription sur l’esprit (Sin ming) (traduit par C. Despeux)
Chapitre III : ÉPANOUISSEMENT
La métaphore du miroir et la « doctrine subite » (Extraits du Miroirspirituel)
par Paul Demiéville
HOUEI-NENG
Introduction par M. B.
Le Sûtra de l’Estrade (Extraits) (traduit par C. — A. C.)
CHEN-HOUEI
Entretiens * (Extraits)
Introduction et traduction par Jacques Gernet
SIN SIN MING * (traduit par L. Wang et J. Masui)
HOUAI-HAI
L’illumination subite * (Extraits du Po-chang kouang-lou)
(traduit par L. Wang)
HOUANG-PO
De la transmission de l’esprit * (extraits du Wan ling lou)
(traduit par L. Wang)
LIN-TSI
Les Entretiens de Lin-tsi * Étude et traduction par P. Demiéville
Chapitre IV : ÉVOLUTION DES TECHNIQUES
Ruth Fuller-Sazaki L’usage du koan en Chine *
Michel Belloni Trois cas du PI YEN LOU*
TSI TCHENG
Le cri tch'an
HSU YUN
Essentiel de l’entraînement tch'an * (traduit par Lou Kouan Yu
et F. Ledoux)
Chapitre V : ART ET POÉSIE
Paul Demiéville Le Tch'an et la poésie chinoise *
Nicole Vandier-Nicolas Le Tch'an et l’Art
Chapitre VI : MAÎTRES JAPONAIS
BANKEI
Bankei et le non-né * par D.T. Suzuki (traduit par F. Ledoux)
HAKUIN ZENJI
Entretien dans une barque au crépuscule * (traduit par R. A.)
Réponse à un proche suivant du Seigneur Nabeshima * (traduit
par F. Ledoux)
Chapitre VII : AU TIBET
Guilaine Mala Empreinte du Tch'an chez les mystiques tibétains
IN FINE
Jacques Masui L’Orient et le Zen dans notre destin *
ÉPILOGUE
APPENDICE
Les sources sur Nieou-t’eou
Rectificatif
Deux tableaux des lignées de Maîtres
Table des matières
Les Voies de la Mystique ou l’accès au Sans-accès d’après le Sivaïsme du Cachemire, des auteurs chrétiens, soufis et un maître du Tch’an 11
Nouvelle orientation d’HERMÈS 13
INTRODUCTION : « ACCÈS AU SANS-ACCÈS » [Jacqueline Chambron]. 23
L’Essence unique et incomparable 24
Intensité omnipénétrante de la lumière 42
Opacité des voiles ou des attributs divins 44
La taie sur l’œil ou le voile de la dualité 45
LES VOIES MYSTIQUES SELON MADAME GUYON [Marinette Bruno] 65
LES TORRENTS par JEANNE-MARIE BOUVIER DE LA MOTTE-GUYON [Extraits, Marinette Bruno] 73
Différentes voies du retour de l’âme à Dieu 73
PREMIÈRE VOIE, d’activité et de méditation ou les petites rivières 74
DEUXIÈME VOIE, passive, mais de lumière ou les grandes rivières et les fleuves 77
TROISIÈME VOIE, passive et de foi nue ou les torrents 81
Premier degré : Amour et intériorité 83
Deuxième degré : course tumultueuse de l’âme à sa perte et à sa mort 87
Dépouillements et trépas mystique 91
Troisième degré : de l’ensevelissement à la poussière ou à l’anéantissement 92
Quatrième degré : commencement de la vie divine 94
De trois voies imperceptibles 104
LES TROIS AVÈNEMENTS DU CHRIST DANS L’ÂME D’APRÈS RUYSBROECK L’ADMIRABLE [Jacqueline Chambron] 109
LES NOCES SPIRITUELLES [extraits — Jacqueline Chambron, trad. J.-A. Bizet] 113
DU TRIPLE AVÈNEMENT DU CHRIST (LIVRE II) 113
A. Le premier avènement lequel se fait dans le cœur 115
B) DEUXIÈME MODE. SURABONDANCE DES CONSOLATIONS 116
C) TROISIÈME MODE. PUISSANT ATTRAIT VERS DIEU 117
D) QUATRIÈME MODE DE LA DÉRÉLICTION 118
PREMIER RUISSEAU : COMMENT IL FAIT L’ORNEMENT DE LA MÉMOIRE 121
DEUXIÈME RUISSEAU : COMMENT IL ÉCLAIRE L’ENTENDEMENT 122
TROISIÈME RUISSEAU : COMMENT IL CONFIRME LA VOLONTÉ EN TOUTE PERFECTION 123
C. Troisième avènement. La touche ressentie dans l’unité de l’esprit 125
COMMENT L’HOMME DOIT ÊTRE ORNÉ POUR ACCÉDER AUX EXERCICES LES PLUS INTIMES 125
DU TROISIÈME AVÈNEMENT DU CHRIST QUI NOUS CONDUIT À LA PERFECTION DANS LES EXERCICES INTIMES 125
D’UNE SORTIE DE L’ESPRIT EN SON FOND INTIME SOUS L’ACTION DE LA DIVINE TOUCHE 126
LA VIE DANS LA CONTEMPLATION DE DIEU (livre III) 129
Quatrième partie : la rencontre 132
LES TROIS VOIES ET LA NON-VOIE DANS LE ŚIVAÏSME NON DUALISTE DU CACHEMIRE [Lilian Silburn]. 137
Manifestation et retour à la source : le jeu divin 137
STANCES FINALES DU PREMIER CHAPITRE DU TANTRÂLOKA d’ABHINAVAGUPTA. 141
STANCES DU TANTRÂLOKA : LA TRIPLE VOIE 147
Voie divine ou de la volonté 147
Voie de l’énergie ou de la connaissance 147
Voie de l’individu ou de l’activité 147
La grâce et la triple absorption 148
Absorption dans la quintessence. 150
Absorption propre à la voie divine 152
Absorption propre à l’énergie 153
Absorption propre à la voie de l’individu 153
VOIE DE L’INDIVIDU OU DE L’ACTIVITÉ 157
Les yogānga ou membres du yoga 159
Recueillement ou méditation (buddhidhyāna) 162
Le sacrifice du monde objectif 164
LA VOIE DE L’ÉNERGIE COGNITIVE 167
VOIE DIVINE OU DE LA VOLONTÉ 177
Triple aspect du reflet de l’univers dans la Conscience 181
L’ABSENCE DE TOUTE VOIE (ANUPÂYA) 185
LE TANTRASARA D’ABHINAVAGUPTA [Lilian- Silburn]. 191
Absorption dans la non-voie (anupāya) 194
Absorption divine de la voie de Śiva 195
Stance traduite du prākrit 199
Absorption propre à l’énergie 199
Absorption propre à la voie de l’individu 205
Poussée ascensionnelle du souffle (uccāra) 207
Phonèmes faits du souffle subtil 209
Stance finale du Chapitre V 210
LES DÉVOILEMENTS DIVINS SELON « ABD AL-KARÎM AL-JÎLÎ [Marinette Bruno] 213
La Divinité et la création ou le déploiement des Qualités divines 215
L’occultation et son remède 216
Les Qualités, voile de l’Essence 217
Métaphysique et expérience 218
DE L’HOMME UNIVERSEL [Extraits, traduction Titus Burckhardt] 219
Du dévoilement (tajallî) des Activités divines 219
Du dévoilement (tajallî) des Noms divins 221
Du dévoilement (tajallî) des Qualités divines 223
Du dévoilement (majla) de l’Essence 229
Le dévoilement unique : celui de Dieu à Lui-même 235
LES DIX ÉTAPES DANS L’ART DE GARDER LA VACHE par K'UO AN [par Paul Petit - analyse : Lilian Silburn] 239
À la recherche de la vache 241
Il découvre les traces de la vache 242
Il rentre chez lui sur le dos de la vache 245
La vache oubliée, l’homme reste seul 245
La vache et l’homme tous deux hors de vue 246
Il retourne à l’origine, à la source 246
Il entre dans la ville, répandant le bonheur à pleines mains 247
Analyse : le domptage du buffle 247
CONCLUSION : LES TROIS VOIES ET LA NON-VOIE À LA LUMIÈRE DE MAÎTRE ECKHART [Jacqueline Chambron] 253
Transformation de l’activité 255
Vanité des œuvres extérieures, des mérites et des vertus 257
Le recueillement ou la douceur d’aimer 262
VOIE DE LA VOLONTÉ OU VOIE DIVINE 273
Effacement de la « grande idolâtrie » 293
Point de naissance pour ce qui est déjà né : 293
Point d’anéantissement dans l’éternelle essence : 294
Point de moyen pour accéder à la réalité : 295
« L’ombre se perdit dans le soleil… » 305
Le Vide Expérience spirituelle en Occident et en Orient 315
LE VIDE, LE RIEN, L’ABÎME. 317
CONCENTRATION MENTALE ET VIDE MYSTIQUE SPONTANÉ 319
ASPECTS PASSIF ET ACTIF DU VIDE MYSTIQUE 322
VIDE ET DÉTACHEMENT DE LA QUIÉTUDE 331
NUIT DE L’AMÈRE DESTRUCTION 341
CONSCIENCE REVENUE SE DÉTACHANT SUR UN FOND DE VIDE INCONSCIENT 363
LE VIDE CHEZ St JEAN DE LA CROIX - DÉNUEMENT ET VIVE FLAMME 383
I. VIDE DOIT ÊTRE L’AUTEL DU SACRIFICE 385
II. « METS-LA AUSSI VIDE SUR LA BRAISE… » 387
III. « APRÈS TOI JE SORTIS CRIANT, ET TU ÉTAIS PARTI. » 393
Pourquoi le laisser ainsi » 396
Et ne pas emporter le vol que Tu fis ? 396
LES SEPT VACUITÉS D’APRÈS LE ÇIVAÏSME DU CACHEMIRE. 403
KHA, MOYEU, ET VIDE DE L’INTÉRIORITÉ 405
VYOMAN OU IMMENSITÉ DE LA CONSCIENCE 405
INTÉRIORITÉ ET VIDE INTERSTITIEL 406
VIDE UNIVERSEL DE L’ÉNERGIE OMNIPÉNÉTRANTE 411
VYOMAN OU IMMENSITÉ COSMIQUE 411
VIDE DE L’ÉGALITÉ (SAMANÂ) 411
Le Maître Spirituel selon les traditions d’Orient et d’Ocident 435
AUJOURD’HUI : QUEL MAÎTRE POUR QUEL DISCIPLE ? 42 [Jacqueline Chambron] 437
Les virtuoses de l’ascension 441
Excursion isolée ou sauvage 444
Point de montagne et point de guide 448
Ni montagne ni carte : les marchands du temple 450
TECHNIQUES DE LA TRANSMISSION MYSTIQUE DANS LE SHIVAÏSME DU CACHEMIRE. [Lilian Silburn] 455
Prātibho guru , maître par illumination. 459
Le maître authentique (sadguru). 461
MODALITÉS DE LA TRANSMISSION 463
Communion dite de l’énergie. 467
Communion dite de l’être limité. 469
1. — Initiation du fils spirituel. 469
Nādavedha, initiation par le son. 472
2. — Onction du guide spirituel (abhisheka). 473
LA TRANSMISSION SPIRITUELLE CHEZ UN MYSTIQUE CHRÉTIEN DU XVIIe SIÈCLE : JEAN-JACQUES OLIER [Jean Bruno] 479
LE RESSORT MYSTIQUE DE L’ACTION 479
UN DIRECTEUR PARFOIS LYRIQUE 481
LE CHRIST VIVANT DANS LE CŒUR 487
UNE INTERACTION PSYCHOLOGIQUE 493
LES EFFETS DE LA TRANSMISSION 496
MADAME GUYON ET LA COMMUNICATION INTÉRIEURE EN SILENCE [Jean Bruno] 501
MADAME GUYON L’EXPÉRIENCE DE LA TRANSMISSION ET L’ÉTAT APOSTOLIQUE [Jacqueline Sebeo] 515
[Jacqueline Sebeo et Marc Porté] 535
I. DÉFINITIONS ET CONTENANT 537
Le lieu, l’espace, le temps 538
Le lieu, l’espace, le temps 543
Transfert et processus transférentiel 549
Le sujet et l’introduction au manque 550
De l’amour fou » à l’amour d’objet » 552
Lien d’amour et introduction à l’Amour divin 554
De l’amour-abandon à l’amour pur 557
DE L’IMPOSTURE À L’INCOMPÉTENCE. BONS ET MAUVAIS DISCIPLES.. 569
[Lilian Silburn et Marinette Bruno] 569
La transformation du disciple 596
AUTOUR D’UN SADGURU DE L’INDE CONTEMPORAINE. 603
A PROPOS DE LA PHOTOGRAPHIE 627
INTRODUCTION [Marinette Bruno] 637
QUELQUES NOTIONS FONDAMENTALES 647
UN FIL D’ARIANE . [Lilian Silburn] 659
SUR LE NUAGE D’INCONNAISSANCE [Lilian Silburn] 665
« HERMÈS », UNE REVUE SPIRITUALISTE OUBLIÉE 673
Table des matières
Quatrième de couverture
III LILIAN SILBURN ET DES AMIS DANS LA REVUE « HERMÈS »
Sous un même titre « HERMES » parurent de nombreuses séries de contributions consacrées à la réalité intérieure. Elles étaient ouvertes à « l’expérimentation spirituelle ». Plusieurs séries se succédèrent entre 1933 et 2010.
Je reprends ici un choix effectué dans les dernières parutions. Il s’agit des textes et présentations d’auteurs mystiques rédigés par Lilian Silburn, Jacqueline Chambron, Jacqueline Sebeo, Jean et Marinette Bruno. Ils constituent une magnifique conclusion aux séries. Ils sont un appel adressé à tous les chercheurs de vie intérieure.
Le quart du présent volume peut être utilisé comme une anthologie mystique ouverte à l’universel. Elle propose des écrits de Ruusbroec, de Jean de la Croix, de Madame Guyon et s’achève sur une une présentation du Nuage d’Inconnaissance. Les traditions en terres d’Islam, en Inde et en Chine sont représentées par des écrits de Jîli, d’Abhinavagupta, de K’uo an.
L’ensemble de tous les textes rédigés par Lilian Silburn et ses amis suit strictement l’ordre des parutions d’« HERMES ». Ils sont prélevés dans les numéros 4 et 6 de la Deuxième série dirigée par Jacques Masui, puis 1, 2, 3, 4 de la Nouvelle série sous la direction de Lilian Silburn.
Ce présent tome III ouvre un projet d’assembler en huit tomes l’œuvre écrite ou dirigée par Lilian Silburn.
2e édition , le 12 février 2021
lulu.com
Garamond gras 10 pts
Assemblage de contributions dans la revue « Hermès »
© 2020.
![]()
Ce
travail est mis à disposition selon les termes de la Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International. - This work by
Dominique Tronc is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of
this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
1 http://criticamasonica.over-blog.com/2016/03/hermes-une-revue-spiritualiste-oubliee.html cette citation et la suivante — Voir en fin de tome section VI : « HERMES », une revue spiritualiste oubliée.
2 La revue elle-même reste méconnue sur le web. En recherche Google, elle est « recouverte » par la revue sociologique portant le même nom d’« Hermès ».
3 Voir la première table non réduite des matières.
Relevés facilitant le recours à cette anthologie : Madame Guyon Torrents 69-104 & 491-502, Ruysbroeck Noces spirituelles 109-132, Abhinavagupta Tantraloka 137-208, Jîli de l’Homme universel 217-236, K’uo an La vache 239-245, citations de Jean de la Croix 379-395, présentation du Nuage d’Inconnaissance 645-648. Soit184 pages sur 690. [relevés qui peuvent varier de quelques pages selon l’édition, ici la première].
4 Pour s’y retrouver, voir notre Section VI, « Trois séries et leurs contenus », 651 sv.[listes complètes en petit corps].
5 Madame Guyon fut désignée malicieusement ainsi par l’honnête, mais distant sulpicien Tronson. Elle fut reconnue un jour comme « une sœur » par Lilian Silburn qui anima et conseilla pas à pas ses « Amis » présentateurs de textes des grands aînés.
6 Outre de nombreux textes d’auteurs mystiques, j’y relève, dans la seule « nouvelle » série sous la direction de Lilian Silburn, les noms reconnus de Kaltenmark, Daumas, Seyyed Hossein Nasr, Burckhardt, Dürckheim, Carré, Despeux, Gernet, Demiéville, Lü Kuan Yu, Blofeld, Conze… Ces noms ne se limitent pas à des lumières de l’intelligenzia française, mais le domaine resta malheureusement trop « pointu », mystique sobre, pour pouvoir s’imposer sur le marché du livre. Ce dont atteste les reprises successives de chantiers éditoriaaux (trois fois… ou six fois si l’on décompose les séries parues avant 1939).
Les contributions sont d’autant plus intéressantes que leur diversité souligne une grande liberté face à l’influence souvent étrangère au domaine mystique de la religion dominante. D’où l’intérêt de se pencher sur les SOMMAIRES de la section VI.
7 incluant titres d’œuvres et leurs abréviations (p. 311 de la première édition).
8 « Style par défaut » Garamond 10 pts gras. Pour des § entiers, « Citations » en retrait de 5 pts.
9 n° 1
[1981, réédité 2008]
Hermès/ Recherches sur l’expérience spirituelle//Les Voies de la Mystique/ ou l’accès au Sans-accès/ d’après le Sivaïsme du Cachemire, des auteurs chrétiens, soufis et un maître du Tch’an/ Avec un hommage à Jacques Masui/ I / Nouvelle série
10 C’est T. Burckhardt qui en fait la remarque, et il déplore que l’expression ait été ensuite « abusivement étendue à des manifestations religieuses fortement empreintes de subjectivité individuelle » (Doct., 21-22). [« Doct. » ? se reporter aux titres d’œuvres et leurs abréviations (ici sous « Soufisme », p.313 de la première édition).]
11 En ce qui concerne la translittération des langues orientales dans notre alphabet, nous respecterons en général celle qu’adoptent les traducteurs des textes choisis, d’où une certaine diversité.
12 Pages de l’édition 2008, notre source (NDE) – J’ai reculé devant la recherche des équivalences de cette réédition !
13 Du haut vers le bas, du centre vers la périphérie : ces images sont à la fois valables et inexactes puisque dualisantes.
14 Voir « œuvres et abréviations ».
15 Page de la source Hermès.
16 Lorsque nous parlons de sûfi, nous entendons ceux dont nous citons des extraits : Hallâj, Ibn « Arabî, Jîlî et leurs continuateurs. D’autres écoles peuvent avoir des interprétations bien différentes.
De même, les sivaïtes auxquels nous nous référons sont les partisans de la non-dualité : écoles cachemiriennes Krama, Kula, Trika, Spanda et non point les sivaïtes dualistes, qu’ils soient du Cachemire ou du sud de l’Inde.
17 « Hermès, nouvelle série, n° 1, « Les voies de la mystique », Ed. des Deux Océans, Paris, 43-78. » - Je reprends la transcription préparée par Élisabeth Mercier, « Jacqueline Chambron/Articles parus dans la revue Hermès », Lulu, Hors commerce, 1-113. (NDE).
18 Coran, CXII, 1-3, trad. D. Masson, Antho. 244.
19 « Un. » : abréviation pour le Traité de l’Unité, longtemps attribué à Ibn‘Arabi.
20 Tantra dont anuttara est le terme clef. Cf. ici p. 181-182 [de la source Hermès].
21 Et c’est bien pourquoi on la dit « Lumière » (Prakāsa.).
22 Kh., 128. Ne pas confondre cet auteur du Xe siècle avec Ibn « Arabi » l’andalou (cf. ici p. 55 n. 20).
23 Hymnes aux Kāli. Cf. le Cantique de Ibn « Arabi où Dieu dit à l’âme : « Je suis la réalité du monde, le centre et la circonférence. » (Im., 131.)
24 Sur bullitio, ebullitio et le jaillissement, cf. Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart par Vladimir Lossky, Vrin, Paris, 1975. D’où cette citation légèrement modifiée est extraite (p. 69).
25 Ibid., p. 115.
26 Le Royaume des Amants (R. p. 145-146).
27 p. 149. Par cette productivité intérieure en laquelle l’Essence se liquéfie et bouillonne seul l’Un agit : « D’où il suite que l’émanation, dans les Personnes divines est une sorte de bouillonnement : c’est pourquoi les trois Personnes sont simplement et absolument un.
28 pp. 136, 148, 137.
29 Cf. ici p. 218 et 222.
30 Cf. ici p. 141 sqq., l’exultation du roi.
31 Pour exprimer cet amour « source toujours débordante d’une effusion infime » Denys se sert du terme Éros, désir amoureux, de préférence à Agapé, amour de charité selon la perspective augustinienne. Cf. introduction de M. de Gandillac, p. 38.
32 Op. cit., successivement p. 108 et 107.
33 P. 104. En lui est ajouté par Denys.
34Traité De l’homme noble, traduit sur l’allemand.
35s.s.v. III, 16, p. 86. Voir aussi 1, 22, p. 57 et l’analyse p. 139 et 172. Le lac est jaillissant en raison des sources de fond.
36Cité par R. Otto, Mystique d’Orient et mystique d’Occident, Payot, Paris, 1951, p. 173.
37Muhyi-d-Dîn ibn « Arabi, dit l’andalou, né à Murcie en 1165, mort à Damas en 1240, grand génie mystique et métaphysicien puissant, a laissé quelque cinq cents ouvrages, dont bien peu ont été traduits en français. Le Traité de l’Unité lui est généralement attribué. Le passage qui suit est extrait de La Sagesse des Prophètes, traduction T. Burckhardt, p. 163.
38Cf. Maitre Eckhart (Anc. tr., 147).
39La Déesse joue sur le double sens de l’expression qu’on peut comprendre comme « grand secret » (maha-guhya) ou comme « grand non -secret » (maha-aguhya. Cf. La Bhakti, p. 28-29).
40(AI-H., 137-138.) AI-Hallāj proclamait encore : « Ô conscience de ma conscience, qui Te fais si ténue, que Tu échappes à l’imagination de toute créature vivante !
« Et qui en même temps, et patente et cachée, transfigures toute chose, par devers toute chose !... » (Diw. a 104).
41Cette expression de Denys convient parfaitement ici.
42Ennéades, VI, 9, 4.
43Omar Ibn-Fāridh. La Grande Ta’iaya. Versets 713 à 717 traduits par Claudine Chonez et Ahmed Bennani in L’Islam et l’Occident, Éd. Cahiers du Sud, 1947, p. 293. Et pour les autres versets R. A. Nicholson, Studies in Islamic mysticism, Cambridge University Press, 1921. Paperback ed., 1978. P. 190-191 et 260-261.
44P. T. 1, p. 50. Ed. S. K., p. 3, l. 5.
45Ces deux termes accolés forment le nom Abhinava-Gupta auteur de la Laghuvtti, stance III de son Introd., éd. A. Padoux, P. T. p. 49.
46 Cf. ici p. 176.
47 Ces conditions limitatives selon Jîlî peuvent être dissoutes par une « intuition instantanée » (Waqt), à savoir en un instant plénier, reflet de l’éternité qui permet de vivre dans la conscience actuelle de la présence divine. Elles peuvent aussi être dissoutes par un « état spirituel » (hāl), irradiation de qualités, ou encore par d’autres actualisations. « Or l’essence transcende tout cela. » N’y a-t-il pas ici voie divine, voie de connaissance, et, pour finir, l’essence par-delà toute voie ?
48 Telle est l’œuvre de apohanasakti, énergie divine qui dissocie, rétrécit, coagule et fige, et dont procèdent les vikalpa. Cf. ici, p. 142, 144 et 166. Eckhart disait de même « la nature divine est la grande diviseuse ». Cf. Evans, p. 117.
49 Extrait du Royaume des Amants, cité par Maurice Maeterlinck dans son introduction à l’Ornement des Noces spirituelles de Ruysbroeck l’Admirable (Maet. p. LXXVIII).
50 Oeuvres complètes de sainte Thérèse de Jésus, Seuil, Paris, 1949, p. 724.
51 La Pierre étincelante, ch. IX.
52 La Vie de Madame J.M.B. de la Mothe-Guyon écrite par elle-même, 1720. 3 vol., tome 11, chap. XI, § 5. Dans toutes nos citations et dans les extraits des Torrents, orthographe et ponctuation sont modernisées.
53 Les Torrents (G., p. 263-264). Voir la suite du passage ici p. 115.
54Petit abrégé de la voie et de la réunion de l’âme à Dieu (G., 318).
55 « Le maître est la voie » dit l’un des Sivasutra référant à ce domaine.
56 Vie, op. cit., tome I, chap VIII, §§ 6 à 10. Ces passages se trouvent également dans les extraits de la Vie publiés par Jean Bruno dans les Cahiers de la Tour Saint-Jacques, n° VI, 1961.
57 Dans son Introduction, J. Orcibal fait une description des quatre manuscrits existants, dont celui que nous avons choisi et qu’il appelle G. (la copie en ayant été faite sur celle de Godet-Desmarais, laquelle avait été transcrite sur celle de Bossuet), et une liste des variantes entre l’édition de 1712 et celle de 1720.
58 L’édition de 1704 présentant ici une lecture manifestement fautive et qui sera corrigée dans les éditions ultérieures, nous donnons la phrase du manuscrit G.
59 Textuellement, en alte.
60 Chap. Il §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; partie du § 9.
61 Manuscrit G. des Archives de Saint-Sulpice. Voir aussi, édition de 1720, chap. II, §§ 10, 15.
62 Ou plutôt : leur solitude et leur vie à tous les accommodements de charité (version de 1720).
63 Autre lecture plus plausible : « passent ce degré » — entendons alors le second degré ou seconde voie —, et plus loin : « elles n’occupent que celle-ci ».
64 Il faut comprendre comme antécédent de « qui » non pas « directeurs éclairés », mais « faute de directeurs éclairés », c’est-à-dire : des directeurs non éclairés.
65Chap. III, §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, partie du § 7, du 8 ; §§ 9. 10 ; partie du 11 ; §§ 13, 14, 15 ; partie du 16.
66 Chap. IV, §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16 ; partie du § 19 et du 20.
67 Chap. V, extraits des paragraphes suivants : 2, 3, 5, 6, 19.
68 Ou plutôt : la pente est trouvée : il faut… (1720).
69 Ici la version de 1720 ajoute à juste tire : (ce lui semblait).
70 Chap. VI, §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. partie du § 10, du 11, du 12 et du 14.
71 Ce paragraphe est extrait du Petit abrégé de la voie et de la réunion de l’âme à Dieu (in Les Opuscules spirituels, réimpression 1978, p. 329), les deux paragraphes précédents et le suivant, du chap. VII des Torrents (§§ 11, 13 et 38).
72 Chap. VIII, §§ 1, 2, 14, 19 et 20.
73 Édition de 1720 : non par vue, application…
74 Réponse omise — oubliée sans doute — dans l’édition de 1704 et que nous restituons selon le manuscrit de Saint-Sulpice.
75 Chap. IX, §§ 1 à 9 ; partie du § 10, du 11, du 12 ; § 13, partie du 15, du 17 ; § 27.
76 Ou « seconde partie » dans l’édition P. Poiret. C’est une sorte d’additif à la « première partie » qui a dû être rédigé un peu plus tard. Version du manuscrit de Saint-Sulpice. Cf. ici p. 85.
77 Le manuscrit porte « au-dessus » et c’est le mot qui figure dans l’article condamné par l’ordonnance de l’évêque de Chartres, mais le sens est bien que l’âme est à la fois au-dessous et au-dessus de l’humilité, ce que confirme l’édition de 1720, que nous suivons ici.
78 Chap. 1, §§ 2, 4 ; partie du 6, du 7.
79Manuscrit fautif (« elle ne perd ») corrigé par les éditions imprimées.
80Ou « si n’est-il pas entraîné » c’est-à-dire : et pourtant il n’est pas entraîné.
81 Entendons la nature du fleuve, les qualités de la mer. Variante : ces qualités
82On voit, de l’extérieur, qu’elle accomplit tout ce que les autres accomplissent, mais, intérieurement, elle ne fait rien comme eux, de façon propriétaire et bornée.
83Chap. II, §§ I (début) ; 5 ; partie du 6, du 7, du 8 ; du 9 ; fin du 12.
84Les âmes rétrécies.
85 Chap. III, partie du paragraphe 3, du 4, § 7, partie du 8, du 10.
86Chap. IV, §§ 1, partie du 2, du 7, du 8.
87Discours chrétiens et spirituels, tome 1, discours XIV. De trois voies imperceptibles de l’intérieur. Paris, 1790.
88 Trad. J.A. Bizet.
89 Trad. Lilian Silbum.
90Hermès, nouvelle série, n° 1, « Les voies de la mystique », Ed. des Deux Océans, Paris, 141-199.
91Śivadrsti de Somānanda, I, 37-38. Écoutons, comme en écho, Angelus Silesius : « Tout cela est un jeu que la Déité se donne. » (II, 198.)
92S.D., I, 37.
93Le sūfī persan Mawlāna Djalāl-od-Dîn Rūmî écrit :
« Tu es une perle cachée dans une poignée de paille mêlée de boue.
Si tu laves ta face de cette boue, ô toi au beau visage ! Qu’arrivera-t-il ? Tu es fils de roi…
Si tu recherches le royaume de ton père, ô pauvre misérable ! Qu’arrivera-til ? », (op. cit., p. 235.)
94Maître Eckhart, citant la parole de l’Évangile : « Sachez que le royaume de Dieu est proche » précise : « Oui, le royaume de Dieu est en nous ». Puis il commente : « Maintenant, vous devez savoir comment le royaume de Dieu est proche de nous. Il nous faut considérer ce propos avec soin. Si j’étais un roi et ne le savais pas, alors je ne serais pas roi. Mais si j’avais la ferme conviction d’être roi, si tous les hommes avec moi en étaient persuadés et si j’étais sûr de leur conviction, alors je serais roi et toute la richesse du roi serait mienne… Semblablement, notre béatitude tient à ce que l’on reconnaisse et connaisse (bekenne et wizze) le souverain Bien, qui est Dieu même. » (Pf., p. 220-221.) Et Ruysbroeck : « Sans notre connaissance nous ne pouvons posséder Dieu… Si nous pouvions être bienheureux sans connaissance de notre part, une pierre qui n’en a aucune pourrait aussi être bienheureuse. Quand je serais maître du monde entier, que m’importerait si je n’en savais rien ? » L’Anneau ou la pierre brillante. Traduit par les Bénédictions de saint Paul de Wisques. Vromant, Paris et Bruxelles, vol. III, 1928, p. 257.
95Abhinavagupta vivait à la fin du Xe et au début du XIe siècle près de Srinagar. Il eut de nombreux maîtres qui lui firent connaître la doctrine des Âgama et ses diverses écoles, la plupart des systèmes de l’Inde et même le bouddhisme. Mais le maître qu’il vénérait entre tous était Sambhunātha qui l’initia à la vie mystique et à qui il exprime sa vénération dans la stance d’ouverture du Tantrasāra.
Il glosa les œuvres de ses plus célèbres prédécesseurs, en particulier l’Isvarapratyabhijñākārikā d’Utpaladeva, lui-même disciple de Somānanda, auteur de la Śivadrsti.
Bien que fort célèbre dans toute l’Inde pour ses vues géniales en esthétique et en dramaturgie, ses autres œuvres et gloses, non publiées, restèrent longtemps dans l’oubli. Leur publication ne date que de ce siècle ; elles sont à présent mieux connues et font l’objet de quelques traductions en langues européennes. Le lecteur trouvera ici des extraits de plusieurs de ses œuvres originales et de ses gloses. Le Tantrāloka est une vaste somme de toute la philosophie et de la mystique du Śivaïsme.
96Sur l’égalité, cf. ici p. [265].
97On a donc en termes sanskrits : citsakti propre à anupāya, non-voie au sens strict ; ānandasakti, relative à anupāya, voie des plus réduites ; icchāsākti propre à sambhavopāya ; jñānasakti relative à sāktopāya ; kriyāsakti relative à ānāvopāya.
98Cf. I. P. v. Vol. II, p. 131-132, ou II, 3, 17. Au sujet de l’intime saisie de Dieu qui remplace les efforts d’une imagination non encore dégagée de l’objectivité, H. Corbin cite un passage d’Ibn « Arabî : « Lorsque les mystiques expérimentent enfin que Dieu est ce même être qu’auparavant ils imaginaient comme étant leur propre âme à eux, il en va comme dans le cas d’un mirage. Rien n’a été aboli dans l’être. Le mirage reste bien objet de vision, mais on sait ce qu’il est, on sait que ce n’est pas de l’eau. » (Fotūhāt, II, 339, cité in Im. p. 246, note 124.)
99I. P. v. Vol. II, p. 131-132 ou II, 3. 17.
100Svasvarūpa peut être aussi traduit par « sa propre essence », mais il s’agit ici de la Suressence, la forme (rūpa) intime (sva) de l’intime (sva).
101Samāvesa, textuellement com-pénétration ou interpénétration.
102I. P. v. III, 2. 11-12.
103Nirupāyasamāvesa. Quant à celui qui est arrivé à la Réalité, un sūfī s’exclame : « Un tel Wāçil n’est pas arrivé à un degré aussi sublime sans avoir vu… que son être intime est l’être intime d’Allah…, sans aucune entrée ou sortie de Lui » p. 31. Ce même Traité de l’Unité précise qu’Allah n’entre en rien et rien n’entre en Lui : « Il ne se trouve pas dans quelque chose et aucune chose ne se trouve dans Lui par une entrée ou une sortie quelconque » (p. 24).
104Sans cintā, obsession mentale ou « pensée constante de Dieu », comme dans la voie de la connaissance. Maître Eckhart, qui insiste lui aussi sur un Dieu vivant éprouvé intérieurement, dit que la vraie possession de Dieu « repose sur le sentiment du cœur… sur une orientation de la volonté vers Dieu. Non sur une idée fixe permanente de Dieu !... L’homme ne doit pas se donner pour satisfait avec une idée de Dieu — quand l’idée disparaît, Dieu disparaît aussi. Mais on doit avoir un Dieu réel qui est élevé au-dessus de la pensée de l’homme et de tout le créé. Ce Dieu ne disparaît pas, à moins qu’on ne s’en détourne volontairement. Qui a ainsi Dieu, essentiellement, celui-là seul prend Dieu divinement et Dieu rayonne devant lui à travers toutes choses : toutes lui donnent le goût de Dieu, dans toutes Dieu se reflète en lui… » (P. 165.)
105On peut lire encore avec certains Maîtres : grâce à un Réveil dû au guru.
106Suddhavidyāvastha dans le premier cas, et Suddhavidyāpramātr dans le second. Cf. Madame Guyon, Les Torrents ici p. [116]. [référence à l’article « Les voies mystiques selon madame Guyon » du numéro d’Hermès, Les voies de la mystique] : « Dieu, dit-elle, donne d’abord les lumières de l’état, ensuite il donne le goût de l’état, enfin il le donne par une notice confuse et non distincte. Puis il donne l’état d’une manière permanente et y établit l’âme pour toujours. » Goût et notice confuse correspondent à la bhāvanā de la voie de l’énergie. On trouve une même distinction chez les sūfī, ici p. [74]. Avicenne dit que l’âme a d’abord des étincelles de lumière, puis ces étincelles sont de plus en plus fréquentes, et finissent par se fondre en une seule lumière permanente.
107Maître Eckhart écrivait également : « si la nature dans son action commence avec le plus faible, Dieu dans son action n’en commence pas moins avec le plus fort et le plus parfait ! » (P. 242).
108Cf. p. [149].
109Ceci a lieu dans la voie de la connaissance puis dans celle de la volonté. Cf. ici p. [187-188, 190, 264-265].
110Quant au quatrième pranāyāma, il n’a lieu que dans la voie médiane, le souffle expiré se dirigeant vers le centre supérieur au moment du vide, et le souffle inspiré, vers le cœur au moment du plein. Avec la suspension, souffles et pensée demeurent très apaisés, sans la moindre oscillation (cf. S.S.v. III. 6).
111Les aranī servent à allumer le feu du sacrifice védique. Ici les souffles inspiré et expiré par leur barattement allument le feu de la kundalinī ou souffle ascendant.
112Cakra, il s’agit ici de la poussée ascentionnelle de l’énergie spirituelle dite kundalinī. La description en est donnée dans le Tantràloka (V. 43-62).
113Cf. ici I.P.v., vol. II p. 261, Kārikā 7.
114Cf. ici p. [205].
115Selon l’expression de Ruysbroeck.
116Si selon la description de la voie divine, un seul élan suffit pour que tout soit accompli, il arrive que dans la pratique les limites ne s’effondrent pas toujours d’emblée, toutes à la fois. Néanmoins c’est spontanément qu’elles cèdent sous la poussée d’élans renouvelés.
117L’âme embrasée d’amour, découvrant sa nature royale, s’écrie :
« Miens sont les cieux, la terre, les nations, miens les justes, les pécheurs… toutes les choses sont miennes ; Dieu lui-même est à moi et pour moi puisque le Christ est à moi tout entier pour moi. Alors, ô mon âme, que demandes-tu et que recherches-tu encore ? Tout cela est à toi et tout cela pour toi.
Ne te rabaisse pas au-dessous de cela, ne t’arrête pas aux miettes qui tombent de la table de ton Père. Dors et glorifie-toi en ce qui fait ta gloire ! Cache-toi en elle et réjouis-toi, et tu exauceras les aspirations de ton cœur. » Oracion del alma enamorada. Saint-Jean de la Croix. Obras de San Juan de la Cruz, p. 817. Madrid, 1954.
118Ici, p. [259].
119Vipāka, assimilation instantanée, cuisson forcée au feu divin.
120« Plus un maître est sage et puissant, disait aussi Eckhart, plus son œuvre se réalise immédiatement… et plus elle est simple. » (P. 39.)
121H. A., Huit stances sur l’Incomparable, p. 57.
122Traduction inédite et presque intégrale des cinq premiers chapitres qui traitent des initiations internes, c’est-à-dire les plus hautes. Le Tantrasāra offre la « moelle » (sāra) ou le suc des Tantra et constitue un bref condensé du vaste Tantrāloka.
123Elle correspond à la vision d’une multitude d’âmes individuelles — les purusa — d’où son nom. Par sa faute, l’évidence de la plénitude ayant disparu, on ne perçoit plus que des êtres fragmentés sous l’effet de l’impureté de finitude. Cette tare congénitale tient à une modalité dualisante de la conscience, le vikalpa, dichotomie inhérente à une perception condamnée à opposer moi et non-moi, sujet et objet. L’ignorance congénitale, responsable de la servitude, est éliminée par les diverses initiations des voies de la libération.
124L’ignorance qui relève de l’intelligence doit absolument et dès le début faire place à une connaissance assurée, faite de détermination, que l’on peut puiser dans la lecture de textes sacrés ou dans la rencontre de bons maîtres.
Bien guidé par la certitude et la détermination « intellectuelles », l’on assouplit et l’on atténue sur les deux voies inférieures cette conscience différenciatrice en vue d’obtenir la conscience indifférenciée (nirvikalpa) dans laquelle se situe la voie supérieure. L’achèvement ultime permettra de saisir le différencié dans l’indifférencié et l’indifférencié dans le différencié.
L’originalité d’Abhinavagupta est d’insister sur cette forme d’ignorance pour deux raisons : d’une part, les pratiques ne pourraient la dissiper ; d’autre part, si on la remplace par la certitude juste, on peut à l’aide de celle-ci enrayer l’autre ignorance, habituellement considérée comme majeure.
125Ce tantra est commenté par Abhinavagupta tout au long du Tantrāloka.
126Cf. ici p. 166-167.
127Samāvesa est ici indifférencié, Bhairava étant ce qui engloutit l’univers différencié.
128Pour donner quelque idée de cette indescriptible conscience indifférenciée, Abhinavagupta a recours à la métaphore du miroir. Son argumentation se développe en deux temps :
Il observe d’abord qu’un reflet ne se manifeste que mêlé à autre chose, tel le visage mêlé au miroir, mais les exemples qu’il prend suggèrent que les choses que nous percevons n’ont de réalité que mêlées à nos sens, à notre perception consciente.
De façon comparable, l’univers « se reflète dans la lumière du Seigneur » sans aucun objet original isolé, sans cause extérieure, la seule cause étant la liberté divine. La conscience infinie englobe tout, tel un immense miroir hors duquel rien n’existe, et les choses se déroulent sur sa paroi lumineuse, distinctes les unes des autres, mais non distinctes de lui, toutes égales. Bien loin de l’âpre saisie complexe et fragmentée de la pensée dualisante, au sein de la divine lumière tout est là présent dans une légère, impondérable perfection.
129Réaction par exemple à l’aspect de son visage dans le miroir.
130Après l’aspect « lumière » (prakāsa) de l’absorption suprême, le texte envisage son aspect de prise de conscience (vimarsa). Car la prise de conscience de soi ne saurait être absente de l’Essence consciente, et la relation entre l’une et l’autre est dite « suprême matrice du son », c’est-à-dire source de l’émanation.
L’émission créatrice s’accomplit à partir de la pure lumière grâce aux prises de conscience phonématiques issues de la matrice du son. Portées sur la vibration sonore, elles déploient peu à peu le faisceau des énergies « qui départissent tout ce qui existe », allant de l’étape de la Pure Science jusqu’à celle de l’illusion où elles se réduisent à de simples phonèmes. Mais les prises de conscience de Śiva demeurent pures, ses énergies « bienheureuses », de sorte que finalement même les phonèmes « ressuscitent », ils vibrent et, recouvrant leur efficience, confèrent la libération.
131Il est impossible de traduire ce passage sans éviter la tautologie. Plusieurs termes en sanskrit désignent ce que nous nommons « conscience ». Nous avons ici prakāsa, Lumière pure et uniforme au même plan que caitanya, Conscience absolue, puis cit et encore citi, conscience en son dynamisme. Avec la racine mrs — toucher, il y a conscience de soi avec les nuances variées de vimarsa, āmarsa, parāmarsa, āmarsana… Si prakāsa est toujours présent, vimarsa peut ne pas l’être en ce sens qu’elle est soit introvertie, soit extravertie
132Nous ne donnons pas toute la description détaillée de cette émanation, notons seulement que les six premières voyelles relèvent du mouvement initial de 1 a Conscience, celui du Je indifférencié. À, anuttara, l’Incomparable, est Śiva, A : Ananda, la béatitude, est l’énergie. I, icchā est le désir. I, la souveraineté, U, l’éclosion de la connaissance… Cf. S.S.v. II, 7., p. 66 sqq.
133Cf. ici p. 78, 148.
134Cf. Hymnes aux kāli.
135Saktipāta, textuellement descente de l’énergie divine.
136Jeu de mots sur ārpana, don, mais aussi « fixé », agencé ; le don se référe à l’offrande extérieure, mais il est « fixé » au sens profond de la racine verbale. Toutes ces choses offertes en sacrifice servent à épanouir la conscience, la voie de l’énergie ayant pour fin ce parfait épanouissement.
137Le passage suivant étant trop technique, nous renvoyons aux Hymnes aux Kali.
138Vapus est plus que le corps ordinaire qu’expriment les termes deha et tarira.
139De pasu il devient pati.
140Elle consume jusqu’aux résidus déposés par les choses en sorte que l’inconscient lui-même est purifié.
141La philosophie islamique depuis la mort d’Averroès jusqu’à nos jours. In Histoire de la philosophie. Encyclopédie de la Pléiade. Paris, Gallimard, 1974, p. 1108.
142 Dite aussi non-manifestation.
143 Ces divers termes, ainsi que « dévoilement » traduisent le mot tajallî dont l’idée, écrit T. Burckhardt, « peut se définir par cette image : quand le soleil “se dévoile”, sa lumière “irradie” dans le monde. » Notons bien que ce même mot désigne à la fois la manifestation de l’univers et les dévoilements divins lors du retour, excepté celui de l’Essence.
144En adoptant cette dernière traduction pour éviter la confusion avec l’Être divin, T. Burckhardt souligne qu’il ne s’agit nullement d’une Qualité comme les autres puisqu’elle les englobe.
145 Cf. ici, p. 75. [« L’eau et la glace »]
146 Cité par Roger Arnaldez dans « La mystique musulmane », contribution à La Mystique et tes Mystiques. Desclée de Brouwer, Paris, 1965, p. 630.
147Ibid., p. 631. Nous supprimons les mots arabes. R. Arnaldez observe que cette théologie de la manifestation est une interprétation mystique que ne partagent pas toutes les écoles.
148On pourrait peut-être évoquer en parallèle les aspects suivants de la perspective itvaite : d’abord, le mpi s’efface par la découverte du « Soi » ; puis on voit le Soi et l’énergie universelle identiques à Siva ; enfin, toute distinction abolie, il n’y a plus que Paramaiva.
149Par exemple au sujet de la possibilité ou de l’impossibilité de connaître soit l’Essence soit les Qualités.
150Comme il a été dit, nous supprimons beaucoup de mots arabes. Quant aux notes du traducteur, elles sont tantôt supprimées, tantôt réduites (avec points de suspension), tantôt gardées et signalées comme N. d. T.
151Sous ce titre, nous insérons quelques définitions empruntées à des chapitres antérieurs, susceptibles d’éclairer les dévoilements qui suivent.
152 On pourrait sans doute comparer cette réalisation aux « prises de conscience » qui ont lieu sur la voie de l’énergie cognitive pour le yogin sivaïte.
153Ou plus précisément : « Celui qui est réel » ; le mot « exister » qui contient une nuance de relativité, a ici une fonction toute symbolique. (N.d.T.)
154Ce serait à bhâvanâ dans le Sivaïsme cachemirien qu’il faudrait comparer cette assimilation. Cf. p. 156, 166, 190-191.
155Le Sivaïsme établit de semblables distinctions : le yogin sur la voie de l’énergie n’a pas la maîtrise de son intuition la plus haute et ne peut à son gré l’étendre au niveau objectif.
156 Madame Guyon dirait des « lumières ».
157Le sommet du Caucase, où l’arche de Noé s’est arrêtée après le déluge. (N.d.T.)
158Jîlî expose ici les trois irradiations de l’Essence à partir de sa « pureté et simplicité première » et qui participent à celle-ci. Cf. ici, p. 203.
159Tout ce passage est paradoxal jusqu’à l’ironie, pour montrer que la nature de l’Essence ne pourra jamais être mise à la portée des intelligences humaines. (N.d.T.)
160L’Oiseau saint est l’Esprit qui, tout en demeurant dans l’homme, en transcende la forme… (N.d.T.)
161 La sphère de l’Unité (N.d.T.).
162Ce discours s’adresse à Dieu, à qui l’esprit s’est identifié, ce qu’exprime précisément l’écriture sur l’aile (N.d.T.)
163C’est-à-dire que l’Essence est au-delà de l’existence et même au-delà de l’Être en tant que détermination ; Elle est à la fois Être et Non-Être, tandis que la Personne divine, qui est décrite par les Qualités parfaites, « existe », car elle fait face à la création… (N.d.T.)
164Ce sont les sept qualités dites de la Personne divine… (N.d.T.)
165Le vert est la couleur de la connaissance… Le soufre rouge est un symbole alchimique de l’Esprit en acte permanent. (N.d.T.)
166C’est-à-dire que dans notre Essence divine tous les contrastes ou complémentaires s’unissent. La nécessité et la possibilité — ou la réalité et la possibilité — représentent en un certain sens les deux pôles ontologiques extrêmes… (N.d.T.)
167Ces deux rapports correspondent aux pôles respectifs « objet » et « sujet ». (N.d.T.)
168Le modèle de ces deux connaissances est la formule fondamentale de l’Islam : « Il n’y a pas de divinité si ce n’est La Divinité »… (N.d.T.)
169L’esprit de l’homme qui a réalisé l’Unité connaît toute chose en principe et globalement, mais l’aspect individuel des choses reste tel qu’il était, c’est-à-dire fragmentaire et d’une variété inépuisable (N.d.T.)
170 Hermès, nouvelle série, n° 1, « Les voies de la mystique », Ed. des Deux Océans, Paris, 224-233. [l’avant-propos et la traduction annotée du commentaire de Kuo an par Paul Petit sont suivi d’une analyse par Lilian Silburn].
171 Adaptation française de Paul Petit, parue dans la revue Commerce, cahier XXIV, été 1930, et aussi en plaquette avec des bois de Jean Bernard. Le texte est le même, mais les notes sont dans cette dernière plus développées, ce sont elles que nous donnons.
172 On sait que la vache a toujours été un animal sacré chez les Hindous qui voient en elle un symbole vivant de Prakriti, la Substance Universelle, Mère de tous les êtres et dispensatrice de tous les dons (dans ce dernier sens elle est Kāmādhenu, la « vache des désirs »). Dans le texte chinois la vache, qui représente la « Nature profonde » de l’être, la « Bouddhéité » de l’École, est prise dans une acception assez différente, et qui fait plutôt penser à la kundalinī tantrique et à I'« embryon » des taoïstes. Dans le Yi-king, le principe féminin, caractérisé par la docilité, est figuré par la jument (deuxième hexagramme), mais aussi par la vache (nieou) (trentième hexagramme). « Le naturel du bœuf, écrit Tcheng-Tse, est placide et soumis et, de plus, il s’agit d’animaux femelles ; cela exprime donc l’extrême soumission. » « La vache, ajoute Tchou-Hi, est un animal doux et soumis. » Dans notre texte la vache est loin d’être aussi docile ; cela tient au double aspect sous lequel elle peut être envisagée et dont nous dirons quelques mots plus loin (note p. 228). Suzuki parle, sans le préciser autrement, d’un Hināyāna-Sūtra qui décrit les onze manières de bien soigner cet animal. Nous signalerons aussi les trente-troisième et trente-quatrième discours du Majjhima-Nikāya, intitulés tous deux : « Le Gardeur de Vaches » (il s’agit de bœufs, vaches et taureaux mélangés ; comme l’allemand Rind le mot pāli n’indique pas le sexe). (N.d.T.)
173Forme abrégée de Ch'anna, transcription chinoise du mot sanscrit Dhyāna (contemplation). (N.d.T.)
174Cinquante ans après le travail de P. Petit, signalons le livre de Catherine Despeux : Le Chemin de l’Éveil, illustré par le dressage du buffle dans le bouddhisme Chan, le dressage du cheval dans le taoïsme et le dressage de l’éléphant dans le bouddhisme tibétain. L’Asiathèque, 1981.
175Mot à mot : n’en étant pas empêché par les six racines des passions.
176L’inspiration de ce passage me semble pouvoir être rapprochée de celle d’un des plus beaux poèmes du Vieillard sur le Mont-Omi de Claudel, La Terre-pure, encore que la vache dont il est question dans la Réflexion subséquente ne soit pas tout à fait la même que celle qui nous occupe ici. (N.d.T.)
177La réalité spirituelle se défend ; il ne suffit pas de l’avoir dépistée, il faut la conquérir. Dans toute cette œuvre le symbolisme de la vache est très subtil, au point que la vache des 4e et 5e étapes (la nature rebelle) ne semble pas être la même que celle des trois premières (la réalité spirituelle) et que les profanes peuvent se demander s’il ne s’agit pas d’une farce, bien chinoise, destinée à dérouter les esprits systématiques dont l’auteur ne se soucie pas d’avoir l’approbation. Les initiés néanmoins estiment, avec raison sans doute, que cette divergence n’est que superficielle et que l’unité profonde du symbolisme de la vache demeure intacte. Ce n’est pas, en effet, le moindre intérêt de ce grand texte de nous laisser entendre que les ordres les plus bas de réalité, ceux mêmes qui constituent les plus gros obstacles à notre progrès spirituel, peuvent, si nous savons les utiliser, devenir des points de départ et des points d’appui, et que, dans l’ascèse chinoise comme dans la catholique et comme dans le Laya-Yoga hindou, il s’agit moins d’une rupture avec la nature que d’une transformation ou, comme disent les alchimistes, d’une sublimation. Quoique opposés, Nature et Esprit correspondent, en effet, à deux aspects du même Principe qui est à la fois Démiurge et Sauveur. La Déesse, disent les Tantriques, est à la fois créatrice (srstirūpa) et libératrice (layātmikā), puissance d’ignorance (Avidyā-Sakti) et puissance de connaissance (Vidyā-Sakti). De même que, dans notre théologie catholique, le Verbe est à la fois Créateur et Rédempteur. La pensée orientale sépare rarement ces deux aspects qui, comme on le sait, sont en rapport avec les symboles doubles du Yin-Yang, Purusha-Prakriti, etc. (N.d.T.)
178Ce membre de phrase semble avoir été purement et simplement omis dans la traduction anglaise de Suzuki. (N.d.T.)
179L’animal dont il s’agit peut être buffle ou bufflesse, bœuf ou vache. Nous choisissons le buffle à cause de sa puissance et de sa violence. Contrairement à la vache le buffle peut être chevauché.
180Cf. ici, p. [191].
181Les deux chemins, traité XVII, E., p.391.
182La Pierre étincelante, ch. IX.
183Puntos de Amor, § 26, p. 828, Obras de San Juan de la Cruz, Madrid, 1954.
184Cf. l’expert en joyau d’Abhinavagupta, Les Voies de la mystique, Hermès 1, nouvelle série, Les Deux Océans, 1981, p. 154.
185 Cf. ici p.191.
186 Cf. ici p. 175.
187 Sur les deux autres puissances, cf. p. 249.
188 Avant d’être une créature.
189 Poésie et vie mystique chez saint Jean de la Croix, par Max Milner, Le Seuil, Paris, 1951 p.196-199.
190L’oiseau plane dans les sphères — impérissable dans l’anéantissement. Cf Jîlî, p.219.
191Cf. ici p.173.
192Cf. ici p.116.
193« Dans sa pure virginité » traduit Evans, p 409. Vasugupta verrait là l’état kaivalya.
194Cet accès caché rappelle « le chemin couvert, effacé et étroit, menant à l’Essence » que chante Jîlî, Cf. Les voies de la mystique, Hermès I, 1981, p. 217
195La Passion d’al-Hosayn ibn-Mansour al-Hallaj, L. Massignon, Paris, 1922, tome II, p. 521-522.
196Comme la bonté, la sagesse.
197Sag. 71. Mais décèle-t-on la Présence divine dans laquelle se révèle cette connaissance de nous-mêmes et du monde : A la question : peut-on voir en même temps le corps du miroir tout en regardant la forme qui s’y reflète ? Il répond que la forme réfléchie ne cache pas essentiellement le miroir, mais que celui-ci la manifeste. Ibid., 45. « Dieu, dit-il, est donc le miroir dans lequel tu te vois toi-même ; comme tu es Son miroir dans lequel II contemple Ses noms. Or ceux-ci ne sont rien d’autre que Lui-même, en sorte que la réalité s’inverse et devient ambiguë. » (45-46)
198M.M. si 40, p. 141 Cf. ici p. 187, 190.
199La doctrine de l’instantanéité semble s’imposer naturellement à tout grand mystique, car, pour échapper à la durée asservissante, il n’est d’autre efficience que celle de l’instant.
200Traité de l’Unité, p. 29 et 30.
201Cf. H. A., p. 57-61 et P. T., p. 19-25.
202À savoir voies inférieures.
203Voie divine.
204Voie divine à son sommet.
205 Voie réduite (cf. ici, p.179.)
206Fin du sermon : « Paul se releva. » Le XIXe chap., dans la traduction d’Evans.
207Cf. T. A., chap. Il, ici p. 180-181.
208Sur la voie de la connaissance.
209Cf Le Royaume des amants. Le don d’intelligence.
210Le Royaume des Amants, chap. XXXVI, Don de Sagesse savoureuse.
211Cf. la félicité cosmique (jagadananda) des shivaïtes cachemiriens.
212Ibid., Don de Sagesse savoureuse, cf R. p. 133.
213Attar, fin de la Conférence des oiseaux.
214Derniers mots de la Conférence des Oiseaux
215 n° 2
[reprise 1989 de l’éd. 1966/7]
Hermès/ Recherches sur l’expérience spirituelle//Le Vide/ Expérience spirituelle/ En Occident et en Orient/ 2/ Nouvelle série
216Contribution parue dans : Hermès 6, « Le Vide, Expérience spirituelle en Occident et en Orient », imprimé pour les Amis d’Hermès, 1969, 15-62 ; réimpr. : Hermès, Nouvelle série n°2, Ed. des Deux Océans, 1981, 15-62.
217[La pagination d’origine est reproduite entre crochets ; elle est utilisée pour certains renvois].
218Oeuvres de Ruysbroeck l’admirable, Trad. de Wisques, t. I, Vromant, 1921. Le Livre des sept clôtures, ch. XIV, p. 180.
219Le Yoga Tibétain et les Doctrines secrètes. Trad. française de M. La Fuente, Paris, 1938, p. 86.
220J. Gernet, Entretiens du Maître de dhyāna Chen-Houei du Ho-Tsö, Hanoï, E-F-E-O —, 1949, p. 57, « Concentration » traduit ici le terme sanscrit samādhi.
221Id., p. 57, n. 31. T’an King. Dhyāna est un recueillement plus élevé que le samādhi, pour les bouddhistes.
222Vive Flamme d’Amour, str. III et comm. du saint.
223Ornement des noces spirituelles, fin de la seconde partie, les faux mystiques.
224J. Gernet, op. cit., p. 36.
225Grand philosophe et mystique qui vivait au Cachemire au Xe siècle, auteur du Tantrāloka et de gloses aux āgama.
226Il ne s’agit donc pas d’un doute intellectuel, mais de l’énergie à la source des fluctuations dualisantes qui empêchent d’adhérer au Réel. Comme le doute préside à toute la vie et s’étend à la sensibilité et à l’activité où il se manifeste par hésitations, craintes, déchirements, contradictions, il semble inéluctable. Il disparaît seulement dans l’expérience du Soi, où fulgure la certitude absolue.
227La Mahārthamañjarî de Mahesvarānanda. Trad. et Introd. par L. Silburn, à paraître chez de Boccard [paru en 1968, Publ. de l’Institut de Civilisation Indienne, fasc. 29]. Citation dans le commentaire de la stance 57.
228A Pistle of Discrecioun of Stirings, pp. 70-72, dans Deonise hid Divinite and other treatises on contemplative prayer related to The Cloud of Unknowing, ed. by Phyllis Hodgson, London, 1955. Early English Text Society, No. 231.
229J. Gernet, op. cit., pp. 53, 43, 27.
230Id., pp. 37, 74, 109, note 33, et p. 56.
231L’Anneau ou la perle brillante. Jan van Ruusbroec, Werken, Tielt, Lannoo, 1944-1948, 2e éd., t. III, p. 40.
232 J. Gernet, op. cit., p. 79.
233Id., p. 53.
234Tantrāloka, IV, 43. The Kashmîr series of texts and studies, Srinagar, Vol. III, 1921.
235The Cloud of Unknowing and the Book of Privy Counselling, ed. from the manuscripts by Phyllis Hodgson, London, 1944. Early English Text Society, No. 218, p. 152.
236Le Château de l’âme. Cinquième demeure. Cbapitre I.
237Tantrāloka, ch. IV, vers 158. Commentaire, p. 173.
238Tantrāloka, V, 27-32.
239Deux phrases condensées en une seule.
240« Not onli what he is, bot that he is. »
241« L’œuvre », élan d’amour, est exposée dès les premiers chapitres et revient tout au long du livre.
242Ainsi G. Bataille, L’Expérience intérieure, Partie II, le Supplice, pp. 46 sv., Gallimard, 1953.
243L. Cognet, Introduction aux mystiques rhéno-flamands, Desclée, 1968, pp. 141-142.
244Oeuvres de Maître Eckhart. Trad. Paul Petit, Gallimard, 1942, p. 42.
245Sainte Thérèse de Jésus, Œuvres complètes, Le Seuil, 1948, pp. 894 sv., Ve demeure.
246Ve demeure, ch. I, trad., p. 898.
247VIe demeure, ch. IV, trad., p. 958.
248Id., p. 959.
249VIIe demeure, ch. III, trad., p. 1042
250Ve demeure, ch. II, trad., p. 904.
251Id., p. 904 de la trad.
252Llama de Amor viva. Commentaire de la stance III.
253Vie, dans L. Cognet, op.cit., pp. 194-195.
254R. Khawam, Propos d’Amour des Mystiques musulmans. Éd. de l’Orante, 1960, p. 75.
255L. Gardet, La mention du nom divin (dhikr) dans la mystique musulmane. Revue thomiste, 1952-III, Desclée, Paris, p. 676.
256R. Amaldez, La Mystique et les mystiques. La mystique musulmane, Desclée de Brouwer, 1965, p. 640 et 630.
257R. Khawam, op. cit., p. 81.
258The Scale of Perfection, ed. by E. Underhill, London, 1923, Ch. XXVII.
259L’auteur de cette page emploie le mot au sens courant et nullement au sens d’Abîme divin.
260Mais qu’on ne confonde surtout pas les expériences ici décrites avec l’impression, éprouvée à l’orée de la vie spirituelle, de vivre dans un monde illusoire et irréel.
261Le Royaume des Amants. Trad. E. Hello, Ruysbroeck l’admirable. Œuvres choisies, Paris, 1912, p. 230.
262Texte flamand, t. II, pp. 223-224.
263 « Grondelose », sans fond.
264Le Livre de la plus haute Vérité ou Samuel. Texte flamand, t. III, p. 292.
265Maître Eckhart, Traités et sermons, Paris, Aubier, 1942.
266Le Lao-tzeu, La Voie et sa vertu. Trad. Houang-Kia-Tcheng et Pierre Leyris, Le Seuil, St. XI, p. 53.
267 L. Wieger, Les Pères du système taoïste. Belles Lettres, Cathasia, ch. VII, D.
268L. Wieger , op. cit., ch. VII, p. 267.
269 Pensée Chinoise. Albin Michel, 1934, p. 524. Cf. L. Wieger, op. cit., p, 141-143.
270Ces extraits sont tirés de La Voie et sa vertu.
271Id., p. 46.
272Benedyct Grynpas, Le Vrai classique du Vide parfait. Lie-tzeu, Gallimard, 1961, p. 87.
273L. Wieger, op. cit., ch. XII, C, p. 295.
274Benedyct Grynpas, op. cit., p. 87.
275En effet « le Tao peut être transmis mais non saisi ». L. Wieger, op. cit., VI, D, p. 255.
276L. Wieger, ch. XIII, A, p. 309.
277Id., B, p. 3 ii.
278Benjamin Major. Opera omnia, Paris, 1855.
279R. Otto, Mystique d’Orient et Mystique d’Occident. Trad. J. Gouillard, Payot, 1951, p. 182.
280J. Gernet, op. cit., pp. 109, 74, 15 et 68, note 6.
281Id., p. 13, note 5.
282Id., p. 109, note 33, T’an King.
283Id., p. 74.
284Ornement des Noces. Trad. Bizet, p. 347.
285Demières pages du Livre de la plus haute Vérité.
286Sermons. Trad. Aubier, p. 60.
287Le Livre de la plus haute Vérité. Trad. de Wisques, t. 2, pp. 205-206, avec de légères modifications.
288Le Lao-tzeu disait également : « Qui sait par le repos passer peu à peu du trouble au clair et par le mouvement du calme à l’activité, ne désire pas être plein. N’étant pas plein, il peut subir l’usage et se renouveler. » (XV.)
289Selon l’expression du Vijñānabhairava, verset 120.
290Nuit obscure, II, ch. XVII.
291J. Gernet, op. cit., p. 79.
292Le Livre des sept clôtures. Trad. de Wisques, t. I, p. 192, ch. XIX.
293Le Lao-tzeu, stance XXI.
294R. Otto, op. cit., p. 36.
295L. Wieger, op. cit., ch. XXII, I, p. 399.
296Id., ch. XIII, G, p. 315.
297R. Otto, op. cit., p. 186.
298Id., pp. 188-189.
299Vijñānabhairava, verset 149.
300Le Miroir du salut éternel. Trad. de Wisques, t. I, p. 128.
301Trad. J. — A. Bizet, pp. 176-177.
302Le Livre des sept clôtures. Trad. E. Hello, p. 109.
303Les Noces spirituelles. Trad. J. — A. Bizet, p. 328.
304Dernières lignes des Noces.
305La traduction ici utilisée est celle des Œuvres complètes traduites par le R. P. Cyprien de la Nativité de la Vierge, éditées par le R. P. Lucien-Marie de Saint-Joseph, Desclée de Brouwer, 1997. M.C. = la Montée du Mont Carmel. N.O. = La Nuit obscure. C.S. = Cantique spirituel. V.F. = La vive flamme d’amour. Les textes de St Jean de la Croix sont composés en caractères romains et ses citations des Écritures en caractères gras.
306Hermès 6, « Le Vide, Expérience spirituelle en Occident et en Orient », imprimé pour les Amis d’Hermès, 1969, 213-221 ; réimpr. : Hermès, Nouvelle série n°2, Ed. des Deux Océans, 1981, 213-221.
307Avec commentaire de Kshemarāja, vol. II, ch. IV, versets 290-294 et versets 254 sv.
308Voir Tantraloka, ch. IV, consacré aux kâlî. Sur le vide voir encore Le Vijñanabhairava, traduit par L. Silburn, Paris, 1961, pp. 51-63.
309Mahārthamanjarî. À paraître bientôt chez de Boccard. Trad. p.137.
310Extrait de la Mahārthamanjarî, p. 83.
311Livre IV, versets 292 et suivants avec le commentaire de Kshemarāja et les éclaircissements du Swāmi Lakshman Brahmacārin.
312 Art et Sagesse en Chine. Mi Fou (1051-1107). Paris, P.U.F., 1963. Le texte de l’auteur sera entre guillemets doubles, les citations qu’elle fait entre guillemets simples. On supprime les références et les parenthèses pour mots restitués.
n° 3
[2010]
Hermès Recherches sur l’expérience spirituelle//Le Maître Spirituel/selon les grandes Traditions et d’après des témoignages contemporains/3/Nouvelle série
314Hermès, Nouvelle série, n° 3, « Le Maître spirituel selon les traditions d’Occident et d’Orient », Ed. des Deux Océans, Paris, 121-138.
315Indications bibliographiques :
Le Tantrasāra, résumé succinct du Tantrāloka par Abhinavagupta lui-même, traduit par Ranielo Gnoli, « Essenza dei Tantra », éd. P. Boringhieri, Torino, 1960.
« Recherches sur la symbolique et l’énergie de la Parole dans certains textes tantriques », par A. Padoux, 1963.
Le Paramārthasāra, d’Abhinavagupta, traduit par L. Silburn, 1957.
Le Vijñānabhairava, traduit par L. Silburn, 1961. Ces trois derniers ouvrages édités par de Boccard, Paris.
316Nommé bhāvanāyajñānin, il diffère du cintāmayajñānin précédent ainsi que du premier, le shrautajñānin.
317Disciple, « celui qui doit être instruit ».
318Niruppāyasamāvesha, textuellement « compénétration qui se passe d’intermédiaire ou de moyen », mais pour la commodité nous traduirons samāvesha par communion. Cf. Ch. II. Sur les trois compénétrations, I, 169 sv. Les diverses sortes de grâce, XIII, 212.
319Le prātibho guru, décrit p. [157].
320Au sens très large du terme ; on ne peut en toute rigueur parler d’initiation même intérieure.
321Via negativa ou voie du dépouillement.
322On la qualifie de ferme et non plus d’extrêmement ferme comme elle se montrait dans la voie divine.
323Le pur et l’impur, un des traits caractéristiques de la religion brahmanique, est le fantôme contre lequel se battent les non-illuminés.
324Il s’agit d’une vibration sonore infiniment subtile nommée anahata nāda ou dhvani.
325De brahmasthāna à brahmasthāna ou brahmarandhra, du centre radical jusqu’au sommet du crâne.
326La Vie par elle-même, Paris, La Fontaine de Pierre, 1973. Lettres Chrétiennes et Spirituelles sur divers Sujets qui regardent la vie intérieure, Londres (en réalité Lyon), 1767-1768. Discours Chrétiens et Spirituels sur divers Sujets qui regardent la vie intérieure par Madame J.M.B. de la Mothe-Guion, Paris, 1790.
327Narrée dans l’autobiographie, mais aussi dans Les Torrents. Cf. Les Voies de la Mystique. Hermès N° 1. 1981.
328Fénelon et Mme Guyon. Documents nouveaux et inédits. Par Maurice Masson. Paris, 1907, p. 68 (lettre de Mme G. à F. Rééd. par Étienne Perrot : Madame Guyon et Fénelon. La correspondance secrète. Ed. Dervy-Livres, Paris, 1982.
329Ibid. p. 44.
330Ibid. p. 129.
331Ibid., p. 101.
332Et Masson, op. cit., p. 115-116.
333Cf. ici Zoran Zec. Le bodhisattva.
334Discours LXV, tome II, p. 361-367.
335Idée souvent exprimée par les sufi et qu’un hadith célèbre formule ainsi : « … Mon adorateur ne cesse pas de s’approcher de Moi jusqu’à ce que Je l’aime ; et quand Je l’aime, je suis l’ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche… » Cité par Titus Burckhardt, Introduction aux Doctrines ésotériques de l’Islam, chap. De l’Union.
336Madame Guyon différencie très nettement les mystiques appelés à guider autrui des mystiques arrivés à l’état de sainteté qui s’anéantissent en Dieu. Cf. ici p. 12.
337Cf. Introduction p. 12.
338In « Quelques réflexions sur l’Ego » (1980) p. 4 in Revue Le Coq Héron n° 78, Paris :
article traduit de l’Anglais (International Journal of Psycho-analysis 1953 vol. 34).
339Lacan, J. Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, p. 93 in Ecrits, Seuil, Paris, 1966. -- Klein, M. Essais de Psychanalyse, Payot, Paris, 1978. -- Spitz, R. A. De la naissance à la parole, PUF, Paris, 1968. -- Winnicott, D.W. Processus de maturation chez l’enfant. Développement affectif et environnement, PBP, Paris, 1978.
340Revue Le Coq Héron n° 78 p. 5 in article cité.
341Hasan Shushud in Le Soufisme, p. 91 et 93, Ed. L’Originel, Paris, 1980.
342Madame Guyon, Discours II, XLVIII, Édition cf. note p. 213.
343Discours, id.
344Winnicott, D. W. (1958) p. 205-213 De la pédiatrie à la psychanalyse in P.B.P. 1976 Paris.
345Silburn, L. Le Vide, le Rien, l’Abîme. in Le Vide, Hermès n° 6 ou Nouvelle série n° 2, p. 18.
346Silburn, L. Le Bouddhisme, Fayard, 1977, chap. III : Intériorité et universalité dans le Mahâyâna, p. 102.
347Silburn, L. Le Bouddhisme, p. 339.
348Kabir, Poème de Kabir, trad. Tagore, R. Mirabeaud-Thorens, H. Gallimard 1969, Paris.
349Sheikh al — 'Arabi ad-Darqâwi, Lettres d’un maître soufi, traduites de l’arabe par T. Burckhardt, Archè, Milano, 1978, p. 37.
350Madame Guyon, Lettres Chrétiennes tome V, Discours XVI, p. 166.
351Madame Guyon, Discours XL1V tome I, p. 314-5.
352Sultân Valad, Maître et disciple, traduit du persan par E. de Vitray-Meyerovitch, Bibliothèque persane, Sindbad, Paris, 1982, p. 40.
353Yunus Emre, Offrandes à l’amour, trad. de Pertev Boratav, in E. de Vitray-Meyerovitch, Anthologie du soufisme, Sindbad, 1978, p. 118.
354Cf. article de J. Chambron, sur la transmission ici p. 268.
355Klein, M. (1934) in Essai de Psychanalyse, Payot, Paris, 1967, p. 320.
356Silburn, L. Le Vide op. cit. p. 37.
357Hamsabheda, trad. Silburn, L. in La Mahârthamanjari de Mahesvarânanda, publ. de l'Inst. de Civilisation Indienne 29, Ed. de Boccard, Paris, 1968, p. 80.
358 Hermès, Nouvelle série, n° 3, « Le Maître spirituel selon les traditions d’Occident et d’Orient », Ed. des Deux Océans, Paris, 252-267.
359 Vie et chants de « Brug-pa Kun-legs, le yogin. Traduit du tibétain et annoté par R.A. Stein. Maisonneuve et Larose, Paris 1972, p. 275.
360 Adeptes « flairés par l’énergie obnubilante » et dont l’éveil se ramène à des conceptions aussi futiles que le port de tel ou tel emblême (linga).
361 Tantrāloka XIV 10, 11, 12. Sur Abhinavagupta cf. ici p. 122.
362 Op. cit. Extraits des chapitres 1 et 27. Nous simplifions les notes.
363 La grue, blanche par-dessus, noire par-dessous, est le type de l’hypocrite. Immobile au bord de l’eau, elle guette le poisson, tout en semblant plongée en méditation. (N.d.T.)
364 Nous donnons ici la variante signalée en note.
365 Littéralement : « ils ont joué un coup de dés. » (N.d.T.)
366 En pleine connaissance de cause… (N.d.T.)
367 Dohākosa de Saraha, cité dans Le Bouddhisme. Textes traduits et présentés sous la direction de Lihan Silburn. Paris, Fayard, 1977. Stances 3, 4, 5, p. 337.
368 Ibid., st. 14 à 18.
369 Les Entretiens de Mazu, maître Chan du VIIIe siècle. Introduction, traduction et notes par Catherine Despeux. Paris, Les Deux Océans, 1980, pp. 44-45.
370 Entretiens de Lin-tsi. Traduits du chinois et commentés par Paul Demiéville. Paris, Fayard, collectif, Documents spirituels, 1972, S17. Les extraits qui suivent appartiennent respectivement aux paragraphes 19d. 30 et 20.
371 L’absence de pensée, ou non-pensée, comme le non-agir, fut au VIIIe siècle avec Chen-houei une formulation percutante et une excellente méthode. Au cours des siècles elle se sclérosa et, d’un instrument efficace entre les mains du maître, elle devint le but d’adeptes égarés.
372 The Zen Master Hakuin. Selecled writings. Translated by Philip B. Yampolski. Columbia University, Press, New York, 1971, pp 170-173.
373 La Sainte Bible. École biblique de Jérusalem. Rééd. 1973.
374 Les Oeuvres spirituelles du B. Père Jean de la Croix. Traduites d’Espagnol en Français par le R. P. Cyprien de la Nativité de la Vierge. Paris, chez Jacques d’Allin, M DC LXV. La Vive Flamme d’Amour. Explication du troisième verset, paragraphe VIII, pp. 379-380.
375 Page empruntée au beau discours sur l’état apostolique dont le lecteur trouvera d’autres extraits, ainsi que la référence, ici p. [224]. [réf. à : « Madame Guyon : L’expérience de la transmission et l’état apostolique » par Jacqueline Sebeo].
376 Op. cit., 1, 24 puis 21-22.
377 Lettres, tome III, CXXVII, p. 553-554.
378 Cf. la métaphore de la montagne ; ici p. [11].
379 Cf. ici p. [246].
380 J.L. Michon, L’Autobiographie (Fahrasa) du Soufi marocain Ahmad Ibn « Agîba 1747-1809. Archè, Milan, 1982.
381 Tantraloka, XIII, citptions et résumés des versets 317 à 345. Le véritable maître d’Ahhinavagupta était Sāmbunata, à qui il voua une infinie reconnaissance.
382 Hermès, Nouvelle série, n° 3, « Le Maître spirituel selon les traditions d’Occident et d’Orient », Ed. des Deux Océans, Paris, 275-291.
383 Tabaqāt al-Sūfiya. Cité par le Père de Beaurecueil, « Nous avons partagé le pain et le sel ». Éd. du Cerf.
384 Voir « Techniques de la transmission mystique dans le Shivaïsme du Cachemire ».
385 anupāya.
386Le Cabaret de l’Amour, LXIV. Trad. Charlotte Vaudeville. Paris, Éd. Gallimard.
387 Il s’agit d’une séance particulière de transmission.
388 De l’arabe lawadjoh : mise en présence face à face.
389 Ce second témoignage est présenté par une Française qui fit un séjour de six semaines auprès du guru en 1964, et établi d’après les lettres qu’elle écrivit alors à sa famille.
390 Ces souvenirs qui remontent aux années 50, accompagnés d’une étude du rôle des maîtres de cette école, sont dus à une personne qui fit plusieurs longs séjours auprès du guru.
391 Adhikāra, charge, privilège accordé à qui en est digne.
392 En sanscrit upasadana « proximité », le maître et le disciple étant assis l’un en face de l’autre, assez proches, en silence et sans bouger.
393 Sahajāvasthā.
n° 4
Hermès Recherches sur l’expérience spirituelle//Tch’an/Zen/racines et floraisons/4/Nouvelle série
[rééd. de l’éd. 1985 ; diffère de [1970] Tch’an (Zen)…, seconde série]
395 Pour une compréhension du bouddhisme ancien et du Grand Véhicule en leurs plus hautes expériences, il est bon d’étudier Le Bouddhisme, textes présentés et traduits sous la direction de Lilian Silburn, Fayard, Le Trésor spirituel de l’Humanité, Paris, 1977. (Dorénavant B.) Nous y aurons souvent recours au début de ce volume.
396 Car il peut y avoir des systèmes philosophiques qui, loin de s’égarer en vaines spéculations, formulent admirablement (même si l’adéquation parfaite est impossible) les grandes vérités que révèle l’expérience.
397 Ainsi saint Jean de la Croix, dans la Vite Flamme d’Amour, explication du troisième verset. Cité dans Le Maitre spirituel, Hermès, n° 3, p. 259 sq.
398 Cf. ici p. 32 sq.
399 Pour la définition du terme chinois par Houei-neng, cf. ici p. 187 sq.
400 Au cours des quatre samâpatti qui font accéder à la sphère immatérielle : 1) infini de l’espace, 2) infini de la conscience, 3) le rien, la « non-existence de quoi que ce soit », 4) la sphère de « ni perception ni non -perception ». B. p. 55 sq. et 60 sq.
401 Siksâsumuccaya, trad. L. Silburn, B. p. 163.
402I bid. p. 177. La dernière des trois citations est de Candrakirti.
403 L. Silburn, ibid. p. 178.
404 Chap. IV. Traduction inédite par Élisabeth Andrès et Byun Kyu-yong.
405 B. p. 163.
406 L’essentiel de ce sutra est traduit par C. Despeux dans Le B. p. 428-448.
407 Ainsi Tche-yi. Cf. ici p. 85, 95 et 119. Ces recherches s’expliquent du fait qu’il n’est point aisé d’accéder ne fût-ce qu’au premier degré du dityiima et que le risque de tomber dans un vide stérile est bien réel.
408 D. T. Suzuki rend tenni-sin et wou-mien par « No-mind » ou par « the Unconscious ». Mais l’Inconscient, même avec une majuscule, prête à toutes les confusions.
409 Le bouddhisme chinois par Paul Demiéville, dans un recueil collectif de conférences : Aspects de la Chine. P.U.F., Paris, 1959, 1er vol. p. 164-165.
410 Tsung-mi. His analysis t-f Tch'an Buddhism. T'oung Pao, vol. LVIII, Leiden, Brill, 1972, pp. 1-53.
411 Le Non-mental selon la pensée Zen. Trad. par Hubert Benoît. Le Courrier du livre, Paris, 1970, p. 62.
412 Mme Vandier-Nicolas rapporte qu’une peinture de Liang K'ai (mir siècle) dont le Japon possède une copie célèbre représentait Houei-neng déchirant les siitz-a, très joyeusement, avec des yeux brillant de malice. (Peinture chinoise et tradition lettrée, p. 150.)
Mais Houei-neng ne déchirait pas les sûtra ; il s’éleva même avec force contre ceux qui les vilipendaient (chap. X du Sûtra de l’Estrade).
413 Zen Dust. The history of the koan and koan study in Rinzai ( Lin-chi ) Zen. Isshû Miura and Ruth Fuller Sasaki. Harcourt, Brace World, New York, 1966, p. 38. (« Transmission of Mind by mind ».)
414 Hermès 4, « Tch’an, Zen racines et floraisons », Ed. des Deux Océans, Paris, 1985, 70-72.
415 Houei-neng, ici [« Le sūtra de l’Estrade », extraits traduits dans le même volume Hermès 4], p. [190].
416 Ici, p. [192].[p. de la source]
417 Manuscrit non publié.
418 Publié le 5 Mars 2016 à 9 h 5 : http://criticamasonica.over-blog.com/2016/03/hermes-une-revue-spiritualiste-oubliee.html
419 Relevé des contenus par Thot trismégiste 09/03/2016 10 h 34
420Relevé DT.
421 En gras : ce qui est repris dans le présent volume
422 L’astérisque désigne un article paru dans le numéro d’Hermès de 1966-1967 [ancienne série n° 4 « Le Maître spirituel »], sans modification.
423 Article revu et augmenté par l’auteur.